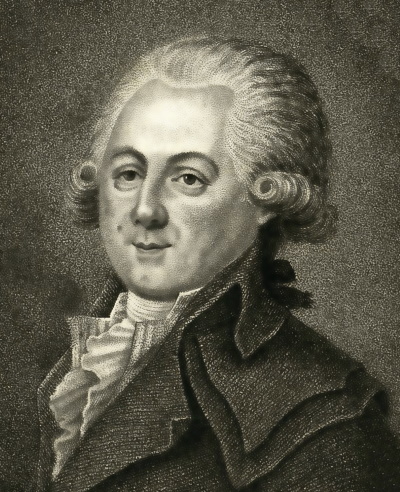Jenneval (Louis-Sébastien MERCIER)
Sous-titre : le Barnevelt français
Drame en cinq actes.
Édité en 1769.
Représenté pour la première fois, à Bruxelles, sur le Grand Théâtre de la Monnaie, le 28 juillet 1772.
Personnages
MONSIEUR DABELLE, chef de bureau
LUCILE, fille de Monsieur Dabelle
JENNEVAL, jeune homme faisant son droit demeurant chez Monsieur Dabelle
BONNEMER, caissier de Monsieur Dabelle, ami de Jenneval
DU CRÔNE, oncle de Jenneval
ORPHISE, cousine de Lucile, nouvellement mariée
ROSALIE
JUSTINE, suivante de Rosalie
BRIGARD, escroc, brétailleur, etc.
UN COMMIS
UN DOMESTIQUE
La scène est à Paris.
PRÉFACE
Lorsque M. Saurin donna Beverley ; le Public parut désirer qu’on traitât le fameux sujet de Barnevelt, ou le Marchand de Londres, qui est comme le pendant du Joueur. La Pièce Anglaise de Lillo jouit d’une grande réputation ; elle le mérite, il y règne cette vérité, ce pathétique attendrissant l’âme du genre Dramatique. Les adieux de Truman et de son ami sont admirables ; mais la confusion des scènes, l’intérêt coupé et divisé, le bizarre à côté du sublime, toutes les fautes enfin du Théâtre Anglais empêcheront qu’elle soit jamais représentée sur le nôtre dans la forme où elle se trouve.
Échauffé par le désir de donner un Drame utile, j’ai voulu peindre les fuites funestes d’une liaison vicieuse, rendre la passion redoutable autant qu’elle est dangereuse, inspirer de l’éloignement pour ces femmes charmantes et méprisables, qui font un métier de séduire, montrer à une jeunesse fougueuse et imprudente que le crime souvent n’est pas loin du libertinage, et que dans l’ivresse enfin, on ignore jusqu’à quel point peut monter la fureur. J’ai tâché de surmonter les obstacles, et d’accommoder ce sujet à notre Théâtre, c’est à-dire à nos mœurs.
Le plan du Joueur Anglais était simple et assez régulier ; le plan du Marchand de Londres est un véritable chaos, où il est impossible de faire entrer l’ordre et l’unité. Tous les gens de lettres ont conçu l’extrême difficulté qu’offrait un pareil sujet. Il fallait nécessairement mettre sur la Scène une courtisane, la faire parler, la faire agir, montrer un jeune homme livré à ses charmes, abandonné à son génie corrupteur, et l’idolâtrant avec le transport et la bonne foi de son âge. Il fallait en même-temps écarter des images capables de flétrir l’âme, et qui l’obsèdent sans cesse à cause du lieu de la Scène. Plus le pinceau devoir être naturel, plus il demandait à être manié avec art.
C’était assez pour moi d’avoir ces conditions à remplir. Je n’ai pas osé aller plus loin. Barnevelt, assassin de son oncle, revenant les mains teintes de sang, montant sur l’échafaud pour expier un parricide, aurait à coup sûr révolté les spectateurs. Nous compatissons aux faiblesses, aux infortunes, aux désordres mêmes des passions ; mais nous n’avons point de larmes à donnera un meurtrier. Sa cause nous devient étrangère, il n’est plus compté dans la société. Son crime pesé à notre âme et l’accable ; rien ne le justifie, rien ne l’excuse à nos yeux, et le théâtre à Paris n’a pas un pont de communication avec la grève.
Mais comment aussi conserver toute la force théâtrale et ménager la délicatesse française qui, dans ce point, me paraît juste et respectable ? Comment exposer la passion dans toute son énergie et ne point perdre le but moral, faire frémir, et ne point faire horreur ? J’ai conduit le jeune homme sur le bord de l’abîme. Je lui en ai fait mesurer toute la profondeur. Il m’eut été facile de l’y précipiter. Mais j’en appelle à la nation. Aurait-elle vu sans pâlir un forcené guidé par la soif de l’or, et par celle de la volupté qui court plonger le poignard dans le sein d’un homme vertueux ? Non, elle eut repoussé le tableau, parce qu’il n’est pas fait pour elle, et qu’elle ne suppose point un parricide au milieu des âmes sensibles qui viennent s’attendrir et pleurer à son spectacle. On peut être ému, effrayé, sans que le poète serre le cœur d’une manière triste et désagréable. Faut-il blesser pour guérir ? Ne suffit-il pas d’environner l’âme du doux sentiment de la pitié, de ce sentiment vainqueur qui nous replie sur nous mêmes, et qui triomphe d’une manière aussi douce qu’intime ? Croira-t-on que le jeune homme faible et trompé, ne pourra ouvrir les yeux, et sortir de l’enchantement, sans qu’on lui montre dans l’enfoncement du théâtre la corde, la potence et le bourreau ? Et pourquoi dans cette situation attendrissante et terrible, où la voix d’une femme commande un assassinat, ne pas laisser au jeune homme interdit et déchiré un retour à la vertu ? Ce retour n’est-il pas naturel, et le nouveau but moral qu’il offre en donnant une idée noble des forces victorieuses que nous recélons en nous mêmes, n’est-il pas fait pour satisfaire autant le public que le Philosophe ?
J’ai donc été obligé d’abandonner la pièce anglaise, et de faire, pour ainsi dire, un Drame nouveau. J’ai conservé le fond de deux caractères ; et j’ai marché seul pour le reste. J ai regretté de n’avoir pu faire entrer dans ma pièce plusieurs beautés de l’Anglais ; mais ayant suivi un plan tout différent, ces beautés n’ont pu trouver leur place. Enfin travaillant, pour ma nation, je n’ai pas dû lui présenter des mœurs atroces.
Je pourrais donner ici mes idées sur ce genre utile, qui met dans un jour si frappant les malheurs les devoirs de la vie civile ; qui, plus que l’orgueilleuse Tragédie, parle à cette multitude, où repose une foule d’âmes neuves et sensibles, qui n’attendent, pour s’émouvoir que le cri de la nature. Je pourrais faire voir que la plupart des auteurs dramatiques n’ont malheureusement travaillé jusqu’ici que pour un très petit nombre d’hommes, que les succès qu’ils devaient attendre et placer dans l’amélioration des mœurs n’ont pas répondu à leurs efforts, parce qu’ils ont employé leur génie à tracer des tableaux superbes, mais le plus souvent de pure fantaisie. Quelques beaux qu’ils puissent être ils ne frappent point le gros de la nation, parce qu’ils n’ont pas un rapport nécessaire avec l’instruction générale. Les Écrivains comme les grands, ont semblé dédaigner l’oreille du Peuple.
Chez les Grecs le but de la Tragédie était sensible. Elle devait nourrir le génie Républicain, et rendre la Monarchie odieuse. J’entends fort bien Corneille ; mais il faut l’avouer, il est devenu pour nous un auteur presque étranger, et nous avons perdu jusqu’au droit de l’admirer. Nous aimons le poli et la massue d’Hercule est noueuse. Corneille enfin devait naître en Angleterre. Que nous reste-t-il présentement à faire, si ce n’est de combattre les vices qui troublent l’ordre social ? Voilà tout notre emploi ; et puisqu’il ne s’agit plus de ces grands intérêts, a jamais séparés des nôtres, ce font mes semblables que je cherche, ce sont eux qui doivent m’intéresser, et je ne veux plus m’attendrir qu’avec eux.
Il est donc singulier que parmi tant d’Auteurs que leur goût portait à la recherche et à la peinture des caractères, presque tous aient dédaigné le commerce des habitants de la Campagne ou n’aient vu en eux que leur grossièreté apparente. Quel trésor pour un poète moral, que la nature dans sa simplicité ! Que de choses à peindre, à révéler à l’oreille des Princes ! Si je ne me trompe, vu nos progrès dans la Philosophie, ce serait aujourd’hui au Monarque à descendre au rang des auditeurs, et ce serait au Pâtre à monter sur la scène. L’inverse du Théâtre deviendrait peut-être la forme la plus heureuse, comme la plus instructive. Le paysan du Danube paraît un instant au milieu du Sénat de Rome, et devient le plus éloquent des Orateurs.
Avouons que l’Art Dramatique n’a pas reçu tout son effet, qu’on la resserré dans des bornes étroites, que nous n’avons presque point de pièces vraiment nationales, que le goût imitateur a proscrit la vérité précieuse, que ces Tragédies où il ne s’agit point des crimes des têtes couronnées, de ces crimes stériles dont nous sommes las, mais des infortunes réelles et présentes de nos semblables font, sans doute, les plus difficiles à tracer, parce que tout le monde est juge de la ressemblance, et qu’il faut qu’elle soit exacte, ou l’effet est absolument nul. Le poète qui me peindrait l’indigent laborieux, environné de sa femme et de ses enfants, et malgré un travail commencé avec l’aurore et continué bien avant dans la nuit, ne pouvant sortir des horreurs de la misère qui le presse, m’offrirait un tableau vrai et que j’ai sous les yeux. Ce tableau offert à la Patrie pourrait l’éclaircir par sentiment, lui donner des idées plus saines de politique et de législation, démontrer leurs vices actuels, et par conséquent il serait plus utile à tracer que ces lointaines révolutions arrivées dans ces états qui ne peuvent nous toucher en rien.
Je pourrais m’étendre davantage ; mais il est trop aisé et trop dangereux de s’ériger en Législateur. L’amour-propre, d’une manière insensible et presque naturelle, vous persuade que Part et vous, ne faites qu’un. Il faut échapper à ce piège où tombe facilement la vanité. Cependant le critique qui n’a qu’un goût étroit, qu’une âme sèche et stérile, s’imaginera que l’Art est détruit, parce qu’il est modifié. Il ne sentira pas que l’Art n’a fait qu’augmenter ses richesses et reculer ses bornes. Triste envieux, froid dissertateur, ne sachant pas même prévoir qu’il risque de rougir le lendemain de ce qu’il a écrit la veille, il osera appeler ce genre le refuge de la médiocrité. Comme si ce n’était rien que de peindre avec sentiment et avec vérité, comme si le génie était attaché au vêtement Grec, Perse ou Romain ; et dépendait servilement de tel ou tel personnage !
Quelle comparaison, dit l’Auteur de la Poétique Française, de Barnevelt avec Athalie, du coté de la pompe et de la majesté du Théâtre ! Mais aussi quelle comparaison du côté du pathétique et de la moralité !
Le vœu général de la nation, je l’oserai dire, est de voir enfin des Drames qui nous appartiennent, et dont le but moral soit plus effectif, comme plus près de nous. Les premiers essais ont été reçus avec transport. Voyez dans toutes nos Provinces les succès qu’ont eu le Père de Famille, le Philosophe sans le savoir, Beverley, etc. Chaque Citoyen a dit, voilà ce qu’il faut offrir à nos enfants, à nos sœurs, à nos femmes. Voici enfin des leçons qui pourront fructifier dans leurs cœurs. Plus la fable approche des événements ordinaires, plus elle ouvre dans l’âme une entrée libre aux maximes qu’elle renferme, dit Gravina.
L’homme de génie qui a fait le Père de Famille pourrait en cette partie enlever tous nos hommages. Ah ! s’il prenait les pinceaux de cette même main qui a parcouru le vaste champ des arts, comme tous les états de la vie civile qu’il a vus et fréquentés recevraient de son âme féconde et brûlante la leçon d’une morale applicable à leurs diverses conditions ! Et que deviendraient alors devant lui ces Auteurs qui vont chercher hors de leur siècle et de leur patrie une nature énergique qu’ils ont sous les yeux et qu’ils sont impuissants à peindre.
À mesure que les lumières s’étendent, se fortifient, naissent dans les arts de nouvelles combinaisons. Elles sont le fruit du temps, de l’expérience et de la réflexion. Il est réservé, sans doute au siècle de la philosophie de donner au peuple un genre dont il puisse entendre et reconnaître les personnages. Le système Dramatique a visiblement changé depuis Corneille jusqu’à La Chaussée encore quelques nuances de plus, un nouveau degré de vérité et de vie, et la nation bénira ses Poètes. On doit des éloges par exemple à M. d’Arnaud ; il vient de déterminer un nouveau genre de Drame, touchant et lugubre ; il a présenté les grands combats de la religion et de l’amour, ces deux puissances du cœur humain. Il l’a vu tel qu’il est, tel qu’il gémit dans les cloîtres, et combien de cœurs infortunés se sont reconnus dans ses tableaux ! Combien d’autres éviteront d’opposer ainsi leur faiblesse à la plus tyrannique des passions ! Quelle force, quelle influence les écrivains n’auraient-ils pas sur les esprits, s’ils ne perdaient jamais de vue que les talents ne sont rien, s’ils ne se tournent vers un objet utile ! Quelle énergie, quel triomphe assuré n’aurait pas en même-temps notre Théâtre, si au lieu de le regarder comme l’asile des hommes oisifs, on le considérais comme l’école des vertus et des devoirs du Citoyen ! Quel art que celui qui, concentrant toutes les volontés, de tous les cœurs peut ne faire qu’un seul et même cœur ! Que de tableaux éloquents nous pourrions enfin exposer en partant de l’heureux point de vue où nous sommes !
ACTE I
Scène première
MONSIEUR DABELLE seul, assis devant une table couverte de papiers
Il écrit.
Un Commis entre et apporte plusieurs lettres, Monsieur Dabelle les ouvre, et à mesure qu’il les lit, il les rend et dit.
Répondez tout de suite à ces trois Lettres... Faites expédier le Congé à ces Soldats, qui ont rempli le temps de leur engagement. Rendons des Agriculteurs aux Provinces, et ne violons jamais la foi publique. Elle est encore plus sacrée que celle des particuliers. Pressez cette autre expédition : elle est importante, elle intéresse plusieurs malheureux...
Il a retenu une lettre qui le concerne particulièrement. Il la lit et la tient décachetée à la main. Le Commis se retire.
Ce jour est donc fait pour me surprendre...
En élevant la voix.
Non, non, l’ambition de m’allier avec un homme plus puissant et plus riche que moi ne m’aveuglera point. Je veux que sa main se donne avec son cœur. Malheur au père assez dur pour faire, du saint nœud de l’Hymen, un lien tissu par l’intérêt. Comte ! Votre lettre me fait beaucoup d’honneur ; mais si ma fille ne vous nomme point, ma réponse est toute faite.
Scène II
MONSIEUR DABELLE, LUCILE
LUCILE, allant à son père et lui baisant les mains avec respect.
Mon père !
MONSIEUR DABELLE.
Bonjour mon enfant. Je t’attendais ce matin avec plus d’impatience encore que les autres jours. Nous devons avoir un assez long entretien ensemble. J’ai bien des choses à te dire, et je désire que Lucile y réponde avec sa franchise accoutumée.
LUCILE.
Vous me parlez toujours avec tant de bonté. Vous jugez si favorablement de mon cœur, que je crains de ne pouvoir mériter vos éloges... Vous savez le plaisir que j’ai à vous entendre... je ne me suis jamais trouvé embarrassée avec vous ; mais combien de fois vous m’avez émue !
MONSIEUR DABELLE.
Je suis trop loin de me reprocher la douceur dont j’ai usé envers toi pour devoir l’abandonner. Eh comment peut-on se résoudre à ne pas traiter son enfant comme soi-même ? Ce n’est qu’aux soins paternels qu’il doit reconnaître celui dont il tient la vie... Asseyez-vous, ma fille... je sais vous rendre justice...
En s’animant.
Lorsque l’épouse chérie dont tu me retraces tous les traits, ainsi que tes vertus, lorsque ta mère, orgueilleuse de remplir les devoirs qu’impose ce nom sacré, t’allaitait sur ses genoux, ma Lucile était encore au berceau, et dans nos doux entretiens nous parlions déjà de la marier. Au milieu de la joie dont nos cœurs étaient pénétrés, nous jetions pour elle nos regards dans l’avenir...
D’un ton non moins touchant, mais plus sérieux.
Votre mère est morte, Lucile : elle m’a laissé seul au milieu du travail de votre éducation ; mais l’ouvrage commencé par ses mains, formé sur le plus noble modèle s’est achevé de lui-même ; vous me tenez lieu d’elle... Mais il est une fin pour laquelle vous êtes née. Chaque âge a sa destination, et quiconque ne la remplit pas se prépare des malheurs plus grands que ceux qu’il croit éviter... Je sens qu’il vous sera dur de vous séparer d’un père ; c’est à moi de vous presser de choisir un époux... Il faut que je vous quitte un jour ; la tombe où repose votre mère m’attend. Alors ne m’ayant plus, sans protecteur, sans amis, vous resteriez seule.
Lucile peinée se lève et voudrait parler ; Monsieur Dabelle lui prenant les mains.
Non ma fille, il n’y a point de réponse à cela. Retenez vos larmes ; je mourrai content, mais ce sera après avoir assuré votre bonheur. Pesons donc ici nos intérêts : vous vous étonnez tous les jours de voir des maisons, où, sous une apparente tranquillité, règne la discorde ; des Maîtres durs ou gouvernés par leurs valets ; des femmes dissipées et sans tendresse ; des chefs de famille dont l’enfance se perpétue jusques dans la vieillesse. Ô ma fille, voici l’origine du mal, c’est que les meilleures qualités le cèdent à une triste opulence. On court après la fortune, on néglige les vertus sociales. Sous le brillant de la richesse, le cœur de l’homme se trouve souvent bien pauvre. On se voit trompé lorsqu’il n’est plus temps de revenir sur ses pas. Je vous ai accoutumée de bonne heure à distinguer le mérite réel de celui qui n’en a que les dehors. Élevée dans la maison paternelle, vous y avez vu le vrai, le beau, l’honnête. Le vice ne s’est offert à votre imagination que comme ces fantômes qui se perdent dans l’ombre. Voici l’âge où la raison se joint chez vous au sentiment. Voici l’instant où je dois être récompensé de mes peines... je vous l’ai déjà dit, ma fille, plus des trois quarts de mes jours sont écoulés... répondez-moi, aurai-je la consolation de vous laisser entre les bras d’un époux ? J’ai toujours attendu que votre cœur parlât : je l’avouerai, j’ai épié avec une secrète impatience jusqu’à ses moindres mouvements. Digne de choisir, je lui ai laissé la liberté. Ma maison s’est à tous ceux qui pouvaient aspirer à votre main. Tous se sont déclarés, et vous qui jouissez de ma confiance et de mon estime, Lucile vous ne me dites rien.
LUCILE.
Oser me décider sur un choix qu’il n’appartient qu’à vous de faire, mon père, trop de regrets suivraient mon imprudence. Cette liberté m’est à charge. Je m’égare, je me perds dans l’examen des hommes répandus dans la société, et jugeant trop sévèrement les personnes que vous adoptez peut-être, je préfère l’obéissance. C’est la vertu de mon sexe ; et elle convient parfaitement à ma situation. Comment votre fille ne pourrait-elle pas aimer celui que vous aurez choisi pour fils ? Nommez-le seulement, je lui trouverai des vertus.
MONSIEUR DABELLE.
Aucun n’est adopté ; non, crois-en ton père. Si j’écoutais mon cœur, tremblant, irrésolu, je n’oserais jamais prononcer son nom. Je serais plus sévère que toi-même, et la tendresse d’un père surpasserait encore ta délicatesse. Je ne vois que trop combien les mœurs, de jour en jour plus corrompues, rendent le plus heureux des liens, le plus difficiles à former ; mais enfin il est un terme pour se décider. Ne point trouver d’hommes avec qui tu crusses pouvoir passer ta vie, ce serait faire un outrage à la société. Le jeune homme que tu aimeras, fut-il sans vertus, ne vivra pas longtemps avec toi sans les connaître.
LUCILE.
Mon père, épargnez votre fille ; vos louanges l’ont fait rougir.
MONSIEUR DABELLE.
C’est par elles que je t’encourage à t’en rendre encore plus digne. Lucile, quand je te loue d’avance de faire le bonheur d’un honnête homme, c’est que je suis sûr que tu le feras. Le rang et les richesses sont à tes yeux comme aux miens de futiles chimères. Tu n’écouteras que la voix de ton cœur. Parle, j’attends ton aveu.
LUCILE, avec embarras.
Eh bien je dompte ma timidité. Nommez-moi donc ceux qui se sont déclarés. Si quelqu’un d’entr’eux peut décider, je...
MONSIEUR DABELLE.
Mais personne n’ignore ce qui attire ici Dorimon, le jeune Voclair. Madame Desmare vient tous les jours pour son fils ; M Versal et le conseiller se suivent d’assez près. Ils t’ont donné tout le plaisir de les connaître, et chacun demande préférence.
LUCILE.
Puis-je parler hardiment sur leur compte ?
MONSIEUR DABELLE.
Il le faut, ma fille.
LUCILE.
Eh bien, je ne vois dans aucun d’eux celui que je nommerai mon époux. Monsieur Dorimon se déguise trop à mes yeux. On voit qu’il tremble de se montrer tel qu’il est. Il me semble apercevoir en lui un caractère qu’il n’est pas facile d’approfondir, et je redoute un homme impénétrable. Pour le jeune Voclair, il est tout superficiel. Il ne m’a pas encore dit un mot qui serve à me prouver qu’il puisse penser. Le fils de Madame Desmare est un homme trop indécis pour que je penche jamais en sa faveur. Je l’ai vu dans une heure changer trente fois d’avis au gré de ceux qui se jouaient de sa volonté. Le Conseiller a eu le malheur de se voir trop jeune en place ; il n’a rien appris ; il tranche, décide, et se croit juge né de l’Univers : je l’ai trouvé trop grave pour de petites choses, et trop inconséquent pour des affaires où l’intérêt général se trouvait compromis. Quant à M. Versal, il ne m’a fait jusqu’ici sa cour qu’en paraissant sous un habit plus élégant que celui de la veille ; il semble n’exister que par ses belles dentelles et par les fleurs de sa veste. Enfin j’ai beau vouloir trouver un mérite qui m’attache, je ne vois autour de moi qu’un éclat emprunté. Est-ce ma faute si vous m’avez rendue si difficile. Celui qui vous appellera son père ne doit-il pas posséder quelqu’une de vos qualités.
MONSIEUR DABELLE.
Peut-être y suis-je, le Comte de Stal ; qu’en penses-tu ?
LUCILE, avec étonnement.
Le Comte ; mon père !
MONSIEUR DABELLE, en souriant.
Voici sa lettre, vous me dicterez la réponse.
Lucile reçoit la lettre et la lit.
Mais dis-moi tout de suite si c’est lui. Devenir Comtesse est un appas à faire tourner une tête !
LUCILE, avec noblesse.
Heureusement ; tout ce clinquant ne m’éblouit pas. Je me représente le Comte dépouillé de ses titres et de ses biens. Je ne vois pas qu’il mérite de l’emporter sur ses rivaux. Je ne l’aime point.
MONSIEUR DABELLE.
Et tu n’aimerais personne ?
LUCILE, hésitant.
Non, mon père.
MONSIEUR DABELLE, d’un ton affectueux et ferme.
Lucile ! me parlez-vous vrai ?
LUCILE.
Vous me pressez... vous m’arrachez un secret... Mais comment résister à l’ascendant de vos bontés ?... Comment vous taire... Il faut vous obéir.
MONSIEUR DABELLE.
S’il est des secrets que tu ne puisses épancher dans le sein d’un père qui te traite en ami, je ne demande plus rien.
LUCILE, avec tendresse.
Je n’aurai jamais d’autre confident que vous. Vous me guiderez, vous me consolerez... Je crains d’aimer... Je crois que j’aime... Je fais un effort sur moi-même, c’est le plus grand, sans doute... Mais du moins n’oubliez pas...
MONSIEUR DABELLE.
Eh, ma fille, méconnaîtrais-tu ton père ?
LUCILE.
Le cœur me bat : pourquoi donc suis-je si tremblante ?
Scène III
MONSIEUR DABELLE, LUCILE, BONNEMER
Bonnemer est entré à pas lents, le front baissé, les bras croisés.
MONSIEUR DABELLE.
Voici Bonnemer.
À part.
Il paraît affligé.
Haut.
Qu’avez-vous mon ami ?... Vous me paraissez tout troublé. Puis-je savoir quel chagrin ?...
BONNEMER, d’un ton triste.
Ah ! Monsieur, on est bien trompé dans ce monde. Il faut renoncer désormais aux doux plaisirs de la confiance. Tel qui porte une physionomie honnête porte une physionomie menteuse. Dans ce siècle la jeunesse est impénétrable. Cette Ville malheureuse est si propre à favoriser, à entretenir ses désordres. Qui l’eut dit ?... Jenneval... Malheureux jeune-homme !
MONSIEUR DABELLE, surpris.
Eh bien Jenneval ?
À sa fille qui fait un mouvement pour se retirer.
Demeurez ma fille, nous devons reprendre notre entretien.
BONNEMER.
Monsieur, j’ai connu son père. Nous fumes ami trente ans. Il mourut dans mes bras. Il m’a recommandé son fils en expirant. Veillez sur lui, me dit-il, guidez sa jeunesse ; il sera susceptible de grandes passions ; préservez-le des malheurs qu’elles enfantent. Se pourrait-il qu’une source aussi pure se fût corrompue, qu’il eût dégénéré de ce sang vertueux !... Il paraissait si sage, si rangé !... Non, c’est une chose qui me passe encore... Malheureux Jenneval !
LUCILE, à part.
Ô Ciel ! Que va-t-il annoncer ?
MONSIEUR DABELLE.
Eh bien, qu’a-t-il fait Jenneval ? Possédez-vous.
BONNEMER.
Ah, vous allez être pénétré de douleur. Ce jeune-homme dont vous m’avez vu si zélé, n’est plus digne de mon amitié. Il m’a trahi.
MONSIEUR DABELLE.
Comment ?
BONNEMER.
Je l’avais chargé d’aller recevoir cette lettre de change que je dois rembourser demain en votre nom. Eh bien Monsieur, j’ai des nouvelles positives qu’il a reçu l’argent, et depuis ce jour je l’ai point revu.
LUCILE, à part.
Malheureuse ! cache ton trouble.
MONSIEUR DABELLE, froidement.
Mais ne m’avez vous pas dit qu’il était à la Campagne, chez son oncle depuis quatre jours ?
BONNEMER.
Et voilà ma faute. J’ai voulu cacher quelque-temps la sienne. J’ai déguisé la triste vérité pour lui donner le temps du repentir. C’est moi qui ai introduit Jenneval dans cette respectable maison, l’asile des vertus. Il obtint votre estime, je voulais la lui conserver ; mais hélas ! C’est un homme perdu. Qu’il me cause du chagrin ! Que je voudrais faire revenir ce temps heureux où dans l’âge de l’innocence, il n’écoutait que ma voix ! J’ai cru que la seule idée de mes inquiétudes le ramènerait vers moi ; mais on l’a vu promener ses pas dans une de ces maisons écartées, où la débauche sans doute entretient ses tristes victimes. Jugez si je dois encore l’adopter pour mon ami, et si je n’ai pas des larmes à verser sur cette âme honnête qu’un moment a corrompue. Je reculais toujours, enfin il a bien fallu vous tout avouer.
MONSIEUR DABELLE.
Ce que vous venez de m’apprendre m’étonne et m’afflige. Je lui ai connu de la droiture, des mœurs ; cette action est bien contraire à son penchant naturel ; mais la fougue, l’emportement, la jeunesse, l’exemple... on l’aura séduit, mon cher Bonnemer, on l’aura séduit. Vous avez besoin de courage et de vigilance. Agissez, mais prudemment ; taisez cette aventure. Un mot prononcé dans la première chaleur du ressentiment a fait quelquefois un tort irréparable ; deux mille écus ne sont rien, mais perdre un cœur sensible et bien né, voilà ce qu’il est important de prévenir. Souvent une imprudence a reçu dans la bouche de la malignité tous les caractères du crime, et l’on a flétri pour le reste de ses jours un homme vertueux, mais faible. Tout en l’observant ayez l’air de vous reposer de sa conduite sur lui-même, marquez-lui encore de l’estime ; c’est un bon moyen pour éloigner les cœurs bien faits de ce qui pourrait les en rendre indignes ; s’il revient repentant, il aura toujours les mêmes droits sur mon cœur... Courez, arrachez-le au vice, il reconnaîtra votre voix, il sentira le remords et nous le retrouverons tel que je l’ai connu.
BONNEMER, en regardant Lucile.
Ah ! Mademoiselle, quel père, et pour moi quel ami !
À Monsieur Dabelle.
Votre générosité réveille la mienne. La pitié succède à mon indignation. Comment ne serais-je point indulgent ; c’est vous qui m’en donnez l’exemple.
MONSIEUR DABELLE.
Les moments sont chers. Prévenez les progrès rapides de la corruption ; mais, couvrez sa faute du voile le plus secret. Faites lui même entendre que je n’ai rien appris. Que la honte s’éveille dans son âme sans qu’il connaisse l’affront ; quiconque se voit une fois avili n’a plus le courage de rentrer dans le sentier de la vertu.
BONNEMER.
Ah ! Que ne peut-il vous entendre !
Scène IV
MONSIEUR DABELLE, LUCILE
MONSIEUR DABELLE.
Ma fille, cet honnête homme nous a troublés... Mais tu pleures, tu t’attendris sur cet infortuné qui s’égare... Va, il peut se relever de sa chute et tirer un plus grand éclat de sa faute même... J’ai vu tes larmes, embrasse moi, et surtout ne me déguise plus rien.
LUCILE.
J’étais prête à céder à vos instances mon père. Imprudente ! J’aurais prononcé peut-être un nom qui l’instant d’après m’eût fait rougir... Non, souffrez que je vous rende le droit qui vous appartient ; est-ce à moi de choisir quand vous-même êtes embarrassé... Que d’exemples effrayants pour une fille craintive !... Vous le voyez, Jenneval et tant d’autres dont la conduite paraissait exempte de blâme... La jeunesse se corrompt de plus en plus ; et comme vous le disiez il y a un instant, le mariage dans ce siècle, est un nœud trop dangereux à former... Laissez-moi toujours vivre auprès de vous. Je vous en conjure au nom de vos bontés... Croyez que le plaisir de vivre avec un père peut balancer celui d’avoir un époux. Pourquoi tant craindre d’un avenir dont le Ciel prendra soin ?
MONSIEUR DABELLE.
J’interprète ton silence, ma chère fille, il m’intéresse, il me touche... va, mon enfant, je sais qu’il est un âge, qu’il est des passions... Mais elles ne seront pas plus fortes que l’amitié, que les principes d’honneur, que la vertu... Calme-toi.
LUCILE.
Pardonnez à votre fille...
UN DOMESTIQUE entre.
Monsieur, Mo. Jenneval demande à vous parler en particulier.
LUCILE, à part.
Je ne supporterai jamais sa vue... Ah mon père, souffrez que je me retire.
MONSIEUR DABELLE.
Allez, ma fille.
LUCILE, fait deux ou trois pas et revenant elle dit.
Cependant si vous étiez fâché contre moi, j’aimerais mieux vous dire tout.
MONSIEUR DABELLE.
Va, mon enfant, ton cœur ne peut-être long-tems à mes yeux une énigme difficile.
Seul.
En croirai-je mes soupçons ! Ciel ! change son cœur, ou du moins rends digne du sien le cœur qui s’est égaré.
Scène V
MONSIEUR DABELLE, JENNEVAL
JENNEVAL, entre en regardant s’ils sont seuls.
Monsieur, j’ai longtemps balancé la démarche que je viens faire... Je marche en tremblant, je parcours avec effroi cette maison qui m’est si connue... Coupable, je n’ose lever les yeux vers vous... Ah Dieu ! Qu’il est cruel de porter la confusion sur le front et le remords dans le cœur... J’ai été un ingrat, j’ai trahi la confiance d’un bienfaiteur, j’ai mis votre ami, le mien, dans le plus cruel embarras. Plaignez-moi, plaignez un malheureux jeune-homme qui chérit l’honneur et qui a fait une action déshonorante. Mais quelque étonnante que vous paroisse ma conduite, je ne puis accuser ici l’emploi que j’ai fait de cette somme, je la dois, c’est une dette sacrée ; c’est la première sans doute que j’acquitterai... permettez qu’à l’instant même je vous offre des engagements...
MONSIEUR DABELLE.
Quels sont ces engagements, Monsieur ?
JENNEVAL.
De vous signer une obligation dont vous me dicterez la forme, je suis encore en tutelle, mais bientôt j’espère...
MONSIEUR DABELLE.
Jenneval, répondez-moi, et osez me regarder. Quelque affaire secrète ; quelque accident imprévu vous aurait-il forcé à détourner le dépôt qui vous était confié ?
JENNEVAL.
Rougirais-je devant vous si je n’étais que malheureux ; viendrais-je le front baissé subir l’affront ?... Vous me pardonneriez monsieur, ce que je ne me pardonnerais pas à moi-même. Je pourrais inventer ici quelque excuse pour colorer ma bassesse ; mais ma bouche ne sait point proférer un mensonge... N’attendez de moi aucun autre aveu. Dans un trouble inexprimable et nouveau pour mon cœur, je me trouve emporté malgré moi ; voilà tout ce que je puis vous dire.
MONSIEUR DABELLE.
Emporté malgré vous, faible jeune-homme ! Vous le croyez... Ajoutez un pas de plus à la démarche que vous venez de faire et je vous réponds de l’estime universelle. Votre sensibilité a besoin d’un frein puissant qui la réprime. Si les passions nous égarent, la voix d’un ami peut nous remettre dans le sentier que notre aveuglement abandonnait. Il peut nous guérir, nous consoler... Ma maison est toujours à vous, cher Jenneval, demeurez-y, et puisse l’air qu’on y respire faire rentrer dans votre âme le calme et la tranquillité de la raison.
JENNEVAL, d’un ton plus touché.
Je me sens indigne de l’habiter désormais. Je ne suis pas né pour ce paisible asile. Son souvenir ne me quittera point, mais il sera toujours comme un poids accablant qui pèsera sur mon cœur... Par pitié oubliez moi... Ne me laissez pas voir tant de bonté ; faites plutôt éclater votre indignation... Abandonnez un homme qui s’est avili, et ne songez qu’à ce qu’il vous doit.
MONSIEUR DABELLE.
Ce que vous me devez n’est rien en comparaison de ce que vous vous devez à vous-même... Vous parlez d’engagements... Si vous ignorez ceux que vous avez contractés avec moi, malheur à vous ; votre dette ne s’acquittera jamais ; vous avez de la grandeur d’âme, ne la poussez point jusqu’à l’orgueil. La vertu n’est pas bornée à ne commettre aucune faute, mais à réparer celles qu’on a commises. Consultez l’honneur et vos devoirs et venez me parler ensuite... Vous ne m’avez vu ni chagrin ni sévère ; si votre cœur s’obstine à vouloir conserver des secrets aussi mystérieux que les vôtres... Vous les garderez, monsieur.
Il fait quelques pas pour s’en aller et revient en disant.
Jenneval, écoutez. Vous n’avez rien perdu de mon estime et de mon amitié ; je vous le répète. Attendez ici Bonnemer ; un jeune-homme comme vous, jeté dans le tourbillon du monde et des séductions, a besoin d’un ami sage et prudent ; et je me plais à penser que vous méritez encore d’avoir un tel ami.
Scène VI
JENNEVAL, seul
J’étais prêt de tomber à ses pieds. Qui m’arrêtait ?... Rosalie, Rosalie, laisse-moi respirer. Tu maîtrises tout mon être. Tout ce qui n’est pas toi n’a plus d’empire sur mon âme... Cruelle, tu semblais me promettre le bonheur... Hélas ! Au lieu de te rendre heureuse, je me perds avec toi ; c’est par toi seule que j’aspire à des biens dont je savais me passer... Que le séjour de cette maison me paraît tranquille !... Où est le temps que je pouvais l’habiter sans rougir ?... Où retrouver ce calme délicieux qui m’accompagnait près de Lucile ?... Quel doux sentiment me faisait tressaillir à l’aspect de son père ?... Je le regardais déjà comme le mien... sa candeur, ses vertus... Ai-je oublié jusqu’à sa tendresse ? Rosalie, Rosalie, ah, pourquoi l’amour que tu m’inspire m’emporte-t-il tout-à-coup si loin de mes devoirs ?... Lucile ne m’a jamais rendu coupable... Fuyons ces lieux où chaque objet me fait un reproche... Souveraine de mon cœur, l’ascendant de tes charmes m’entraîne... Je ne puis te résister... Dispose de mes jours... Heureux ou malheureux mon sort est de vivre à tes genoux.
ACTE II
La scène représente l’appartement de Rosalie. L’ameublement est neuf. Une toilette est toute dressée : Rosalie est dans un déshabillé élégant.
Scène première
ROSALIE, JUSTINE
ROSALIE, en se regardant dans le miroir.
Comment me trouves-tu ce matin ? J’ai peu dormi, mes yeux ont, je crois, perdu quelque chose de leur vivacité.
JUSTINE.
Oh, je vous conseille de vous plaindre. Jamais vos grands yeux noirs n’ont été plus doux et plus brillants, et je ne sais quel air de tendresse répandu sur votre physionomie la rend charmante, et votre sourire... Vos yeux font tout ce qu’ils veulent faire... Hier encore, Jenneval les contemplait avec un transport si vrai et toujours si nouveau que je prenais du plaisir à le considérer dans l’extase de l’amour.
ROSALIE.
De sorte que Jenneval te paraît toujours beaucoup amoureux de moi ?
JUSTINE.
À mesure qu’ils jouissaient, ses regards devenaient plus avides ; ce jeune homme brûle d’une flamme bien sincère.
ROSALIE.
Il est aimable, je l’avoue ; mais il a un défaut.
JUSTINE.
Lequel, s’il vous plaît ?
ROSALIE.
Mais c’est de n’avoir pas seulement dix mille écus de rente. Il a le cœur tout neuf et l’esprit romanesque. J’ai besoin d’entretenir cette ardeur respectueuse. Il est homme à grands sentiments, et rien n’est assurément plus étrange dans le siècle où nous vivons. Il ne manque point d’esprit, mais il est ombrageux, timide, indécis, quoique d’un caractère sensible. Cependant il est héritier d’une assez grosse fortune, il est docile à ma voix, il m’idolâtre. Allons, toute réflexion faite je dois vivre avec lui.
JUSTINE.
Vous avez raison. Avec votre esprit et votre beauté que chacun admire, profitez de vos jours brillants pour vous assurer un jeune homme libéral et passionné. Que mon exemple vous serve de leçon. Une maladie de six mois m’a volé tous mes attraits et avec eux mes plaisirs et ma fortune. Autrefois l’on me servait, et ce m’est un bonheur aujourd’hui de vous servir.
ROSALIE.
Va, les hommes sont nos plus grands ennemis. Leurs soins sont intéressés et barbares, ils sont tous ingrats et ils osent encore nous mépriser ; une guerre secrète règne entre nos deux sexes, ce sont des tyrans qui veulent nous ployer sous leur joug, mais plus faibles nous devons avoir recours à l’artifice, et paraître le contraire de ce que nous sommes, ainsi nous nous vengeons... Puisque je maîtrise Jenneval, je puis espérer qu’enfin... Oui, de la réserve sans dureté, quelques nuances fines d’amour, mais sans faiblesse ; voilà tout ce qu’il faut pour le soumettre. Mais il y a une heure que je devrais être en état de paraître... Quand Jenneval viendra, qu’on l’annonce... Enfin, voici Brigard... Allez...
Justine sort.
Scène II
ROSALIE, BRIGARD
Il doit avoir l’air d’un homme qui a passé la nuit.
BRIGARD.
J’aurais donné cette nuit ma vie pour une obole. J’ai joué d’un malheur effroyable ; j’ai perdu tout ce qu’on pouvait perdre... j’ai du noir dans l’âme.
ROSALIE, avec familiarité.
Libertin ! Tu n’es donc pas trop satisfait de ta journée ? Et depuis as-tu été aux informations ?
BRIGARD.
Oh, je n’y ai point manqué. Jenneval n’est point riche par lui-même comme tu l’as fort bien deviné ; mais il a un oncle opulent dont il est l’unique héritier. Le jeune-homme est encore sous la tutelle de cet oncle qui vit à la campagne à quatre lieues d’ici. On me l’a peint comme un homme fort bizarre, dur...
ROSALIE.
Cet oncle est donc bien riche ?
BRIGARD.
Oui ; de plus, avare.
ROSALIE.
Et combien de temps peut-il vivre encore ?
BRIGARD.
Mais dix à douze années. Il peut pousser jusques-là.
ROSALIE.
Dix à douze années ! Ô Ciel !
Scène III
ROSALIE, BRIGARD, JUSTINE
JUSTINE.
Monsieur Jenneval, mademoiselle.
ROSALIE, à Brigard.
Vite, passe de l’autre côté.
BRIGARD, en s’en allant.
Au revoir.
Scène IV
ROSALIE, JENNEVAL, JUSTINE
Rosalie prend un air riant et agréable. Jenneval la salue, la regarde tendrement et lui baise la main.
JENNEVAL.
Ah ! chère Rosalie, je ne trouve qu’ici le bonheur et la joie... Non, jamais je n’ai eu plus de besoin de me trouver auprès de vous.
ROSALIE.
Mon cher Jenneval, qu’avez-vous ? Et que vous serait-il arrivé ?
JENNEVAL.
Rien que je n’eusse dû prévenir... Rosalie, je voudrais être seul un moment avec vous.
Rosalie fait un signe à Justine qui sort, et fait asseoir Jenneval à côté d’elle. Jenneval continue.
Me croirez-vous, chère Rosalie. Je vous répète que je vous aime, je vous le dis du fond de l’âme, et je venais dans le dessein de rompre avec vous pour jamais.
ROSALIE.
Avec moi, Ciel ! Comment ?
JENNEVAL.
Mon cœur est sur mes lèvres. Chère Rosalie, retenez vos larmes... Écoutez-moi... Je ne puis parler.
ROSALIE.
Vous m’étonnez, vous m’inquiétez... Jenneval que voulez-vous dire ?
JENNEVAL.
Que je suis un malheureux indigne de vous et de l’estime des hommes... Vous allez rougir de m’entendre... Mais avant que l’aveu échappe de ma bouche, dites, m’aimez-vous, Rosalie ? Si vous ne m’aimez pas avec passion je suis perdu.
ROSALIE.
Pouvez-vous insulter à ma tendresse par un semblable doute ? Ah ! Jenneval si j’ai évité quelquefois vos regards, vos transports, c’est qu’un cœur tendre a besoin du secours d’une vertu fière. Le Ciel en me donnant la sensibilité, m’a fait là un présent bien dangereux... Oui, vous êtes un ingrat, si vous pensez ce que vous dites.
JENNEVAL.
Je ne doute plus de votre amour, mais puisque ce cœur est à moi, il me pardonnera... Je ne dois plus hésiter... Lorsque je vous vis pour la première fois, Rosalie, ce fut de ce moment que je sentis la douleur de n’être pas né riche. Cependant n’écoutant que cet amour dont vous daignez m’assurer encore, vous vîtes en moi seul l’heureux mortel à qui vous accordâtes votre confiance. Mon bonheur eût été parfait si ma fortune présente eût répondu à mes désirs. Je n’eus jamais la force de vous avouer que mes moyens étaient au-dessous de ce que vous pouviez attendre, mais ne pouvant en même-temps vous voir former d’inutiles souhaits, j’ai tout tenté pour vous prouver mon amour ; je suis loin de vanter mon zèle ; que dis-je ? C’est à vos pieds que je viens rougir de m’être déshonoré ; je vais perdre votre estime, mais souvenez-vous que sans l’amour le plus extrême, je serais encore innocent.
ROSALIE.
Et de quel crime êtes-vous donc coupable ?
JENNEVAL.
J’ai trahi la confiance d’un homme respectable que je n’ose plus nommer mon ami... Ces deux mille écus que je remis entre vos mains, il y a huit jours tant pour fournir à cet ameublement qu’à notre dépense ; cet argent n’était point à moi... J’ai tâché de dérober jusqu’ici à vos yeux les remords qui me tourmentaient... J’ai des espérances ; mais pour le moment je me trouve sous la loi d’un tuteur... Est-ce assez m’humilier à vos yeux ?... À présent osez me répondre, m’aimez-vous encore ?
ROSALIE.
Vous croyez donc que c’étaient ces richesses qui m’attachaient à vous... vous me faisiez cette injure, vous Jenneval ! Ah, reprenez vos dons. Si je les ai acceptés, c’est parce que c’était votre main qui me les offrait. Je n’ai point eu cette fausse délicatesse qui tient à l’orgueil ou à l’indifférence. Je n’ai point rougi de tout partager avec celui à qui j’avais donné mon cœur... Oui, je suis piquée, mais c’est de votre défiance. Pourquoi ne m’avez-vous pas parlé avant de commettre une telle imprudence, je vous l’aurais épargnée... Je vous aime toujours Jenneval, ouvrez-moi votre cœur : quel sont aujourd’hui vos desseins ?
JENNEVAL.
Sans cet aveu qui me charme et qui me rend pour toujours à vous, j’allais fuir pour ne reparaître jamais à votre vue. Pardonnez, je vois que vous ne m’aimez que pour moi... Je sors de chez ce digne homme que j’ai trompé. Guidé par le repentir, je me suis offert à toute l’indignation que je méritais. Il m’a parlé avec bonté et j’ai mieux aperçu toute la honte qui m’environnait. Je ne puis la supporter plus longtemps.
Avec feu.
Je suis sûr de toute ta tendresse, chère Rosalie... Eh bien ayons ce courage que l’amour inspire. Que l’amour nous tienne lieu de richesses coupables... Est-il de plus doux plaisir que la paix de l’âme ? Allons habiter un simple réduit où nous goûterons le bonheur sans remords. Qu’importe un séjour moins brillant à deux cœurs qui s’aiment !... Je vendrai ces meubles qui me reprochent ma honte... Je restituerai la somme que j’ai détournée. Un jour viendra, Rosalie, que le Ciel couronnera notre constance. Pour vivre obscurs, nous n’en vivrons pas moins heureux. Que dis-je ? Rentré en grâce avec cet ami qui m’aime et que j’estime, je n’aurai plus de remords et tous nos jours couleront paisibles et fortunés.
ROSALIE.
Mon ami, vous parlez de remords, comme si vous étiez un grand criminel. Je vous ai écouté patiemment. J’estime la noblesse de votre âme, mais son excessive sensibilité vous abuse. Pour avoir commis une faute, au fond très réparable faut-il connaître le désespoir ? Vous poussez toujours les choses à l’extrême. Cela est dans votre caractère, et c’est un défaut. Songeons paisiblement aux moyens d’accorder ce que vous devez à l’honneur : mais en même-temps ce que vous devez à vous-même pour votre propre félicité. Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez un oncle assez riche de qui vous attendiez un jour ?...
JENNEVAL.
Ah ! De qui me parlez-vous ? Son nom seul m’inspire l’effroi. Si jamais il découvrait notre liaison, je ne saurais comment me dérober à son ressentiment. Homme sévère, inflexible, à force de vertus... Non Rosalie, jamais je n’aurai recours à lui, et ce qui doit hâter encore plus une juste restitution, c’est la crainte trop bien fondée que ma faute ne parvienne bientôt à son oreille.
ROSALIE.
Vous ne m’avez point entendu Jenneval. De grâce n’outrez rien. Point de déclamation. Répondez-moi : a-t-on paru bien furieux contre vous chez M. Dabelle ?
JENNEVAL.
Je vous l’ai dit : on m’a reçu avec trop d’indulgence et c’est ce qui me déchire le cœur.
ROSALIE.
Eh bien, on ne vous voit donc pas si coupable que vous vous imaginez l’être. En homme habile, profitez de cette bienveillance. Ne sauriez-vous prendre des arrangements avec ces personnes qui vous connaissent et vous estiment ? Elles n’ignorent pas que l’héritage de votre oncle ne saurait vous manquer. Il n’est pas immortel. Un emprunt légitime n’est défendu, ni par les lois, ni par l’honneur. Ce conseil que je vous donne, au moins, Jenneval, vous le verrez par la suite, est parfaitement désintéressé. Jeune, et dans l’âge où vous devez paraître, laisserez-vous échapper ce tems heureux qui fuit et ne revient plus. Vous ne me ferez pas l’injure de penser que j’ai ici quelque vue d’intérêt...
D’un ton le plus tendre.
Va, mon cher Jenneval, un réduit obscur, une vie solitaire, une chaumière dans un village, tout me sera égal, pourvu que je la partage avec toi... Je veux ton bonheur, et je t’aime trop pour y renoncer ; mais toi, Jenneval, tu n’es pas assez décidé.
JENNEVAL.
Parlez, et je vous jure de l’être.
ROSALIE.
Garde-toi donc de former le projet de vivre dans cette médiocrité honteuse, qui attire à coup sûr le sourire du mépris. Crois-moi, je connais le monde. Il pardonne tout hors les ridicules, et la pauvreté est le plus grand à ses yeux. Si tu ne t’y présente pas avec un certain éclat, mieux vaudrait n’y jamais paraître. Le monde juge l’habit, la demeure, la dépense : tout cela tient à l’homme. Le monde peut juger faussement, mais il juge ainsi. Use de toutes les ressources que tu peux avoir. Quelque argent anticipé sur tes revenus futurs, au lieu de renverser ta fortune ne peut que l’établir plus sûrement. Les gens riches ou ceux qui paraissent l’être, s’attirent les uns les autres et forment un corps séparé. Un étranger n’y est point admis, quelque mérite qu’il ait d’ailleurs. Il faut semer l’argent pour le recueillir ensuite. Sans un coup décisif, Jenneval, vous ne ferez que languir, et vous perdrez avec vos plus belles années jusqu’à l’espoir de vous faire un état. C’est donc une sagesse, une prudence ; je dirai plus, une économie de forcer le crédit en cas de besoin. Mon bon ami, il n’y a donc qu’une terreur enfantine, ou une inexpérience absolue qui ait pu vous empêcher jusqu’ici d’avoir recours à ces moyens utiles. Je ne vous prescris point la prodigalité. Je désire seulement que vous vous mettiez en état de vous faire honneur de ce qui vous appartient. Si vous avez des amis, leur bourse doit vous être ouverte. On s’intrigue, on s’arrange. On trouve un peu d’un côté, un peu de l’autre. Un jour vient qui paye le tout. Que dis-je ? Le jour où vous sortirez de tutelle n’est pas si éloigné. La nation est partagée en deux portions. En gens qui prêtent et en gens qui empruntent. Pourquoi rougiriez-vous de faire ce que fait la moitié du monde ?
JENNEVAL.
Je sens la force de vos raisons. Mais, soit ignorance, soit timidité, soit répugnance secrète, mon cœur a toujours hésité.
ROSALIE.
Si vous m’eussiez parlé plutôt, au lieu de commettre une telle étourderie, j’aurais pu vous indiquer...
JENNEVAL.
Se peut-il ? J’oserais espérer...
ROSALIE.
Je veux vous laisser un peu de regret d’avoir manqué de confiance envers moi, de ne m’avoir pas ouvert votre âme ; d’avoir pu faire un seul pas, sans en faire part à celle qui vous aime, à celle qui ne réfléchit que pour vous rendre libre et heureux.
JENNEVAL.
Ah divine Rosalie !... Pardonnez...
Scène V
ROSALIE, JENNEVAL, JUSTINE
JUSTINE.
Mademoiselle, une personne demande Monsieur Jenneval, et s’obstine à vouloir lui parler.
ROSALIE.
Mais avez-vous dit qu’il n’était point ici ?... Ne laissez point entrer.
JENNEVAL, surpris.
Qui viendrait ? Et d’où pourrait-on savoir ?... Mais j’entends sa voix... Ô Ciel ! C’est Bonnemer, c’est mon ami... Non je ne puis... Il faut que je l’entende...
ROSALIE, d’un ton artificieux.
Il est trop juste... Nous nous reverrons, mon cher Jenneval.
Rosalie se retire dans un cabinet voisin.
Scène VI
BONNEMER, JENNEVAL
BONNEMER, derrière le théâtre.
Il est ici, vous dis-je... Je le sais... Je veux lui parler... J’entrerai...
Avec exclamation.
Ah, cruel ami que vous me donnez de peine !... Êtes-vous bien résolu à désoler tous ceux qui vous connaissent ?... Jenneval, cher Jenneval, pourquoi n’êtes-vous pas déjà dans mes bras ?
JENNEVAL.
C’est que je me rends justice... Mes peines sont pour moi... Laissez-moi, de grâce... Votre présence me fait trop souffrir... Un jour nous pourrons nous revoir... Mais pour aujourd’hui, je vous le dis sans détour, je ne veux entendre ni reproche ni conseil.
BONNEMER.
Ami aveugle, mon amitié t’importune ! Tremble à la vue du précipice, lorsque ma main vient t’arrêter sur le bord. Voilà donc pour qui tu t’égares, pour qui tu abandonnes ceux qui te furent si chers ! C’est pour une femme méprisable...
JENNEVAL.
Arrêtez Bonnemer, n’insultez pas à l’objet que j’aime. Si vous venez ici pour l’outrager, je consens plutôt à ne plus vous voir.
BONNEMER.
Je sortirai, jeune insensé. J’abandonnerai mon ami, puisqu’il le veut. Je retournerai sans lui chez le généreux Dabelle, chez ce père respectable qui t’aime, qui te plains, qui t’attend, qui, à l’exemple de sa fille, versera plus d’une larme, en apprenant que tu rejettes jusqu’aux soins de l’amitié. Adieu, embrasse-moi du moins pour la dernière fois.
JENNEVAL, ému, et lui prenant la main.
Non... demeurez un instant.
BONNEMER, avec le cri de l’âme.
Eh j’ai perdu ton cœur, ta confiance. Tu t’es caché de moi, et ce fut-là l’original de tes désordres. Ta folle passion t’expose à de plus grandes fautes encore que celles que tu as commises. Je suis toujours le même ; et toi, Jenneval, qu’es-tu devenu ? Pourquoi ton cœur est-il changé ? Dis-moi donc qu’est devenu mon ami ?
JENNEVAL.
Ah ! Si tu l’es, dépose donc cette âpre austérité, qui condamne toujours et qui ne veut rien sentir. Tu ne connais pas celle que j’adore ; si tu l’avais vue... Tu sais que dans cette honorable maison, où l’on ne m’a que trop bien reçu à ta recommandation, je pouvais être le plus heureux des hommes. Les grâces, les vertus, les charmes de Lucile, m’attachèrent à tous ses pas. Si ce n’étaient point des désirs aussi brûlants que ceux qui me consument, c’était du respect, de la confiance, de l’amitié, une admiration tendre et respectueuse, une sorte de confiance douce et attrayante... Je croyais l’aimer... Mais, que depuis un mois j’ai senti la différence de ce tendre intérêt qu’inspire la douceur, et de ce feu tumultueux qu’allume la beauté ! As-tu connu cet ascendant impérieux ? Dès l’instant que j’aperçus Rosalie je reçus un nouvel être... Il fallait mourir ou tomber à ses genoux, j’y tombai et je ne vis plus qu’elle dans l’univers, et la vie ne me parut un bienfait des cieux que parce que désormais je pouvais en consacrer tous les instants sous ses yeux... Je t’ai fui dans ces moments, craignant d’être guéri, redoutant tes conseils... Je les redoute encore... Ne me force pas à devenir plus coupable... Furieux que je suis, je sacrifierais l’amitié même à l’amour. Pardonne, je t’ouvre mon cœur. Il est en proie aux transports les plus violents... Eh pourquoi tant déclamer contre un tel penchant ? Il suffit d’abandonner un amant malheureux aux tourments secrets qui le tyrannisent... Cher Bonnemer, je crois cependant que je serais fortuné si je jouissais des biens que la providence m’a accordés. Je les partagerais avec l’objet qui me fait chérir l’existence, mais un oncle en me refusant ce que j’avais droit d’attendre a été le premier auteur de ma faute... Tu connais son humeur intraitable... Je ne lui exposerai point des besoins qu’il ne comprendrait pas. Les plus chers sentiments de mon cœur sont oppressés sous sa tyrannie... Ô, mon ami, j’ai voulu être libre en aimant, et je sens que la main de la nécessité m’a chargé de chaînes encore plus pesantes.
BONNEMER.
Cette passion fondée sur les sens, ne te causera que du trouble et du désespoir. Crois-moi, Jenneval, il ne tient qu’à toi de briser tes liens ; le veux-tu ?
JENNEVAL.
Que tu connais peu l’amour, si tu penses qu’on puisse ainsi l’assujettir ! Moi ! Que je renonce au plaisir d’être aimé... Ah !... Il est trop fait pour ce cœur tendre et qui le goûte pour la première fois... Un orage violent s’est élevé dans mon âme, et malgré mes combats, ma honte et ta douleur, jamais je n’ai senti si vivement l’avantage d’être né sensible. Crois-moi, il est affreux de vivre sans aimer, et lorsque notre cœur rencontre l’objet heureux qui le captive, ami, c’est le Ciel qui l’amène sous nos regards pour achever notre bonheur. Nous y refuser n’est plus alors en notre pouvoir ?
BONNEMER.
Ce n’est point le sentiment de l’amour qui est criminel, c’est l’objet que tu as choisi... Ah ! Si Lucile avait fixé ton choix, tous les cœurs y auraient applaudis. Ta félicité serait pure, aucun nuage ne la troublerait. Au plaisir que donne l’amour, se joindrait celui de l’approbation publique. Elle est nécessaire, elle complète le sentiment du bonheur. Qu’il est triste d’être obligé de justifier son penchant sans pouvoir espérer qu’on nous le pardonne !
JENNEVAL.
Que m’importe l’opinion publique ! elle est injuste. Je n’écouterai que la voix qui commande au fond de mon cœur ; elle me parle, elle me rassure ; elle me dicte de nouveaux devoirs... J’aime... Si je pouvais disposer de ma main, j’irais de ce pas la lui assurer solennellement aux pieds des Autels... Il faut que des nœuds éternels nous enchaînent l’un à l’autre... Je ne serai heureux que lorsque je pourrai l’avouer et la montrer à tous les yeux, portant mon nom et possédant mon cœur. Mais tu sais que la mort d’un père m’a donné un maître despotique. Il me reste un ami, l’aurai-je encore longtemps ?
BONNEMER.
Il te restera malgré-toi, infortuné Jenneval. Pourrais-je t’abandonner dans l’égarement où ton inexpérience t’entraîne ? Ton cœur est encore honnête, quoique livré au désordre ; mais prends garde, la contagion du vice t’approche de près, elle flétrira bientôt tes mœurs aimables. Alors tu deviendras vil, alors tu ne seras plus mon ami... Ha, crédule jeune-homme ! Ce n’est point ici où demeure celle avec qui tu dois passer ta vie... Élevé dans les bras d’une facile confiance, tu ignores les artifices d’une femme perdue, tu n’aperçois point les pièges qu’elle multiplie sous tes pas.
JENNEVAL.
Tu n’imagines pas, Bonnemer, à quel point tu m’affliges. Je ne t’avais jamais vu injuste... Que t’a fait Rosalie ? Que tu la condamnes légèrement !... Va, crois-moi, sans sa vertu...
BONNEMER.
Sa vertu !
JENNEVAL.
Oui, son âme est remplie de délicatesse... C’est sa vertu qui me rend malheureux... Ses grâces et sa franchise tempèrent seules la sévérité de sa réserve...
Avec chaleur.
Mais il n’y a personne au monde qui puisse savoir cela mieux que moi...
BONNEMER.
Ne nous emportons point sur les termes... Ami Jenneval, c’est donc une fille honnête, sincère, vertueuse, qui s’est jeté dans tes bras, qui t’a fait violer tous tes devoirs, à qui tu as donné un bel ameublement, qui l’a accepté... Où est ta raison ? Va, l’amant aimé est rarement celui qui donne. L’intérêt seul lui dicte ce qu’elle te dit de plus tendre. Son cœur ne peut être susceptible d’aucun sentiment délicat. À la première occasion elle te trahira pour un homme plus riche ou plus prodigue, ou bien elle aura recours aux manèges de l’intrigue, à l’hypocrisie pour t’amener au point de t’avilir publiquement avec elle. Méprisé le reste de ta vie, de quel front soutiendras-tu les regards du public ?... Je le déchire, hélas ! ce cœur trop tendre ; par mes réflexions cruelles, j’empoisonne tes plus beaux jours : pardonne ! Je veux te sauver à la fois de l’opprobre du malheur.
JENNEVAL.
Que tu me fais souffrir !... Change de langage... Qui de nous deux doit juger de l’état où ce cœur doit être heureux ?...
BONNEMER.
Tes yeux sont fascinés, et de nouveaux remords t’attendent. C’est une femme méprisable te dis-je. Périssent ces infâmes courtisanes ; la honte de leur sexe !
JENNEVAL, avec le cri de la douleur.
Elle ?... Rosalie !... Tu l’outrages ! Adieu, je me retire.
BONNEMER, d’un ton ferme et tendre.
Si tu ne m’étais pas aussi cher, je me serais déjà retiré, ou plutôt je ne serais pas venu te chercher ici. Ose me répondre. Est-ce ma cause ou la tienne que je soutiens en ce moment ? T’ai-je jamais trompé ? Reviens, lis en mon âme le motif qui me fait agir ; vois toute ma tendresse, et sois ensuite assez insensible pour refuser la main que je te présente.
JENNEVAL, la saisissant avec transport.
Je l’accepte comme celle d’un bienfaiteur, d’un ami. C’en est fait, je n’aurai plus rien de caché pour toi, mais respecte l’innocent objet d’un amour malheureux. Je lui avais juré un secret inviolable, tout m’échappe en ta présence... Tu vas devenir mon juge... Que j’aurais mauvaise opinion de toi, que tu m’offenserais si tu gardais tes préjugés contre Rosalie après l’avoir vue !... Sans doute un de ses regards la justifiera plus que toutes mes paroles.
En courant vers le cabinet voisin, et prenant Rosalie par la main.
Venez Rosalie, joignez-vous à moi ; c’est un ami inflexible qu’il nous faut gagner.
Scène VII
BONNEMER, JENNEVAL, ROSALIE
ROSALIE.
Je tremble... À quoi m’exposez-vous ?
BONNEMER, à part.
Dans quel étonnement !...
JENNEVAL, à Rosalie.
À tout ce qui peut vous rendre chère aux yeux d’un autre, comme aux miens.
ROSALIE, à Bonnemer.
Monsieur, dans la solitude où mes malheurs m’ont forcée à me cacher, je ne puis m’empêcher de rougir à l’aspect d’un nouveau témoin de l’état où je suis ; mais malgré les apparences, mon cœur vous est sans doute connu. Jenneval m’est cher, vous êtes ami de Jenneval, et ce titre seul calme un peu le trouble dont je ne pouvais me défendre. Croyez que la plus pure tendresse m’unit à Jenneval. Si vous trouvez que je fasse son malheur, entraînez-le loin de moi. Punissez-moi de l’avoir aimé ; mais j’en atteste le Ciel qui nous entend, dans la douleur où mon âme sera plongée, et en quelque lieu où mon sort me conduise, mon cœur ne sera jamais qu’à lui.
JENNEVAL, à Bonnemer.
Mon ami ! Mon ami ! La voyez-vous, l’entendez-vous ?
BONNEMER.
Très bien, ma foi, elle fait à merveille...
JENNEVAL.
Quoi ?
BONNEMER.
Son Rôle.
JENNEVAL.
Que dites-vous ?
BONNEMER, à Rosalie.
Mademoiselle, Jenneval est mon ami, jusqu’ici il s’est montré vertueux. S’il vous est cher, comme vous le prétendez, ne l’écartez point du sentier de ses devoirs. C’est ce qu’il doit avoir de plus sacré dans le monde. Il est jeune et vos charmes le subjuguent. N’abusez point de ce dangereux pouvoir. J’ignore vos malheurs, mais si les apparences sont contre vous, avouez que jamais elles ne furent mieux fondées...
ROSALIE, en l’interrompant.
Vous prenez avec moi, Monsieur, un ton qui m’étonne, m’humilie... Votre ami a du vous dire... Mon cœur est oppressé...
Elle s’appuie sur Jenneval et dit en pleurant.
Jenneval, Jenneval, vous savez qui je suis et vous m’exposez à cet affront !... Est-il possible ; non, je n’en reviendrai jamais...
JENNEVAL.
Bonnemer !
BONNEMER.
Mademoiselle, allez, on ne m’abuse point. Croyez-moi, donnez-vous pour ce que vous êtes...
ROSALIE, en sanglotant.
Ô Ciel ! Infortunée que je suis !
JENNEVAL, d’une voix altérée.
Bonnemer !
BONNEMER, à Jenneval.
Jeune imprudent ! ces larmes que tu vois couler sont fausses et perfides comme elle.
JENNEVAL, d’un ton emporté.
Vous auriez du respecter... Cruel... Allez, vous n’êtes plus mon ami... Retirez-vous...
BONNEMER, avec force.
Ingrat ! Je le suis encore, et quoi que tu fasses, je le serai toujours : que dis-je ? tu me deviens plus cher dans ton délire, et je t’en donnerai la preuve en t’arrachant, malgré toi, au piège où cette Sirène artificieuse voudrait te conduire. Mon active tendresse emploiera jusqu’à l’autorité publique, si tu n’écoutes pas la voix de ton ami... Adieu.
Il sort.
Scène VIII
JENNEVAL, ROSALIE
ROSALIE, feignant de s’évanouir.
Dieu ! Je me sens mourir.
JENNEVAL, soutenant Rosalie.
Ô Ciel !... Reprenez vos esprits... Je ne pourrai donc faire que votre malheur... Je suis désespéré.
Il conduit Rosalie sur un fauteuil, et courant vers la porte.
Homme terrible, qu’es-tu venu faire ici ? Va, va te ranger au nombre de ceux qui me persécutent... Je les braverai tous.
Aux genoux de Rosalie.
Pardonne Rosalie, serait-il possible que tu m’aimasse encore ?
ROSALIE.
Ah ! ce seul mot me rend à la vie... Si je t’aime encore ! Jamais tu ne me fus plus cher. Je ne sais pas te rendre responsable de l’injustice d’autrui. L’idée de te perdre, de te voir arracher loin de moi, voilà ce qui a bouleversé tous mes sens. Apprends de moi comme il faut aimer. Ah ! Que l’empire que je devrais avoir sur ton cœur n’est-il égal à celui que tu as sur le mien !
JENNEVAL.
En pourrais-tu douter ?
ROSALIE.
Non... Mais faisons ici le serment de ne point nous séparer. Livre-moi désormais toutes tes volontés, je te réponds des miennes. Unissons-nous contre nos persécuteurs ; créons nos ressources, et que notre courage nous rende à la fois indépendants des événements et des hommes.
JENNEVAL, pressant la main de Rosalie.
Je m’abandonne à toi, ô ma chère Rosalie.
ROSALIE, du ton du reproche.
Jenneval... Pourquoi ta main tremble-t-elle dans la mienne ?
JENNEVAL, avec vérité.
Tu es loin de connaître tous les combats qui se passent en mon âme... Tu l’emportes... Je t’adore... Ne m’en demandes pas davantage.
ROSALIE.
Mon cœur ne te déguise rien... Je me livre à toi.
JENNEVAL, avec feu.
Tu ne seras point trompée !
ROSALIE.
Je le souhaite, mais il est de ces moments orageux, où, séduit par une voix imposante, tu redeviendras faible... Où tu ne m’écouteras plus.
JENNEVAL.
Ne crains rien.
ROSALIE.
Me promets-tu de t’en rapporter toujours à moi seule ?... à moi ?...
JENNEVAL.
Je te le promets.
ROSALIE.
Quel est donc cet homme que tu nomme si facilement ton ami ?
JENNEVAL.
C’est... Je te l’ai sacrifié. Il fut dans tous les temps mon protecteur. C’est de lui que je tenais cette lettre de change... Il m’aima toujours ; il en est bien récompensé !
ROSALIE.
Quoi ! il demeurerait chez M. Dabelle ?
JENNEVAL.
C’est son caissier, son ami.
ROSALIE.
Écoutez, Jenneval... Vous avez commis une imprudence très grave en m’exposant à ses regards. Vous avez cru pouvoir le fléchir, mais il est un de ces hommes froids qui sont loin de sentir ou d’excuser la plus auguste, la plus tendre des passions. L’amour n’est pour eux qu’un sentiment étranger... Il m’a outragée... Vous avez besoin de lui ; c’est votre ami, dites-vous ?... Je lui pardonne l’offense qu’il m’a faite.
JENNEVAL, en lui baisant les mains.
Ah ! Votre cœur est aussi noble que sensible.
ROSALIE.
Vous sentez-vous, en même-tems, capable de suivre mes conseils ?
JENNEVAL.
Des conseils !... Ordonnez, je ne veux qu’obéir.
ROSALIE.
Il faut aller retrouver votre ami, lui parler d’un ton repentant, l’apaiser, employer jusqu’à la soumission s’il est nécessaire ; l’assurer, non pas que vous m’avez abandonnée (ta bouche ni la mienne, cher Jenneval, ne prononceront jamais un mot si cruel) mais lui faire entendre que tu n’es point esclave de mes charmes, que je ne gouverne point tes volontés que rien ne te tyrannise. Surtout laisse lui dire tout ce qu’il voudra de ma personne. Que m’importent les discours de l’Univers. De toi seul dépend ma renommée... Mon bonheur. J’apprendrai à tout souffrir, dès que ton intérêt paraîtra l’exiger.
JENNEVAL.
Quoi, tu veux que je m’avilisse à feindre !
ROSALIE.
Voilà donc cette obéissance que tu m’avais promise ? Sais-tu à quoi tu m’as exposée ? À tout l’effet de son ressentiment il peut devenir terrible. Mon déshonneur va voler de bouche en bouche. Tu as entendu quel nom Bonnemer était sur le point de me donner ; attends encore et tu reverras ici ce même homme irrité...
JENNEVAL.
Si tu savais ce qu’il m’en coûte pour dissimuler !... Qui, moi ! dire une fois seulement que je ne t’aime pas avec idolâtrie, proférer ce mensonge dont mon cœur est si loin, c’est un moment affreux et je préférerais...
ROSALIE.
Sans doute, de me perdre pour toujours.
JENNEVAL, avec douleur.
Que dis-tu ?... J’obéirai...
ROSALIE.
Cours le rejoindre et tremble de le trouver rebelle à tes prières. Souvent un seul mot qu’on a hésité de prononcer, lorsqu’il le fallait, a causé des malheurs irréparables. Allez mon cher Jenneval, et ne tardez point à me rendre compte du succès... Apaisez Bonnemer, et revenez toujours plus digne d’être aimé.
JENNEVAL, dans un transport rapide.
Adorable Rosalie, tu possèdes toutes les vertus, tu oublies une offense, tu me rends un ami ; tu veux confirmer ma félicité. Ton âme héroïque et tendre me dictera tout ce que je dois lui dire, et soudain je revole à tes genoux pour m’enivrer des pures délices que ta voix et tes regards me font goûter.
Scène IX
ROSALIE, seule
Il fallait prévenir la tempête qui aurait pu s’élever... Que ce caractère ardent est difficile à manier ! Que de fois il m’échappe ! Comme sa vertu naïve vient à tout moment rompre mes projets... Mais je les ai conçus, il faut qu’ils s’accomplissent... Je ne subjuguerais pas un cœur amoureux !... Sa fortune ne demeurerait pas captive entre mes mains !... Plutôt mourir que d’en perdre l’espoir.
ACTE III
Scène première
ORPHISE, LUCILE
ORPHISE.
Ah ! Cousine, vous ne m’échapperez pas ! Je vous y prends... On se cache donc comme cela pour pleurer toute seule ?
LUCILE.
Moi !
ORPHISE, la contrefaisant avec tendresse.
Moi !... Mais non, ces yeux-là qui voudraient mentir ; qui, mouillés encore de larmes s’efforcent de dire, nous n’avons point pleurés.
LUCILE.
Oh pour cela... Mais ma cousine je n’aime pas non plus qu’on me suive de si près.
ORPHISE.
Eh ma chère enfant, rends-toi de bonne grâce... Je sais tout... Tu ne te souviens donc plus combien de fois tu m’as parlé de Jenneval ?
LUCILE.
Je ne vous en parlerai plus, je vous en assure...
ORPHISE.
Qu’en pleurant. Allons pauvre amie, mets-toi à ton aise. Un petit sourire pour moi ; cela ne se peut... Eh bien soulage ton cœur. Passes tes bras autour de mon col. Cache ta tête dans mon sein. Soupire, mon enfant, soupire. Répète-moi cent fois que tu es malheureuse. Mes larmes se mêleront aux tiennes. Je sais tout ce que tu souffres. Jenneval fait des fautes que mon cœur ne peut excuser.
LUCILE, en l’embrassant avec affection.
Ai-je tort de pleurer ? Il va perdre ses mœurs, ses vertus... Vous savez comme il paraissait honnête et s’il méritait la préférence sur tant d’autres que nous avons jugés ensemble... Vous-même, cousine, étiez prévenue en sa faveur... Nous trompait-il alors ?... Ah ! Croyons plutôt qu’il s’est laissé séduire, mais l’est-il pour jamais... Voilà ce qui déchire mon cœur... La crainte, la douleur, l’espoir s’y succèdent... Je n’ai jamais éprouvé une si violente agitation... Que de combats je me suis déjà livrés... Combien des pleurs j’ai déjà versés... Ah qu’il est cruel celui qui me les fait répandre... Et ce dernier événement. Cette indigne rivale... Je rougis de ma faiblesse.
Elle cache son visage dans le sein de son amie.
ORPHISE.
Je suis si pénétrée que je ne sais plus que te dire ; et cet oncle, ce cruel oncle, dis-moi, il arrive à point nommé pour faire feu. Qui l’a fait venir ? Qui a pu l’informer ?...
LUCILE.
Ce n’est assurément ni mon père, ni M. Bonnemer.
ORPHISE.
Que je souffrais pour toi ! Comme nous n’attendions que le moment de nous échapper de table. Quel homme terrible que ce M. Ducrône ! Il sort des forêts. Quel ton ! J’ai manqué vingt fois de m’emporter contre lui ; et ton père ! Ah, ma cousine, je ne sais pas comment je ne me suis point jetée à son col. Il plaidait pour le neveu et semblait deviner nos cœurs pour y nourrir l’espérance.
LUCILE.
Chère cousine, si vous saviez combien j’appréhende ses bontés ! À quel état je suis réduite ! Je crains mon père, moi qui n’avais fait jusqu’ici que l’aimer ; mais je suis donc coupable puisque je le crains... Tant que je crus Jenneval vertueux, le penchant que je me sentais pour lui ne pouvait m’être un sujet de reproche, mais aujourd’hui tout est contre moi... Et j’ose y penser encore et je n’ai point fait le désaveu de ma flamme dans les bras de l’auteur de mes jours... Je suis toute troublée ; je crois que d’aujourd’hui je n’aime plus rien. Les deux personnes que je chérissais le plus s’offrent à mes yeux sous un jour nouveau... L’aspect de mon père m’est redoutable, et Jenneval, l’ingrat Jenneval... Crois-tu bien qu’il m’aimât avant ce malheureux événement. Pour moi je pense que c’est une chose impossible.
ORPHISE.
Impossible de s’attacher à une autre personne après t’avoir connue, cela devrait être ma bonne et tendre amie. Jenneval avait conçu pour toi les sentiments les plus tendres. J’ai vu plusieurs fois ses yeux le trahir malgré lui en ta présence ; tout exprimait un amour retenu par cette crainte respectueuse qui nous donnait une idée avantageuse de ses mœurs ; mais il n’aura fallu qu’un malheureux moment pour égarer ce jeune homme dans une ville ou le vice triomphe et revêt extérieurement tous les charmes de la volupté ; comment...
LUCILE, l’interrompant.
Ne serait-il plus possible qu’il revînt à lui même. Quelques jours d’égarements causeraient-ils la perte de sa vie entière ? Jenneval pourrait-il chérir l’infamie ! Ah ! Cousine quand je l’ai vu rentrer ce matin avec cet air confus, humilié, tous mes sens ont tressailli. Pourquoi faut-il qu’il se soit encore échappé et plus coupable que jamais ?... Comme son ami est chagrin ! Quoi, l’amitié, ce dernier sentiment qui s’éteint dans une âme noble, l’amitié n’a pu toucher son cœur ! Je me flatte trop peut-être, mais si je lui eusse parlé, je serais plus tranquille. Je me rappelle un temps où il semblait prévoir jusqu’à mes moindres pensées ; mais plus je le vis me donner des preuves d’un attachement qui croissait de jour en jour, plus je me crus obligée d’en réprimer les marques trop visibles en affectant une froideur d’autant plus nécessaire que mon cœur en était loin. Peut-être se sera-t-il cru rebuté... cette erreur aura été la cause de sa perte... mais tu vois quel détour mon cœur prend pour se flatter. Cousine je m’égare. Aide moi à bannir pour jamais une pitié trop dangereuse, et qui peut-être n’est que l’interprète d’un sentiment qui ferait le malheur de ma vie si je ne m’empressais à l’étouffer.
ORPHISE.
J’entends son oncle avec ton père.
LUCILE.
Ah ! Je me souviens de mille choses que j’avais à te dire...
ORPHISE.
Je me sauve, je ne puis souffrir la sévérité de cet homme, et sa vertu me fait trembler.
Lucile reste.
Scène II
MONSIEUR DABELLE, MONSIEUR DUCRÔNE, LUCILE
MONSIEUR DUCRÔNE.
Monsieur vous voyez en moi un homme qui dans toutes les circonstances possibles a agi avec fermeté et qui dans une telle conjoncture sait par conséquent ce qui lui reste à faire.
Il tire sa montre.
Je n’ai point perdu de temps Dieu merci. Dans une heure et demie j’ai fait quatre grandes lieues. Vous me trompiez tous. Vous me cachiez ses déportements, vous attendiez sans doute pour m’en instruire que sa honte fût publiée sur les toits. Bien m’a pris d’avoir eu un surveillant fidèle et qui a su m’avertir à point nommé... Ah ! ah ! Monsieur mon neveu, vous me faites quitter la campagne, mais patience vous me payerez mes peines.
MONSIEUR DABELLE.
Le mal n’était point à son comble et d’ailleurs nous espérions le guérir. Chaque faute doit être appréciée d’après l’âge et le caractère. De grâce ne dérangez rien au plan que nous sommes convenus de tenir à son égard. Abandonnez-nous cette affaire ; cher oncle nous répondons du succès.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Je ne prends jamais conseil que de ma tête, Monsieur, et je n’ai jamais eu lieu de m’en repentir. Je suis son oncle et vous sentirez bientôt que je dois penser tout autrement que vous. Ce n’est pas votre neveu qui vous a volé ; c’est le mien, c’est mon sang qui s’est avili, dégradé ; ce sang jusqu’alors pur et sans tache dans toute notre famille. Et peut-être ici n’affecte-t-on tant d’indulgence que par une pitié assez déshonorante.
MONSIEUR DABELLE.
Vous ne rendez point justice aux vrais sentiments qui me font agir. Si je m’intéresse au sort de ce jeune homme croyez que je connais à fond son caractère et que j’ai mes raisons pour plaider en sa faveur. Il vaut mieux éclairer le coupable que de le punir. N’aggravons point ses fautes, lorsqu’il est encore facile de les réparer...
MONSIEUR DUCRÔNE.
Vous vous trompez très fort si vous le pensez. Tant de bontés ; tant de zèle m’étonne, mais ne m’entraîne pas. Chacun a ses principes. Les vôtres peuvent être fort bons envers
En regardant Lucile.
une fille dont le caractère est naturellement porté à la vertu. Je donnerais la moitié de mon bien pour avoir une enfant comme celle là. Mais je connais un peu comme il faut mener cette jeunesse extravagante, indisciplinable. Celui qui a osé une fois manquer au devoir que l’honneur lui imposait ne mérite plus aucun ménagement. Il faut presser sur lui tout le châtiment qu’il s’est attiré ; c’est des suites de sa faute que doit naître son repentir. Enfin je suis très éloigné de cette complaisance dont vous me parlez. Je ne connais qu’un chemin, monsieur ; celui de l’exacte probité. C’est un sentier dont un honnête-homme ne peut s’écarter sans mériter un nom infâme. Tout ce qui va de biais n’est plus sur la ligne droite, et pour peu qu’on se fourvoie... Tenez, ce sont de ces pas qui demeurent imprimés dans l’opprobre et qui ne s’effacent jamais.
LUCILE, à part.
Je n’y saurais plus tenir, mon cœur souffre trop.
Elle sort.
MONSIEUR DABELLE.
Vous ne croyez donc pas que plusieurs après s’être égarés sont rentrez dans le droit chemin et ont marché plus avant dans cette nouvelle carrière. J’honore votre façon de penser mais entre nous, je la crois trop austère. Il faut mesurer la chute d’après les dangers qui environnent la jeunesse. Elle est bien exposée dans ce siècle malheureux. Un cœur neuf et sensible se trouve séduit avant que de s’en douter. L’expérience de ses aïeux est en pure perte pour lui. Ce n’est pas la sévérité qui réussit, c’est l’indulgence ; et sous sa main douce et généreuse, tel homme qu’on croit abandonné, échauffe souvent en lui-même ses germes renaissants qui tout-à-coup font refleurir les vertus.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Oh ! Vous ne me persuaderez jamais que c’est un homme de vingt-deux ans qui se relève d’une pareille chute. Sa conduite a tous les caractères de la mauvaise foi et du libertinage. Si vous réfléchissez qu’il a commis cette sottise en faisant son droit, en se disposant à embrasser l’honorable profession d’Avocat... Je rougis de honte et de fureur... Ah ! Mon fils fut bien moins coupable, il commit une faute moins grave et je le punis bien plus sévèrement. Il s’échappa de la maison paternelle. J’appris qu’il était en garnison à cent lieues de moi. Savez vous ce que je fis. Je le laissai servir le roi. Il m’écrivait des lettres plaintives. Mon père je n’ai point mes aises, je manque de tout ; eh mon fils tu l’as voulu, tu y resteras, bonne école ! Je lui achetai néanmoins une sous-lieutenance ; l’année suivante son régiment fut taillé en pièces et lui tué ! Sa perte ne laissa pas que de m’affliger. Présentement qu’il est mort je puis dire que je l’aimais... Et tenez ce malheureux Jenneval ne sait pas que dans le fond de mon cœur... mais je me garderai bien de le lui laisser jamais paraître. Je ne voudrais pas pour tout au monde qu’il s’en doutât seulement. Rien n’est plus dangereux que cette molle indulgence dont vous me parlez, que cette faiblesse du sang...
Ici paraît Bonnemer conduisant Jenneval par la main.
Scène III
MONSIEUR DABELLE, MONSIEUR DUCRÔNE, JENNEVAL, BONNEMER
MONSIEUR DUCRÔNE, continue.
Mais assurément il est bien effronté ! Avoir l’audace de paraître en ma présence, de remettre encore ici le pied !... Que vient-il chercher ?
BONNEMER, allant à Ducrône et d’un ton suppliant.
Cher monsieur... Votre surveillant a été égaré par son zèle. Il a chargé Jenneval de trop noires couleurs. Il a annoncé la faute, mais il a tu le remord. Jenneval est repentant, Jenneval abjure le passé. Son front s’est couvert de cette rougeur salutaire, qui annonce un parfait retour à la vertu. Nous répondons tous de lui...
MONSIEUR DABELLE.
Cher Jenneval approchez, que je lise dans vos yeux cet heureux retour dont mon ami se félicite.
JENNEVAL, d’une voix basse qui prouve son embarras et sa confusion.
Monsieur, puissé-je me rendre digne de toutes vos bontés.
À part.
Quel supplice !
BONNEMER, à Jenneval.
Je te l’ai dit. Mets bas cette fausse honte ; tout est réparé, tu ne dois plus rougir. Un seul mot de ta bouche a désarmé. Tout le monde te connaît sincère.
Il l’embrasse. À Monsieur Ducrône.
Allons cher oncle le traité de paix est conclu et je le garantis.
Il fait signe à Jenneval de parler. Pendant tout ce temps l’oncle présente un front courroucé, et frappe le plancher de sa canne.
JENNEVAL, s’avançant.
Mon oncle, si j’osais espérer de vous autant d’indulgence, vous adouciriez les peines que je rencontre à chaque pas de ma vie. Consentez à me vouloir heureux. Dites une parole et je le serai. Ces amis généreux m’ont enhardi à paraître en votre présence ; mais un mot de votre bouche, un seul témoignage de bienveillance va me rendre à moi-même.
MONSIEUR DUCRÔNE, d’un ton ferme.
Monsieur voulez-vous bien entendre quelles sont mes volontés ?
JENNEVAL, avec respect.
Mon oncle !
MONSIEUR DUCRÔNE.
Elles seront irrévocables, je vous en avertis. Je devine que ce prompt retour est l’ouvrage de la nécessité ; mais ce n’est point moi qui se laisse endormir. J’exige d’abord que l’on m’informe et dans le plus grand détail de l’emploi qu’on a fait de cet argent volé. Je veux savoir ensuite quelle est cette fille depuis quand, où, et comment vous l’avez connue ?
BONNEMER, l’interrompant.
Eh cher Ducrône, tirons le rideau là-dessus. Il a avoué s’être laissé séduire. La séduction a donc perdu tout son effet. Que demandez-vous de plus ?
MONSIEUR DABELLE.
Monsieur, soyons généreux. Son cœur se rend à nous. Accordons-lui les honneurs de la guerre. Jenneval jetez-vous au col de votre oncle et que tout soit oublié.
Jenneval s’avance pour embrasser son oncle.
MONSIEUR DUCRÔNE, reculant.
Non, messieurs, non... Je vous suis fort obligé, ne me pressez plus comme cela, je vous en prie. Je vous l’ai déjà dit, on ne me gagne point par de fausses caresses. Vous ne le connaissez pas comme moi. Voyez cette modestie contrefaite et cet air de douceur hypocrite ; elle n’est occasionnée en ce moment que par l’intérêt qui l’assujettit à moi...
JENNEVAL, d’un ton étouffé.
Moi ! hypocrite, monsieur !...
À part.
Puis-je encore dissimuler !
MONSIEUR DUCRÔNE.
Je veux de meilleures preuves d’un vrai repentir. Le seul moyen de me faire connaître que c’est plutôt à mon cœur qu’à ma bourse qu’on en veut, c’est de fléchir à l’instant même sous mes ordres. Oh ! je ne suis point dupe d’une grimace passagère. Avant que de me convaincre il faut par plusieurs années d’une conduite irréprochable, effacer les taches de celle-ci. D’abord cette somme dérobée que je vais restituer sera prise sur ta pension, et par conséquent les quartiers, à commencer d’aujourd’hui, seront retranchés en parties égales jusqu’à entière satisfaction. Il est bon de te faire sentir ce que vaut la perte d’un argent aussi follement prodigué. J’en ai assez fait pour vous, monsieur. Il est temps que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Nous verrons ce que vous saurez faire. L’oisiveté a été le piège de ta jeunesse, et le travail deviendra un sûr préservatif. Or donc, voici les conditions auxquelles je puis encore pardonner. Choisis de les mettre à exécution ou à ne me revoir jamais. J’entends que tu partes dès demain pour la Province, en telle ville et telle maison que je t’indiquerai, afin d’y achever ce droit qui, dans ce maudit Paris traîne tant en longueur. Je prétends que tu t’éloignes de cette funeste Capitale, où tu achèverais de perdre tes mœurs, et cela sans y entretenir aucune correspondance directe ni indirecte. Paris est plein de ces filles qui révoltent la jeunesse contre leurs parents ; mais je n’aurai point amassé mon bien pour servir de proie à la débauche. Ta brillante Déesse, ta Rosalie, ce soir même je la fais enfermer. Ma plainte est déjà portée, et le sage magistrat qui veille autant à la conservation des bonnes mœurs qu’à la sûreté des citoyens, saura la placer en lieu sûr. Elle sera ma foi claquemurée pour le reste de ses jours.
JENNEVAL, élevant la voix.
Et de quel droit, Monsieur, la persécutez-vous ? Comment osez-vous attenter à la liberté d’une personne que vous ne connaissez pas. Surprendre un tel ordre à l’aide d’une basse calomnie c’est commettre une lâcheté d’autant plus cruelle, qu’on la colore d’un air de justice. Gardez-vous d’aller plus loin, car j’ose ici vous assurer...
MONSIEUR DUCRÔNE.
Ah ! tu fais le Don Quichotte. Va, va, tu me remercieras un jour quand le tems de tes folles amours sera passé. Tu donnerais alors la moitié de ta vie pour racheter la première. Crois-moi, abandonne-la à sa bassesse ; laisses-la retomber dans la misère d’où ton imbécillité l’a fait sortir... Une vile créature...
JENNEVAL.
Si elle était aussi vile que vous le prétendez ; votre injustice, votre dureté, la confirmeraient dans le désespoir du vice ; car vous lui donneriez l’affreux droit de haïr, vous, et tous les hommes... Mais moi, je ne serai point assez lâche.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Quoi, tu pousses l’extravagance... J’y mangerai la moitié de mon bien, vois-tu, et de ce pas... elle sera enfermée, te dis-je, et si étroitement...
JENNEVAL, éclatant avec fureur.
Je la défendrai contre tous... fut-ce contre vous même... Il y va de ma vie... Si vous troublez son repos, barbare vous m’en répondrez.
MONSIEUR DUCRÔNE, levant sa canne et arrêté par Bonnemer.
Insolent !
MONSIEUR DABELLE.
Jenneval, serait-il possible !... Je suis aussi surpris qu’affligé.
BONNEMER.
Est-ce là ce que tu m’avais promis ?... Pour l’amour de moi...
JENNEVAL, avec véhémence.
Abandonnez-moi tous, mais du moins ne me tourmentez plus.
En s’attendrissant.
Pardonnez ! ah ! si mon âme vous était développée toute entière. Non, je ne puis plus dissimuler. Forcé de feindre un instant, mon rôle était trop dangereux, et j’ai manqué en effet d’y succomber. Voyez-moi donc tel que je suis. J’aime, et c’est à celle qu’on outrage, à celle dont on révoque en doute les vertus connues de moi seul, que je dois la modération dont j’ai usée jusqu’ici. Ma raison justifie tout l’excès de ma tendresse. Je remplirai les engagements chers et sacrés avoués de mon cœur. Que ne puis je, dès ce moment même, pour effacer des soupçons injurieux, la conduire aux pieds des Autels. Là, on verrait combien je la respecte. Elle est pauvre dira-t-on, eh oui ; tel est le gage de ses vertus. Quoi, l’indigence sera regardée du même œil que le crime. Et parce qu’une fille ne vivra point dans l’opulence, elle cessera d’être honnête ! misérables préjugés, c’est moi qui le premier vous braverai.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Si elle était vertueuse, si l’honneur parlait à son âme, si elle t’aimait, enfin, elle te ramènerait à des sentiments délicats, elle ne t’aurait point exposé au repentir, au danger, à l’affront qu’entraîne une friponnerie flétrissante ; n’a-t-elle pas partagé les fruits de ta bassesse... Va, je saurai te réduire. Je te ferai connaître comme on fait rentrer un jeune libertin dans le devoir. Tu n’es pas encore où tu crois en être. Suis ton beau chemin ; je te suivrai à mon tour, non par amour pour toi, mais par respect pour la mémoire de ton père. J’empêcherai bien que conduit par une femme débauchée, tu ne fasses un jour publiquement le déshonneur de ta famille.
JENNEVAL.
Ah ! si je me suis rendu coupable d’une bassesse que vous me reprochez tant de fois et avec tant d’amertume, sachez que je ne suis pas seul criminel. Je vous ai pardonné la situation extrême où vous m’avez réduit, pardonnez-moi du moins une faute dont vous êtes la première cause.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Moi !
JENNEVAL.
Oui, vous... La loi vous a nommé dépositaire de mon bien ; mais avez-vous rempli son esprit et son intention ? Vous en avez agi avec moi avec une rigueur inflexible. Vous m’avez refusé non pas cet absolu nécessaire, qui aurait élevé contre vous d’éternelles clameurs, mais vous m’avez ôté les moyens de satisfaire à ces autres besoins, enfants de l’honneur, non moins pressants et plus chers à une âme noble. C’étaient-là des dépenses indispensables dans un monde où par état je devais me présenter honorablement. Mais vous n’avez jamais voulu concevoir cet esprit du siècle qui maitrise nos volontés. Que de fois ce cœur fier a été humilié ! Si vous m’eussiez accordé ce que j’avais droit d’attendre et même d’exiger, je ne serais pas aujourd’hui diffamé. Le dernier artisan, concentré dans le cercle obscur où le sort l’avait placé, était cent fois plus heureux que moi, obligé de paraître et forcé de me cacher.
MONSIEUR DUCRÔNE.
J’ai donné tout ce qu’il faut donner. Si le siècle extravague je ne suis point fait pour obéir à ses caprices. L’esprit de la loi est-il qu’un tuteur favorise les débauches de son pupille. L’or serait devenu dans tes mains un poison dangereux. D’ailleurs ton compte est en règle. Au jour de ta majorité on te le présentera et en bonne forme. Si tu n’es point content, attaque moi en justice ; ma réponse est toute prête.
JENNEVAL.
Non... Je n’attendrai pas des tribunaux ce que votre cœur me refuse. Si vous ne savez pas vous juger vous-même, ce n’est point à moi à rougir.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Oublies-tu à qui tu parles ?
JENNEVAL.
Je m’en souviendrais si vous n’étiez pas inhumain. Un oncle qui aime son neveu le plaint s’il s’égare et ne l’insulte pas.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Puis-je t’insulter, toi, qui ne mérites plus que le mépris...
BONNEMER, s’avançant l’œil humide de larmes.
Cher Ducrône, c’est assez... eh modérez-vous au nom de l’amitié.
Pendant ce temps M. Dabelle se tait et soupire.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Que je me modère ! Ah le Ciel m’est témoin que ce n’est point le courroux qui m’agite. C’est son propre intérêt que je cherche plutôt que le mien... Messieurs, dans tout ce qui sera honnête, juste, raisonnable, il me verra toujours prêt à le seconder, et quoiqu’il en dise, à prévenir même ses désirs ; mais aussi qu’il voie en moi, s’il résiste au devoir, une fermeté que rien ne pourra vaincre... Nous verrons ; si demain, à l’heure où je vous parle, il n’est pas à vingt lieues d’ici ; je fais serment...
JENNEVAL, avec fierté.
Épargnez-vous d’inutiles menaces. Je ne recevrai plus de lois que de ce cœur qu’on voudrait anéantir et qui se sent assez grand pour prendre une juste confiance en lui-même. Je serai libre, indépendant, maître de disposer de ma personne. Pourquoi vous inquiéter si fort à tourmenter ma vie ? Si vous renoncez à me faire du bien, du moins ne me rendez pas plus malheureux. Seriez-vous plus jaloux de votre autorité que de mon bonheur ?
MONSIEUR DUCRÔNE.
Je le voulais, ingrat, ce bonheur que tu rejettes ; mais tu braves une bonté qui tient trop de faiblesse. Tu m’as trop manqué pour que je te pardonne jamais. Si tu m’avais obéi j’aurais pu oublier encore le passé, mais tout est dit... Vois jusqu’où allaient mes bontés pour toi. J’avais mis en réserve une somme de cent mille livres pour t’acheter une charge, dès que ton droit serait achevé ; mais Dieu m’en garde. Cet argent est à moi, et je saurai en jouir. Voici une nouvelle création de rentes viagères qui vient fort à propos pour te punir et doubler mon revenu. Eh je m’en priverais, pour qui, s’il vous plaît ? Pour un libertin, avide, intéressé, pour un neveu ingrat, dénaturé, dont les vœux secrets me poussent dans le cercueil et qui n’attend que l’instant de ma mort pour venir avec son abominable créature rire et danser sur ma tombe !
JENNEVAL.
Ces vils sentiments que vous me prêtez, vous seul avez pu les concevoir. Gardez votre bien et faites-en l’usage qu’il vous plaira. Je ne demande point qu’on soit généreux à mon égard, je désirerais seulement qu’on fût juste.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Je le serai enfin en te déshéritant... Tu as trop mérité mon indignation.
MONSIEUR DABELLE, à Ducrône, d’un ton noble et pathétique.
Ah cher Oncle, n’écoutez pas ce premier instant de chaleur. Il vous laissera reprendre les mêmes sentiments qui vous ont toujours animé. Je suis père, je connais le plaisir d’avoir un bien-être pour l’assurer en paix à ses descendants. Cependant croyez que si je n’avais pas ma fille et que j’eusse plusieurs héritiers, jamais je ne trouverais de prétextes pour en priver aucun de son droit de succession. Ce droit est inaliénable et sacré ; car, ce n’est point en les privant de notre héritage, que nous les rendrons plus honnêtes gens. Toute action qui n’a pas un but utile est bien prête d’être blâmable. Si l’état autorise la rupture des liens les plus étroits, laissons les cœurs insensibles céder à cette amorce fatale. Le vrai citoyen n’est pas un être solitaire. Gardons-nous surtout de réserver pour ce moment où nous paraîtrons devant l’Être suprême tout ce qui pourrait ressembler à la haine ou à la vengeance... De grâce laissez-moi être médiateur en cette affaire. Concluons un nouveau traité. Relâchez un peu de cette sévérité extrême... Jenneval est sensible, ce caractère précieux doit être ménagé.
MONSIEUR DUCRÔNE, en ôtant son chapeau.
Encore un coup, Monsieur, ce n’est point votre neveu. Je ne consulte jamais que moi, et je sais très bien ce que je fais. Permettez donc que je ne change rien à mes premières dispositions ; ce serait avoir une tendresse ridicule que de la conserver à un neveu rebelle qui fait ma honte et ma douleur... Cependant pour me disculper de toute animosité ; je veux bien lui laisser encore le choix. Soyez donc ici témoins de mes dernières bontés.
À Jenneval.
Allons, résous-toi à partir sur le champ, ou si tu balances, tiens... Prends-garde... Tu t’assures de mon inimitié éternelle.
JENNEVAL, d’un ton tranquille.
Faites tomber les traits de votre vengeance sur l’objet infortuné à qui j’ai attaché le bonheur de ma vie, vous le pouvez, monsieur ; mais il m’est impossible de me séparer d’elle... Je vous en dirais davantage, mais vous me traitez trop despotiquement pour une confidence que je refuserais peut-être à un ami. Laissez-moi à moi-même, à la malheureuse destinée qui m’attend ; assez de tourments me sont réservés.
En regardant Monsieur Dabelle avec douleur et tendresse.
Si j’avais pu me rendre, je me serais déjà rendu.
MONSIEUR DUCRÔNE, avec colère.
Tu me résistes, eh bien, il n’y a plus de retour ; j’en jure par l’honneur que tu as trahi. Je rougis d’avoir eu tant d’indulgence pour toi. Je t’avais mal connu et je me repens même d’avoir veillé si tendrement sur tes premières années. Il vaudrait mieux pour toi que tu fusses mort au berceau. Si ton père vivait tu le ferais expirer de chagrin. Va, je vois d’un œil sec tes déportements ; j’étais trop bon de m’échauffer pour tes intérêts. Péris puisque tu veux périr. Avance dans la carrière du libertinage et du vice. Tu en recueilleras les tristes fruits. Tous les maux qu’ils enfantent réunis bientôt sur ta tête, vengeront mon autorité outragée et mes leçons mises en oubli... Je te défends de me nommer jamais ton parent. Pour moi... Je n’ai plus de neveu.
Il sort.
JENNEVAL, avec vivacité.
Et moi je n’ai jamais eu d’oncle.
Scène IV
MONSIEUR DABELLE, JENNEVAL, BONNEMER
MONSIEUR DABELLE.
Abjurez ces dernières paroles, jeune-homme infortuné. Il vous restera, croyez-moi. Tout inexorable qu’il est, vous devez le respecter. Sa rigueur tient à son caractère. C’est l’emportement de la vertu, et peut-être même celui de la tendresse. S’il vous aimait moins, il n’aurait pas poussé les choses à l’extrême.
JENNEVAL.
Monsieur, je connais votre âme... Je vous aime... Je vous respecte... Je donnerais mon sang pour vous ; si j’avais pu me modérer, je l’eusse fait ; ce que je dois à vos soins... Plaignez-moi ; ne condamnez point un penchant invincible... Ah ! Il fut un temps... N’en parlons plus. Si quelqu’un avait pu m’aider à vaincre, c’était vous sans doute...
MONSIEUR DABELLE, en le serrant dans ses bras.
Calmez-vous...
Montrant Bonnemer.
Remettez-vous entre les bras de cet ami... Ouvrez-lui votre cœur. Est-il quelque blessure que l’amitié n’adoucisse ! Je vous plains, mais du moins que l’orage des passions ne vous fasse point oublier les devoirs les plus sacrés. Ils doivent l’emporter dans une âme bien née et l’emporter sur tout.
Il sort. Jenneval demeure immobile et pensif.
Scène V
JENNEVAL, BONNEMER
BONNEMER.
Ah ! si tu pouvais renoncer à cette funeste passion ! Si tu voulais combattre pour l’amour de nous. Si par un sacrifice héroïque et généreux... C’est là être homme que de remporter la victoire... Je t’afflige, pardonne...
JENNEVAL.
Cher Bonnemer, je mérite la pitié des âmes sensibles et indulgentes, la compassion que l’on a pour les malheureux.
BONNEMER.
Et les insensés !
JENNEVAL.
Eh ! j’en suis plus à plaindre. L’indulgence alors devient justice. Laisse-moi, je crains plus de céder à tes larmes que je n’ai de douleur d’y résister. On menace la liberté de Rosalie ; je vole... Que de coups réunis sur ce cœur sensible ! Et que je me sens oppressé !... Ciel, voici le dernier, Lucile !...
Scène VI
LUCILE, JENNEVAL, BONNEMER
LUCILE, avec une vérité noble.
Non, Monsieur, vous ne sortirez point. Souffrez que je vous représente ce que l’amitié me dicte en ce moment. Quoi ! vous en coûterait-il donc tant pour vous soumettre à un oncle que vous devez connaître dès votre enfance. Ne pouvez-vous céder à mon père, à votre ami... Moi-même je me trouve forcée de me joindre à eux... Je viens de le rencontrer. Je lui ai dit tout ce que mon cœur à pu m’inspirer. Je l’ai vu ébranlé : peut-être serait-il encore temps de le fléchir... Vous ne répondez rien... M’envieriez-vous la part que je prends à vos douleurs ?...
JENNEVAL.
Mademoiselle, il ne manquait aux tourments que j’endure que de vous y voir sensible. Quoi ! Vous daignez vous intéresser aux destins d’un homme qui ne mérite plus vos regards. Je suis trop indigne de votre pitié. Je suis... Désespéré, emportant dans mon cœur le repentir de n’oser lever les yeux devant vous ; permettez que je cache ma honte, ma douleur... et mes regrets.
BONNEMER, courant après Jenneval.
Jenneval !
JENNEVAL, dans le fond du théâtre.
Eh que veux-tu encore de moi, lorsque j’ai pu forcer mon âme jusqu’à lui résister ?
Scène VII
LUCILE, BONNEMER
LUCILE, avec feu.
Ne l’abandonnez point. Sa raison est troublée. Suivez ses pas. Ramenez-le malgré lui. Il faut pour le sauver, mettre tout en usage. Je ne puis voir qu’un jeune homme qui semblait né pour le bien ; qui, le jour d’hier, jouissait encore de l’estime générale, soit sur le point de perdre et ses mœurs et cette même estime qui lui assurait la mienne... Si... Je ne puis achever.
BONNEMER.
Ah ! si mon zèle avait besoin d’être excité, votre généreuse pitié m’enflammerait d’un feu nouveau. Je ne le quitterai point, et dut ma présence le fatiguer, il entendra toujours la voix attendrissante et sévère de son ami.
Scène VIII
LUCILE, seule
Il se perd d’amour pour une autre, et je peux encore y être sensible ! Trop cher Jenneval ! si du moins les peines qui me consument pouvaient te rendre le repos ; mais non, ta vie est aussi agitée que la mienne.
ACTE IV
Le théâtre représente une chambre où il n’y a que les quatre murailles, et quelques chaises. Un homme apporte un coffre et le dépose. Rosalie arrive précipitamment et en désordre. La nuit commence et ce triste séjour n’est éclairé que d’une lumière sombre.
Scène première
ROSALIE, JUSTINE
ROSALIE.
Quoi toujours poursuivie par la fureur des hommes !
Regardant le coffre.
Voilà donc tout ce que l’on a pu sauver ! Ô vengeance ! Donnons quelque essor à ce feu terrible qui fermente dans mon sein... Un instant plus tard où serais-je ? Dans une horrible prison... Je vous reconnais lâches persécuteurs ; vous écrasez le faible sans pitié, vous êtes aussi cruels que vous pouvez l’être, mais vous n’y aurez rien gagné ; votre despotisme aura pour vous des suites funestes. Je surpasserai vos fureurs... Tremblez !
À Justine.
Penses-tu que nous soyons en sûreté dans ce misérable lieu, car il semble depuis un temps que les murs soient devenus transparents. Un bras infatigable conduit de tout côté une armée d’argus, et il n’y a plus d’asile contre cet œil vigilant et terrible.
JUSTINE.
Soyez sans crainte... Dès que nous sommes cachées ici Brigard répond...
ROSALIE, avec une fureur impatiente.
Va-t-il venir ?
JUSTINE.
Il ne doit pas tarder. Il nous a averties à temps et sans ses soins...
ROSALIE.
Ah sur qui doit retomber tout le poids des tourments que j’endure !... Je me sens là un besoin de vengeance : hâte-toi, moment qui dois le satisfaire... Le Ciel est de fer pour moi, les hommes sont acharnés à ma ruine... Eh bien tyrans de mon existence, avez-vous quelques fléaux en réserve, lancez tous vos traits je brave votre double colère. Je pousserai jusqu’au bout ma destinée ; favorable ou terrible, il est tems qu’elle se décide.
JUSTINE.
Tout n’est pas désespéré...
ROSALIE.
Je ne veux rien entendre te dis-je...
À voix basse tandis que Justine est dans le fond.
L’abîme m’environne ; j’y tombe ou j’y précipite mon ennemi. Je l’épargnais, ma cruauté devient justice. Balançons le pouvoir de l’homme injuste. Ô nuit, épaissis tes voiles ! Ô vengeance active et ténébreuse, toi qui veilles et qui frappes dans l’ombre, cache ton poignard jusqu’au moment où je l’aie appuyé sur le cœur de ma victime ; qu’elle tombe, et que mon destin l’emporte...
À Justine.
Va voir si quelqu’un paraît.
Scène II
ROSALIE, seule
Me faudrait-il abandonner cette capitale le seul endroit sur la terre où je puisse marcher tête levée et rencontrer le bonheur que tant d’autres possèdent ? Ah ! Si je ne trouve aucune ressource ici, il n’en est plus pour moi dans l’Univers... détestable vieillard c’est toi qui est venu rompre le plan heureux que j’avais formé ; je peux t’anéantir, mais je n’ai rien fait si ton neveu n’est le premier complice. Jenneval me reste et mon âme entière n’a point passé dans la sienne, et je ne lui ai pas inspiré ma rage ! Qu’est devenu mon génie ? Mais sa vertu... Sa vertu doit céder à mon ascendant... Il est faible... Il a commencé par le vol, il finira par le meurtre... Son âme est dans mes mains... Enivrons le d’amour, qu’il en soit furieux, qu’égaré par mes séductions il vole à ma voix percer le sein que j’abhorre et que tout sanglant il se rejette dans les bras qui doivent apaiser le cri de ses remords.
Scène III
ROSALIE, BRIGARD
ROSALIE.
Où est Jenneval ? L’as-tu trouvé ? Viendra-t-il ?
BRIGARD.
Oui ; j’ai fait davantage ; j’ai observé tous ses pas. J’ai espionné ensuite l’oncle (c’est mon ancien métier.) il va secrètement souper au marais chez un homme qui fait ses affaires, et qui s’est chargé de lui trouver à placer son argent à fond perdu, mais le plus avantageusement possible : d’ailleurs ce vieillard qui ne ménage rien contre nous a été imprudent. Il a blessé le cœur de son neveu. Je l’ai rencontré dans la première chaleur de son ressentiment ; il était furieux, il m’a tout confié. Je lui ai dit que je préviendrais les coups que cette tête opiniâtre voulait nous porter, que je te mettrais à couvert de ses poursuites ; il m’a appelé son protecteur, son ami. Tu dieu ! Placer son bien à fonds perdu ! Si cette succession ne tombe à son neveu, adieu nos espérances, mais j’ai cette affaire trop à cœur pour l’abandonner. Avec sa petite épée d’argent massif qu’il porte à la vieille mode, il a tout l’air d’un de ces tapageurs du temps passé. Ô si je lui suscitais une querelle d’allemand. Il est vif, colère ; il tirerait l’épée, et moi,
Il pousse une botte.
Et moi, jadis prévôt de salle, je ne tarderais pas à le coucher sur le carreau. Qu’il serait bien là ! C’est un insecte qui veut mordre et qu’il faut écraser.
ROSALIE.
Cours et m’amène Jenneval ; il faut que je sois sûre de lui, tu m’entends. S’il se livre à moi, comme je n’en doute point... Frappe... Ses coups suivront les tiens ? Il est furieux, dis-tu... Sois attentif à tous ses mouvements, aux miens... Lorsque nous serons ensemble, entre à propos, sors de même... Tu interpréteras mon geste et jusqu’à mon silence... Mais après songe à tout et mets à profit les instants ; que la prudence s’unisse à l’audace...
BRIGARD.
À qui dis-tu cela ? Je dérouterai tous les limiers de la police ; je connais toute leur allure. J’ai quatre recoins ténébreux dans cette grande ville où je défie... Puis un homme mort ne parle point... C’est un fait... Rosalie, avec intrépidité. Tu perds le temps en parole. Je devrais à cette heure même recevoir la nouvelle de son trépas... L’attente me consume et je ne vis plus...
Scène IV
ROSALIE, BRIGARD, JUSTINE
JUSTINE, accourant.
Mademoiselle, Jenneval monte...
ROSALIE, à Brigard.
Ne perds pas un seul de mes regards...
Brigard fait un signe d’approbation et sort. Rosalie se jette sur une chaise le mouchoir sur les yeux, un bras en l’air et paraît plongée dans le plus grand désespoir.
Scène V
JENNEVAL, ROSALIE
JENNEVAL, apercevant Rosalie en pleurs.
Ô Ciel ! Voilà donc les tourments que je te cause ! À toi !... Ah je mourrai de ta douleur, si ce n’est de la mienne... Adorable Rosalie, pardonne. Ne me vois pas en coupable. J’ai souffert plus que toi... Rassure mon cœur déchiré... Dis que tu ne rejettes pas sur moi l’indigne traitement où mon malheureux sort t’a exposée ; dis que rien ne peut altérer ton amour, cet amour précieux qui fait aujourd’hui mon unique espoir... Non, ce n’est qu’à tes genoux que je rencontre encore quelque ombre de bonheur.
ROSALIE.
Il n’en est plus pour moi, Jenneval ; l’indigence n’est rien, mais l’infamie dont on a voulu me couvrir, le mépris... L’éclat scandaleux des insultes qu’on m’a faites m’humilie et me déchire le cœur... Heureuse avant que de vous connaître, je regarde le premier jour où je vous ai vu comme la funeste époque du malheur de ma vie... Que venez-vous chercher encore ici ?... Il faut nous séparer... Laissez moi à mon sort... Tout horrible qu’il est, je crains que vous ne l’aggraviez encore... Ne nous revoyons jamais ; je n’ai rien à vous dire de plus.
JENNEVAL.
Jamais ! Quel mot ! L’as tu pu prononcer ?
ROSALIE.
Oui, je vais fuir loin de vous. Mes yeux noyés dans les pleurs ne vous verront plus que quelques instants. Je voudrais dompter ces indignes larmes... Puissiez-vous m’oublier !
JENNEVAL.
Non chère et tendre amie. Non, je n’écoute point l’injuste accent de votre douleur. Vous n’achèverez point de me désespérer. C’est de vous seule que mon cœur se promet quelque soulagement. C’est à vous qu’il vient s’abandonner tout entier. Ne me présentez point l’image de vos maux, ils sont gravés dans mon âme en traits ineffaçables ; mais lorsqu’un même coup nous frappe tous deux, ne songerons-nous qu’à nous affliger au lieu de nous secourir mutuellement... Je suis la première cause du malheur qui t’opprime, mais quand mon cœur l’avoue, le tien, chère Rosalie, qui doit compatir à mes maux, le tien, ne plaide-t-il point en ma faveur contre moi-même ? Tout ce que tu endures est présent à mon âme, mais ce que je souffre tu l’ignores... Non tu ne le sauras jamais.
ROSALIE, en sanglotant.
Qu’ai je fait à cet homme barbare pour me poursuivre ? De quel droit attente-t-il à ma liberté et à mon repos ? Que d’outrages il m’a fait ! Il m’a traitée comme la plus vile créature ; et Jenneval, vous savez si je méritais cet affreux traitement... C’en est fait, ne me revoyez plus ; n’exigez plus que je vous revoie. L’état horrible où il m’a réduite ne me laisse d’autres ressources qu’une mort prompte.
JENNEVAL.
Que me dis-tu ? Toi mourir, toi !... Au nom de ma tendresse ne te laisse point accabler... Calme-toi. Je n’ai jamais senti tant d’amour et de fureur.
ROSALIE.
Je te l’avoue, j’aurai plutôt le courage de mourir que celui de languir dans l’opprobre. L’opprobre est un poison lent qui tue une âme sensible, et la mienne l’est mille fois plus que tu ne l’imagines. Quelle amertume répandue sur tes jours et sur les miens ! Ah ! Si je ne puis relever, résous-toi à me perdre. J’y suis décidée. Si tu ne m’aimais pas, je ne vivrais déjà plus.
JENNEVAL, en se frappant les mains.
Malheureux que je suis ! Ah Rosalie, au nom de l’amour sauve-moi du désespoir. Quoi, j’entendais mon cœur me crier, c’est toi qui est son assassin ! Elle meurt pour t’avoir aimé. C’est ta main qui la pousses au tombeau. Ah périsse plutôt tout ce qui n’est pas toi...
ROSALIE.
Il n’y a qu’un seul homme acharné à nous perdre ; et je n’ai point trouvé un défenseur qui soutînt ma cause avec la même fermeté que celui-ci met dans sa persécution.
JENNEVAL.
Tu n’es pas la seule victime de sa fureur. Il m’a maudit, déshérité ; va ; j’ai rompu tous les nœuds qui m’attachaient à lui... J’aurais dû peut-être... Mais cet homme est mon oncle.
ROSALIE.
Dis plutôt ton bourreau. C’est lui qui a toujours empoisonné ta vie d’un fiel amer. Vois quelle est sa violence. Combien elle est terrible, inexorable. Tu m’aimes, c’est assez, je deviens l’objet de sa haine. Il me calomnie, il soulève contre moi une force aveugle et je serai sacrifiée, car l’innocente faiblesse l’est toujours ; mais mon cœur saignera encore plus de tes blessures que des miennes. Sous un tel tyran, cher Jenneval, quel avenir t’est réservé !
JENNEVAL.
Mon destin est horrible, mais il ne doit pas toujours durer.
ROSALIE.
Tant qu’il vivra, n’en attendez point un autre.
JENNEVAL.
J’implorerai le secours des lois pour disposer à mon gré de ma liberté et de ma fortune. Je ne parle point de te défendre, de t’arracher à tes vils persécuteurs. De pareils serments offenseraient l’amour et toi. Je serai libre, te dis-je, et malgré tous ceux qui pourraient s’y opposer.
ROSALIE.
Cher Jenneval, quand on a recours aux lois, ces simulacres insensibles, l’issue est bien douteuse, et par quel labyrinthe long, difficultueux, pénible, te faudra-t-il passer ? On t’a ravi ton bien : est-ce dans le dessein de te le restituer ? On t’aura ôté jusqu’aux moyens de produire tes premières demandes. Est-ce un vain tribunal qui donnera quelque force à tes faibles droits ?
JENNEVAL, après un moment de silence.
À quoi m’a-t-il réduit cet homme inflexible ? J’aurais pu l’aimer malgré ses rigueurs et je sens trop combien ma haine de moment en moment s’allume contre lui. Me préserve le Ciel de hâter son trépas par mes vœux ; mais si la mort descendait sur sa tête... Il fut injuste, il fut dur et barbare, je porte un cœur vrai, je ne sais point feindre ; s’il mourait, non, je ne répandrais point de larmes sur sa tombe.
En s’attendrissant.
Cependant autrefois j’ai vu des moments où j’aurais donné tout mon sang pour lui !
ROSALIE.
S’il n’était plus, dis Jenneval, quel changement de fortune !
Scène VI
ROSALIE, JENNEVAL, BRIGARD
BRIGARD, dans le fond du théâtre, à part.
Allons, il est temps ; jouons notre rôle.
Haut.
Votre très humble Monsieur Jenneval. Toujours prêt à vous servir, entendez-vous. Disposez de moi ; vous le savez, je suis tout à vous.
JENNEVAL, avec exclamation.
Ah ! voilà celui à qui je dois plus que je ne puis exprimer. Sans lui, sans ses avis, sans ses soins généreux, chère Rosalie, je ne jouirais pas en ce moment du bonheur de te revoir... À qui demander, où te trouver ?...
ROSALIE.
Il a fait plus, il m’a indiqué cet asile secret et caché. Il a opposé ce rempart à l’ardente fureur de nos ennemis. Sans lui je gémirais dans la profondeur des cachots, en proie au désespoir, mourante... Tu lui dois tout.
BRIGARD, en regardant derrière lui.
Ah, le péril n’est point encore passé.
JENNEVAL, troublé.
Comment ?
BRIGARD.
Ah, Monsieur, on en agit bien indignement envers vous, je suis accouru pour vous prévenir. Tout nous menace ; ce vieil oncle qui veut vous enlever Rosalie pour jamais, a obtenu de nouveaux ordres. Des espions sont répandus de tous côtés, et je tremble pour demain.
JENNEVAL, saisissant Rosalie par le bras et la main sur son épée.
Ah, le premier qui osera contre elle... quel que soit le nombre, ce fer... Ou du moins j’expirerai en embrassant tes genoux !
ROSALIE.
Je ne doute point de ton courage ; mais vois combien il serait inutile. Nos malheurs pourraient s’étendre plus loin encore. Est-ce là le seul parti que l’amour te dicte pour sauver une infortunée que tu as exposée au plus cruel affront ? Toi seul connais mon innocence, mais les autres séduits ou trompés, me traiteront avec ignominie. Le déshonneur et la mort seront le prix de ma fidélité.
JENNEVAL.
Quelle affreuse idée ! comme elle bouleverse mon âme ! Je vois couler tes pleurs. Ah tu m’épargnes encore, tu ne me parles pas de cette indigence qui te presse et t’environne. Ce barbare qui se dit mon oncle m’a ôté l’espoir de te présenter la moitié de ma fortune. Ciel ! Inspire-moi ce que je dois tenter...
ROSALIE, en s’asseyant et se couvrant les yeux d’un mouchoir.
Ah, pense pour moi, car le trouble qui m’agite m’ôte la faculté de penser.
Jenneval se promène à grands pas.
BRIGARD, sur le devant de la scène, et comme dans un monologue.
Maudit vieillard ! si tu pouvais nous faire la grâce de décéder subitement, nous te pardonnerions tout le reste... Le sang me bout dans les veines. Il jouit de vos biens tandis qu’il vous brave et qu’il vous insulte. C’est une chose inouïe que cette injustice-là... S’il se rencontrait ce soir devant moi, je crois que l’indignation m’emporterait...
Ici Jenneval le regarde. En adoucissant sa voix.
Vous ne savez pas tout, monsieur ; ce vieillard importun qui ne respire que pour votre ruine, à cette heure même fait dresser un contrat de rente viagère, où il comprend tous ses biens, afin de vous ravir un héritage qui vous est si légitimement dû...
JENNEVAL.
Oncle cruel ! Vous pousseriez jusques-là votre vengeance... Je ne l’aurais jamais cru.
BRIGARD.
Hélas ! il n’est que trop vrai. Mon zèle pour vous m’a fait découvrir l’impossible. Il soupe ce soir au marais, chez l’homme chargé de conduire secrètement cette affaire. Si vous en doutez encore, suivez-moi ce soir vers les onze heures au détour de la fontaine...
JENNEVAL, avec fierté.
Eh, qu’il garde ses biens, ces biens vils que je méprise, et auxquels il me croit si fort attaché, pourvu que tu me restes, chère Rosalie. Je ne les désirerais que pour toi. Mais tu dédaigneras comme moi ces richesses : prends mon courage. L’adversité m’a rendu fort, imite-moi. Nous irons, s’il le faut, vivre dans un désert, pour y jouir de nous-mêmes. Je me sens secrètement flatté de n’espérer plus rien de lui. Ses biens me deviennent odieux comme sa personne. Mes amis ! Qu’on ne prononce plus son nom devant moi. Il viendrait, soumis et suppliant pour réparer ses torts que je ne lui pardonnerais pas. Il m’a fait trop souffrir en faisant couler tes larmes. Pardonne, daigne encore m’aimer, me revoir. J’oublierai jusqu’au nom de cet oncle inhumain. Eh, que peut-il pour mon bonheur ?
ROSALIE, soulevant son mouchoir, et d’un ton froid.
Il peut mourir...
Puis elle se couvre le visage comme abandonnée d’une douleur muette.
BRIGARD.
Demain, monsieur, demain (j’en frémis d’avance) mais je vois que vous serez tous deux sacrifiés. Le pouvoir, le terrible pouvoir est entre ses mains. Comment prévenir... Il faudrait de ses coups désespérés. Ah, si par un acte de vigueur je pouvais...
ROSALIE.
Non, non, qu’il me laisse périr en consentant à tout, en m’abandonnant...
JENNEVAL.
Qu’oses-tu dire ?
ROSALIE.
Que tu n’as pas une âme assez forte, assez décidée et que ton irrésolution enchaîne après toi le malheur.
JENNEVAL.
Eh quoi donc décider ? Ose résoudre. Dans ces extrémités quel parti dois-je prendre ?...
ROSALIE, en se levant.
T’abandonner entièrement à moi, jurer de ne pas rejeter le moyen que je vais t’offrir ; c’est le seul qui nous reste...
JENNEVAL, avec emportement.
Je te le jure par tout ce qu’il y a de plus sacré... Mon âme souffre dans la tienne, je ne veux plus voir tes douleurs... Prononce... Le regard des hommes n’est plus rien pour moi. Je ne vis plus que pour te servir...
Rosalie, en se détournant pendant ce couplet, a fait à Brigard un geste homicide, signal terrible du meurtre. Brigard a répondu à ce signal affreux, et est sorti. Tout ceci a dû s’exécuter dans un instant.
Scène VII
ROSALIE, JENNEVAL
ROSALIE, s’avance et saisit la main de Jenneval.
Jenneval, m’aimes-tu ?
JENNEVAL.
Quel langage, ô Ciel !
ROSALIE, en souriant avec une joie cruelle.
Eh, bien, cette nuit même n’achèvera point son cours sans amener le terme de notre adversité. La fortune, tu le sais, ne tient souvent qu’à un moment de courage...
JENNEVAL.
Quoi, serait-il possible !... Que vois-je ? Tous tes traits sont changés. Quelle joie extraordinaire brille sur ton visage !... Tu pourrais entrevoir...
ROSALIE.
Va, tout est vu.
JENNEVAL.
Tu espères ?...
ROSALIE, d’un ton le plus tendre.
Tous nos malheurs vont finir, viens essuyer mes larmes. Viens rendre la paix à mon cœur. Viens me dire que tu m’aimes, afin que je perde toute l’idée de me donner la mort. Jenneval, répète-moi que ma volonté sera l’arbitre de tes destins.
JENNEVAL, avec impatience.
Rosalie, méconnais-tu ton amant ?
ROSALIE, le serrant contre son sein.
Tu l’es, mon cher Jenneval ; c’en est fait... Tu deviens en ce moment la plus chère moitié de moi-même... Va, ma tendresse sera désormais sans bornes. Écoute ce cœur qui t’est si bien connu, qui se livre à toi sans réserve. Ton amante à cette heure brûle de plus de feux que tu n’en eus jamais pour elle. Elle te préférerait aux mortels les plus opulents. Elle te choisirait dans le monde entier pour ne suivre, ne voir, n’adorer que toi ; enfin elle va te donner la plus grande preuve de son amour, en osant entreprendre pour que rien ne nous sépare.
JENNEVAL, ému.
Prends garde, chère Rosalie ; je n’ai point assez de force pour supporter des marques si vives de ton amour... Modère une joie trop précipitée... Tu t’abuses peut-être. Je t’idolâtre, je suis le plus heureux des hommes... Mais... Explique-moi enfin... Je dois savoir...
ROSALIE.
Ingrat ! j’aurais voulu que tu l’eusses deviné. Écoute, la haine ne proscrit-elle personne dans ton âme ? Sens-tu cette fureur ardente qui consume la mienne ? Ta Rosalie ne vit-elle plus en toi ? Ne t’inspire-t-elle pas son projet ?... il est terrible, mais si tu la chéris, tu sais ou plutôt tu sens, ce que demande une femme outragée...
JENNEVAL.
Arrête. Ne sens-tu pas toi-même combien tu me fais souffrir... Je tremble... Eh que veux-tu ?
ROSALIE.
Ton bonheur et le mien. Voici l’instant de me prouver que tu m’aimes. La rage de cette âme de fer, de cet odieux tyran qui se dit ton oncle, d’allumer ma juste vengeance. Il nous poursuit... Si je ne l’arrête nous périssons... C’est sa mort que je te demande.
JENNEVAL.
Sa mort !
ROSALIE.
Crains de balancer.
JENNEVAL.
Le frère de mon père ! Dieu !
ROSALIE.
Lui ! ce despote farouche.
JENNEVAL.
Tout mon être frémit ; cruelle, qu’oses-tu prononcer ? Demande ma vie, c’est l’unique chose qui me reste à te sacrifier.
Changeant rapidement de ton.
Ah ! l’infortune t’égare et te fait oublier... Non, ce n’est pas toi qui parle... Dis-moi quel noir démon trouble ton âme ?
ROSALIE.
Homme faible et lâche, qui ne sais rien oser pour ton propre bonheur, demain tu rendras grâce au coup hardi qui nous aura délivré. Demain, nous n’aurons plus rien à craindre ; tu seras libre, riche et maître de ta Rosalie.
JENNEVAL.
De quelle horreur es-tu possédée ? J’en atteste ici le Ciel... Je n’achèterais pas même un trône au prix du sang de ce vieillard.
ROSALIE.
Qu’as-tu tant à frémir ? Est-ce la vie que tu lui raviras ? Ce sont à peine quelques jours fragiles et languissants ? Leur flambeau pâlit achève de l’éteindre. Serait-ce un vain titre d’oncle qui retiendrait ton bras ? Va, les chimériques liens du sang sont trop équivoques pour en imposer. Ceux qui nous aiment et qui nous font du bien, voilà nos parents ; mais celui qui se rend notre persécuteur, qui nous hait, cet homme quel qu’il soit, n’est plus qu’un mortel ennemi que la nature elle-même nous enseigne à détruire.
JENNEVAL.
Eh quel droit ai-je sur ses jours ?... Le vil assassin frappe dans l’ombre, mais depuis quand prétend-il justifier au grand jour, sa lâche et obscure fureur ?... Rosalie ! Comment ton âme est-elle devenue sanguinaire ?... Ah, reprends, reprends cette douce sensibilité qui honore ton sexe et qui faisait tous tes charmes. Autrefois tu m’as montré des vertus, ne les déments pas. Reviens, reviens à toi-même et tu désavoueras bientôt un langage si contraire à ton cœur et au mien.
ROSALIE.
Eh bien fais-lui grâce pour qu’il me tue ; attends que ce monstre que tu épargnes m’ait arrachée d’ici pour me plonger vivante dans les cachots. Déteste ton amante et chéris son tyran féroce... si tu n’as pas le courage de prévenir ses coups, soulage-moi avec ton épée... Tu seras moins cruel.
Elle se jette sur l’épée de Jenneval.
JENNEVAL, la repoussant.
Malheureuse ! ô Ciel !
ROSALIE, dans l’attitude du désespoir.
La mort n’est qu’un instant. L’indigence et l’opprobre sont éternels. Accorde-moi sa mort, ou tremble... Je me perce à ta vue.
JENNEVAL.
Tu veux mourir. Meurs du moins innocente... Dans quel égarement te jette un désespoir que ma douleur partage ! Rosalie ! est-ce là ce que tu m’avais fait espérer ? Quoi, tu connais l’amour, et tu peux être barbare !
ROSALIE.
Qui de nous deux l’est davantage ?... Tu pleureras ma mort, puisque tu chéris sa vie aux dépens de la mienne.
JENNEVAL.
Tu m’assassines à coups redoublés... Ta rage semble passer dans mon cœur. Laisse-moi respirer... Je ne me connais plus. Le désordre de mon âme... Je ne sais ce que je hasarderais dans ces moments pour te sauver de l’affreux état où je te vois.
ROSALIE, d’un ton suppliant.
Rends-moi ce jour que la tyrannie veut m’ôter et ma vie entière, je la consacre à jamais sous tes lois. Vole, cher Jenneval, la nuit et la mort obscurciront tous les objets. Les ténèbres sont d’insensibles témoins. Elles enseveliront cet événement dans une ombre éternelle. Rien ne transpire de la nuit des tombeaux, et leurs secrets périssent avec ce qu’ils enferment. Nuls vestiges, point d’indices. Les soupçons ne s’élèveront pas même jusqu’à toi... Crois-en ton amante, elle a tout disposé et tout est prévu.
JENNEVAL.
Eh quand j’échapperais à tous les regards, à l’œil même du vengeur éternel des crimes, je le saurais toujours moi ! La voix de cette conscience que rien n’étouffe me reprocherait mon forfait : que m’importe le jugement de l’Univers, si cette voix terrible qui m’accuse tonne à jamais dans mon cœur... Barbare ! Est-ce ainsi que tu reconnais ma tendresse, est-ce en me regardant coupable et malheureux que tu veux signaler le pouvoir de tes charmes. Quoi ! le chef-d’œuvre de la nature voudrait en devenir l’horreur ?... Mon âme est épuisée... Que j’ai besoin de me fortifier contre tes attraits dangereux !... Mais, que dis-je ? En voulant frapper, le poignard me tomberait des mains ; ce vieillard !... Il porte sur son front les traits chéris d’un père... Il m’a caressé dès le berceau, il a élevé mon enfance, il fut mon bienfaiteur ; et à travers toutes ses rigueurs, je sens, oui, je sens trop qu’il m’aime... ah, son ombre en montant au séjour éternel, son ombre sanglante irait m’accuser devant un père ; elle lui dirait : Vois cette blessure ouverte, ce flanc déchiré... C’est la main de ton fils !... La foudre alors s’échapperait sur ma tête, ou, si la terre portait encore un parricide, seul avec mon crime je n’oserais plus regarder le soleil ; une image ensanglantée me poursuivrait jusqu’en tes bras... Écoute, ne sens-tu pas déjà des remords ; toujours plus dévorants, ils corrompraient nos jours ? Plus d’amour pour nos cœurs. La discorde qui suit les forfaits viendrait s’asseoir entre nous, et nous armerait bientôt l’un contre l’autre. Échappés aux bourreaux, nous n’échapperions pas à nous-mêmes... Ah...
ROSALIE, d’un ton terrible.
Je rejette ton indigne pitié, tes prières, tes vœux, tes remords, apprends qu’ils deviennent inutiles. J’avais prévu ta faiblesse, je me suis chargée de ta destinée. Tu l’avais remise entre mes mains. Il n’est plus en ton pouvoir que d’ordonner mon trépas... L’arrêt en est porté... Tu entreras malgré toi dans mon complot... Au moment où je te parle c’en est fait, Ducrône, notre tyran expire.
JENNEVAL, courant désespéré.
Ah perfide ! Je t’avais mal connue.
En pleurant.
Bonnemer, cher Bonnemer, tu me l’avais prédit... Où es-tu ? Viens, vole à mon secours.
ROSALIE, froidement.
Cesse de vaines clameurs, et choisis maintenant d’être ou mon accusateur ou mon complice. Traîne sur l’échafaud une femme qui t’aime, qui a tout osé pour toi, ou laisse tomber un sinistre vieillard dont tu recueilleras l’immense héritage, et qui entraînera avec lui dans sa tombe le secret impénétrable de sa mort. Il n’a aucun droit de me toucher lui !... Je ne demande point que tu prennes un poignard, que tu ensanglantes tes faibles mains... Ferme les yeux ; laisse agir Brigard ; il nous sert avec zèle. D’ailleurs, n’espère pas pouvoir le fléchir. Il sait qu’il faut te servir malgré toi et que demain tu baiseras la main qui nous aura délivrés.
JENNEVAL, rapidement.
Le barbare se trompe... Je cours défendre et sauver ce vieillard malheureux. Je l’aime depuis que ses jours sont en danger, et toi, je crois que je commence à te haïr, je crois...
Il va pour sortir.
Laisse-moi, j’abjure l’amour, je déteste la vie...
ROSALIE, l’arrêtant.
Arrête, cher Jenneval...
JENNEVAL, furieux.
Eh que veux-tu de moi, furie implacable ?... tremble !
ROSALIE.
Dieux ! quel nom ! quel regard !
Tombant à ses genoux.
Immole ta Rosalie, et ne l’outrages pas. Elle redoute plus ton mépris que la mort. Elle est prête à sacrifier sa vie à tes pieds. Accuse le sort, maudis notre destinée. J’ai, comme toi, le meurtre en horreur, mais une fatalité terrible nous écrase et je veux te sauver. Comment renoncer à la vie, à la liberté, à l’amour ? Je t’idolâtre. Crime ou vertu, l’amour l’emporte sur tout et ne connaît point d’autre loi... Dans un pareil état, est-ce à nous de réfléchir ?... Cher et faible Jenneval, affermis ton âme, il n’est plus temps de reculer... Écarte les fantômes qui obsèdent ta crédule imagination. Vole où ton amante te conduit... Seras-tu insensible au prix unique qu’elle garde à ton obéissance... Pressé dans les bras qui s’ouvriront pour te recevoir et payer ton courage ; tout entiers à nous-mêmes... libres, heureux, vengés...
JENNEVAL.
Lève-toi, barbare ; je ne veux plus t’entendre... Mes cheveux se dressent d’horreur. Que ton génie est terrible ! Que ta tendresse est perfide ! par quels détours m’as-tu conduit dans l’abîme... Fatale beauté ! tu vois le délire de mes sens, tu sais que tu règnes impérieusement sur ce cœur déchiré, et tu le pousses au meurtre... tes cris, tes gémissements, tes pleurs m’accablent. Ils ont ébranlé mon âme, et en ont chassé la vertu... Triomphe ! l’échafaud nous attend tous deux... Justice du Ciel, qu’avez-vous résolu de moi ?... Ah, quels combats ! quels tourments !... Je chancelle... Je frissonne... Par où sortir ?...
S’appuyant contre la muraille.
Je me meurs...
Ranimant ses forces.
Laisse-moi aller... Cruelle ! Ne demandes-tu pas sa mort ?
ROSALIE.
Oui.
JENNEVAL, éperdu.
Eh bien je répandrai...
ROSALIE.
Tu répandras son sang !
Ici la déclamation muette de Jenneval est dans son plus haut degré d’énergie ; Rosalie le tient, le presse, le fixe ; il s’arrache de ses bras.
JENNEVAL.
Oui, je le répandrai... Laisse-moi... Laisse-moi, te dis-je.
Il sort.
Scène VIII
ROSALIE, seule et marchant à grands pas
Enfin, j’ai reçu son aveu... Que de fois il m’a fait frémir ! mais c’en est fait... Ce secret terrible est un nœud qui l’enchaîne à mes destins... Il reviendra ; je m’attends à ses cris plaintifs, à ses remords... Ils s’abîmeront bientôt dans les feux de la volupté ; c’est la divinité puissante qui fait taire tout ce qui contredit sa voix : elle régnera profondément sur l’impétueux Jenneval, et souveraine absolue je triompherai par elle.
ACTE V
La scène est dans la maison de Monsieur Dabelle ; il est nuit.
Scène première
LUCILE, BONNEMER
LUCILE, suit Bonnemer qui a l’air inquiet.
Monsieur Bonnemer, non, vous ne paraissez pas assez tranquille pour me rassurer. Je lis sur votre front que votre cœur est en secret violemment agité. Je suis dans un effroi mortel. Qui vous fait répéter sans cesse le nom de mon père et celui de M. Ducrône.
BONNEMER.
Ils sont sortis ensemble, Mademoiselle ?
LUCILE.
Oui, et ils devraient être rentrés.
BONNEMER.
Ils sont sortis sans domestique ?
LUCILE.
Eh mon dieu oui.
BONNEMER.
Et vous ne pourriez me dire à peu près dans quel quartier ils sont allés ?
LUCILE.
Non, monsieur.
Regardant à sa montre.
Ciel ! Onze heures et demie.
Elle donne toutes les marques de la plus vive inquiétude.
BONNEMAR, à voix basse.
Où irai-je ? Comment le rencontrer ?... Je ne puis étouffer un fatal pressentiment...
LUCILE, prête à pleurer.
Monsieur ; au nom de l’amitié que vous avez toujours eue pour moi, dissipez le trouble affreux où je suis plongée... Vous vous trahissez malgré vous. Je ne vous quitte pas. Je donnerais tout au monde pour voir paraître à l’instant mon père et M. Ducrône. Comme je volerais dans leurs bras ! Tout ce que j’ai dans l’esprit ne serait plus alors qu’un mauvais rêve bientôt oublié.
BONNEMER.
Quoi, votre esprit s’alarmerait-il ?... Qu’imaginez-vous donc Mademoiselle ?
LUCILE.
Mais vous-même, c’est en vain que vous dissimulez. On a tout employé pour réconcilier l’oncle et le neveu. L’un est trop rigoureux, l’autre trop emporté... Dites-moi, qu’a fait depuis Jenneval ?
BONNEMER.
Ne me le demandez point, ah...
Il veut sortir.
LUCILE, l’arrêtant et rapidement.
Bonnemer, parlez-moi ; parlez-moi, ne me quittez pas, je vous en conjure ; vous ne sentez pas que vous me faites cent fois plus souffrir que si vous m’annonciez les plus tristes nouvelles. Achevez...
BONNEMER.
Mademoiselle... Je frémis de vous le dire. Je l’ai rencontré, ce malheureux Jenneval, mais dans un désordre extrême. J’ai voulu l’arrêter, le ramener ici ; furieux, il m’a méconnu, il s’est arraché de mes bras. Le nom de son oncle a échappé de sa bouche. Il m’a demandé plusieurs fois d’un ton sourd et terrible où l’on pouvait le rencontrer sur l’heure même. Je n’ai pu réussir à apaiser le trouble extraordinaire de ses sens. J’ai cru que c’était un reste d’émotion de la scène vive qu’il avait eu avec son oncle ; lorsqu’en rentrant ici un exempt m’a fait appréhender un noir complot. Il m’a demandé si M. Ducrône était de retour ; il m’a bien recommandé qu’on l’avertît d’être sur ses gardes, de ne point se hasarder le soir. Il s’est informé des maisons qu’il fréquentait et il est parti précipitamment.
LUCILE, jetant un cri.
Ciel ! Se pourrait-il !... Courez, volez, laissez-moi.
BONNEMER.
Ah ! reprenez vos sens, vous changez de couleur ; je ne puis vous laisser en cet état. Je vais appeler... Mais j’entends quelqu’un.
M. Dabelle entre lorsque Bonnemer soutient Lucile dans ses bras.
Scène II
MONSIEUR DABELLE, LUCILE, BONNEMER
MONSIEUR DABELLE.
Qu’est-ce donc ? ma fille prête à s’évanouir !
LUCILE, d’une voix étouffée.
Ah ! Mon père !... Quoi, seul ?...
BONNEMER.
Mon cher Monsieur Dabelle vous revenez seul...
MONSIEUR DABELLE, soutenant sa fille.
Mon ami, mon cher ami... Lucile, qu’a-t-elle donc ? Qu’est-il arrivé ?
BONNEMER.
Et M. Ducrône où est-il ?
MONSIEUR DABELLE, conduisant sa fille sur un fauteuil.
Il n’est pas rentré !... Qu’est-ce à dire ?... Chère enfant... Bonnemer... D’où naît votre effroi mutuel ? Dites-moi donc...
BONNEMER.
Ah Monsieur !
MONSIEUR DABELLE.
Vous m’inquiétez d’une manière étrange...
BONNEMER.
Où l’avez-vous laissé ?... êtes-vous toujours demeurés ensemble ?
MONSIEUR DABELLE.
Non, depuis quatre heures, nous nous sommes séparés. En me quittant il m’a dit ; je ne tarderai point à vous rejoindre
Allant à sa fille.
Eh bien ma fille tu pleures...
BONNEMER.
Hélas, Monsieur, nous vous revoyons... Pourquoi avez-vous abandonné Ducrône... Ses jours sont en danger... Juste ciel ! Le malheureux l’aurait-il assassiné !
MONSIEUR DABELLE.
Vous me glacez d’effroi... Comment ? Assassiné ! Que voulez-vous dire ?
BONNEMER.
On croit que Jenneval veut attenter aux jours de son oncle... Cette femme criminelle et perfide qui l’a corrompu... On soupçonne le plus affreux dessein... Hélas ! Son œil troublé évitait mes regards.
LUCILE, en reprenant ses sens.
Jenneval n’est point un barbare. Mon cœur me soutient le contraire. Il me semble encore l’entendre converser sur le précieux sentiment de l’humanité ; mais il est faible, il est livré à des scélérats qui peuvent sans lui... C’est trop de n’avoir pas su les détester, les fuir... Ah si l’amour a tant de pouvoir sur sa volonté, quel malheur pour lui de n’avoir pas été excité aux plus hautes vertus !
MONSIEUR DABELLE.
Ma fille calme-toi... Si tu ne peux jamais te représenter Jenneval assassin, je ne puis non plus me faire à cette idée révoltante... cependant je suis hors de moi.
Appelant un domestique.
Qu’on mette tout de suite les chevaux aux deux voitures... Je me doute de deux ou trois endroits... On m’a arrêté si tard aussi... Il me semblait que quelque chose me rappelait ici.
À Bonnemer.
Mon ami vous irez d’un côté, moi de l’autre. Nous le rencontrerons sûrement... Ma fille, vous trouvez-vous mieux... Un moment de patience.
Il sort.
Scène III
LUCILE, BONNEMER
Pendant cette scène Lucile erre dans le fond du théâtre.
BONNEMER, sur le devant seul.
Ciel ! Veille sur lui ! Fais que je le revoie... Ne permets pas qu’un crime s’accomplisse ; sauve à la fois deux âmes honnêtes ; et faites pour s’aimer.
LUCILE.
J’entends plusieurs voix confuses... On vient... Permettez...
Elle sort et entre en s’écriant.
Ah mon cher Monsieur Bonnemer, c’est le cher Monsieur Ducrône avec Monsieur Jenneval !
BONNEMER, avec le cri de l’âme.
Le Ciel soit loué ! Soit béni mille fois !
Scène IV
MONSIEUR DABELLE, MONSIEUR DUCRÔNE, LUCILE, JENNEVAL, BONNEMER
Ducrône et Jenneval se tiennent par la main ; Jenneval a l’épée nue sous le bras. Ils sont tous deux sans chapeau.
BONNEMER, à Lucile.
C’est lui, c’est lui ; embrassons les tous deux.
Il embrasse Ducrône et Jenneval.
JENNEVAL, saluant Lucile, puis reprenant la main de son oncle.
Ah mon cher oncle !
MONSIEUR DABELLE.
À quel danger êtes-vous échappé ?
MONSIEUR DUCRÔNE.
Au plus grand de tous.
Montrant Jenneval.
Voici mon libérateur... Je suis encore tout ému... Eh qu’est devenue ma canne ?... Nous sommes tous deux sans chapeau... Jour cruel ! Ce soir j’ai soupé et demeuré fort tard chez un homme d’affaires et cela pour déshériter ce Jenneval qui vient de me sauver la vie... Écoutez bien : au détour d’une rue, vers le coin d’une fontaine, un déterminé est venu à ma rencontre l’épée nue à la main. J’ai aperçu son fer qui brillait dans l’obscurité. Surpris, j’ai tiré mon épée, mais la lame et le fourreau sont venus tout ensemble... C’était fait de moi... Voici que soudain un inconnu vole à ma défense ; le combat se livre, il renverse l’assassin à mes pieds... Je vois, je reconnais mon neveu. Il avait suivi secrètement mes pas. Il me prend, me guide par la main... C’est lui, messieurs, qui a exposé sa vie pour conserver la mienne.
BONNEMER.
Généreux défenseur !
MONSIEUR DABELLE.
Brave jeune-homme !
JENNEVAL, se couvrant le front des deux mains.
Arrêtez... Suspendez ces cris de joie... Frémissez tous de m’entendre... Je rejette vos louanges, je ne les mérite point. Frémissez vous dis-je d’horreur et de pitié, sachez qu’une larme de plus, j’étais un parricide... Ah mon oncle ! Cette main qui presse la vôtre avec tendresse, cette même main qui a sauvé vos jours était prête à se plonger dans votre sang... Vous vous étonnez... Ah dieu ! Vous n’avez pas vu cette femme en pleurs, prosternée à mes genoux, vous n’avez pas entendu ses accents. Vous ne concevez pas de quels traits elle a frappé mon cœur... Échauffé par ses cris, excité par ses larmes, plein du poison dont elle m’avait enivré j’allais...
MONSIEUR DUCRÔNE.
Mon neveu, ne t’exagère point à toi-même ta propre faiblesse.
JENNEVAL.
Non, je dois tout révéler... mon âme hors d’elle même allait embrasser le crime. J’adorais Rosalie vous l’aviez persécutée. Homme imprudent et cruel vous ignoriez donc cet ascendant terrible, cette fièvre des passions, ce délire d’un cœur réduit au désespoir et ce qu’il peut entreprendre à la voix d’une femme... Ah ! Souvenez-vous de mon père, il ne fut jamais inexorable, il eût cédé aux larmes de son fils, il l’eût plaint dans sa funeste passion, il eût connu la pitié, il eût adouci ses maux. Pardonnez-moi ces reproches, j’ai combattu, j’ai triomphé, j’ai été plus tendre, plus humain, plus sensible que vous : mais du moins sentez un remord salutaire ; tremblez en écoutant un formidable aveu... Apprenez que j’ai vu un moment où ne voyant plus en vous qu’un inflexible ennemi, j’allais vous assassiner !... Le ciel...
MONSIEUR DUCRÔNE.
Mon cher neveu, nous ne nous sommes point encore embrassés.
Ils se précipitent dans les bras l’un de l’autre.
JENNEVAL.
Ô joie ! Ô doux moments ! Est-ce bien vous que je serre sur mon sein... Ah dieu, laissez-moi pleurer... Encore vertueux et étonné de l’être, je n’ose en cet instant même m’avouer ni me croire innocent... Femme artificieuse et cruelle !... Eh si tu n’avais point révolté mon âme, si le Ciel en m’éclairant tout à coup ne m’eût point fait lire sur ton front l’empreinte du crime...
Avec énergie.
Mon cher oncle, couvert de votre sang, chargé d’opprobres, en exécration à moi-même je mourrais de la mort des scélérats, peut-être avec leur cœur endurci. Je n’ai point commis le forfait et j’en éprouve tous les tourments. Que serait-ce donc si j’étais coupable !
Étendant les bras vers le Ciel et dans une attitude suppliante.
Grand Dieu qui m’as prêté ta force victorieuse, je te rends grâces, ma vertu est ton ouvrage ! Si ta miséricorde n’est pas épuisée, frappe le cœur de Rosalie, accorde-moi ses remords... Ta bonté surpasse son crime... Dieu puissant, ce nouveau miracle appartient à ta clémence !
À Bonnemer.
Soutiens-moi mes forces s’épuisent.
Bonnemer le conduit sur un fauteuil. Jenneval assis continue après une courte pause.
Et vous mon oncle, puisque le Ciel a détourné les coups qui vous menaçaient, laissez tomber cet événement dans un éternel oubli, ne poursuivez point cette malheureuse et ses jours infortunés. Essayons les bienfaits sur ce cœur si longtemps tourmenté. Votre compassion doit être excessive, si vous voulez l’égaler un moment à mes peines.
MONSIEUR DUCRÔNE.
Jenneval écoute ; tu m’as sauvé la vie, je n’en disconviens pas ; mais vois-tu, j’aimerais mieux être cent pieds dessous terre que d’autoriser même indirectement le moindre désordre. Oui, je te pardonnerais plutôt ma mort que ton libertinage. Laisse les assassins attenter à ma vie, je les crains moins que la perte douloureuse de tes mœurs, et je te le dis ici en oncle reconnaissant et sévère, si tu osais renouer avec ta Rosalie...
JENNEVAL, d’un ton froid.
Homme extrême, épargnez ce nom à mon oreille. Vous ne m’entendez point. Ah... quand je l’adorais, je la croyais vertueuse. J’idolâtrais le fantôme qu’avait paré mon imagination. J’ai été détrompé... Je suis affermi pour jamais contre ses coupables appas ; si je suis généreux envers elle, c’est que je puis l’être sans danger... Imitez-moi.
MONSIEUR DABELLE, s’avançant.
Cher oncle, j’ai tout vu, tout observé et le cœur de ce digne jeune-homme a paru tout entier à mes regards. C’est moi qui veux lui présenter une fille vertueuse : j’en connais une qui a un cœur sensible, tendre même, mais elle a un ami prudent, secourable, qui depuis son enfance veille sur sa sensibilité. Elle a remis ses plus chers intérêts entre ses mains. Elle lui sera toujours plus chère que tout ce qu’il pourra jamais aimer dans le monde ; il lit tous les secrets de son cœur, c’est à lui enfin à décider son choix. Notre Jenneval, cher oncle, me semble fait pour être aimé d’un cœur tel que le sien, car j’ose ici répondre de la noblesse d’âme de l’un et de la tendresse de l’autre.
LUCILE, troublée, attendrie, se décèle à tous les yeux par son embarras.
Mon père !
MONSIEUR DABELLE, ironiquement.
Lucile pense donc que c’est d’elle que je parle ?
LUCILE, avec le plus grand attendrissement.
Ah ! Mon père !
MONSIEUR DABELLE.
La fausse honte que vous éprouvez en ce moment, ma fille, car c’en est une, est la seule faiblesse que je vous reproche.
LUCILE.
Ah permettez à votre fille de se retirer.
JENNEVAL, à part.
Je me trouverais coupable si je balançais encore.
Haut.
Le voile est tombé, adorable Lucile ; un père respectable m’enhardit ; je ne vois plus que vous seule au monde, digne d’être adorée... Ah comment exprimer des sentiments toujours si chers, mais que j’ai trahis ; toute ma vie pourra-t-elle effacer... Aveugle, je prêtais vos vertus à un objet qui ne les connut jamais... Ah ! C’était vous que j’adorais... vous voyez un homme nouveau.
LUCILE.
Si vos remords sont vrais, Monsieur, ils effacent à mes yeux toutes vos fautes. Mon père ne vous a point retiré son estime, vous pouvez encore prétendre à la mienne. Un sentiment plus doux aurait été votre partage si vous eussiez resté ce que vous paraissiez être...
JENNEVAL, avec feu.
Ah ! Vous me verrez digne de vous. J’en fais le serment à vos genoux ; daignez m’encourager et d’un seul regard vous ferez de moi tout ce que je dois être. Heureux si vous voulez étendre vos bienfaits sur le reste de ma vie.
MONSIEUR DUCRÔNE.
C’est fort bien dit, que cela mon neveu ; je suis très content de toi, aime bien et de toute ton âme cette honnête et sage demoiselle. Tu peux compter dès ce moment sur mon héritage comme sur mon amitié. Messieurs, je lui ai toujours reconnu un caractère excellent au fond. Il m’a causé bien des chagrins, mais dieu merci en voici la fin.
JENNEVAL, à Monsieur Dabelle.
Voilà donc comme vous me punissez ?... Ah tout me fait sentir qu’auprès de vous le sentiment de l’amour surpasse même celui du respect !
MONSIEUR DABELLE.
Nos âmes s’entendent, cher Jenneval, elles sont faites pour être unis... C’est toi qui rendras la fin de ma carrière douce et fortunée.
À sa fille.
Aide-moi à sauver un jeune-homme sensible et vertueux des pièges du vice qu’il ignore, afin que tous les cœurs applaudissent au choix qu’il aura fait.
LUCILE.
Mon père ! Ah je crains que vous n’écoutiez que mon cœur...
MONSIEUR DABELLE.
Va, crois-moi, ne plaide point contre lui.
JENNEVAL, baisant la main de Lucile.
Comment exprimer tout ce que je sens ! Sortir du désespoir pour goûter la plus pure félicité !... Quel passage rapide et inattendu ! Belle Lucile, non je ne vous ai pas été infidèle, je vous aime trop pour penser que j’aie cessé un instant d’adorer tant de perfections réunies.
MONSIEUR DUCRÔNE, à M. Dabelle.
Mais vous êtes un homme étonnant. Savez-vous que vous m’avez tout attendri, moi qui n’ai point de mollesse ? Que vous me faites bien sentir le plaisir qu’on doit goûter à être bienfaisant ! Ce n’est que dans cet instant que je viens de m’apercevoir que votre caractère vaut beaucoup mieux que le mien. Je sens combien il me serait doux de pouvoir vous ressembler. Je sais me rendre justice. Je ne me dissimule pas que j’ai peut-être été trop sévère, mais la jeunesse aussi, la jeunesse... Allons ; allons, vos bontés ne feront plus de reproches à ma conscience.
À Lucile.
Chère belle et vertueuse demoiselle, si vous ne redoutez pas d’avoir un oncle aussi grondeur que moi, si mon ton brusque ne vous fait pas peur, il faudra me permettre, s’il vous plaît, de remettre cette gentille main dans celle de mon neveu, et le tout en faveur de son repentir... Le pauvre garçon, qu’il a souffert ! Mais qu’il sera heureux !
À M. Dabelle.
Son droit fini je le marie et je lui achète la plus belle charge possible.
JENNEVAL.
Mon cher oncle !... Ah ! Monsieur !... Ah charmante Lucile ! Un sentiment éternel d’amour et de reconnaissance... Mon cœur vous confond tous trois... Cher Bonnemer, qui l’eût dit... Mais quels souvenirs amers se mêlent à ma joie !... Te rappelles-tu ce moment où sourd à la voix de l’amitié, je t’outrageai ?... Oublieras-tu...
BONNEMER.
Je ne vois, je ne sens que ton bonheur... Il t’était du... Tu verras quelle différence il y a d’un amour bien placé, à celui dont il faut rougir.
MONSIEUR DABELLE.
Qu’il ne soit plus question que de la joie qui doit régner ; ce jour est marqué pour un des plus beaux de ma vie.
JENNEVAL.
Tant que je vivrai, il servira d’exemple à la mienne, et votre main (si je suis assez heureux pour l’obtenir) chère Lucile, deviendra le gage de mes vertus.