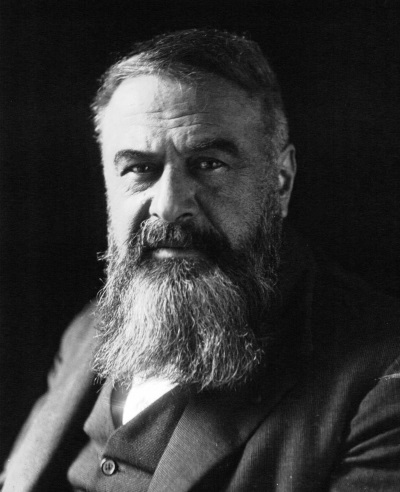Le Cordon bleu (Tristan BERNARD)
Comédie en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de ma Potinière, le 30 mars 1920.
Personnages
OCTAVE
DUMOREL
BARNEREAU
ARTHUR
DICK
ACHILLE
IRMA
GERMAINE
RÉGINA
CÉLESTINE
MADAME DUMOREL
SÉRAPHINE
AGATHE
ACTE I
La scène se passe dans un petit salon assez sommairement meublé d’une table. Appareil téléphonique.
Octave est tout seul en veston d’appartement, il paraît accablé. Coup de fusil au dehors, Octave tressaille douloureusement. Second coup de fusil, nouveau tressaillement. Au troisième coup de fusil, il se lève énervé.
OCTAVE.
Ah ! que c’est assommant d’habiter à côté d’un tir à la carabine !
Nouveau coup de fusil.
Bon ! quatrième coup !
Il prête l’oreille.
Il ne tire pas ses cinq coups, ce n’est pas un carton, c’est un individu qui tire à l’œuf, ça !
On sonne à la porte.
Bon !
Il regarde sa montre.
Ah ! ce n’est pas possible que ce soit elle, déjà, c’est probablement Henri.
Un instant se passe ; la petite bonne fait entrer Henri.
HENRI, garçon de l’âge d’Octave, trente ans environ.
Bonjour, Octave, j’ai passé tout à l’heure chez tes parents. J’ai trouvé ton mot, m’indiquant cette adresse. C’est ici maintenant que tu habites ! C’est rigolo, je suis ton voisin, mon bureau est au coin de la rue.
OCTAVE.
Oui, oui, je sais, au coin de la rue...
Nouveau coup de fusil.
HENRI, sursautant.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
OCTAVE.
Ça ? Ce n’est rien, c’est un tir à la carabine. Il est installé dans un terrain vague à côté, et il se trouve que les cibles sont contre ce mur.
Second coup de fusil.
HENRI.
Ce n’est pas excessivement amusant, ce voisinage !
OCTAVE.
Un peu de patience ; j’en ai bien, moi, qui suis ici une bonne partie de la journée. Toi, tu viens trois minutes et tu te plains !
Silence.
On n’entend plus rien, c’est encore un type qui tirait à l’œuf, et qui n’avait que huit sous sur lui.
HENRI.
Voisinage impossible, décidément.
OCTAVE.
Qu’est-ce que tu veux, mon vieux, c’est tellement difficile de trouver une garçonnière ! Je me suis estimé bien heureux quand j’ai découvert cet appartement. J’ai d’ailleurs suivi les préceptes que tu m’as souvent donnés. Quand on fait la cour à une femme, on a tort d’attendre que la femme ait cédé pour se procurer un appartement.
HENRI.
Oui, il vaut mieux avoir l’appartement d’abord.
OCTAVE.
La femme y vient fatalement. Quand on fait la cour à une dame et qu’on n’a pas encore d’appartement, cette question vous préoccupe, on se dit : Où ça va-t-il se passer ? On n’ose pas pousser la dame avec assez d’énergie, on craint qu’au moment où elle va tomber, on ne soit pas à l’endroit convenable pour la recevoir dans ses bras. Au contraire, quand on a l’appartement...
HENRI.
Alors, maintenant, l’appartement attend la femme ?
OCTAVE.
Elle va venir aujourd’hui pour la seconde fois, mais figure-toi...
Il approche et baisse la voix.
Mais figure-toi que je n’ai encore rien obtenu.
HENRI.
Mon pauvre vieux !
OCTAVE.
Qu’est-ce que tu veux ? C’est à cause de ces coups de fusil. La première fois, ça l’a impressionnée terriblement. J’ai eu beau lui expliquer que ce n’était rien du tout, elle est partie presque tout de suite sans m’accorder même un baiser.
HENRI.
Est-ce qu’il y a de l’indiscrétion à te demander si je connais cette dame ?
OCTAVE.
Oui, oui, mon vieux, il y a de l’indiscrétion. Mais dans le cas particulier, il n’y en a pas. Je ne peux pas te dire son nom, je ne le connais pas moi-même.
HENRI.
Ah bah !
OCTAVE.
Tout ce que je sais, c’est que c’est une femme du monde... enfin, de bonne bourgeoisie, elle est mariée depuis quelques années.
HENRI.
Elle n’a jamais trompé son mari ?
OCTAVE.
Ah ! mon vieux, tu m’en demandes trop ! Je n’en sais encore rien, nous ne sommes pas assez liés pour que j’aie pu lui poser la question.
HENRI.
Où l’as-tu rencontrée ?
OCTAVE.
Dans un grand magasin. Je lui ai dit quelques mots et le bonheur a voulu qu’il pleuve tout à coup à torrents. J’ai été lui chercher un taxi. Elle s’est enveloppée d’un grand mystère, j’espérais qu’elle allait donner son adresse au chauffeur, mais elle lui a simplement indiqué un thé dans le quartier de l’Étoile. Enfin, elle a tout de même consenti à me promettre un rendez-vous ici. Elle est venue.
Coup de fusil.
Elle est partie, et je suis descendu derrière elle pour lui trouver un taxi. Encore l’adresse d’un thé, d’un autre thé, cette fois !... Elle ne veut pas que je sache qui elle est, où elle habite, mais j’ai idée que ce doit être près de l’Étoile.
HENRI.
Et tu n’as pas pensé à la suivre ?
OCTAVE.
La suivre ? Non, je n’ai pas envisagé ça. Moi, tu sais, ce n’est pas dans mon caractère. Et puis, elle était en taxi, je n’en ai pas trouvé d’autre. Je ne pouvais tout de même pas la suivre à pied ! Ah ! si tu savais comme ce mystère m’énerve ! J’attends avec impatience qu’il y ait un peu plus de lumière.
Il regarde l’heure.
Mais, toi, tu vas me faire un grand plaisir.
HENRI.
Celui de m’en aller ?
OCTAVE.
Je n’aurais pas osé te le dire, mais elle ne va pas tarder à arriver.
HENRI.
Mais je ne t’ai pas dit le but de ma visite !
OCTAVE.
Oui, pourquoi es-tu venu ?
HENRI.
C’est pour te demander un renseignement. La Compagnie dont je t’ai parlé cherche un directeur d’usine à Paris. Il y a deux mille à deux mille cinq à gagner par mois ; pas besoin d’une grande compétence technique ; le travail est assez dur, voilà tout, il faut s’occuper chaque jour pendant une bonne dizaine d’heures. Je voulais savoir si tu ne connaîtrais pas dans ton entourage un jeune homme qui ferait l’affaire ?
OCTAVE.
Je ne vois pas à première vue, mais enfin je vais penser à cela et je chercherai.
HENRI.
Tu ne chercheras rien du tout, et aussitôt que je serai sorti, tu n’y penseras plus. Enfin, il ne faut désespérer de rien. Si tu trouves le monsieur en question, veux-tu téléphoner à Miran, notre nouvel administrateur, c’est lui qui s’occupe de cela ; tiens, voilà son numéro de téléphone.
Il lui tend un bout de papier qu’Octave met dans sa poche.
OCTAVE.
Bon !
HENRI.
Tu sais, un garçon énergique et qui veuille en mettre sérieusement, car, je te le répète, le boulot est pénible. Tu ne sais pas bien ce que c’est que l’énergie, toi, mais tu sauras peut-être reconnaître un homme énergique d’un homme qui ne l’est pas.
OCTAVE.
Tu parles bien, mais tais-toi, et fous-moi le camp.
On entend sonner.
Je ne me trompe pas, on vient de sonner, la voilà !
Il va à la porte et dit à la cantonade à la petite bonne.
Attendez un peu, vous irez ouvrir et vous ferez entrer cette dame dans la salle à manger.
Revenant à Henri.
Tu vas attendre qu’elle soit dans la salle à manger pour sortir par là.
HENRI.
Ah ! mais, tu es d’une discrétion admirable !
OCTAVE.
C’est bien naturel.
Un instant de silence.
Tu peux t’en aller maintenant.
HENRI.
Tu penseras à Miran ?
OCTAVE.
Miran ?
HENRI.
Oui, Miran, notre administrateur, si tu as une idée pour le directeur d’usine. Il n’y pense déjà plus maintenant !
OCTAVE.
Mais si, je t’assure, c’est gravé là.
Il le conduit jusqu’à la porte, le regarde s’éloigner, traverse l’antichambre, puis va ouvrir la porte à gauche. Il ramène Irma par la main. Tendrement.
Chérie, ma chérie, je suis bien heureux !
IRMA.
Oh ! moi, vous savez, je suis très inquiète, j’ai peur...
OCTAVE.
Mais il ne faut pas avoir peur !...
IRMA.
Oh ! mais ce n’est pas de vous !
Octave va pour l’embrasser.
Non, ne m’embrassez pas encore, il faut auparavant que je vous parle très sérieusement.
Elle s’assoit.
OCTAVE, souriant.
Très sérieusement ?
Irma lui fait signe de s’asseoir. Octave prend la chaise et va s’asseoir tout près d’elle.
IRMA.
Très sérieusement.
Elle lui fait signe de la main de reculer sa chaise.
Aujourd’hui, je ne vous dirai pas encore qui je suis, je me hâte d’ajouter que, si je vous disais mon nom, cela ne vous apprendrait rien. Mais tout de même vous êtes intrigué, il faut que je vous explique pourquoi je m’entoure de mystère... J’ai dans ma vie un souvenir très grave et très profond, oui, je vous le dis sans détour, j’ai eu un amant... Il est mort en mars 1917, le premier jour de la fameuse offensive de Champagne.
OCTAVE.
D’un éclat d’obus ?
IRMA.
Non, il s’est blessé au dépôt de Toulouse en coupant du pain, mais il se trouve que c’était précisément le jour de l’offensive. On l’a transporté à l’infirmerie, il n’a pas été admirablement soigné, et quelques semaines après... Je vous dirai qu’à ce moment-là, nous avions déjà rompu, mais nous n’avions pas annoncé notre rupture aux quelques amis qui étaient au courant de notre liaison. Alors, dans mon entourage immédiat, personne ne savait que nous n’étions plus amant et maîtresse. Mes amies m’ont tellement plainte que je me suis remise à l’aimer. J’ai oublié complètement notre rupture et j’ai juré que je n’aurai jamais plus d’autre amant. C’est même ce serment, très grave et solennel, qui fait que j’ai accepté de venir ici.
OCTAVE, étonné.
Ah !
IRMA.
Oui, n’est-ce pas, quand vous m’avez rencontrée pour la première fois et que vous avez eu l’obligeance de me procurer un taxi, chose que je n’oublierai jamais, vous m’avez demandé de venir prendre le thé avec vous, ici. Je me suis dit alors : Je ne risque rien.
OCTAVE.
Ah !
IRMA.
Oui, je ne risque rien, puisque j’ai juré une fidélité éternelle à la mémoire de mon amant... Seulement, il y a quelque chose qui m’ennuie, c’est que je ne suis plus aussi sûre de ne rien risquer...
OCTAVE.
Chérie !
IRMA.
Attendez, ne vous approchez pas ! Je puis vous dire en tout cas, que, quoi qu’il arrive, même si j’ai la faiblesse de succomber, vous ne saurez pas qui je suis. Bien entendu, je suis sûre de votre discrétion, mais je frissonne à l’idée que mes amies pourraient apprendre que je suis venue vous voir ici, dans un appartement de garçon. Quand vous me connaîtrez mieux, quand je serai certaine que vous avez pour moi un véritable...
Hésitante.
un véritable amour, je serai plus sûre de votre discrétion. À ce moment-là, alors, je consentirai à vous dire mon nom.
OCTAVE, tendrement.
Ne me dis pas qui tu es, j’ai confiance en toi... Tu me le diras plus tard, mais je t’en prie...
Il avance, il va pour la prendre dans ses bras... Elle se lève.
IRMA.
Attendez, j’ai encore autre chose à vous dire ; c’est que je suis très inquiète aujourd’hui. Mon mari n’a jamais rien su de ma première aventure, mon mari a eu, toute sa vie, la plus grande confiance en moi ; eh bien ! depuis quelque temps, il me semble tout soupçonneux. Lui, qui parle très peu d’ordinaire, continue à ne pas me dire grand-chose, mais, comment vous dirai-je ? il a une façon de se taire qui n’est plus la même. D’habitude, il se tait parce qu’il n’a pas beaucoup de conversation, mais, ces jours-ci, il me semblait qu’il y avait en lui une volonté de ne pas parler.
OCTAVE.
Ce sont peut-être des idées que vous vous faites ?
IRMA.
Tout à l’heure, à déjeuner, il a eu une manière de me dire : « Tu sors ? » qui ne m’a pas semblé naturelle.
OCTAVE.
Il ne vous demande jamais si vous sortez ?
IRMA.
Si, tous les jours.
OCTAVE.
Eh bien ?
IRMA.
Mais pas de cette façon.
OCTAVE.
Ah ! ce sont des nuances qui ne signifient pas grand-chose.
IRMA.
Et puis, vous savez, moi, quand j’ai un pressentiment...
OCTAVE.
Il se réalise toujours ?
IRMA.
Non, il ne se réalise pas, mais il ne faut pas que je me dise trop qu’il ne se réalisera pas. Sans cela, il se réalise.
OCTAVE, pressant.
Écoute, ne pense pas à tout cela, viens près de moi, je te parlerai doucement, tendrement, tu oublieras toutes ces idées.
IRMA, sans l’écouter.
Tout à l’heure, dans l’escalier qui est obscur, dans le coin du palier au premier, vous savez, l’endroit où l’escalier tourne, j’ai bien cru qu’il y avait une ombre.
OCTAVE.
Vous finirez par m’impressionner... Mais calmez-vous, ma chère amie, admettez un instant que votre mari vienne, eh bien ! vous ne risqueriez rien.
IRMA.
Je ne risquerais rien ?
OCTAVE.
Non, vous passerez par cette porte.
Il la mène contre la porte.
Vous traverserez cette pièce, vous vous trouverez dans la cuisine, puis, dans l’escalier de service, vous monterez deux étages, il y a un appartement vide, la clef est sur la porte de la cuisine, vous n’aurez qu’à entrer et, là, attendre tranquillement le départ de votre mari. Ainsi, tu vois, tu n’as plus peur ?
IRMA, souriant.
Non, je n’ai plus peur.
On sonne.
C’est certainement lui !
OCTAVE, agité.
N’ayez pas peur, voyons, n’ayez pas peur.
Son agitation redouble.
Traversez la pièce, puis la cuisine, puis deux étages à monter.
Il la pousse doucement.
Si ce n’est pas lui, j’irai tout de suite vous chercher.
À peine est-elle sortie que la bonne ouvre la porte et que Dumorel, le chapeau sur la tête, la canne à la main, écumant de fureur, se précipite sur la scène.
DUMOREL.
Ma femme est là, monsieur ! ma femme est là, il est inutile de le nier ! Ah ! damoiseau ! Ah ! ignoble petit galvaudeux ! Je vais vous apprendre à vous moquer de moi, polisson, à vous jouer de l’honneur d’une femme et de celui d’un brave homme ! Vous allez voir la vengeance que je vais tirer de vous, je vais vous tuer comme un chien !
Octave prend un air digne. Dumorel le regarde, puis sa figure se détend, il sourit et retire son chapeau.
Voilà ce qu’aurait dit un mari d’il y a trente ans, mais que voulez-vous, monsieur, le changement des mœurs, la plus grande liberté laissée aux femmes qui ne sont plus enfermées... comment appelle-t-on ça ?... dans les gynécées, l’institution même du divorce : tout a contribué à faire perdre au mariage son caractère de rigueur... Je sais, monsieur, que, pour la seconde fois, ma femme s’est rendue chez vous aujourd’hui... Je le sais, parce que tout bonnement je me suis adressé à une agence qui la suit depuis quelque temps. Cette agence, ce n’est pas par jalousie que je l’avais mise en mouvement. J’avais une autre arrière-pensée et, pour tout dire, un plan, monsieur. Je vous l’avoue tout net, je désire, depuis quelque temps, reprendre ma liberté, mais ma conscience ne me le permettrait que si j’étais en droit de le faire. Du moment que ma femme m’a donné un prétexte de séparation, ma conscience m’autorise à en profiter. Seulement, que voulez-vous ? je ne suis pas un mauvais homme et je ne veux pas brusquer la situation. Je n’abandonnerai ma femme que si je suis sûr qu’elle a trouvé dans la vie un autre protecteur qui lui assure une existence paisible. Je vous demande donc carrément : « Êtes-vous disposé à l’épouser ?... » Attendez, ne me répondez pas tout de suite et permettez-moi de m’asseoir.
OCTAVE.
J’allais vous en prier.
Ils s’assoient tous les deux.
DUMOREL.
Je tiens à vous dire exactement pourquoi je tenais à reprendre ma liberté. Il n’y a pas d’incompatibilité véritable entre ma femme et moi... mais, depuis quelque temps, je suis, comment vous dirai-je ? je suis amoureux, oui, je suis très amoureux d’une certaine personne qui s’occupe de cuisine... chez moi... mais je me hâte d’ajouter que ce n’est pas une cuisinière ordinaire... C’est une femme divorcée qui, avant la guerre, occupait une situation enviable dans un pays du Nord. Elle a dû venir à Paris et, comme elle manquait de ressources, elle a été obligée de se placer chez moi. Elle m’a plu, je crois que je ne lui ai pas déplu... Je lui fais une cour discrète... Mais c’est une femme de principes très rigoureux, elle ne me cédera que si je l’épouse. Elle m’a déclaré, en outre, qu’elle ne consentirait à m’épouser que si ma femme avait des torts envers moi... Ma femme, jusqu’à présent, n’avait pas de torts envers moi... Le destin, dont vous êtes le délégué, fait qu’elle en a maintenant. Alors, que puis-je vous dire ?... j’entrevois la liberté.
Silence.
OCTAVE.
Monsieur, je ne vous cache pas que votre proposition me prend un peu au dépourvu. Quand j’ai rencontré madame... je ne sais pas son nom...
DUMOREL.
Madame Dumorel...
OCTAVE.
Madame Dumorel... Ce nom ne me dit rien... Quand j’ai rencontré, dis-je, madame Dumorel dans un grand magasin et quand j’ai cru que la foule, la cohue, m’autorisaient à la protéger en la saisissant de chaque côté par le gras du bras, je vous avoue que je ne pensais pas, à ce moment, que j’unirais mon existence à la sienne. Puis j’ai eu, puisque vous le savez maintenant je n’ai aucune raison de vous le cacher, j’ai eu l’occasion de la voir. Je dis simplement de la voir, et je vous prie de croire qu’il n’y a pas eu entre nous autre chose que des conversations platoniques...
DUMOREL.
J’aime mieux ça tout de même. Mais l’important, pour la réalisation de mon projet, est qu’elle ait eu pour vous un sentiment que je suis forcé de qualifier de coupable, puisqu’elle était unie à moi par les liens du mariage.
OCTAVE.
Je puis vous dire, en tout cas, que, de mon côté, ce sentiment existe. Je n’irai pas jusqu’à prétendre que, la première fois que j’ai dit à madame Dumorel que je l’aimais, c’était déjà le grand amour ! Et puis, je lui ai répété si souvent « Je vous aime » que, par une sorte d’autosuggestion, j’ai fini par l’aimer... Alors, comme vous la trouvez chez moi, comme elle est votre femme légitime, comme vous êtes en droit de m’obliger à une réparation, il serait indélicat de ma part de ne pas accepter la solution tout amiable que vous voulez bien me proposer.
DUMOREL.
J’ai tenu à ne pas soulever la question d’intérêts avant d’aborder la question sentimentale, mais...
Octave va pour parler, il lui fait signe de se taire.
Mais je tiens à vous dire que ma femme a cent vingt mille francs de rentes bien à elle.
OCTAVE, très sérieux.
Arrêtez, monsieur, après ce que vous venez de me dire là, je n’ai plus le droit de vous écouter. Du moment qu’il est question d’intérêts entre nous, je suis obligé de vous dire nettement, très dignement... brisons là !...
Dumorel le regarde étonné.
OCTAVE, sourit et continue.
Voilà ce qu’aurait dit un jeune homme d’il y a trente ans, et puis, il aurait peut-être fini par accepter la proposition après s’être fait légèrement prier. Moi, j’appartiens à une époque plus franche et je n’use pas de pareilles hypocrisies ! J’ai une petite situation qui m’est créée par ma famille, une situation honorable, mais modeste. Je ne suis donc pas fâché que madame Dumorel ait, de son côté, des ressources assez brillantes pour me permettre de continuer à lui assurer le confortable auquel elle doit être habituée.
DUMOREL.
En somme, tout ceci me paraît fort bien.
OCTAVE.
C’est parfait... J’aurai une grande satisfaction intime à assurer à madame Dumorel une existence heureuse.
Il feuillette machinalement un catalogue illustré d’autos.
Un petit landaulet 12 HP pas trop grand. Pour la ville et pour les excursions c’est plus que suffisant ; je vais en retenir un le plus tôt possible par des relations que j’ai dans l’automobile, parce que c’est désagréable d’attendre...
Il repose le catalogue.
Mais, j’y songe, il faudrait dire à madame Dumorel, qui était un peu inquiète tout à l’heure...
DUMOREL.
Elle était inquiète ?
OCTAVE.
Oui, elle était troublée, il lui semblait avoir remarqué que vous aviez quelques soupçons.
DUMOREL.
Tiens, pourtant, il me semblait que j’avais bien dissimulé. Elle était inquiète ?
OCTAVE.
Oui, très énervée, une surexcitation que j’essayais de calmer, mais qui ne se passait pas.
Coup de fusil.
DUMOREL, se levant effrayé.
Qu’est-ce que c’est que ça ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Où est-elle ?
OCTAVE, calme.
C’est rien, c’est un tir à la carabine.
DUMOREL.
Un tir à la carabine ?
OCTAVE.
Oui, il y a un tir dans le terrain vague à côté.
DUMOREL.
Oh ! mais c’est très désagréable cela, vous n’auriez pas pu trouver un endroit plus agréable ?
Coup de fusil.
Oh ! je n’aime pas ça !
OCTAVE.
Il faut attendre, ça doit être un carton. Vous savez, cinq balles...
Troisième coup de fusil.
Oui, c’est simplement un carton.
DUMOREL.
Il n’y a pas de conversation possible !
OCTAVE.
Attendons encore, qu’est-ce que vous voulez.
Silence.
Eh bien ! vous voyez, ce n’est pas un carton, c’est plutôt un individu qui tire à l’œuf, tantôt il tire deux balles, puis tantôt trois balles... Nous pouvons continuer à causer, c’est fini.
DUMOREL.
En ce qui concerne ma femme, je désire qu’on ne lui apprenne pas la chose tout de suite, parce que, auparavant, je voudrais en parler à Régina...
OCTAVE.
Régina ?
DUMOREL.
Oui, oui, enfin la personne de chez moi que la question de cuisine intéresse.
OCTAVE.
Mais moi, qu’est-ce que je vais dire à votre femme alors ?
DUMOREL.
Dites-lui que c’était un monsieur, un raseur, qui venait vous relancer, que ce n’était pas moi.
OCTAVE.
Alors, je ne dirai rien, vous avez ma parole.
DUMOREL.
Voyons, voulez-vous venir chez moi tout à l’heure, d’ici deux heures par exemple ?
OCTAVE.
Oui, dans deux heures, mais vous ne m’avez pas donné votre adresse ?
DUMOREL.
Ah ! c’est vrai. Monsieur Dumorel, 112, rue Galilée.
OCTAVE.
Bon, bon !
DUMOREL.
À tout à l’heure, donc, à quatre heures !
Il fait un mouvement comme pour lui serrer la main.
Nous nous serrerons la main quand tout sera arrangé, n’est-ce pas ? Il vaut mieux attendre jusque-là, c’est plus correct.
Octave le conduit jusqu’à la porte.
Et puis, ce qui sera bien, une fois que nous serons mariés, c’est qu’elle ne fera plus la cuisine, parce qu’il faut vous le dire, entre nous, mais que ça ne lui soit jamais répété, elle a beaucoup de prétentions, elle la fait très mal.
Il sort.
OCTAVE, resté seul.
Dumorel, 112, rue Galilée... Tiens, je n’ai pas demandé l’étage, mais Irma me le donnera... Ah non ! au fait, je ne dois pas en parler à Irma.
Il sort. À peine est-il sorti qu’on entend un coup de sonnette ; peu après, la petite bonne fait entrer Dick et Achille par la porte du fond. Elle sort.
DICK, au comble de l’indignation.
Bien, nous l’attendrons.
À Achille.
Je t’ai amené ici, parce que je veux que tu fasses, toi-même, l’aveu de ta gaffe, de ton effroyable gaffe ! C’est inimaginable !
Regardant Achille.
Avoir affaire à une moule pareille ! Comment, un monsieur vient me trouver à mon cabinet de détective.
Il pousse un soupir.
Une agence secrète que je viens de fonder, et une agence secrète, ça ne peut exister qu’avec une large publicité qui dépasse trente mille francs. Tu entends, trente mille francs qui n’étaient pas à moi, passons... Un monsieur donc arrive au bureau, il me demande de faire suivre sa femme. Je te charge de la filature. Tu l’attends à la porte et tu suis une autre femme, tu la suis jusqu’ici. Alors, je fais savoir à monsieur Dumorel que sa femme le trompe et qu’elle vient retrouver un monsieur dans cet immeuble, impasse Jolicœur. Ce monsieur Dumorel ne fait ni une ni deux et se précipite ici, où il doit être maintenant. Ah ! quels dégâts, quels dégâts il a dû faire en arrivant ici !...
ACHILLE.
Mais qu’est-ce que tu veux, mon vieux, je me suis conformé au signalement qu’on m’avait donné.
DICK, l’imitant rageusement.
Au signalement qu’on m’avait donné !... Tu ne pouvais pas parler au concierge ?
ACHILLE.
Mais ce monsieur Dumorel t’avait bien recommandé de ne pas parler au concierge.
DICK.
Mais, nom d’un chien, il faut avoir de l’initiative dans ces heures-là ! Mes trente mille francs de publicité sont à l’eau. Qui est-ce qui voudra m’employer maintenant, après une gaffe pareille !
ACHILLE.
Ça ne se saura pas.
DICK.
Ça se sait toujours ! Et puis qu’est-ce qui va se passer dans cette maison ? Qu’est-ce qui va se passer ?... Et je serai responsable de tout !
Un coup de fusil. Il tressaille.
Ah ! mon Dieu ! ça y est, nous arrivons trop tard, il l’a tuée !...
ACHILLE.
Mais puisque ce n’était pas sa femme ?
DICK.
Est-ce qu’on sait, dans le trouble, l’affolement, puis la chambre à coucher était peut-être obscure.
Coup de fusil.
Ah ! mon Dieu ! voilà qu’il tue l’amant maintenant.
Il tombe accablé sur une chaise.
Ah ! c’est abominable, quelle responsabilité ! Ah ! qu’est-ce qui va me tomber sur la tête !
Nouveau coup de fusil. Il se lève précipitamment.
Il s’est tué ! Il a retourné son arme contre lui, il s’est tué !...
ACHILLE.
Comment peux-tu savoir tout ça ?
DICK.
Je le devine, et puis, ces coups de fusil, que les balles soient pour elle, pour lui ou pour l’autre, c’est épouvantable ! Foutons le camp !
Ils sortent tous les deux.
IRMA, entre suivie d’Octave par une porte de côté.
Enfin, allez-vous vous décider à parler ?
OCTAVE.
Je n’ai pas voulu vous le dire dans l’escalier.
IRMA.
Mais nous ne sommes plus dans l’escalier.
OCTAVE.
Eh bien ! c’était votre mari qui était là.
IRMA.
Ah ! mon Dieu !
OCTAVE.
Seulement, vous ne savez rien...
IRMA.
Comment je ne sais rien ?
OCTAVE.
J’ai donné ma parole d’honneur que je ne vous répéterais rien de ce qui s’est dit entre nous.
IRMA.
Mais vous allez me le dire sans manquer un mot.
OCTAVE.
Certainement, seulement, auparavant, il faut que je vous demande quelque chose. Il m’a fait jurer que je ne vous parlerai de rien, je m’y suis engagé, mon honneur est en jeu. Alors vous allez me jurer à moi que jamais vous ne lui direz que je vous l’ai dit.
IRMA, impatiente.
Mais oui, c’est entendu !
OCTAVE.
Ma chérie, il ne suffit pas de dire que c’est entendu.
IRMA.
Vous ne me croyez pas ?
OCTAVE.
Mais si, mais si, je crois parfaitement à votre discrétion autant qu’à la mienne.
Après réflexion.
Plus qu’à la mienne. Il faut tout de même que vous soyez protégée contre vous-même si on vous presse de parler, il faut que vous puissiez vous dire : J’ai juré ! Allons, jurez-moi... sur quoi pouvez-vous me jurer ?
IRMA.
Ah ! qu’il est fatigant ! parlez, parlez !...
OCTAVE.
Sur quoi pouvez-vous me jurer ? Je ne parlerai pas avant.
IRMA.
Il n’y a qu’un seul serment que je puisse vous faire, et celui-là est si terrible, que je n’ose le formuler.
OCTAVE.
Quel serment ?
IRMA.
Sur la mémoire de Gabriel, l’ami que j’ai perdu. Ah ! non, non, ce n’est pas possible, je ne peux pas jurer sur la mémoire de Gabriel !
OCTAVE.
Mais pourquoi ? Puisque vous êtes décidée à tenir votre serment !
IRMA.
C’est un serment trop effroyable !
OCTAVE.
Écoutez, ma chère amie, je ne vous comprends pas. Je vous demande un serment sérieux, vous pouvez bien le prononcer puisque, moi, j’ai donné ma parole d’honneur à votre mari.
IRMA.
Mais vous ne l’avez pas tenue, votre parole d’honneur ?
OCTAVE.
Vous voyez bien ! Alors, il faut quelque chose de plus important encore, sur la mémoire de la personne dont vous venez de parler.
IRMA.
Ne me demandez pas ça, je ne jurerai jamais sur la mémoire de Gabriel !
OCTAVE, fermement.
En ce cas, je ne dirai rien.
IRMA, rapidement.
Alors je jure sur la mémoire de Gabriel !
OCTAVE.
Je vais donc parler.
IRMA.
Enfin !
OCTAVE.
D’ailleurs, ce n’est qu’une discrétion de quelques heures que je vous demande, puisque j’ai rendez-vous dans deux heures avec votre mari.
IRMA.
Où ça ?
OCTAVE.
Chez lui, il m’a donné son nom et son adresse. Je sais maintenant, ma chérie, votre nom et votre adresse. Nous devons continuer la conversation sur ce qu’il m’a proposé.
IRMA.
Mais que vous a-t-il proposé ?
OCTAVE.
C’est tellement important, tellement beau, tellement miraculeux, que je ne trouve pas le mot pour le dire... Il m’a proposé de vous épouser.
IRMA, étonnée.
De m’épouser ?
OCTAVE.
Mais, vous ne partagez pas ma joie ?
IRMA.
Mais si, mon ami, mais si... actuellement, ma première impression... c’est tout de même la surprise... cette proposition venant de lui...
OCTAVE.
Il m’a proposé de vous épouser !
IRMA.
C’est stupéfiant qu’il ait pu vous proposer cela !
OCTAVE.
Cela vous étonne tellement ?... Puisqu’il faut tout vous dire, il a autre chose dans sa vie...
IRMA.
Autre chose dans sa vie ?
OCTAVE.
Oui, vous ne vous en doutiez pas ? On dit que les maris sont aveugles, mais les femmes ne sont guère plus clairvoyantes. Vous avez chez vous, près de vous, une femme dont il est amoureux.
IRMA.
Près de moi ?
OCTAVE.
Une femme à votre service.
IRMA.
Une bonne à moi ?
OCTAVE.
Oui.
IRMA.
Ce n’est pas possible, voyons, ce serait Séraphine !
OCTAVE.
Qui est Séraphine ?
IRMA.
Ma femme de chambre, je ne vois que ma femme de chambre.
OCTAVE.
Vous n’avez pas de cuisinière ?
IRMA.
J’ai une cuisinière.
Riant.
Mais elle ne compte pas. Si vous la voyiez, vous pousseriez des hurlements à l’idée qu’on puisse imaginer de pareilles horreurs !
OCTAVE.
Eh bien ! je vous dis la chose brutalement, puisque vous ne voulez pas me croire. Voici ses propres paroles : « Je vous propose, monsieur, d’épouser ma femme, parce que je vais épouser ma cuisinière. »
IRMA.
C’est de la folie !
OCTAVE.
Je n’ai pourtant pas l’air d’être fou.
IRMA.
Mais c’est lui qui est fou. C’est une effroyable aberration de l’esprit et des sens ! Se peut-il qu’un homme ait de ces perversités ?
OCTAVE.
D’ailleurs, il paraît que votre cuisinière n’est pas une femme ordinaire et qu’elle est très bien.
IRMA, levant les yeux au ciel.
Elle est très bien ? Mon mari est fou !
OCTAVE.
Elle occupait une très belle situation avant la guerre, elle arrive des départements du Nord et des revers de fortune l’ont obligée à se placer chez vous.
IRMA.
Il n’y a pas un mot de vrai là-dedans. C’est une histoire romanesque qu’il vous a racontée. C’est peut-être parce qu’il a eu un éclair de raison, à l’idée d’avoir pu tomber dans une dégradation pareille. Il a tenu à relever un peu à vos yeux cette créature.
OCTAVE.
Mon amie, ce n’est pas à cela maintenant que vous devez penser.
IRMA.
À quoi voulez-vous que je pense !
OCTAVE, avec un étonnement douloureux.
Vous le demandez ? Mais on vous propose d’unir votre vie à la mienne, on vous apprend, en même temps, que vous avez un mari indigne... je ne sais pas, moi, mais il me semble...
IRMA, décidée.
Vous avez raison... Si vraiment mon mari est l’amant de la cuisinière...
OCTAVE.
Il n’a pas dit qu’il était l’amant de la cuisinière, il a dit qu’il voulait l’épouser.
IRMA.
C’est encore plus monstrueux. Si vraiment il a des goûts aussi anormaux, il faut que je me sépare de lui.
OCTAVE, pressé.
Mais oui, chérie, mais oui, d’autant plus que vous avez près de vous l’amoureux le plus tendre, le plus fidèle... Si tu avais vu ma joie quand il a parlé d’unir mon sort au tien, de ne jamais te quitter ! Il n’y a qu’une chose, ma chérie, qui m’a fait hésiter... un scrupule, parce que tu sais, moi, si ma famille est aisée, si j’ai un jour un peu de bien, je ne suis pas, pour le moment, ce qu’on appelle fortuné, et toi, il paraît que tu es riche...
IRMA, étonnée.
Riche ?
OCTAVE.
Oh ! comme elle a dit ça avec surprise ! faut-il qu’elle soit habituée à l’opulence ! Ton mari m’a appris que tu avais à toi cent vingt mille francs de rentes.
IRMA.
Mais ce n’est pas vrai !
OCTAVE.
Comment, ce n’est pas vrai ?
IRMA.
Je ne sais pas ce qui l’a poussé à vous dire ça ! J’ai eu en tout et pour tout une dot de quatre-vingt-dix mille francs, et je crois qu’elle est très fortement entamée.
OCTAVE.
Voyons, vous êtes sûre ? Je ne vous demande pas ça, bien entendu, pour être renseigné... Ah ! ça m’est bien égal.
Mollement.
Au contraire, au contraire... cela fait disparaître un scrupule que j’éprouvais, étant donné la disproportion de nos situations. Il n’y a qu’une petite chose qui m’ennuie, c’est que cela semble indiquer que votre mari m’a monté le coup, et ceci, joint à cette histoire de cuisinière, me fait me demander s’il a bien sa raison !
IRMA, comme à elle-même.
Peut-on s’imaginer qu’on a vécu pendant des années à côté d’un individu sans s’apercevoir que c’est un être abominable !
À Octave.
Oh ! Octave ! oh ! mon ami ! je veux être votre femme, je veux que vous me sortiez de cette vie de honte et de mensonge !
OCTAVE, généreux.
Mais oui... mais oui...
IRMA.
Je vous impose, peut-être, une charge un peu lourde ?
OCTAVE.
Je travaillerai, mon amie, je travaillerai... je travaillerai et je me rendrai digne de vous...
La regardant.
Nous allons être heureux.
Il ne peut s’empêcher d’être un peu triste.
IRMA.
Alors, je vais rentrer chez moi.
OCTAVE.
Oui, j’y viendrai tout à l’heure, j’ai rendez-vous maintenant d’ici une heure et demie avec votre mari.
Mollement.
Ma chérie...
IRMA.
Oui, oui.
Elle s’en va doucement vers la porte.
OCTAVE.
Votre mari m’a donné son nom et son adresse, il ne m’a pas dit quel étage ?
IRMA.
Au troisième.
OCTAVE, avec une conviction volontaire.
Nous allons être bien heureux !
IRMA.
Oui, oui.
Tout en parlant, elle est allée du côté de la porte du fond.
OCTAVE a pris la main d’Irma et veut serrer la jeune femme dans ses bras.
Plus tard, plus tard...
Grave.
Oui, oui, vous êtes ma fiancée, maintenant.
Elle sort. Il reste un instant sur le seuil de la porte, la main sur les lèvres, en lui envoyant un long baiser, puis il revient à l’avant-scène, abîmé dans ses réflexions. Il prend machinalement le catalogue d’automobiles, le regarde, et, quand il s’aperçoit qu’il l’a entre les mains, le jette violemment à terre avec dégoût. Rentre Henri.
HENRI.
Dis donc, mon vieux, on peut entrer ?
OCTAVE.
Ah ! c’est toi ?
HENRI.
Justement, j’avais quitté mon bureau et, en passant devant ta porte, j’ai vu sortir une jeune femme.
OCTAVE.
C’était elle, elle sort à l’instant... Mon vieux, un événement très important...
HENRI.
Comme tu me dis cela ! Grave ?
OCTAVE.
Assez grave.
HENRI.
Événement malheureux ?
OCTAVE, vivement.
Non, non, plutôt heureux... le mari est venu, j’ai fait disparaître la jeune femme. Un mari très accommodant qui a une intrigue ailleurs. Il m’a proposé d’épouser sa femme, j’ai accepté.
HENRI.
C’est très bien, mais quelle situation a-t-elle ? Je sais que la question sentimentale a de l’importance, mais il y a aussi la question capitale.
OCTAVE.
Ne t’occupe pas de ça, nous aurons de quoi vivre... nous travaillerons, car je tiens à travailler.
HENRI.
Ah !
OCTAVE.
À propos, cette place de directeur d’usine, dont tu parlais tout à l’heure, il faut que tu me la fasses obtenir à moi.
HENRI.
Tu es fou ! Quatorze heures de travail par jour !
OCTAVE.
Ça ne m’effraie pas.
HENRI.
Et ça t’est venu subitement le goût du travail ?
OCTAVE.
Oui, je te dirai que, depuis aujourd’hui, il s’est fait en moi une transformation. J’ai vu brusquement la vie d’une façon plus sérieuse, plus grave... je suis heureux.
HENRI.
Comme tu dis ça, tu n’as pas l’air très emballé.
OCTAVE.
C’est un bonheur encore un peu confus, il faut que je m’en rende bien compte. D’ailleurs, il faut que je sorte, je suis obligé d’aller chez le mari d’ici très peu de temps. Accompagne-moi, je te raconterai tout en chemin. Nous causerons, en marchant doucement... nous causerons... Tu vas trouver en moi un ami de très bon conseil...
HENRI.
Tant mieux, parce que tu sais, moi, je ne me fais pas meilleur que je suis, j’ai besoin de conseils dans la vie.
OCTAVE.
Je t’empêcherai de faire des imprudences.
HENRI.
Oh ! comme tu deviens raisonnable !
OCTAVE.
J’acquiers de l’expérience, je distingue ce qui est inconsidéré de ce qui est réfléchi. Ainsi, ce que j’ai fait, moi, d’aborder une femme que je ne connaissais pas, ça a eu un très beau résultat, un résultat miraculeux ! Ça n’empêche pas que c’était très imprudent...
HENRI.
Mais, enfin... tu es content ?
OCTAVE.
Mais qu’est-ce qu’il a à me demander tout le temps si je suis content ! Je te l’ai dit une fois pour toutes.
Coup de fusil.
Encore un coup de fusil !
Il a un instant de tristesse. Avec force.
Je suis bien content ! ... Alors, partons, je suis bien content !...
ACTE II
La scène se passe dans un petit salon, chez monsieur Barnereau ; porte au premier plan à gauche et au premier plan à droite. Les entrées des personnes venant du dehors se font par une porte en pan coupé au fond à gauche.
Au lever du rideau, Séraphine, femme de chambre, est en scène. Irma entre, son chapeau sur la tête.
IRMA.
Séraphine, je vais enlever mon chapeau dans ma chambre et je monterai ensuite au quatrième chez madame Merlier. Si monsieur me demande, vous direz que je suis là-haut.
SÉRAPHINE.
Bien, madame.
Irma sort par la droite, au fond.
Barnereau est entré peu après par la porte de droite ; il lit une lettre qu’il vient d’écrire.
BARNEREAU.
...Madame la Directrice des Annales, je vous serais obligé de vouloir bien lire ma conférence de demain et me dire ensuite si vous jugez convenable que j’y apporte des modifications quelconques. Veuillez agréer, etc.
On sonne.
Qu’est-ce que c’est ?
SÉRAPHINE.
Je vais ouvrir, monsieur.
Barnereau s’installe devant un petit bureau à droite, placé de profil. Il est assis entre le bureau et la porte de droite. Il insère sa lettre dans une enveloppe.
SÉRAPHINE, rentrant.
Monsieur, c’est le locataire du premier, monsieur Dumorel.
BARNEREAU.
Qu’est-ce qu’il me veut ?
SÉRAPHINE.
Il voudrait, qu’il dit, parler à monsieur.
BARNEREAU, à lui-même, d’un air indifférent.
Qu’est-ce qu’il veut ?
Haut.
Priez-le de venir. Une seconde, j’ai un coup d’œil à jeter encore sur ma conférence.
Il regarde sa montre.
Voyons, il est trois heures. Est-ce que madame n’est pas rentrée ?
SÉRAPHINE.
Je vous demande pardon, monsieur, madame est rentrée, il y a quelques minutes. Elle a été ôter son chapeau, qu’elle a dit, puis elle est montée au quatrième, chez son amie madame Merlier.
BARNEREAU, après avoir jeté un coup d’œil rapide sur des feuillets.
Bien, vous allez me faire une course, vous irez jusqu’aux Annales, porter ma conférence. Vous direz qu’on la remette à la directrice et vous attendrez, pour voir s’il y a une réponse.
Il écrit l’adresse sur l’enveloppe.
C’est entendu, Séraphine, vous allez me porter cela tout de suite. Et maintenant, faites entrer ce monsieur.
Séraphine, sur le pas de la porte, fait signe à Dumorel d’entrer, puis elle sort.
DUMOREL, entrant, une casquette assez voyante à la main.
Bonjour, monsieur Barnereau !
BARNEREAU, se levant.
Bonjour, monsieur Dumorel ! Qu’est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite et qu’est-ce qui vous a décidé à monter mes trois étages ?
DUMOREL.
Deux étages seulement, monsieur Barnereau, puisque je suis parti de chez moi au premier.
BARNEREAU.
C’est juste, monsieur Dumorel, vous êtes un homme précis.
Il fait signe à Dumorel de s’asseoir en face de lui et, une fois Dumorel assis, reprend sa place sur son fauteuil.
DUMOREL.
Ma visite est un peu soudaine, monsieur Barnereau, je m’en explique à l’instant. À la suite de diverses conversations que j’aurai tout à l’heure avec des personnes... qui me touchent de près, il se produira sans doute dans ma vie une modification... Mais n’anticipons pas... Je me suis souvenu que, l’autre jour, dans l’escalier, vous m’aviez dit que vous cherchiez un appartement dans le quartier pour y établir une pension de jeunes filles... C’était d’autant plus intéressant pour moi, que je n’ai pas le droit de sous-louer à n’importe qui et qu’il est infiniment probable que le propriétaire consentira à ce que je vous sous-loue à vous, puisque vous êtes déjà locataire. Je me suis donc hâté de vous en prévenir, afin que vous ayez l’obligeance de ne pas vous engager ailleurs sans m’en avoir parlé.
Il ouvre une petite boîte de bonbons.
Un bonbon ?
BARNEREAU.
Je ne suis pas très fort pour les sucreries, merci...
DUMOREL, tendant la boîte.
Ils sont excellents.
Barnereau va pour prendre un bonbon.
Mais prenez donc toute la boîte.
BARNEREAU.
Toute la boîte ?
DUMOREL.
J’en ai dix mille, monsieur Barnereau. Oui, c’est une affaire que j’ai faite le mois dernier. C’est curieux, n’est-ce pas, depuis que je suis retiré des affaires, j’en fais beaucoup plus qu’avant ! Je reviens à la question. Mon appartement, comme je vous le disais, sera donc libre avant peu.
BARNEREAU.
Je vous remercie beaucoup de cette communication, monsieur Dumorel.
DUMOREL.
Vous vous demandez, sans doute, quel peut être ce changement d’existence dont je vous parle ?
BARNEREAU.
Je ne poserai jamais, monsieur Dumorel, une question aussi indiscrète.
DUMOREL.
Monsieur Barnereau, croyez bien que je n’hésiterais pas à vous en faire confidence, car j’ai une confiance absolue dans votre discrétion et dans l’austérité de votre personnalité, mais le mur de la vie privée doit être... voyons... doit être...
BARNEREAU.
Opaque.
DUMOREL.
Opaque, c’est cela. Ah ! comme c’est agréable d’avoir affaire à un homme instruit ! Moi, je ne suis qu’un ancien négociant, je n’ai pas autant de mots à ma disposition. Je ne dis pas que je m’exprime mal... mais souvent...
BARNEREAU.
Souvent, le terme précis vous échappe ?
DUMOREL.
M’échappe sans m’échapper, je finis toujours par le trouver... mais quelquefois je mets du temps.
BARNEREAU.
Alors, ça ralentit la conversation.
DUMOREL, riant.
Eh oui ! ça ralentit la conversation et, comme aujourd’hui je suis un peu pressé, nous avons tout intérêt à ne pas... comment dirais-je ?...
BARNEREAU.
À ne pas perdre de temps.
DUMOREL.
C’est l’expression que je cherchais. Ah ! ah ! attendez...
Il tire un stylo et un carnet.
Il faut que j’écrive le mot « opaque ». Je sais parfaitement ce qu’il signifie, mais il ne m’est pas familier.
BARNEREAU.
Vous avez un bon stylo.
DUMOREL, tout en écrivant.
C’est la marque la meilleure, mais vous allez me permettre de vous l’offrir ?
BARNEREAU.
Vous plaisantez, monsieur Dumorel !
DUMOREL.
J’en ai cent quarante douzaines...
Il tend le stylo à Barnereau qui fait un geste discret de refus. Dumorel insiste et Barnereau finit par prendre le stylo.
Je disais donc, ou plutôt vous disiez, que le mur de la vie privée doit toujours rester...
Il regarde son carnet.
opaque.
Avec satisfaction.
Opaque. Bien entendu, je ne parle pas pour vous, monsieur Barnereau, vous pourriez vivre dans une maison de verre.
BARNEREAU.
Je n’y contredis pas, monsieur Dumorel, mais je n’ai pas de mérite à mener une existence limpide et sûre ; ma situation et mon métier m’y obligent absolument.
DUMOREL.
Vous êtes professeur dans un cours de jeunes filles ?
BARNEREAU.
Oui, depuis plus d’un an. Avant j’étais dans un lycée de garçons. Puis, j’ai donné ma démission pour rentrer dans un établissement libre où j’ai professé la morale pratique. Je dois dire que mon enseignement a été accueilli avec faveur. La renommée a enflé peut-être exagérément mon succès qui, gagnant de proche en proche, est arrivé jusqu’à la directrice des Annales. Cette dame m’a fait l’honneur de me demander une série de conférences. Me voilà donc devenu, au milieu d’un cercle de fidèles de plus en plus étendu et de plus en plus élégant, une sorte de directeur de conscience et, même si mes instincts et mon éducation ne me le conseillaient pas, je serais tenu, par ma profession même, par une sorte d’apostolat, de donner l’exemple d’une vie absolument irréprochable. Dans cette voie de la responsabilité, si j’ose dire, je ne saurais être trop strict. Il ne me suffit pas de satisfaire ma conscience, mais je ne dois rien faire dans mon existence qui puisse donner lieu à la calomnie. C’est d’ailleurs pour cette raison que, depuis quelque temps déjà, j’ai demandé au Conseil d’État de changer mon nom.
DUMOREL.
Ah ! je ne savais pas.
BARNEREAU.
Le décret me l’a accordé avant que j’entre dans cette maison où je ne suis plus connu que sous le nom de Barnereau qui est désormais mon nom légal, mais mon véritable nom est Papavoine. Papavoine, je vous l’apprends peut-être, est le nom d’un assassin dont je ne suis pas du tout le descendant ; une simple homonymie. Ce personnage célèbre a été, il y a deux ans, mis dans un film. Alors, dans le cours où je professais, on me faisait des plaisanteries, des chansons de plus ou moins bon goût. J’ai donc demandé à prendre le nom de mon grand-père maternel qui s’appelait Barnereau.
DUMOREL, se levant.
Eh bien ! monsieur Papavoine, je vous demande pardon, monsieur Barnereau, il me reste à me retirer. Dès que je serai dégagé d’une certaine discrétion que je suis obligé d’observer encore quelque temps, je viendrai vous parler de mes affaires personnelles et je vous demanderai même une petite consultation comme à un directeur de conscience. Vous voyez... directeur de conscience, j’ai bien retenu le terme que vous avez employé.
BARNEREAU.
À votre disposition, monsieur ! Oh ! comme vous avez une belle casquette !
DUMOREL.
Oui, je la mets toujours quand je suis à la fenêtre, à mon balcon, et je vous dirai même que, dans l’appartement, je préfère avoir la tête couverte.
BARNEREAU.
Ah ! je suis bien de votre avis. À un certain âge, on commence à avoir le front dégarni, et moi je m’enrhume à chaque instant !
DUMOREL, lui tendant la casquette.
Voulez-vous me permettre de vous l’offrir ?
BARNEREAU.
Vous plaisantez, monsieur Dumorel ?
DUMOREL.
Je n’en ai que trois cents, mais je vous assure que vous me ferez un grand plaisir en acceptant.
BARNEREAU.
Je suis confus.
DUMOREL.
Je suis trop heureux de vous être agréable, mais soyez tranquille, je vous mettrai à contribution, monsieur le professeur de morale pratique.
BARNEREAU.
Alors, si ce sont des honoraires anticipés, j’accepte votre casquette.
DUMOREL.
Au revoir donc, cher monsieur, et pensez à l’appartement !
BARNEREAU.
Je vous en parlerai dès demain.
Il met la casquette sur la table et va pour reconduire Dumorel qui proteste.
DUMOREL.
Ne vous donnez pas la peine, je trouverai bien le chemin, puisque votre appartement a exactement la disposition du mien.
BARNEREAU, insistant.
Mais voyons, mais voyons !
Au moment où ils vont sortir, entrent Irma, Arthur Merlier et Germaine Merlier.
DUMOREL.
Ah ! mais voilà des personnes de connaissance, monsieur Barnereau ! Monsieur et madame Merlier, toute la maison est réunie : le premier, le troisième et le quatrième !
BARNEREAU, à Irma et aux autres.
Je reconduis monsieur Dumorel et je suis à vous. Irma, j’ai envoyé la femme de chambre porter la conférence aux Annales.
IRMA.
Tu es rentré depuis peu de temps ?
BARNEREAU.
Je ne suis pas sorti, mon enfant.
Il sort avec Dumorel.
IRMA, à Arthur et Germaine.
Il dit qu’il n’est pas sorti !
ARTHUR.
Quelle force de dissimulation !
GERMAINE, à Irma.
Il ne veut pas te dire maintenant qu’il a été impasse Jolicœur, et c’est pour cette raison, si tu veux m’en croire, qu’il a envoyé la femme de chambre en course, afin que tu n’aies pas l’idée de l’interroger et de lui demander si monsieur est sorti après le déjeuner.
ARTHUR.
Quant à la cuisinière...
IRMA lève les yeux au ciel.
La cuisinière !...
GERMAINE.
Celle-là, il est sûr de sa discrétion !...
IRMA.
Quel satyre ! Vous la connaissez ma cuisinière ?
ARTHUR.
Je l’ai déjà aperçue chez vous et en bas sous le porche, mais je n’ai jamais fait grande attention à elle.
GERMAINE.
Moi non plus ! J’avoue que je l’aurais regardée davantage si j’avais su quelle place elle occupait dans les préoccupations sentimentales de ton mari !
IRMA.
Quelle horreur !
Germaine lui fait signe de se taire en montrant la porte par où va entrer Barnereau.
BARNEREAU, entrant.
Bonjour, les amis Merlier, vous allez être gentils et m’excuser si je ne puis rester avec vous. Il faut que j’aille dans ma bibliothèque pour préparer les éléments de ma seconde conférence.
IRMA.
Tu attends quelqu’un ?
BARNEREAU, à son bureau, lui tournant le dos et rangeant des papiers sur la table.
Non, je n’attends personne.
Irma regarde Germaine qui regarde Arthur.
GERMAINE, à mi-voix.
Il sait mentir !
BARNEREAU.
Ah ! bon ! voilà les livres du ménage. Avant d’aller travailler, il faut que je vérifie les comptes avec la cuisinière.
GERMAINE, regardant Irma.
Ah !
ARTHUR.
Ah ! c’est vous qui faites les comptes de la cuisinière ?
BARNEREAU.
Mais oui, les chiffres, c’est plutôt mon affaire à moi que celle de ce petit oiseau...
Il caresse du doigt le menton d’Irma qui se détourne instinctivement.
GERMAINE, à Arthur, bas.
Tu parles, Tartuffe !
IRMA.
Eh bien ! alors, nous allons te laisser... te laisser seul avec Célestine.
Coup d’œil à Arthur.
BARNEREAU.
Mais vous pouvez rester, vous ne me gênez pas.
IRMA.
Je sais bien que nous ne te gênons pas.
ARTHUR.
Et vous n’avez même pas besoin de nous le dire.
IRMA.
Mais cette séance de comptes de cuisinière, ça n’a vraiment aucun intérêt pour nos amis.
À Arthur et à Germaine.
Vous venez dans ma chambre ?
ARTHUR.
Oui, nous venons.
Ils entrent dans la chambre à gauche premier plan, après avoir jeté un regard significatif sur Barnereau qui a déjà commencé à examiner le carnet.
BARNEREAU, seul, il sonne.
Pas moyen de se retrouver dans ces comptes !
On frappe.
Entrez !
Entre Célestine, elle est malpropre, laide, elle a le nez rouge, elle est d’un âge indéfinissable et très négligée dans son accoutrement.
Ah ! vous voilà !
Il reste quelques instants, le nez dans ses comptes.
C’est un vrai casse-tête chinois, vos livres, vous faites des chiffres qui n’ont pas figure humaine et vous ne les mettez jamais les uns en dessous des autres. Comment voulez-vous vérifier une addition dans des conditions pareilles ! Est-ce que vos gages sont compris dans le total ?
CÉLESTINE.
S’ils sont compris ?
BARNEREAU.
Vous ne comprenez pas le mot compris, hein, n’est-ce pas ? Je vous demande si vous avez marqué vos gages ?
CÉLESTINE.
Oui, monsieur, le 8 de chaque mois.
BARNEREAU, lisant.
2 fr. 50 ?
CÉLESTINE.
Oh ! non, monsieur, c’est des francs, c’est 250 francs.
BARNEREAU.
Je le sais. Mais pourquoi mettez-vous les 50 dans la colonne des centimes ? En revanche, j’aperçois là 45 francs d’allumettes. Je sais bien que la vie est chère...
CÉLESTINE.
C’est 0 fr. 45, monsieur.
BARNEREAU.
Ces 45 centimes sont dans la colonne des francs.
On frappe au premier plan à gauche.
Entrez.
Entre Arthur.
C’est vous qui frappez avant d’entrer ?
ARTHUR.
Je ne sais pas, j’ai frappé machinalement. Je vous dérange ?
BARNEREAU.
Mais non, pourquoi est-ce que vous me dérangeriez ?
Arthur va se mettre un peu au fond et regarde longuement Célestine.
ARTHUR, à part.
C’est inimaginable !
BARNEREAU, continuant ses comptes.
260 francs d’épinards ?
CÉLESTINE.
2 fr. 60.
BARNEREAU, du bureau.
Ah ! je m’en doutais.
ARTHUR, au bout d’un instant, après avoir pris un petit air malin.
On m’a raconté ce matin une histoire extraordinaire. L’histoire d’une réfugiée, oui, d’une réfugiée du Nord.
Il regarde en dessous Célestine.
Il paraît que cette personne assez riche a été obligée de se placer à Paris pour faire la cuisine.
BARNEREAU.
Oh ! quelle plaisanterie !
ARTHUR.
Évidemment, évidemment, c’est une plaisanterie ! Je retourne près de ces dames.
À part, après un autre coup d’œil à Célestine.
C’est inimaginable !
Il sort par la gauche, premier plan.
BARNEREAU, continuant ses comptes avec Célestine.
Ma fille, c’est absolument impossible d’en sortir !
CÉLESTINE, pleurant.
Si monsieur me fait comme ça des misères, je m’en irai. Je ne suis pas embarrassée, j’ai une place toute prête dans mon pays.
BARNEREAU.
Toujours la menace à la bouche ! Vous savez bien que les domestiques sont difficiles à trouver et vous en abusez. Je vous demande de faire attention à vos comptes, ce n’est pas le diable !
CÉLESTINE, pleurant.
C’est affreux de se voir disputer comme ça tout le temps.
On frappe à gauche, premier plan.
Qu’est-ce que c’est ?
GERMAINE.
Je ne vous dérange pas ?
BARNEREAU.
Mais non, voyons, qu’est-ce que vous avez tous à imaginer que vous me dérangez !
GERMAINE, examinant Célestine, à part.
C’est formidable !
Elle l’examine de nouveau.
Oh ! je vous demande pardon, j’étais venue chercher une adresse dans l’annuaire.
Elle fait mine de regarder l’annuaire du téléphone.
BARNEREAU, à Célestine.
Il faudra que vous me recopiiez complètement tous ces chiffres, je ne pourrai vérifier votre total et vous régler votre compte qu’à ce moment-là. Allez.
Célestine sort. À Germaine.
C’est une fille susceptible, mais qu’est-ce que vous voulez, pour le moment, on ne peut pas en trouver, et puis, c’est un peu la faute d’Irma qui, tout de même, devrait être plus soigneuse et plus ordonnée.
GERMAINE, grave, descendant en scène.
Votre femme, Adrien, a des qualités très sérieuses, vous savez. J’ajoute qu’elle a pour vous un attachement véritable, croyez-en sa meilleure amie, un attachement que vous ne pouvez soupçonner.
BARNEREAU.
Mais si, je sais ça parfaitement, mais à propos de quoi me dites-vous cela ?
GERMAINE, un peu embarrassée.
Je vous dis cela pour rien, parce que l’occasion s’en présente. D’abord, entendez-moi bien, Irma ne peut pas vous être infidèle. Je crois tellement à sa fidélité, que je la verrais de mes yeux en conversation tendre avec un jeune homme, que dis-je, chez un jeune homme, que je demeurerais persuadée de son innocence !... Elle voudrait vous tromper qu’elle ne le pourrait pas.
BARNEREAU.
Mais j’espère bien qu’elle ne le veut pas !
GERMAINE, à elle-même.
Il est impénétrable.
BARNEREAU.
Ma chère amie, je vais travailler dans ma bibliothèque, vous m’excuserez. Ah ! la cuisinière a encore oublié son carnet. Quel désordre !... quel désordre !...
GERMAINE, souriant.
Et puis, entre nous, elle n’est pas jolie, jolie...
BARNEREAU.
Ah ! pas précisément, mais ça m’est bien égal, pourvu qu’elle fasse bien mon affaire... Au revoir.
Il sort par la droite, premier plan. Germaine, aussitôt après le départ de Barnereau, ouvre la porte de gauche et fait signe à Arthur et Irma de venir.
GERMAINE.
Venez un peu par là. Eh bien ! vraiment, cet homme a une maîtrise de lui-même merveilleuse !... Je lui ai lancé quelques pointes, il n’a pas sourcillé.
ARTHUR.
Mais que dis-tu de cette cuisinière ?
GERMAINE.
C’est fantastique !
ARTHUR.
Dire que cet homme austère, l’austérité même, a pu faire son idole de cette créature ! C’est évidemment un cas pathologique.
IRMA.
Je ne peux pas y croire.
ARTHUR, à Irma.
Vous savez, chère amie, les cas analogues sont beaucoup plus fréquents qu’on ne le croit. J’ai connu un homme, dans la force de l’âge, qui était amoureux fou d’une vieille femme siamoise de soixante-dix ans !
GERMAINE.
Oui, c’est extraordinaire, oui, mais cette vieille siamoise avait peut-être un intérêt exotique qui fait tout à fait défaut à Célestine.
ARTHUR, sérieux.
En matière de dépravation, tout est possible. Un jour, dans l’esprit de cet homme un peu déprimé par la vie casanière qu’il mène, un jour, a poussé cette idée vicieuse de posséder Célestine.
IRMA.
C’est vrai !
ARTHUR.
Il lui a sans doute fait des avances, elle lui a résisté.
GERMAINE.
Elle lui a résisté, je me demande pourquoi ?
IRMA.
En effet, il est difficile de s’expliquer pourquoi, car s’il s’agissait d’une fille d’une conduite exemplaire... Je ne surveille pas trop les sorties de mes bonnes, mais celle-là, je le sais par la femme de chambre... il lui est arrivé quelquefois de découcher.
GERMAINE.
Peut-être s’est-elle dit que, si elle cédait à son patron, elle risquait de perdre sa place.
IRMA.
Pourquoi ? Elle sait qu’elle en retrouverait une autre demain.
GERMAINE.
C’est peut-être pour l’exaspérer par sa résistance et pour l’avoir plus sûrement à elle.
ARTHUR.
Voyons, parlons peu, mais parlons bien, il est trois heures et demie, c’est vers quatre heures que le jeune homme en question va venir voir votre mari ?
IRMA.
Oui.
ARTHUR.
Eh bien ! voulez-vous mon avis ? Avant qu’il le voie, il faut le mettre au courant de la question. Quand Barnereau lui a dit : « Je consens à ce que vous épousiez ma femme », il a pris au sérieux cette proposition ?
IRMA.
Oh ! je vous crois qu’il l’a prise au sérieux. Quand je l’ai revu, le bonheur était peint sur sa figure !
ARTHUR.
Vraiment ? Mais d’abord, étant donné le caractère pathologique, je le répète, du cas de Barnereau, cette combinaison de divorce et de remariage ne peut pas être envisagée aussi sérieusement. La proposition émane d’un être anormal.
GERMAINE.
Enfin, parle-moi franchement, ma chère amie. Tu peux parler devant Arthur. Est-ce que toi, tu tiens à épouser ce garçon ?
IRMA.
Je ne peux pas dire qu’il ne me plaise pas. S’il ne m’avait pas plu, je ne serais jamais allée chez lui. Je sais bien que ma visite ne pouvait pas avoir de conséquences, car vous savez à quel point je suis attachée à la mémoire de ce pauvre Gabriel. Je considérais même que le fait d’aller voir ce jeune homme était une trahison à l’égard du pauvre disparu et jamais je ne vous en aurais parlé, si cela n’avait été dans ces circonstances : la visite de mon mari et la proposition qu’il a faite à Octave.
ARTHUR.
Enfin, Octave ne vous déplaît pas ; il y a même à présumer qu’il vous plaît, mais de là à l’épouser, à changer complètement votre vie... Au moment où il vous a transmis la proposition d’Adrien, qu’est-ce que vous avez pensé ?
IRMA.
J’ai été prise au dépourvu, un peu en désarroi. Mais je lui ai dit que je serais sa femme. Il est impossible de revenir sur ce que je lui ai dit.
ARTHUR.
Pourquoi, impossible ?
IRMA.
Mais ce garçon ne pense qu’à cela maintenant ! Si on lui disait que je reprends ma parole, ce serait pour lui un déchirement épouvantable !
ARTHUR.
Eh bien ! que voulez-vous, ce sera un déchirement. Nous sommes vos amis déjà depuis une dizaine d’années et nous avons le devoir de vous parler le langage de la raison. Ce serait une folie d’épouser ce garçon, tout simplement parce que l’idée du mariage a poussé dans la tête un peu dérangée de votre mari.
IRMA.
Il est possible que vous ayez raison, vous voyez la chose avec plus de sang-froid ; mais même si je vous écoutais, comment voulez-vous dire à ce garçon qu’il faut renoncer à nos projets ?
ARTHUR.
Vous pouvez toujours vous en sortir. Voyons, vous direz que votre mari est malade et que vous n’avez pas le droit de l’abandonner. C’est pour cette raison qu’il me paraît nécessaire de revoir ce jeune homme avant qu’il se retrouve en présence de Barnereau. Qu’est-ce qu’il fait, Barnereau, maintenant ?
IRMA.
Il doit être tout à son travail dans la bibliothèque. Quand il est dans son travail, vous savez, ça l’absorbe complètement.
ARTHUR.
Au point d’oublier qu’il a un rendez-vous à quatre heures ?
IRMA.
Je vous dis que c’est un homme étonnant, que son travail l’absorbe beaucoup.
ARTHUR.
C’est peut-être encore là un signe qu’il n’a pas sa tête à lui, s’il oublie le rendez-vous que lui-même a fixé il y a deux heures.
GERMAINE.
Est-ce que, de sa bibliothèque, on entend sonner ?
IRMA.
On entend sonner, mais, quand il travaille, il ne fait peut-être pas attention.
ARTHUR.
Tout de même, il vaut mieux que ce jeune homme ne sonne pas.
GERMAINE.
On ne peut pourtant pas l’attendre dans l’escalier.
ARTHUR.
Non, mais ce qu’Irma peut faire – il va arriver maintenant d’ici quelques minutes – ce qu’Irma peut faire, c’est de le guetter à la fenêtre. Quand elle le verra entrer dans la maison... vous lui avez bien dit à quel étage c’était ?
IRMA.
Oui, je lui ai dit au troisième.
ARTHUR.
Eh bien ! quand vous le verrez entrer sous la porte, vous irez tout de suite dans l’antichambre et vous lui ouvrirez vous-même sans qu’il ait à sonner.
IRMA.
C’est une idée ! Je vais le guetter à la fenêtre.
GERMAINE, l’embrassant.
À tout à l’heure, ma chérie, nous t’aimons bien, tu sais ?
IRMA.
Oui, vous êtes de bons amis.
Elle sort à gauche, premier plan.
GERMAINE, à Arthur.
Je n’ai pas du tout l’impression qu’elle tient à épouser ce jeune homme. Elle ne le dit pas, mais je le vois bien.
ARTHUR, songeur.
Je reviens à mon idée.
Comme à lui-même.
Barnereau, un jour, brusquement, a le désir de posséder Célestine. Il trouve chez elle une résistance inattendue, ça l’énervé, il veut l’avoir à tout prix, jusqu’à lui promettre le mariage. Tout est possible dans cet ordre d’idées, mais je suis persuadé que, si une fois seulement Célestine cédait à Barnereau...
GERMAINE.
Tu me dégoûtes !
ARTHUR, continuant.
Ça suffirait pour le détourner d’elle à jamais.
Décidé.
Voici ce que je vais faire, je vais en parler à cette fille, elle est moins sur ses gardes que notre ami Barnereau, elle est moins forte aussi. Plus j’y pense, plus je vois que c’est le seul moyen de guérir le pauvre homme de cette idée fixe. Tu te rappelles cette phrase qui, un jour, t’avait fait sourire quand nous l’avions lue ensemble dans un vieux livre : « Le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c’est d’y succomber » ? Il faut que Barnereau ne soit plus tenté par Célestine.
GERMAINE.
Oh ! je n’aimerais pas assister à la conversation que tu auras avec elle.
ARTHUR.
Va tenir compagnie à Irma et ne lui parle pas de ce que je vais faire.
GERMAINE.
Oh ! oui, parce que l’image de ce qui pourra se passer entre Barnereau et Célestine lui sera certainement odieuse.
ARTHUR, sonnant.
Je vais faire venir Célestine.
GERMAINE.
Comment vas-tu lui dire ça ?
ARTHUR.
Tu peux rester.
GERMAINE.
Oh ! non, je n’y tiens pas !
Entre Célestine par le fond à droite ; Germaine s’en va par le premier plan à gauche, après l’avoir regardée en levant les yeux au ciel, comme pour dire : « Ça dépasse tout ! »
CÉLESTINE.
C’est monsieur qui a sonné ?
ARTHUR.
Oui, c’est moi qui ai sonné.
CÉLESTINE.
Est-ce que monsieur et madame dîneraient ici ?
ARTHUR.
Non, non, il n’en est pas question.
CÉLESTINE.
Ah ! bien, monsieur.
ARTHUR.
Dites donc, Célestine, arrivez voir un peu par ici !
CÉLESTINE.
Qu’est-ce qu’il y a, monsieur ?
ARTHUR.
Il ne faut pas jouer au plus fin avec moi, ma fille.
CÉLESTINE.
Au plus fin ?
ARTHUR, brusquement.
Pourquoi ne voulez-vous pas coucher avec monsieur Barnereau ?
CÉLESTINE, stupéfaite.
Pourquoi je ne veux pas coucher avec monsieur Barnereau ?
ARTHUR.
Oui, oui, ne faites pas la maligne.
CÉLESTINE.
Mais monsieur ne m’a jamais demandé une chose pareille !
ARTHUR.
Il ne vous l’a jamais demandée ?
À part.
Elle a l’air sincère.
Haut.
Oh ! tout de même, il a bien fait quelques avances ?
CÉLESTINE, bêtement.
Quelles avances ?
ARTHUR.
Vous ne savez pas ce que c’est ? Enfin, vous n’avez pas remarqué qu’il tournait autour de vous ?
CÉLESTINE.
Qu’il tournait autour de moi... oh ! monsieur... en tout cas, je ne m’en ai pas aperçu ! Sûr qu’il n’est pas drôle, monsieur, tout le temps à me disputer...
ARTHUR.
Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire !... Dites donc, ça vous ferait-il plaisir de gagner un billet de cent francs ?
CÉLESTINE.
Ça fait toujours plaisir.
ARTHUR.
Voilà cent francs. Quand vous vous trouverez seule avec monsieur Barnereau, vous le regarderez comme ça, bien en face, dans les yeux, et vous lui direz que vous voulez bien coucher avec lui.
CÉLESTINE.
Oh ! bien, par exemple, jamais je n’oserai lui dire ça. Je vois bien ce qui arriverait !... Il m’enverrait un grand coup de pied dans le derrière et il me flanquerait à la porte.
ARTHUR.
Je vous donne en tout cas ma garantie personnelle que vous ne serez pas mise à la porte.
CÉLESTINE.
Mais, monsieur, qu’est-ce que madame va dire ?
ARTHUR.
Madame n’en saura rien ; d’ailleurs, je vous garantis qu’elle ne dira rien. Alors, ça va ?
CÉLESTINE.
Oh ! je ne dis pas que ça va, je vais y penser. Peut-être bien que je vais vous dire oui, que j’accepte et puis, qu’après ça, j’aurai pas l’audace et que je vous rendrai les cent francs... Ça, ça m’embêterait, par exemple.
Léger bruit de sonnette.
On sonne au service, monsieur, il faut que j’aille ouvrir. Dites donc, monsieur, une supposition qu’il veuille, qu’est-ce qu’il faudra faire ?
ARTHUR.
Vous n’avez qu’à faire tout ce qu’il vous demandera.
CÉLESTINE.
Ah ! ça, c’est rigolo, par exemple !
Elle sort par la droite, au fond, au moment où Germaine entre rapidement dans la pièce, suivie d’Irma.
GERMAINE.
Le voilà ! Voilà le jeune homme, il vient de tourner le coin de la rue.
IRMA.
Je vais donc l’attendre dans l’antichambre.
GERMAINE.
Oui, tu ouvriras doucement la porte de l’escalier, comme ça, tu le verras arriver et il n’aura pas à sonner.
Irma sort par le fond, à gauche.
ARTHUR, à Germaine.
Eh bien ! Tu sais, je viens d’interroger la cuisinière. Barnereau ne lui a jamais parlé de rien, il n’a pas osé. Elle fera tout ce que je lui ai dit. GERMAINE, prêtant l’oreille.
Je crois que voilà le jeune homme.
Après un instant de silence, Irma entre dans la pièce, précédant Octave.
IRMA, présentant Octave.
Monsieur Octave Ormont, mes amis, monsieur et madame Merlier. Monsieur Octave, mes amis sont au courant de tout. Le serment que je vous ai fait de ne rien rapporter de la conversation de mon mari ne tient pas pour eux, n’est-ce pas ? parce que je suis absolument sûre de leur discrétion. Ils sont donc au courant de la proposition de mon mari.
Un temps.
Je crois qu’il serait bon de faire un tour dans la bibliothèque pour voir s’il est bien en train de travailler, parce qu’il ne faut tout de même pas qu’il rentre à l’improviste.
GERMAINE, vivement.
Oui, vas-y, c’est une idée !
Silence. Irma sort par la droite. À Octave.
Je suis très contente qu’elle ait eu l’idée de s’éloigner, et puisqu’elle nous a laissés seuls, j’en profite pour vous dire une chose dont il faut que vous teniez compte. Elle aime profondément son mari ; d’autre part, cette histoire de cuisinière est parfaitement inimaginable. Le cas de notre ami est tout à fait morbide. Taisons-nous, elle revient !
IRMA, rentrant en scène.
Il est absorbé, j’ai tourné dans sa chambre, il n’a même pas fait attention à moi.
GERMAINE.
Nous, ma chérie, nous allons remonter chez nous. Quand vous aurez causé, monsieur Ormont verra ton mari, puisqu’il a rendez-vous avec lui.
IRMA.
C’est que mon mari semble avoir tout à fait oublié qu’il devait recevoir monsieur.
OCTAVE.
Eh bien ! on en sera quitte pour le faire demander.
GERMAINE.
À tout à l’heure, ma chérie, à tout à l’heure !
Elle fait un signe de politesse amicale à Octave, ils sortent par le fond, à gauche.
OCTAVE, s’approchant d’Irma va pour l’embrasser, mais elle lui tend la main qu’il baise.
Ma chère âme, je ne fais que penser depuis tout à l’heure à ce que sera notre vie tout entière consacrée à l’amour, et pour moi, du moins, au travail. Je travaillerai à l’usine avec acharnement, mais le soir, en rentrant dans notre chez nous, quelle récompense !
IRMA.
Ah ! mon ami, je suis bien malheureuse ! Nous avons parlé de tous ces projets, mes amis et moi, et ils n’ont fait que me répéter que le cas de mon mari relève de la médecine. Quand il vous a fait cette proposition, il était, selon eux, dans un état anormal. Alors, mon ami... ah ! je vous fais toutes mes excuses de vous parler ainsi... mais je ne puis pas ne pas vous dire que j’ai un scrupule à accepter ma liberté d’un homme malade, à l’abandonner tout seul à l’étrangeté de sa passion. Si je ne reste pas à côté de ce pauvre homme pour le surveiller, c’est fini, sa vie est brisée !
OCTAVE.
Alors quoi, mon amie ?
IRMA.
Alors, mon ami, a-t-on le droit de goûter égoïstement ce bonheur de vivre sa vie en sacrifiant un être humain ? Ah ! j’ai à vous dire une chose si terrible que je ne sais comment la formuler... Si je vous demandais... si je vous demandais de me rendre ma parole ?...
OCTAVE, après un silence.
Ah ! Irma, vous me demanderiez le plus grand sacrifice de ma vie !
IRMA.
Mon Dieu, mon Dieu ! que me dites-vous là ! Alors, je n’ose plus vous le demander...
OCTAVE, vivement.
Si, si, demandez-le-moi, je suis prêt à tout pour vous. Vous voulez que je m’éloigne ? Je m’éloignerai en emportant dans mon cœur le plus cher et le plus douloureux des souvenirs.
IRMA, émue.
Vous êtes un saint !
OCTAVE, ému.
Mon Dieu ! non, je suis un homme, je compatis aux tristesses humaines.
La regardant.
Mais faudra-t-il renoncer à vous complètement ?
IRMA, attendrie.
Je ne sais si j’ai le droit de vous priver de ma tendresse.
OCTAVE.
Ah ! non, puisque vous me demandez un si grand sacrifice.
IRMA.
Eh bien ! nous verrons...
OCTAVE, content.
Oui, oui, nous verrons.
IRMA.
Ah ! ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.
OCTAVE.
Si si, vous l’avez dit, ne vous rétractez pas, ma petite Irma que j’aime.
Se reprenant et poussant un soupir.
C’est égal, c’est un gros chagrin pour moi de ne pas vous épouser, mais jurez-moi que vous serez ma petite amie, à moi, ma vraie petite amie...
IRMA.
Ne me le demandez pas et attendez l’avenir.
Ils se tiennent par la main et se regardent un instant en silence.
C’est bien, ce que nous faisons !...
OCTAVE.
Ah ! c’est douloureux ; mais que voulez-vous, si cet homme n’est pas dans un état normal...
IRMA.
Oh ! ne me parlez pas de cela, c’est effrayant ! Je sais que c’est mon devoir de ne pas l’abandonner, mais je me demande si j’aurai la force de ne pas courir à vous, de peur de rester avec un pareil mari !
OCTAVE.
Si, si, il faut rester à votre devoir !
IRMA.
Vous êtes bon, j’ai une grande admiration pour vous, mon ami, vous êtes un être parfait.
À demi-voix.
Admirable. Je vous aime.
Le regardant.
Écoutez, si nous ne faisions pas ce sacrifice ?
OCTAVE, vivement.
Mais puisqu’il est fait maintenant, ma chère amie ! Je vous en prie, arrêtons-nous à une décision et tenons-nous-y, car c’est terrible d’aller de l’extrême désespoir où je me trouve quand je pense que vous ne serez pas ma femme, à l’extrême joie où je serais en me disant que vous allez l’être, et puis de revenir au désespoir... puis à la joie... puis au désespoir à nouveau !...
IRMA.
Où est le devoir, Octave ?
OCTAVE, grave.
Vous l’avez dit tout à l’heure, Irma.
IRMA.
Maintenant, le moment est venu pour vous de voir mon mari. Mais il ne doit pas savoir que nous avons eu cet entretien préalable.
OCTAVE.
D’autant qu’il est convenu que je ne vous ai rien dit de ses projets.
IRMA.
Alors, écoutez, je vais sonner... on viendra et vous le ferez prévenir.
Elle sonne et gagne la porte premier plan à gauche.
OCTAVE, avec tristesse.
Vous savez, je ne suis pas heureux.
IRMA, d’un air désespéré.
Je ne suis pas heureuse non plus !
Elle sort. Octave reste un instant seul. Il réfléchit, prend malgré lui un air très joyeux et se frotte les mains. Entre Célestine.
CÉLESTINE.
On m’a sonné, monsieur ?
OCTAVE.
Oui.
Il l’examine
Vous êtes la cuisinière ?
CÉLESTINE.
Oui, monsieur.
OCTAVE, stupéfait.
Pas possible !
CÉLESTINE.
Pas possible, comment pas possible ? Monsieur trouve que j’ai l’air d’une femme de chambre ?
OCTAVE.
Non, non, rassurez-vous, vous avez bien l’air d’une cuisinière. Voulez-vous prévenir monsieur Dumorel que je voudrais le voir.
CÉLESTINE.
Mais monsieur Dumorel n’est pas ici, monsieur.
OCTAVE.
Comment, monsieur Dumorel n’est pas ici ?
On sonne.
CÉLESTINE.
Il faut que j’aille ouvrir, la femme de chambre n’est pas là.
OCTAVE, resté seul.
Pourquoi Irma me dit-elle que Dumorel est dans sa bibliothèque et pourquoi la cuisinière prétend-elle qu’il n’est pas ici ? Tout ceci est un peu louche !
CÉLESTINE, entrant.
Monsieur, c’est justement monsieur Dumorel.
OCTAVE.
Comment, c’est lui qui sonnait !
CÉLESTINE.
Oui, monsieur.
OCTAVE.
Il sonnait à la porte d’entrée ?
CÉLESTINE.
Mais oui, monsieur.
OCTAVE.
Il n’a pas sa clef sur lui ?
CÉLESTINE.
Je ne sais pas s’il a sa clef sur lui, je ne lui ai pas demandé.
OCTAVE.
Dites donc, s’il n’a pas la clef de la porte d’entrée, il a bien celle de votre chambre ?
CÉLESTINE.
Monsieur Dumorel, la clef de ma chambre ! Pensez-vous, monsieur !
OCTAVE.
En tout cas, s’il ne l’a pas, il voudrait bien l’avoir !
CÉLESTINE, stupéfaite.
Oh ! il ne m’a jamais dit ça.
OCTAVE.
Il me l’a dit à moi.
CÉLESTINE.
Ça, c’est trop fort par exemple !
OCTAVE, se reprenant.
Je vous demande pardon... Vous ne l’avez pas vu, depuis tout à l’heure ?
CÉLESTINE.
Monsieur Dumorel ?
OCTAVE, comme à lui-même.
Alors, j’ai gaffé !
À Célestine.
Mettons que je n’aie rien dit.
CÉLESTINE.
Je vais y dire d’entrer.
En allant à la porte.
Qu’est-ce qu’ils ont tous à courir comme ça après moi !
Ouvrant la porte.
Voulez-vous entrer par ici, monsieur.
Entre Dumorel, sans regarder Célestine. Octave les observe l’un et l’autre.
DUMOREL, entrant.
Ah ! vous voilà, vous ?
Célestine sort au fond à droite.
OCTAVE, à Dumorel, lui désignant la porte par où est sortie Célestine.
Elle est intéressante.
DUMOREL.
Qui ça ?
OCTAVE.
Cette personne qui vient de sortir par là.
DUMOREL.
J’ai pas regardé.
OCTAVE, à part.
J’ai encore gaffé, probablement !
DUMOREL.
Figurez-vous que j’étais à la fenêtre à vous guetter à quatre heures. Je vous vois entrer dans la maison, je vais m’asseoir dans mon salon, pensant que vous alliez sonner d’un moment à l’autre. J’attends dix minutes, vingt minutes, je descends chez le concierge, je lui explique comment vous êtes, il me dit qu’il avait vu, en effet, un monsieur qui répondait à votre signalement et que ce monsieur était entré au troisième.
OCTAVE.
Oui, je n’ai rien demandé au concierge, parce que tout à l’heure, chez moi, madame Dumorel m’a dit que vous habitiez au troisième.
DUMOREL.
Comment, vous lui avez parlé de moi ?
OCTAVE.
Non, nous avons parlé des appartements d’une façon générale. Alors, dans la conversation, elle m’a dit que vous habitiez au troisième.
DUMOREL.
Vous vous êtes certainement trompé, elle n’a pu vous dire ça, car nous avons toujours habité au premier. Ici, nous sommes chez monsieur Barnereau.
OCTAVE.
Chez monsieur Barnereau ! Alors, il y a une chose que je ne comprends pas du tout, c’est que tout à l’heure...
Hésitant.
une personne qui se trouvait là m’a dit qu’on était chez monsieur Dumorel.
DUMOREL.
Cette personne a dû se payer votre tête. Enfin, quoi qu’il en soit, laissez-moi vous dire qu’il vaut mieux retarder un peu notre conversation jusqu’à ce que j’aie parlé à ma femme. Vous allez ressortir de la maison, vous ferez ce que vous voudrez, mais ne venez donc pas chez moi avant une demi-heure ou même trois quarts d’heure.
OCTAVE.
Alors, voyons, précisons ! Ici, chez qui suis-je ?
DUMOREL.
Mais, je vous le répète, vous êtes chez monsieur Barnereau. Écoutez, plutôt que de ressortir, vous n’avez qu’à vous présenter à monsieur Barnereau, c’est un professeur qui fait des conférences. Vous allez lui dire que vous venez lui demander où vous pourriez louer des places, pour les conférences en question. Attendez, je vais sonner. Comme ça vous resterez tranquillement ici dans cet appartement jusqu’à ce que je vienne vous chercher. Faites prévenir monsieur Barnereau que vous êtes ici.
Il sonne lui-même.
Moi, je redescends.
Entre Célestine, qui reste au fond.
OCTAVE, à l’avant-scène, à Dumorel.
Alors, dites donc, cette femme-là, c’est la cuisinière de monsieur Barnereau ? Ce n’est pas la vôtre, celle dont vous m’avez parlé ?
DUMOREL.
Mais vous êtes un peu piqué, je crois ! Régina, dont je vous ai parlé, n’est pas une cuisinière ordinaire.
OCTAVE.
Enfin, je ne sais pas, moi... Alors... Régina est bien ?
DUMOREL.
Ah ! c’est une fort jolie fille.
OCTAVE.
Vous n’êtes pas aveuglé par la passion ?
DUMOREL.
Pourquoi me dites-vous cela ?
OCTAVE.
Parce que, tout à l’heure, une personne qui se trouvait là, que je ne connais pas, disait que votre cuisinière n’était pas aussi bien que vous vouliez le dire.
DUMOREL.
Mais, à propos de quoi avez-vous parlé de cela à cette personne ?
OCTAVE.
À propos de cuisinières. Nous parlions de domestiques, des difficultés qu’il y avait à en trouver...
DUMOREL.
Avec une personne qui connaissait ma cuisinière ?
OCTAVE.
Oui.
DUMOREL.
Et qui est cette personne ?
OCTAVE.
Je ne sais pas, une personne qui se trouvait ici tout à l’heure.
DUMOREL.
Enfin, nous recauserons de ça. Je viens vous reprendre d’ici une demi-heure ou peut-être avant.
Il sort.
CÉLESTINE, descendant à l’avant-scène.
Qu’est-ce qu’il y a pour votre service, monsieur ?
OCTAVE.
Il faudrait prévenir monsieur Barnereau que je voudrais lui parler. CÉLESTINE, à part.
Oui, et puis moi aussi j’aurais à lui dire quelque chose. Enfin, je lui dirai tout à l’heure.
Songeuse.
Je lui dirai plus tard...
Elle s’éloigne et sort à droite premier plan.
OCTAVE, seul.
Je ne sais pas du tout ce que je vais raconter à ce Barnereau !... Ah ! tout ce qui se passe ici est bien étrange... Je suis au milieu de fous... ou de menteurs... Je commence à ne pas être rassuré. Je suis tout de même un garçon courageux... mais toutes ces choses inexpliquées... tout ce mystère... ça m’énerve !
À ce moment, entre Barnereau, par la droite, premier plan. Octave le regarde.
Tiens ! monsieur Papavoine !...
Barnereau le regarde avec étonnement.
Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Papavoine, parce que j’ai changé, mais vous, vous êtes toujours le même. Vous étiez mon professeur à Jeanson-de-Sailly.
BARNEREAU, à son bureau.
En effet, oui, je commence à me souvenir maintenant. Ah ! c’est qu’il m’est passé tellement d’élèves devant les yeux. Je suis resté douze ans à Jeanson et vous étiez soixante par classe, et je faisais encore des cours dans d’autres divisions ! Mais vous savez, mon ami, je ne m’appelle plus Papavoine.
OCTAVE.
Ah ! pourquoi ?
BARNEREAU.
Je m’appelle Barnereau.
OCTAVE.
Comment, c’est vous qui êtes monsieur Barnereau ?
BARNEREAU.
C’est moi qui suis monsieur Barnereau. Et que me vaut le plaisir de votre visite ?
OCTAVE, à lui-même.
Je ne me rappelle plus exactement ce que je devais lui dire.
À Barnereau.
Eh bien ! monsieur, je voulais vous revoir... je voulais vous revoir...
BARNEREAU.
Vous êtes bien gentil ! C’est une idée qui vous a prise comme ça, brusquement ?
OCTAVE.
Oui, tout à coup, un souvenir d’enfance !... Les souvenirs d’enfance sont attendrissants...
BARNEREAU.
Comment, vous vouliez me revoir et vous avez été étonné quand vous m’avez aperçu ?
OCTAVE, bafouillant.
Oui, parce que je n’espérais pas vous voir... Je ne pensais pas que vous me recevriez... Je me disais que vous étiez sans doute très occupé...
BARNEREAU.
Je travaillais justement à une conférence.
OCTAVE, à lui-même.
Ah ! oui, ça y est !
Haut, vivement.
C’est précisément des billets que je voulais vous demander. Oh ! pas des billets à l’œil, je voulais savoir où l’on pouvait se procurer des billets pour votre conférence. C’est ça, je n’étais pas venu voir monsieur Papavoine, j’étais venu voir monsieur Barnereau. Alors, ce qui m’a surpris, c’est qu’au lieu de monsieur Barnereau, je voyais monsieur Papavoine...
BARNEREAU, un homme qui ne comprend pas.
Je saisis, je saisis.
À lui-même.
Il n’est pas très... posé, ce jeune homme !... Voyons, soyons poli.
À Octave.
Je suis très touché que vous soyez venu me rendre visite et j’espère bien que vous ne vous en tiendrez pas là.
OCTAVE, s’asseyant.
Ah ! oui, je suis bien content de vous revoir, monsieur.
BARNEREAU, à part.
Est-ce qu’il va me coller longtemps comme ça !
SÉRAPHINE, entrant par le fond, à gauche.
Monsieur, voici une jeune femme des Annales qui vient avec les papiers que vous m’aviez donnés.
Entre une jeune femme, type de jeune étudiante, avec un binocle. Barnereau va à elle.
LA JEUNE FEMME DES « ANNALES », très émue.
Monsieur le professeur... Maître... Madame la Directrice m’avait priée de vous soumettre quelques observations et de venir le plus tôt possible pour que vous puissiez faire les modifications sur l’heure... J’en profite
Avec beaucoup de trouble.
pour vous dire toute mon émotion de me trouver en présence d’un homme pour lequel nous avons une vénération véritable... et que nous considérons comme un saint laïque.
BARNEREAU, gentiment.
Je suis touché, mademoiselle... Je vais vous indiquer les corrections que vous pourrez reporter sur mon manuscrit. Veuillez passer dans ma bibliothèque.
À Séraphine.
Conduisez donc mademoiselle dans ma bibliothèque.
Elles sortent toutes les deux par le premier plan de droite. À Octave, avec l’air de dire qu’il voudrait bien que le jeune homme s’en aille.
Je suis occupé, vous le voyez ?
Octave ne comprend pas et reste assis.
OCTAVE.
Oh ! ça ne fait rien, monsieur Barnereau...
BARNEREAU, sans pouvoir réprimer un léger signe d’impatience.
Écoutez, je vais vous faire faire la connaissance de madame Barnereau.
OCTAVE.
Avec plaisir, monsieur.
BARNEREAU va jusqu’à la porte de gauche, premier plan. À lui-même.
Comme ça, ma femme le recevra et il me laissera tranquille !
Il appelle.
Irma, Irma !
Silence.
Irma !... La voici.
Irma arrive jusqu’à la porte que Barnereau a ouverte. Il lui masque la vue d’Octave.
Dis donc, Irma, je suis très occupé et il y a là un jeune homme qui me tanne un peu, je voudrais te le présenter.
IRMA.
Quel jeune homme ?
BARNEREAU.
Un garçon que je connais depuis des années, un ancien élève, monsieur Octave Ormont.
IRMA, le regardant de l’air d’une femme qui croit à une tactique de Barnereau.
Ah ! bon, bon, un de vos anciens élèves ?
BARNEREAU, à Octave.
Alors, mon cher ami, je vais vous présenter à ma femme. Monsieur Octave, madame Barnereau.
Il démasque Irma. Stupéfaction d’Octave. Irma et Octave se tendent.
IRMA.
Très heureuse de faire votre connaissance.
BARNEREAU.
Je vous laisse, il y a une demoiselle des Annales à qui il faut que je donne les corrections de ma conférence.
Il sort par la droite.
OCTAVE.
Oh ! oh !... oh ! oh !... Ah ! qu’est-ce que tout ça veut dire ? Je suis enveloppé de mystère... de conspiration d’abord... Qu’est-ce que vous me racontez, maintenant ! Ce type qui vous présente comme sa femme et qui n’est pas votre mari !...
IRMA.
Comment ce n’est pas mon mari !
OCTAVE, ironiquement.
Alors, vous avez deux maris ?
IRMA.
J’ai deux maris ?
OCTAVE.
Vous vous appelez madame Papavoine ?
IRMA.
Non, je m’appelle maintenant madame Barnereau.
OCTAVE.
Et tout à l’heure madame Dumorel !
IRMA.
Madame Dumorel ?
OCTAVE.
Vous commencez par me dire que vous habitez au troisième, alors que vous habitez en réalité au premier.
IRMA.
Moi, j’habite au troisième et pas au premier !
OCTAVE.
Alors, vous n’êtes pas madame Dumorel ?
IRMA.
Mais je n’ai jamais été madame Dumorel.
OCTAVE, exaspéré.
Elle n’a jamais été madame Dumorel ! Mais vous l’avez dit vous-même, il y a deux heures !
IRMA.
Je vous ai dit ça, moi ?
SÉRAPHINE rentre et annonce.
Monsieur Dumorel.
OCTAVE.
Voilà qui va vous confondre.
Entre Dumorel, pendant que sort Séraphine.
DUMOREL, cérémonieusement.
Madame.
IRMA, cérémonieusement.
Monsieur.
OCTAVE, hurlant.
Qu’est-ce que c’est que cette comédie ! Dans quelle bande d’imposteurs est-ce que je suis tombé !
À Dumorel.
Pourquoi dites-vous madame à votre femme ?
À Irma.
Pourquoi dites-vous monsieur à votre mari ?
DUMOREL.
Mais, madame n’est pas ma femme.
IRMA.
Mais, monsieur n’est pas mon mari.
OCTAVE.
Alors, tout a changé en deux heures ! En deux heures, vous avez eu le temps de changer de femme et madame de changer de mari !
DUMOREL.
Il est fou !
IRMA.
Il est fou, ou bien il y a dans tout ça quelque chose d’incompréhensible.
Entre Barnereau, à droite, premier plan.
OCTAVE.
Voilà qui va tout éclairer.
À Barnereau.
Écoutez, monsieur Papavoine.
BARNEREAU.
Barnereau.
OCTAVE.
Barnereau, Papavoine, Barnereau, je m’en fous ! Monsieur Barnereau, mon ancien professeur, je suis plein de respect pour votre personne. J’ai en vous une confiance absolue. Vous m’avez présenté cette dame comme votre femme et monsieur prétend que c’est la sienne...
DUMOREL.
Mais, je n’ai jamais prétendu cela !
OCTAVE.
Comment, lequel de ces messieurs était, il y a deux heures, impasse Jolicœur ?
DUMOREL.
C’était moi.
IRMA.
Comment, c’était vous ?
BARNEREAU, à Dumorel.
Qu’est-ce que tout ça veut dire ?
Comme Octave a passé pendant ce colloque près d’Irma et que Barnereau a le dos tourné, Irma pince Octave et lui dit tout bas avec véhémence.
IRMA.
Il s’est produit une erreur monstrueuse, mon mari ne sait rien et vous n’allez pas le lui apprendre !
DUMOREL.
Et maintenant, continuons. Quelle était la dame qui se trouvait avec vous impasse Jolicœur ?
OCTAVE.
Je n’en sais rien, moi !
DUMOREL.
Comment, vous n’en savez rien ! Ce n’était pas ma femme ?
IRMA.
Mais si, mais si.
DUMOREL.
Ah ! je respire, vous m’avez fait peur !
À Octave.
Dites donc, je n’ai pu encore la rencontrer, ma femme, attendez-moi quelques instants encore.
Il sort.
IRMA, à voix basse à Octave.
Disparaissez, ça vaut bien mieux.
BARNEREAU, qui a fait quelques pas pour accompagner Dumorel, à Octave.
Enfin allez-vous m’expliquer ?
OCTAVE.
Il n’y a rien à expliquer, monsieur, tout est clair comme de l’eau de roche.
Il sort par le fond, à gauche.
BARNEREAU, à Irma.
Qu’est-ce que ça signifie ?
IRMA.
Mais je ne sais pas, ce sont des fous !
Elle sort par la gauche, premier plan.
BARNEREAU, allant dans la direction d’Irma.
Mais qu’est-ce que ça signifie, Irma ?
Il sort également par la porte de gauche. Entrent Séraphine et Achille.
SÉRAPHINE, entrant par la droite, premier plan, à Achille.
Monsieur Dumorel était ici il y a un instant, il doit être avec notre monsieur dans la bibliothèque, il va repasser par ici.
Elle sort.
ACHILLE, seul.
Je vais peut-être rattraper ma gaffe. Je cours après Dumorel chez lui. On me dit qu’il est monté ici. Je monte par l’escalier de service. Pourvu qu’il ne soit pas descendu pendant ce temps-là par le grand escalier ! Et puis je ne le connais pas. Il paraît qu’il a sur la tête une casquette verte.
À ce moment entre Barnereau avec la casquette que Dumorel lui a donnée.
Ah ! monsieur, je suis content de vous voir. J’ai fait erreur, je viens réparer ma gaffe. La dame qui se trouvait impasse Jolicœur avec le jeune monsieur ce n’était pas madame Dumorel, c’était madame Barnereau.
BARNEREAU, stupéfait.
Qu’est-ce que vous dites ?
ACHILLE.
Rien, rien, monsieur, je n’accepterai rien de vous. La satisfaction de ma conscience me suffit, j’ai réparé ma gaffe.
Il s’en va et ferme la porte au nez de Barnereau. Barnereau revient effaré et tombe sur un fauteuil. À ce moment rentre Célestine, par la porte du fond, à droite.
CÉLESTINE.
Monsieur, j’ai quelque chose à vous dire.
BARNEREAU.
Je n’ai pas le temps de m’occuper de vous.
CÉLESTINE.
Oh ! monsieur, écoutez-moi. Cette fois ce ne sont pas des comptes de cuisine, c’est une affaire de sentiment.
BARNEREAU, à part.
Est-ce qu’elle saurait quelque chose ?...
CÉLESTINE.
Monsieur, je veux bien coucher avec vous.
Elle s’assoit sur les genoux de Barnereau au moment où la demoiselle des Annales rentre par la porte de droite. Effroi de Barnereau, stupéfaction de la demoiselle des Annales.
ACTE III
Dans le salon des Dumorel, au premier étage, même disposition que le salon des Barnereau, meubles et tentures différents.
Irma, suivie d’Octave, entre en scène, au lever du rideau, par la porte du fond, à gauche. Ils sont précédés d’Agathe, femme de chambre des Dumorel.
OCTAVE.
Est-ce que vous pourriez nous annoncer à monsieur Dumorel ? Monsieur Ormont et madame Barnereau.
AGATHE.
Ah ! Monsieur Dumorel n’est pas ici, il vient de monter au sixième.
IRMA.
Il est monté au sixième ?
AGATHE.
Oui, il a dit comme ça qu’il allait jusqu’à la poste. Quand il dit qu’il va à la poste, c’est qu’il est pour monter au sixième. Faut vous dire que monsieur s’occupe beaucoup des ordres à donner pour la cuisine. Du moment que la cuisinière ne se trouve pas près de ses fourneaux, monsieur Dumorel monte dans sa chambre pour lui donner des ordres précis. Mais si monsieur et madame veulent attendre, je crois que monsieur sera bientôt là.
Elle sort.
IRMA.
Voilà une femme de chambre que je ne prendrai jamais chez moi si elle vient à changer de place.
OCTAVE.
Il ne s’agit pas de ça. Qu’est-ce que je vais dire à Dumorel ?
IRMA.
Eh bien ! vous n’avez qu’à l’entretenir dans son erreur. Il croit que sa femme était tout à l’heure impasse Jolicœur, il faut qu’il continue à le croire. Êtes-vous galant homme ou non ?
OCTAVE.
Je pense que vous n’avez pas de doute là-dessus ?
IRMA.
Eh bien ! le galant homme que vous êtes doit faire tout au monde pour empêcher le soupçon de naître.
OCTAVE.
Je vous entends. En ce qui vous concerne c’est irréfutable, mais, est-ce toujours d’un galant homme de laisser planer des soupçons sur une innocente comme madame Dumorel ?
IRMA.
Qu’est-ce que ça peut vous faire ? Une innocente peut être soupçonnée. C’est moins dangereux, en tout cas, que pour une femme coupable.
OCTAVE.
Irma, vous avez peut-être une conception un peu trop personnelle de ce que doivent être des sentiments vraiment chevaleresques.
IRMA.
Vous m’assommez avec votre chevalerie. Vous ne devez avoir qu’une préoccupation, c’est de me sauver.
Elle va à la porte d’entrée et revient.
Tenez, la voilà, madame Dumorel.
Madame Dumorel entre du fond, à gauche. C’est une femme d’un certain âge, rouge de teint et pas très jolie. Elle porte un binocle.
MADAME DUMOREL.
Que me vaut le plaisir ?
IRMA.
Aujourd’hui, madame Dumorel, c’est votre mari que je viens voir avec un ami de mon mari, monsieur Ormont, qui voudrait parler à monsieur Dumorel.
MADAME DUMOREL.
Vous voulez bien m’excuser, n’est-ce pas, je vais retirer mon chapeau.
IRMA.
Mais faites donc, madame. D’ailleurs je vais être obligée de remonter chez moi, aussitôt que j’aurai mis ces deux messieurs en présence.
MADAME DUMOREL.
Je vous demande pardon.
Elle sort par la gauche, premier plan.
OCTAVE.
Et voilà la femme dont vous voulez que j’aie été l’ami !
IRMA.
Elle n’a pas été votre maîtresse, vous l’avez simplement attirée dans votre garçonnière.
OCTAVE.
C’est déjà trop que j’aie pu avoir une idée pareille ! Enfin, vous l’avez vue, est-ce que ce n’est pas la statue vivante de l’austérité ? C’est un sacrilège abominable de laisser soupçonner cette femme une minute seulement. Irma, Irma, vous ne pouvez pas exiger cela de moi !
IRMA.
J’exige que vous me sauviez ! Je vous le commande, puisque votre conscience de galant homme est trop simple pour vous donner des ordres.
Elle sort.
OCTAVE.
C’est pas possible, c’est pas possible ! Laisser le soupçon planer sur une aussi vénérable créature !... Tous les sentiments de respect qu’une forte éducation avait mis en moi et que j’avais d’ailleurs un peu oubliés, il me semble qu’ils se réveillent en présence d’un tel sacrilège !
DUMOREL, entrant de droite, deuxième plan.
Me voilà !
OCTAVE.
Oui.
DUMOREL.
Vous savez que Régina ne me croit pas.
OCTAVE.
Régina ?
DUMOREL.
Oui, la personne en question, elle prétend qu’il est impossible que ma femme puisse avoir un amant.
OCTAVE.
Le fait est...
DUMOREL.
Voulez-vous me rendre un service, voulez-vous dire à Régina, vous-même, que vous êtes l’amant de ma femme ?
À la porte.
Entrez, Régina.
Entre Régina par la porte de droite, second plan.
Monsieur Octave, permettez-moi de vous présenter à une amie, madame Watreloos.
OCTAVE, à Dumorel.
À la bonne heure, celle-là est bien !
DUMOREL.
Oui, mais je ne la possède pas encore.
RÉGINA, à part, à Dumorel.
Mais ce n’est pas possible que ce garçon-là... avec madame Dumorel !...
DUMOREL.
Vous allez voir.
Solennellement.
Monsieur Octave, je vous délie de tout devoir de chevalerie et je vous autorise à dire à madame que vous avez fait la cour à ma femme et qu’elle a répondu favorablement à vos premières avances.
OCTAVE, à lui-même.
Oh ! Irma, où est la chevalerie ?
DUMOREL.
Eh bien ! monsieur ?
OCTAVE.
Eh bien ! monsieur, j’avoue.
À Régina.
J’avoue que tout ce que vous a dit monsieur Dumorel est vrai.
RÉGINA.
Alors, monsieur, devant une pareille déclaration, je n’ai qu’à m’incliner.
Dumorel prend des chaises et invite tout le monde à s’asseoir. Il s’assoit au milieu.
DUMOREL.
Puisque voilà la situation éclaircie, asseyez-vous, madame Watreloos, et laissez-moi continuer les présentations. Madame Watreloos est la femme divorcée d’un riche commerçant de Tournai.
RÉGINA.
Vous connaissez les Flandres, monsieur ?
OCTAVE.
Un peu, madame, un peu, j’aime beaucoup les musées.
RÉGINA.
Moi, c’est ma passion ! Je ne saurais dire exactement où est tel ou tel tableau, mais j’en connais certainement un grand nombre.
DUMOREL.
Quelle jolie éducation !
Entre Agathe par la droite, second plan.
Qu’est-ce que vous voulez ?
AGATHE.
C’est à Régina. Régina, vous savez que c’est l’heure de mettre vos navets au feu.
DUMOREL.
C’est trop fort ! Vous pouviez bien les mettre vous-même.
RÉGINA, se levant.
Non, monsieur Dumorel, Agathe a raison. À chacun son travail.
DUMOREL.
Alors, revenez tout de suite, madame Watreloos.
Sortent Agathe et Régina. À Octave.
Comment la trouvez-vous ?
OCTAVE.
Ah ! elle est très bien, monsieur Dumorel, elle est très bien, et vraiment j’admire cette façon digne et noble d’accepter la situation que les événements lui ont imposée. Ah ! monsieur Dumorel, je comprends votre désir, voilà au moins une aventure vraisemblable, tandis que moi...
DUMOREL.
Que voulez-vous dire ?
OCTAVE.
Rien, monsieur Dumorel, rien.
À lui-même.
Oh ! Irma, dans quelle situation cornélienne et ridicule m’as-tu placé ?
DUMOREL.
Maintenant que Régina me paraît convaincue, vous pouvez parler à ma femme.
OCTAVE.
Parler à votre femme ?
DUMOREL.
Oui, enfin, comme il était convenu, lui dire que je sais tout.
OCTAVE.
Oh ! rien ne presse, rien ne presse !
DUMOREL.
Oh ! si, si, c’est urgent ! Elle est rentrée, je vais la prévenir.
OCTAVE.
Mais que vais-je lui dire ?
DUMOREL.
C’est bien simple, vous allez lui dire que je sais tout, que je lui pardonne, que je consens à un dénouement pacifique et que je l’autorise à vous épouser.
Il sort par la gauche, premier plan.
OCTAVE, seul, avec exaltation.
Irma, Irma, tyran de ma vie !
Changeant de ton.
Je ne sais pas ce que les jeunes gens vont faire dans les grands magasins !... Ah !... ce jour-là, le désœuvrement... le désir de plaire... joint au fait que j’avais besoin d’acheter six cravates !... Ah ! voilà cette irréprochable dame !
Entre madame Dumorel par la gauche, premier plan.
MADAME DUMOREL.
Excusez-moi, monsieur, je n’en finissais pas de rajuster ma toilette. Je sors tous les jours, j’ai beaucoup d’œuvres dont je suis obligée de m’occuper. Mon existence me force à être souvent dehors, mais mon mari vient de me dire que vous aviez à me parler ?
OCTAVE, très rapidement.
Oui, madame, oui, madame, j’ai quelque chose à vous dire d’un peu délicat...
MADAME DUMOREL.
D’un peu délicat ?
OCTAVE.
Oui, d’un peu grave aussi.
MADAME DUMOREL.
Un peu grave ?
OCTAVE.
Monsieur Dumorel est dans un état mental que je qualifierai d’un peu anormal... ce n’est pas maladif, car la suspicion n’est pas une maladie.
MADAME DUMOREL.
La suspicion ?
OCTAVE.
Mais la suspicion agit un peu comme une maladie... Eh bien ! madame, votre mari s’imagine que vous le trompez...
MADAME DUMOREL.
Ah ! mon Dieu !
OCTAVE.
Je comprends ce qu’une pareille suspicion a d’offensant.
MADAME DUMOREL, tombant accablée.
Ah ! mon Dieu ! comment a-t-il pu s’en apercevoir ?
Octave la regarde avec stupéfaction.
OCTAVE.
Alors... comment... c’était vrai ?
MADAME DUMOREL.
Ah ! monsieur, c’est terrible ! Je croyais que jamais il ne s’apercevrait de rien, j’avais pris toutes mes précautions.
OCTAVE, à lui-même, avec un sourire qu’il ne peut réprimer.
Si je m’attendais à cela, par exemple !
MADAME DUMOREL.
Mais je suis une femme perdue, il va me tuer !
OCTAVE, sans l’écouter.
Ah ! j’aurais perdu sur ce pari-là toute ma petite fortune.
MADAME DUMOREL, se pendant à son bras.
Il va me tuer, monsieur !
OCTAVE.
Mais non, madame.
MADAME DUMOREL, affolée.
Il va me tuer !
OCTAVE.
Mais non, madame, il n’est pas question de cela !
Il la repousse légèrement.
MADAME DUMOREL.
Je vous en supplie, monsieur, il va me tuer !
OCTAVE.
Je vous répète que vous n’avez rien à craindre, votre mari est un homme pacifique, souverainement bon, comme beaucoup de maris quand ils se trouvent dans une situation embarrassante et que la bonté leur paraît le seul parti à prendre. Je vais vous dire une chose qui va vous stupéfier sans doute : il consent à ce que vous épousiez votre amant.
MADAME DUMOREL.
À ce que j’épouse mon amant !
OCTAVE.
Oui, et je vous assure que, personnellement, je ne serais pas fâché de cette solution.
MADAME DUMOREL.
Il consent à ce que j’épouse mon amant ?
OCTAVE.
Puisque je vous le dis.
MADAME DUMOREL.
Mais lequel ?
OCTAVE.
Lequel ?
MADAME DUMOREL, d’une voix faible.
Il y a quatre personnes qui ont droit à ce titre : d’abord un inspecteur du Bon Marché, puis mon neveu qui est à Louis-le-Grand, et enfin mes anciens filleuls de guerre, deux tirailleurs sénégalais.
OCTAVE.
Ah ! ces courageux petits nègres ! Eh bien ! madame, il est heureux que vous ayez eu d’abord cette entrevue avec moi, car je dois vous dire que votre mari n’est pas au courant de tous ces menus détails.
MADAME DUMOREL.
Il ne sait pas tout cela ?
OCTAVE.
Il en est à cent lieues. Pour tout dire, il croit que vous avez non pas un amant mais un flirt très poussé et que ce flirt très poussé, c’est avec moi, madame.
MADAME DUMOREL, s’approchant de lui.
Vous, monsieur ?
OCTAVE.
Oui, madame.
MADAME DUMOREL.
Et comment se fait-il ?
OCTAVE.
Madame, je ne vous ai pas demandé de renseignements complémentaires sur vos affaires. Je consens à vous sauver. Maintenant j’ai un peu moins de scrupules à vous mettre dans mon jeu. Je vous sauve. En revanche, vous viendrez à mon secours.
MADAME DUMOREL, minaudant.
Je veux bien, monsieur, car vous me paraissez un charmant jeune homme.
OCTAVE, s’éloigne.
Oui, madame, oui.
MADAME DUMOREL, s’avançant.
Charmant et sympathique. Mais que puis-je faire pour vous être agréable ?
OCTAVE.
Votre mari croit profondément que nous avons eu ensemble deux rendez-vous au cours desquels il ne s’est rien passé.
MADAME DUMOREL, levant les yeux au ciel.
Il ne me connaît pas.
OCTAVE.
Il désire que vous m’épousiez.
MADAME DUMOREL, intéressée.
Ah !
OCTAVE.
Vous allez dire, énergiquement, que vous ne voulez pas.
MADAME DUMOREL.
Que je ne veux pas !
OCTAVE.
Que vous ne voulez sous aucun prétexte !
MADAME DUMOREL.
Mais ce n’est pas très poli pour vous.
OCTAVE.
Ne vous occupez pas de cela, je suis au-dessus de ces questions de politesse. Je vous sauve, mais il est bien entendu que vous étiez, avec moi, tout à l’heure, dans ma garçonnière.
MADAME DUMOREL.
Comment se fait-il ?
OCTAVE.
Excusez-moi de ne pas vous fournir de précisions plus grandes ; je n’ai pas osé vous en demander, tout à l’heure, quand vous m’avez parlé des tirailleurs sénégalais. Votre mari m’a proposé de vous épouser, j’ai accepté.
MADAME DUMOREL.
Je vous remercie.
OCTAVE.
Ne me remerciez pas, c’était une erreur. J’ai accepté. Je continue à être forcé de dire oui, mais vous, il faut que vous disiez non, et le plus énergiquement possible.
MADAME DUMOREL.
Et s’il me demande pourquoi ?
OCTAVE.
Le temps presse, je ne peux pas vous fournir de raisons. Trouvez-en, c’est votre affaire. Le voici.
DUMOREL, entrant par la gauche.
Eh bien ?
OCTAVE, à Dumorel.
Eh bien ! mon vieux, ça ne va pas tout seul...
DUMOREL.
Comment ça ?
OCTAVE.
Puisque nous sommes au courant de tout, nous pouvons parler tous les trois librement. J’ai dit à madame Dumorel votre généreuse idée d’unir mon sort au sien, mais elle ne veut pas en entendre parler.
DUMOREL.
Pourquoi ne veux-tu pas ?
MADAME DUMOREL.
Eh bien !...
DUMOREL.
Donne-moi au moins une raison.
OCTAVE.
Elle dit qu’elle n’a aucune raison à vous donner.
DUMOREL.
Tu étais tout à l’heure dans sa garçonnière ?
MADAME DUMOREL, humblement.
Mon ami...
OCTAVE.
Elle dit que ça ne constitue pas un droit pour vous, que le flagrant délit n’est pas prouvé.
DUMOREL.
Comment !... Mais elle ne dit rien !
OCTAVE.
Elle me l’a dit tout à l’heure, maintenant elle est intimidée... La situation l’intimide...
DUMOREL.
Le flagrant délit n’est pas prouvé, mais je t’ai vue !...
OCTAVE.
Elle dit que ça ne vaut rien au point de vue légal.
DUMOREL.
Enfin, c’est trop fort ! Je ne te propose rien de désagréable. Je te trouve chez un jeune homme, c’est que ce jeune homme te plaît !
OCTAVE, vivement.
Mais non, mais non, je ne lui plais pas !
DUMOREL.
Félicité, Félicité !...
OCTAVE.
Qu’est-ce que vous dites ?
DUMOREL.
Félicité, Félicité !...
OCTAVE, ahuri.
Elle s’appelle Félicité ?...
DUMOREL.
Félicité, je veux que tu me dises les raisons de ton attitude.
OCTAVE.
Elle ne vous les dira pas, elle est butée, et puis vous voyez bien que vous la torturez, cette femme. Alors, madame, vous m’avez refusé, je n’insiste pas et même, on vous obligerait à accepter, que je ne pourrais plus accepter maintenant, mon amour-propre est blessé à mort ! Allez, madame.
À madame Dumorel.
Allez-vous-en ! Je ne sais plus que dire.
Elle sort par la gauche, premier plan.
DUMOREL, partant sur sa trace.
Je vais la décider.
OCTAVE.
Vous n’y parviendrez jamais.
DUMOREL.
Vous allez voir.
OCTAVE.
Ah ! mais, c’est que, maintenant, c’est moi qui ne veux plus... puisqu’elle ne s’est pas décidée tout de suite, puisqu’elle n’a pas eu d’élan...
DUMOREL.
Allons, allons, pas de dépit amoureux, je vous dis que je vais la décider.
Il sort par la gauche, premier plan.
OCTAVE.
Comment est-ce que je vais me tirer de là !
Entre Irma.
IRMA, très agitée.
Je viens de voir mon mari, il m’a parlé comme si de rien n’était, avec la froideur d’une statue de marbre !... Je suis sortie de la pièce, j’ai écouté à la porte, il parlait tout seul dans sa bibliothèque. Je n’ai pas entendu ce qu’il disait, mais il doit avoir une grave préoccupation. Quand il est très préoccupé, il se fait des conférences à lui tout seul. Je suis certaine qu’il a de graves, graves soupçons.
OCTAVE.
Mais non... mais non...
IRMA.
Vous avez vu monsieur Dumorel ? Il est toujours persuadé que c’est sa femme qui était impasse Jolicœur ?
OCTAVE.
Oh ! il le croit dur comme fer et il veut que je l’épouse !
IRMA.
Mais, qu’est-ce que vous risquez ? Il faut tout de même son consentement à elle...
OCTAVE.
Ah ! c’est qu’elle faiblit, c’est qu’elle faiblit...
IRMA.
Eh bien, mon ami, que voulez-vous ? Avant tout il faut que vous me sauviez. Si elle consent à vous épouser, épousez-la !
OCTAVE.
Mais vous êtes folle !
IRMA.
Vous m’avez compromise, il faut que vous me sauviez, il n’y a pas deux règles de chevalerie.
OCTAVE.
La chevalerie prescrit d’épouser la dame de ses pensées que l’on a compromise et ne nous force pas à épouser une dame qui n’est pas de vos pensées !
Énergiquement.
Et puis, c’est impossible, je ne peux pas me marier avec cette femme-là !
IRMA.
Pourquoi ça ?
OCTAVE.
Pour des raisons... des projets... des superstitions sénégalaises.
IRMA.
Vous feriez un mariage avantageux.
OCTAVE.
Oui, je sais, 120 000 livres de rente... mais j’aime mieux travailler quatorze heures dans une usine en gagnant 350 francs par mois. 120 000 livres de rente avec cette femme-là !... Les heures de nuit ne sont pas payées assez cher !
IRMA.
Enfin, mon cher, je ne sais qu’une chose, je suis une femme perdue si vous n’épousez pas madame Dumorel.
OCTAVE, douloureusement.
Félicité !
IRMA.
Pas d’ironie.
OCTAVE.
Ce n’est pas de l’ironie, c’est son petit nom.
IRMA.
Prenez votre parti. Si d’ici un quart d’heure vous n’avez pas arrangé les choses, j’avoue tout à mon mari. Je suis trop énervée de sentir cette épée au-dessus de ma tête.
OCTAVE.
Quelle épée ?
IRMA.
L’épée de Damoclès.
Elle sort par le fond, à gauche.
OCTAVE, tirant un revolver de sa poche.
Ah ! si mon revolver n’était pas chargé à blanc et si je ne tenais pas tant à la vie !... Je crois que je vais prendre un parti moins élégant... Je vais m’en aller tout doucement de cette maison... Je donnerai 1 000 francs à un chauffeur pour m’emmener en dehors de Paris, pour qu’il continue en ligne droite jusqu’à ce qu’il y en ait pour 500 francs au compteur. À ce moment-là, il me laissera sur la route ; les autres 500 francs seront pour le retour... Partons !
DUMOREL, entrant de droite, au premier plan.
Ah ! vous partiez !... Ne vous en allez pas, au nom du ciel ! j’ai besoin de vous. Entrez, Régina !
Entre Régina, bas à Octave.
Parlez-lui, mon ami, je vous en conjure, décidez-la à me prendre pour mari. Moi, pendant ce temps-là, je vais décider ma femme à vous épouser.
Il sort.
OCTAVE, à Régina, il lui fait signe de s’asseoir sur le petit canapé et il s’assoit à côté d’elle.
Pardon, madame, je suis chargé par monsieur Dumorel d’une mission... d’une mission délicate. Pourquoi ne voulez-vous pas l’épouser ?
RÉGINA.
Mais, monsieur, je n’ai jamais eu l’intention d’être sa femme...
OCTAVE.
Il dit que vous le lui avez promis.
RÉGINA.
C’est entendu, je le lui ai promis, mais j’ai mis une condition que je jugeais impossible à réaliser. Pour me débarrasser de ses instances, je lui ai dit : Je vous épouserai si madame Dumorel a des torts envers vous. Madame Dumorel, avoir des torts envers lui, avoir un amant, voilà qui me semblait impossible ! Oh ! je vous demande pardon...
OCTAVE.
De quoi ?
RÉGINA.
Je vous ai dit qu’il était impossible que madame Dumorel ait un amant et je n’avais pas pensé... Elle est encore très bien.
OCTAVE.
Vous trouvez ? Eh bien ! vous n’êtes pas difficile !
RÉGINA.
Oh ! monsieur, de votre part, cette façon de parler d’elle...
OCTAVE, réfléchissant.
Ah ! oui... oui... je ne me souvenais plus, vous avez raison... oui, oui, elle est encore très bien.
RÉGINA.
En tout cas, elle n’est pas plus mal que monsieur Dumorel qu’on veut me faire épouser à moi.
OCTAVE, gémissant.
Épouser madame Dumorel ! Ah ! ce n’est pas ce que j’avais rêvé à l’aube de ma vie !...
RÉGINA.
Si vous croyez qu’à l’aurore de la mienne, j’avais rêvé épouser monsieur Dumorel ! monsieur...
Cherchant son nom.
Monsieur ?
OCTAVE.
Octave.
RÉGINA.
Monsieur Octave, vous me voyez comme cela en fille de service ; vous ne me voyez pas sous mon véritable jour.
OCTAVE, la regardant.
Mais c’est un jour fort agréable, un jour tout à fait riant.
RÉGINA, sortant de sa poche une petite photo.
Voilà comme j’étais, avant d’être réfugiée.
OCTAVE, regardant la photo.
Elle est charmante, mais je vous assure que vous êtes aussi charmante que cette photo.
RÉGINA.
Alors, vous trouvez que je dois épouser monsieur Dumorel ?
OCTAVE.
Je trouve, je trouve... Enfin, c’est une commission que je vous fais...
RÉGINA.
Mais enfin, vous me conseillez de l’épouser ?
OCTAVE.
Et vous, est-ce que vous me conseillez d’épouser madame Dumorel ?
Il regarde la photo.
Mais vous êtes vraiment délicieuse, madame Watreloos.
Il pousse un soupir.
RÉGINA.
Vous soupirez ?
OCTAVE.
Oui, voilà le premier moment de satisfaction depuis bien des heures ! C’est parce que je suis à côté de vous. Je voudrais que ça ne finisse pas, madame Watreloos !
Il lui prend la main
RÉGINA.
Monsieur Octave...
Ils se regardent. Elle fond en larmes.
Ah ! monsieur Octave, je suis bien malheureuse !
OCTAVE.
Il ne faut pas être malheureuse comme ça, madame Watreloos !
Il la prend dans ses bras.
RÉGINA, languissante.
Qu’est-ce que vous avez fait de ma photo, monsieur ?
OCTAVE.
Je l’ai dans la main, je vous demande la permission de la garder quelque temps encore. Je ne veux pas m’en séparer tout de suite, je vous la rendrai si vous la redemandez.
Il la met dans la poche intérieure de son veston.
Et si vous vouliez me faire plaisir, il faudrait me la laisser, cette petite photo, je veux avoir un souvenir de vous.
RÉGINA, après un temps.
Mais à quoi ça vous servira-t-il, monsieur Octave, un souvenir de moi ?
OCTAVE.
Eh bien ! ça me sera agréable ! Il ne faut pas demander à quoi servent les choses ; ça me sera agréable, voilà tout !
Elle se met à sangloter ; il la serre dans ses bras et l’embrasse doucement.
DUMOREL, entrant en tapinois par la porte de gauche, au fond, les voit dans les bras l’un de l’autre.
Eh ben ! eh ben !
OCTAVE, du ton le plus naturel.
Eh bien ?
DUMOREL.
Vous la prenez dans vos bras, vous l’embrassez maintenant ?
OCTAVE.
Eh bien ! que voulez-vous ? Vous m’avez dit de la décider. Avec une femme, il faut employer la douceur...
DUMOREL.
Oui, mais la douceur a des bornes ! Est-ce que vous l’avez décidée, au moins ?
OCTAVE.
Pas encore, mais ça vient, ça vient.
DUMOREL.
Eh bien ! je préfère m’en occuper moi-même, maintenant.
À Régina.
Mais venez donc avec moi.
OCTAVE.
Il l’emmène ! Allons, allons, je vais m’en aller ! Je ne sais pas pourquoi, j’ai un peu moins envie de m’en aller maintenant... D’ailleurs, voici encore le papa Papavoine.
Il sort à droite, au premier plan. Barnereau entre en scène, précédé de la bonne, par la porte du fond à gauche.
LA BONNE.
Je vais prévenir monsieur Dumorel.
BARNEREAU.
Non, un instant, j’ai besoin de me recueillir.
La bonne sort.
BARNEREAU, s’avançant à l’avant-scène, au public, d’une voix très douce.
Madame Barnereau est adultère, c’est pour cela que j’ai mis mon chapeau haut de forme, car, un mari trompé doit redoubler de correction dans sa tenue. Le moment est venu d’agir. Si l’on sait que je suis trompé – il est probable qu’on le saura – on n’admettra pas que moi, Barnereau, qui soutiens l’institution du mariage, je n’observe pas une sévérité indomptable. J’attendrai patiemment un prochain flagrant délit. Je ne veux pas accabler ma femme, mais je tuerai son amant. Je ne tuerai pas ma femme, parce que je la connais et qu’il est impossible de tuer les personnes que l’on connaît, mais je n’hésiterai pas à tuer ce jeune homme, mon ancien élève, dont j’ai gardé un souvenir assez vague et qui n’était pas dans les premiers de la classe... Voilà ce que me commande la raison.
Il reste quelques instants abîmé dans ses réflexions.
Autre événement fâcheux, l’histoire de la cuisinière qui, frappée d’amour, se jette à mon cou. La lubricité imprévue de cette fille de cuisine est d’autant plus intempestive qu’elle coïncidait avec l’entrée de cette demoiselle des Annales qui me vénérait – ce sont ses propres paroles – comme un saint laïque. Je crois avoir arrangé les choses en disant qu’elle était ma sœur de lait, j’avoue que cela me répugne d’avoir tété, fût-ce en apparence, le même lait que cette immonde créature.
DUMOREL, entrant.
Ah ! voici monsieur le professeur...
BARNEREAU, distrait.
Oui, oui...
DUMOREL.
Je vous avais dit, monsieur le professeur, que je vous mettrais à contribution.
BARNEREAU.
C’est que je suis un peu préoccupé.
DUMOREL.
Ce ne sera pas long. Voici, j’ai surpris tout à l’heure, ma femme dans la garçonnière d’un jeune homme.
BARNEREAU.
Vous l’avez tué, ce jeune homme ?
DUMOREL.
Mais non, mais non, je ne l’ai pas tué. Ce jeune homme est celui que vous avez vu tout à l’heure, monsieur Ormont... Il est l’amant de ma femme.
BARNEREAU.
Mais non, mais non !...
DUMOREL.
Pourquoi mais non, mais non ?
BARNEREAU.
Vous faites confusion ; ce jeune homme n’était pas dans sa garçonnière avec madame Dumorel.
DUMOREL.
Qu’est-ce que vous me racontez ?
BARNEREAU.
Je suis très renseigné. La personne qui était avec ce jeune homme était une autre dame.
DUMOREL.
Qu’est-ce que c’est que cette histoire-là ?... Puisqu’ils ont avoué l’un et l’autre...
BARNEREAU.
Votre femme a avoué ?
DUMOREL.
Mais oui, ma femme a avoué.
Il va à gauche, premier plan et appelle.
Félicité ! Viens ici, tu peux parler devant monsieur, monsieur est professeur de morale. Étais-tu, tout à l’heure, impasse Jolicœur, avec monsieur Octave Ormont ?
MADAME DUMOREL.
Puisque tu me forces à le dire, et puisque c’est nécessaire pour que j’épouse cet aimable garçon, oui, j’ai été impasse Jolicœur.
BARNEREAU, à lui-même.
Est-ce qu’on m’aurait donné un renseignement inexact ?
DUMOREL, à madame Dumorel.
Nous allons maintenant consulter monsieur Barnereau sur un autre point. Monsieur Barnereau...
BARNEREAU, sans écouter, à lui-même.
Alors, tout ce que j’avais projeté n’a plus aucune raison d’être...
DUMOREL.
Voici les faits, monsieur le professeur...
BARNEREAU, ne l’écoutant pas.
J’aime mieux ça, d’ailleurs, car, si ma raison et mes principes me poussent à des actes sanguinaires, mon tempérament ne m’y incline en aucune façon.
DUMOREL.
Monsieur Barnereau, voulez-vous me prêter un peu d’attention ? Je disais que j’avais surpris ma femme chez monsieur Ormont...
BARNEREAU, distraitement.
Vous m’en voyez très heureux.
DUMOREL.
Comment très heureux ?
BARNEREAU.
Non point, monsieur Dumorel, très malheureux, je répondais à une autre préoccupation. Mais je suis tout à vous, parlez, monsieur Dumorel.
DUMOREL.
J’ai consenti à ce qu’elle épouse ce jeune homme.
BARNEREAU.
C’est ce que nous appelons une solution pacifique, mais que vous avez le droit de proposer.
DUMOREL, à madame Dumorel.
Tu vois ce que dit notre arbitre.
MADAME DUMOREL.
Mais, mon ami, qu’est-ce que tu veux que je te dise !...
DUMOREL.
Tu ne peux pas faire autrement que d’accepter.
Il va vers le fond à droite, où est Octave, il ouvre la porte, il aperçoit Octave et Régina.
Comment, il embrasse encore Régina ! Monsieur Ormont, je vous en prie, je vous ai dit que votre tâche était terminée... que le reste me regardait... Venez un peu par ici.
OCTAVE, rentrant.
Qu’est-ce que vous me voulez encore maintenant ?
À Barnereau.
Ah ! bonjour, monsieur Barnereau !
BARNEREAU, lui serrant la main.
Bonjour, monsieur Ormont.
OCTAVE.
Bonjour, bonjour !
À part.
Qu’est-ce que disait Irma ? Il a l’air très gentil...
DUMOREL.
Monsieur Barnereau, que nous venons de consulter, a décidé que ma femme devait vous épouser.
OCTAVE.
Mais en quoi cela le regarde-t-il ?
DUMOREL.
Nous l’avons pris comme arbitre.
OCTAVE.
Moi ! je l’avais pris comme arbitre ?
DUMOREL.
Vous, vous n’êtes pas en jeu, puisque vous êtes consentant.
OCTAVE.
Consentant !
DUMOREL.
Puisque vous avez consenti à épouser ma femme, il ne reste qu’à obtenir son acquiescement à elle. Devant le jugement de monsieur Barnereau, elle s’est inclinée.
OCTAVE, énergique, s’approchant de madame Dumorel.
Alors, madame, vous avez consenti ?
MADAME DUMOREL.
Non, je n’ai pas consenti !
DUMOREL.
Comment ! tu n’as pas consenti ?
MADAME DUMOREL.
Ah ! je ne sais plus quoi dire.
Elle se sauve par le premier plan à droite, suivie de Dumorel. Octave et Barnereau restent seuls en scène.
BARNEREAU.
Mon cher, arrivez ici. Maintenant qu’ils sont partis, je puis vous dire à quel point je suis heureux de ce que je viens d’apprendre. Figurez-vous que, tout à l’heure, un homme louche est venu me voir chez moi et m’a dit, en propres termes, qu’une personne se trouvait avec vous dans un appartement de l’impasse Jolicœur, et que cette personne n’était autre... Je vous le donne en mille !
OCTAVE.
Dites toujours.
BARNEREAU.
N’était autre que ma femme, madame Barnereau !
OCTAVE, riant nerveusement.
Quelle plaisanterie ! quelle plaisanterie ! Qu’est-ce que c’était que cet homme louche ?
BARNEREAU.
Alors, je m’apprêtais à susciter un flagrant délit et à vous immoler. Je ne vous dissimule pas que cela m’eût été pénible, car je n’avais pas gardé de vous un mauvais souvenir, bien que vous fussiez assez médiocre au cours de morale. Quand monsieur Dumorel m’a dit que c’était sa femme qui était avec vous, j’ai eu un grand soulagement.
À la bonne qui entre.
Qu’est-ce que c’est encore ?
LA BONNE.
C’est un monsieur qui a vu entrer monsieur Barnereau ici et qui demande à lui parler.
BARNEREAU.
Eh bien ! faites-le entrer.
Elle introduit Achille.
ACHILLE, s’approchant de Barnereau.
Monsieur, c’est encore moi, j’ai réfléchi, vous m’avez dit tout à l’heure que vous vouliez me donner une petite récompense. J’avais répondu, dans un premier moment, que la satisfaction de ma conscience me suffisait, mais j’ai réfléchi que les temps étaient durs...
BARNEREAU.
Vous êtes un imposteur, mon garçon !
ACHILLE.
Un imposteur !
BARNEREAU.
Un gredin !
À Octave.
C’est l’homme en question.
OCTAVE.
Ah ! c’est lui !
Il s’approche d’Achille.
C’est vous qui venez ainsi donner de faux renseignements ?
ACHILLE.
De faux renseignements ! Ah ! non, je me suis trompé une fois, mais cette fois-ci, ça n’a rien à faire, voilà la photo de cette dame.
Il tire une photo de sa poche. Octave l’intercepte et la met dans sa poche, après lui avoir jeté un coup d’œil.
BARNEREAU, vivement.
Qu’est-ce que c’est ?
OCTAVE.
Mais ce n’est rien, c’est une simple photo, ce misérable ne raconte que des stupidités !
BARNEREAU.
Je voudrais voir tout de même cette photo...
OCTAVE.
Mon cher ami, non, je ne peux pas vous la montrer.
BARNEREAU.
Vous risquez de faire revivre mes soupçons...
OCTAVE, ayant une inspiration, tire de sa poche la photo de Régina et la tend à Barnereau, puis, à mi-voix.
Eh bien ! est-ce que c’est votre femme ?
BARNEREAU.
Non, ce n’est pas elle.
OCTAVE, à voix basse.
C’est une dame qui habite ici.
Il a une nouvelle inspiration.
C’est pour ça que je ne voulais pas montrer la photographie.
BARNEREAU, à Achille.
Voulez-vous vous en aller !
OCTAVE.
Voulez-vous me foutre le camp, et plus vite que ça !
ACHILLE, se sauvant.
Comment ! Est-ce que je me suis gouré encore une fois !...
RÉGINA, entrant à ce moment par la porte de droite, premier plan.
Monsieur, est-ce que monsieur Dumorel est ici ?
BARNEREAU.
Il n’est pas ici, madame.
Elle sort à droite. Il la regarde. À Octave.
Ce visage...
Il regarde la photo
Mais c’est la dame de la photographie !...
OCTAVE, lui prenant la photo et la mettant dans sa poche.
C’est une dame de la maison, qui plaît à monsieur Dumorel. Vous avez compris pourquoi, maintenant, je ne peux pas épouser madame Dumorel ? Vous comprenez ?
BARNEREAU.
Oui, oui... Très franchement, je ne comprends rien du tout !
DUMOREL, entrant par la gauche, premier plan.
Monsieur Octave, je crois que j’ai décidé ma femme.
OCTAVE.
Il ne s’agit pas de cela. Monsieur Barnereau, notre arbitre, vient de rendre une décision définitive, et il déclare que ce mariage est impossible.
Il fait un signe à Barnereau.
BARNEREAU, d’une voix vague.
Impossible...
OCTAVE, énergiquement.
C’est son avis formel !
BARNEREAU, vaguement.
Formel...
DUMOREL, à Octave.
Alors, je ne peux pas épouser Régina ?
OCTAVE.
C’est l’avis formel de monsieur Barnereau.
BARNEREAU.
Sans appel...
DUMOREL.
Ah !
CÉLESTINE, rentrant.
Monsieur Barnereau, vous m’avez mise à la porte, je le méritais. J’ai trouvé une autre place, c’est la dame des Annales qui me l’a procurée, quand elle a su que j’étais votre sœur de lait.
BARNEREAU.
Ah ! tant mieux...
CÉLESTINE.
Ma nouvelle adresse est 250, boulevard Haussmann, et je sors tous les soirs.
Barnereau la regarde, irrité.
RÉGINA, entrant par la porte de droite, premier plan.
Monsieur Dumorel !...
DUMOREL.
Qu’est-ce qu’il y a ?
RÉGINA.
Monsieur Dumorel, je suis obligée de vous rendre mon tablier.
DUMOREL, bas, à Régina.
C’est impossible !
RÉGINA.
Mon parti est pris.
IRMA, entrant.
Mon ami, mon ami, je suis poursuivie par un fou.
BARNEREAU.
Un fou ?
ACHILLE, entrant.
Ah ! la voilà ! c’est elle, je la reconnais !
OCTAVE, passant vivement devant Irma et mettant son revolver sous le nez d’Achille.
Vous, vous allez vous débiner.
Il pousse Achille vers la porte.
ACHILLE.
Comment ? Comment ?
OCTAVE.
Haut les mains !
Achille lève les mains. Octave le poursuit dehors, il tire deux coups de revolver à la cantonade, dans la direction d’Achille.
IRMA.
Oh ! c’est fou, c’est fou, tuer cet homme !
OCTAVE.
Je vous demande pardon, le revolver n’est pas chargé, mais il fallait flanquer cet homme à la porte. Au moins, on en sera débarrassé ! Excusez-moi de vous avoir mis en émoi par ces coups de feu. Excusez-moi, monsieur Barnereau.
BARNEREAU.
Ne recommencez pas, c’est bien désagréable !
OCTAVE, à Régina.
Excusez-moi, madame.
RÉGINA.
Oh ! moi, les coups de feu ne m’effraient pas...
OCTAVE.
Ah ! les coups de feu ne vous font pas peur ?
À demi-voix.
Alors, je vous connais un domicile, 6, impasse Jolicœur.
CÉLESTINE, à Dumorel, tout bas.
Monsieur, ma nouvelle adresse, c’est 250, boulevard Haussmann, et je sors tous les soirs.