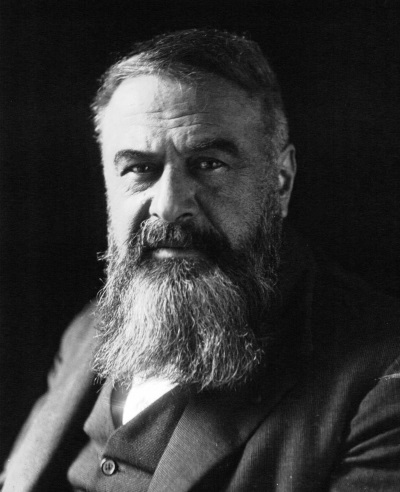Je vais m’en aller (Tristan BERNARD)
Comédien en un acte.
Personnages
HENRI
JEANNE, sa femme
HENRI, JEANNE
La scène est à Paris, dans un petit salon, élégamment meublé. Au lever du rideau, Jeanne, suivie d’Henri, entre par la gauche. Elle va s’asseoir sur un canapé au premier plan à gauche. Henri va d’abord à une fenêtre au fond, puis vient s’asseoir à droite sur une chaise placée à gauche d’un guéridon, où est servie une tasse de café.
HENRI.
C’est régulier... Tous les dimanches, il fait beau temps jusqu’à midi. À midi, le temps se couvre. Il pleuvote. Il fait gris. Quand ce n’est pas de bonnes averses comme dimanche dernier... Tout ça parce que j’aime aller aux courses !
JEANNE.
Tu as l’intention d’aller aux courses cet après-midi ?
HENRI, légèrement inquiet.
Mais oui, voyons, est-ce que ce n’est pas entendu ? Je te l’ai déjà dit ce matin.
JEANNE.
Tu vas encore perdre ton argent.
HENRI.
Tu sais bien que je ne joue jamais.
JEANNE.
Alors tu vas me laisser toute seule ? Emmène-moi ?
HENRI, énergiquement.
Non, non, ce n’est pas la même chose. Quand j’y vais seul, je prends un fiacre pour cent sous, et c’est tout ce que ça me coûte. J’ai mon entrée à l’œil, et je trouve toujours un ami qui m’emmène dans sa voiture. Tandis que, si tu viens avec moi, il faut tout de suite prendre une voiture de cercle, pour un louis.
JEANNE.
Nous en avons eu une pour quinze francs la semaine dernière.
HENRI.
Parce qu’il faisait mauvais temps. En tout cas, il faut que je prenne une carte d’entrée de dame, pour dix francs. Je ne vois pas l’utilité de dépenser trente francs – mettons vingt-cinq – pour un plaisir qui ne t’amuse pas. Car tu m’as dit cent fois que ça ne t’amusait pas... Et puis, moi, c’est bien simple, quand je vais aux courses avec toi, je ne m’amuse plus.
JEANNE.
Tu es gentil !
HENRI.
Non, je ne m’amuse plus comme lorsque j’y vais seul. Quand tu es avec moi, je ne peux plus me déplacer, m’en aller à droite et à gauche, au paddock où l’on promène les chevaux, aux balances, au-dessus des tribunes... Tout seul, je me sens libre et léger... Et puis, si je vais avec toi, je suis obligé de mettre un costume neuf... Celui-là est tout abîmé... Je ne m’amuse pas dans les vêtements neufs... Non, si tu veux sortir avec moi, allons nous promener où tu voudras, mais pas aux courses.
JEANNE.
Oui, pour monter les Champs-Élysées ensemble. Tu seras tout le temps à me faire la tête. Quand je sors avec toi, ce sont des observations à n’en plus finir.
HENRI.
C’est que tu es assommante... Tu ne veux jamais me donner le bras.
JEANNE.
Ça a l’air trop bête.
HENRI.
Si tu marchais comme une personne naturelle ! Mais tu ne marches jamais aussi vite que quand tu te promènes. Tu t’en vas à fond de train ! Quand je suis à côté de toi, à ta droite par exemple, et que tu veux dépasser les personnes qui sont devant nous, tu passes si près d’elles à leur gauche, qu’il ne me reste plus de place ; je suis forcé de rester derrière toi et de m’essouffler ensuite, en courant comme un toutou, pour arriver à ta hauteur... Je tiens à être à côté de toi, parce que j’ai peur qu’on ne te croie seule et qu’on ne te dise des polissonneries.
JEANNE.
Mais tu me laisses sortir seule ?
HENRI.
Je te laisse sortir...
JEANNE.
Oui, parce que ça t’est égal qu’on me dise des polissonneries quand tu n’es pas là pour être obligé de les relever.
HENRI.
...Enfin ça m’ennuie de sortir avec toi. Et connue, toi, ça ne t’amuse pas non plus...
JEANNE.
Oh ! non ! ça ne me passionne vraiment pas. Mais si tu te tenais tranquille, et si tu ne me faisais pas toujours des observations, j’aimerais autant sortir avec toi qu’avec n’importe qui.
HENRI, après un temps.
Quelle heure est-il ?
JEANNE.
Il n’y a pas d’heure ici. La petite pendule de Saxe est cassée depuis huit jours.
HENRI.
Je vais demander l’heure à la cuisine.
JEANNE.
Tu sais bien que la cuisinière n’a jamais l’heure juste, qu’elle avance ou retarde d’une demi-heure, sui vaut qu’elle est prête ou non pour le dîner.
HENRI.
...Je vais m’en aller tout de suite. Comme ça je n’aurai pas besoin de prendre une voiture. Je descendrai prendre le train à la gare Saint-Lazare.
Il va pour embrasser Jeanne.
JEANNE.
Alors, décidément, tu me laisses seule ? Bien !
HENRI, s’asseyant auprès d’elle.
Voyons, petit coco... Qu’est-ce que ça peut te faire que j’aille m’amuser, puisque, si je restais près de toi, tu ne t’ennuierais pas moins !
JEANNE.
C’est charmant ! C’est tout naturel que je m’ennuie, et que monsieur aille s’amuser.
HENRI.
Ce n’est vraiment pas un temps engageant pour aller se promener.
JEANNE.
Le temps n’est pas plus beau pour aller aux courses.
HENRI.
Mais si. Aux courses, on court par tous les temps. C’est vrai qu’on s’amuse beaucoup moins quand il pleut... Tu sais, je ne vais pas m’amuser beaucoup aujourd’hui.
JEANNE.
Pourquoi ne m’emmènes-tu pas ?
HENRI.
Je te l’ai déjà dit... Et puis il va pleuvoir... Tu abimerais ta robe.
JEANNE.
J’en mettrai une vieille.
HENRI.
Alors tu ne t’amuseras pas...
Il se lève impatienté.
Non, je trouve absurde de dépenser trente francs par un temps pareil. Tu seras toi-même à me les reprocher pendant huit jours.
JEANNE.
C’est vrai que je trouve peu raisonnable de dépenser trente francs pour aller aux courses. J’aime mieux aller aux Variétés et souper ensuite.
HENRI.
Voilà. Tu as raison... Tu es une petite femme pleine de sens, et très pratique. Je vais ni ‘en aller.
Il s’approche d’elle.
Tu veux bien que je m’en aille ?
JEANNE.
Fais ce que tu voudras.
HENRI.
Dis-moi que tu veux bien.
JEANNE.
Tu es libre.
HENRI.
Je ne veux pas m’en aller si tu fais la tête.
JEANNE.
Je ne peux vraiment pas sauter de joie parce que tu me laisses toute seule ici pendant que tu vas t’amuser.
HENRI.
Tu ne sors pas ?
JEANNE.
Où veux-tu que j’aille ?
HENRI.
Faire un petit tour... prendre l’air...
Il essaie un adieu.
Au revoir !... Allons, bon ! voilà que tu fais la tête !
Irrité.
Veux-tu que je te dise : tu es une rosse, une vraie petite rosse !
JEANNE.
Pourquoi ?
HENRI.
Parce que tu fais la tète exprès pour me gâter mon plaisir. Mais j’aurais bien tort de me gêner pour une méchante bête comme toi ! Ça me fait plaisir d’aller aux courses : je vais aux courses !
Il prend sa lorgnette et son chapeau.
Oh ! l’égoïsme des femmes !
Revenant près de Jeanne.
Au revoir... Embrasse-moi au moins...
JEANNE, nettement.
Non !
HENRI.
Pourquoi ?
Geignant presque.
Voilà qu’elle ne veut plus m’embrasser maintenant !
JEANNE, dure.
Je n’ai pas besoin d’embrasser un homme qui me traite de rosse et de méchante bête.
HENRI, irrité.
Eh bien ! c’est bon ! Eh bien, c’est bon !
Déposant sa lorgnette et son chapeau.
Tu veux m’empêcher d’aller aux courses. Sois satisfaite ! Je n’y vais pas ! J’avais une carte de vingt francs ! Je vais la déchirer !
Il tire sa carte de sa poche.
Je vais la déchirer !... Alors tu me laisses la déchirer ? Elle vaut vingt francs...
JEANNE.
Elle vaut vingt francs si tu t’en sers. Mais comme tu ne-peux pas la vendre, elle ne vaut rien du tout.
HENRI, remettant sa carte dans sa poche.
Voyons, coco... Je vais te faire une proposition...
Il s’assoit près d’elle.
Tu sais si je t’aime...
Gentil.
Je vais rester encore un quart d’heure avec toi. Je n’irai pas prendre le train à la gare Saint-Lazare. Je prendrai un fiacre devant la porte.
JEANNE.
Si tu veux t’en aller, j’aime autant que tu t’en ailles tout de suite et que tu économises les cent sous du fiacre.
HENRI.
Tu crois ?... Je vais m’en aller. Au revoir ! Embrasse-moi.
Elle se lève et l’embrasse.
JEANNE.
Tiens !
HENRI.
De meilleur cœur !
JEANNE.
Ah ! tu m’embêtes !
Elle s’en va par la gauche, dans sa chambre. Henri resté seul prend sa lorgnette et son chapeau et va pour sortir. Mais il hésite et s’assoit pour réfléchir.
JEANNE, rentrant.
Comment ? Tu n’es pas encore parti ?
Henri ne répond rien.
Tu es bien libre de t’en aller. Moi je sors.
HENRI.
Où vas-tu ?
JEANNE.
On vient de me remettre un télégramme de Juliette. Elle ne sort pas. Elle me dit que je serais bien gentille d’aller la voir.
HENRI.
Bon ! Parfait !
Il se lève.
Je vais m’en aller. Au revoir !
JEANNE.
Au revoir, mon chéri.
Henri s’éloigne.
Amuse-toi bien.
HENRI, s’arrêtant et la regardant.
Comment dis-tu ?
JEANNE.
Je te dis de bien t’amuser.
HENRI.
Tu es contente maintenant que j’aille aux courses ?
JEANNE.
Très contente, puisque ça te fait plaisir.
HENRI.
Alors je reste ici, réflexion faite.
Il pose sur un meuble sa lorgnette et son chapeau, et s’assoit. Préoccupé.
Ce n’est pas naturel que tu sois contente comme ça... Veux-tu me faire le plaisir de me montrer ce télégramme de Juliette ?
JEANNE.
Pourquoi cet air mystérieux ? Le voici.
Elle lui tend le télégramme.
HENRI.
Tu me le donnes bien vite... Tu n’obéis pas si vite d’ordinaire, quand je te demande quelque chose... Il faut que tu aies intérêt à te disculper rapidement.
JEANNE.
Mon pauvre ami, tu es complètement fou !
HENRI, se montant.
Oui, je suis surtout le bon imbécile que tout le monde fiche dedans, et qui ne s’aperçoit de rien... Cette dépêche de Juliette, veux-tu que je dise ce que c’est ? C’est un signal. Elle te ménage des rendez-vous. À charge de revanche naturellement ! Vous ne valez pas mieux l’une que l’autre !
JEANNE, agacée.
Tu es trop bête. Je ne te répondrai pas.
HENRI.
C’est plus commode !... Allons ! voilà la première course ratée... Tant pis ! J’aime autant ne pas aller aux courses dans ces conditions-là. Je serais ennuyé, tracassé... Je n’aime pas les plaisirs gâtés... J’aime mieux ne pas m’amuser ; je vais rester près de toi.
JEANNE, énervée.
C’est effrayant !
HENRI.
Oui, je sais. Je dérange vos projets. Tout était bien concerté entre Juliette, toi et... l’autre, le monsieur que je ne connais pas... mais que je devine...
Furieux.
J’irai lui parler du pays à ce monsieur-là.
JEANNE.
Je n’ai pas l’honneur de le connaître, ce monsieur-là. Mais je sais bien qu’il va te rire au nez, quand tu iras lui parler du pays.
HENRI.
En attendant je vais m’installer ici
Il tape énergiquement sur la table.
tranquillement.
JEANNE, exaspérée et lui mettant le chapeau sur la tête.
Oh ! écoute, je t’en supplie, va aux courses ! Car j’ai mal aux nerfs et je ne pourrais pas passer tout mon après-midi avec un être aussi insupportable que toi !
HENRI.
Bon. Je vais m’installer ici. Je ne bougerai pas.
JEANNE.
Mais de quoi as-tu peur ?
HENRI, sombre.
Que tu n’ailles chez Juliette... ou ailleurs !
JEANNE.
Tu n’as qu’à m’accompagner chez Juliette.
HENRI.
Tu veux que je t’accompagne chez Juliette ?
Il se lève.
Soit... Va mettre ton chapeau.
Elle s’éloigne, mais il la retient par la main.
Tu y consens de bon cœur ? Regarde-moi dans les yeux...
Scandant ses paroles.
Tu veux que je t’accompagne chez Juliette ?
JEANNE.
Oui. Eh bien ?
HENRI, épanoui.
Eh bien, je vais aux courses... je vois que je m’étais trompé... Je t’aime bien ! Au revoir...
Il l’embrasse tendrement.
Mais sais-tu ce que tu devrais faire pour être complètement gentille ? Tu devrais ne pas aller chez Juliette, et rester ici, bien tranquillement.
JEANNE.
Ça c’est le comble ! C’est magnifique ! Non content de me laisser ici comme un pauvre chien, tu veux encore m’empêcher de sortir !
Pleurant.
Eh bien, je resterai ici ! Eh bien, je resterai ici !
HENRI, ému.
Mon petit chéri ! Mon petit chéri ! Ne pleure pas ! Je vais rester près de toi. Je vais rester près de ma petite femme que j’aime !
JEANNE, toujours attristée.
Oui ! Tu m’aimes à ta façon !
HENRI la prend dans ses bras.
Mais si, je t’aime, puisque je te sacrifie mon après-midi. Je te le sacrifie joyeusement.
Silence.
Joyeusement.
Silence. Il l’embrasse sur le front.
En revanche, je sais bien, si j’étais à ta place, ce que je répondrais à mon petit mari.
Il l’embrasse.
Je lui répondrais : mon ami, tu m’as suffisamment prouvé ton amour.
Il l’embrasse tendrement.
Je ne veux pas de ton sacrifice.
Jeanne s’écarte de lui. Henri, gravement.
Jeanne, nous ne sommes plus des enfants.
Solennellement.
Nous voyons clair en nous. Ne nous gâtons pas notre bonheur en nous faisant des sacrifices dont nous ne nous savons aucun gré. Sauvegardons notre bien-être par des concessions réciproques.
JEANNE.
C’est une belle théorie. Mais tu ne me la sers jamais quand c’est mon tour de m’amuser. Ainsi, tu sais combien ça me fait plaisir d’aller au bal. Tu refuses toujours de m’y conduire, sous prétexte que tu détestes le bal.
HENRI.
Ah ! petit coco, ce n’est plus la même chose ! Au bal, je suis forcé de t’accompagner. Tandis qu’aux courses tu n’es pas forcée de venir avec moi.
JEANNE.
Mais je ne demande que ça. Emmène-moi !
HENRI.
Il pleut.
JEANNE.
Il ne pleut plus.
HENRI.
Ça va retomber... Quelle heure est-il ?
JEANNE, soupirant.
Ah ! l’heure de t’en aller !
HENRI, avec effusion.
Oh ! Merci !... Alors ça ne te fait rien que je m’en aille ?
JEANNE.
Rien du tout.
HENRI.
Tu ne vas pas sortir ? Tu vas rester seule ici, comme un pauvre chien ?
JEANNE.
Comme un pauvre chien.
HENRI.
Est-elle gentille !
Il se lève. D’un air triste.
Allons ! Je vais aux courses !
Il prend son chapeau et sa lorgnette et va à la porte de droite d’où il regarde Jeanne avec tendresse.
Au revoir, petit chéri !
Il sort.
JEANNE attend un instant, écoute si la porte d’entrée s’est refermée, puis se lève, et va à la porte du fond. À la cantonade.
Marie, vous ne sortirez pas avant de m’avoir préparé une grosse tasse de chocolat, que je mangerai froid à mon goûter. Vous me monterez aussi deux croissants. Mais, avant ça, vous irez chercher dans ma chambre ma grande boîte de rubans, avec tous mes rubans, et mes deux formes de paille.
Revenant à l’avant-scène. Joyeusement.
Je vais m’amuser à me faire des chapeaux !