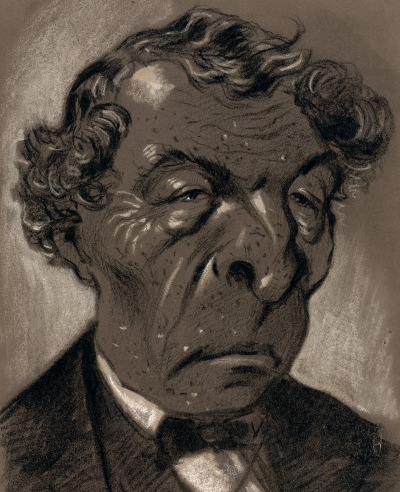L’Angélus (Adolphe D’ENNERY - Jean-Baptiste-Pierre LAFITTE)
Drame en cinq actes et six tableaux.
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 10 novembre 1846.
Personnages
LE DUC DE PALLAVICINI
LE COMTE TORRIANI
LE MARQUIS DE CAMPEGGI, capitaine de Province
GENNARO
FLAVIO
BRACCHI
LE PODESTAT
LE SÉNATEUR
JACOPO,
MARINI, bûcheron
PREMIER SEIGNEUR
SECOND SEIGNEUR
BEATRIX PALLAVICINI
FENELLA
FIORELLA
LUIGINA
LA SOUS-MAÎTRESSE
PREMIÈRE PENSIONNAIRE
DEUXIÈME PENSIONNAIRE
SEIGNEURS
BÛCHERONS
PAYSANNES
PIQUEURS
GARDES
ACTE I
Une vaste chambre de paysan dont la charpente est très élevée. Au fond, une croisée et une grande porte laissant voir que la maison est bâtie dans une clairière de forêt. À quelques pas de la porte d’entrée, un escalier en bois qui monte dans une autre pièce, élevée de plusieurs pieds au dessus du sol. Presque sur l’avant-scène, à gauche, un massif de murailles forme un angle. Dans ce massif et sur la ligne qui est vis-à-vis du spectateur est une porte à plein cintre, dont les battants ouverts laissent voir un vaste hangar. Sous les poutres qui servent de pilastres à ce hangar, on aperçoit les premiers arbres de la forêt.
Scène première
FIORELLA, PLUSIEURS OUVRIERS BÛCHERONS, puis FLAVIO
Quelques ouvriers entrent et sortent chargés de fagots, qu’ils portent dans le hangar. Un autre ouvrier les range en tas.
FIORELLA.
Assez comme ça !... Il faudra maintenant ranger les autres près du four.
JACOPO, s’approchant de Fiorella avec un air de confiance.
Paie-t-on aujourd’hui, mamselle Fiorella ?
FIORELLA.
Vous savez que ce n’est pas à moi qu’il faut demander ça.
MARINI.
C’est vrai, Jacopo ; tu sais ben que c’est pas cette jeunesse qui tient la caisse.
JACOPO.
Pardi ! je crois bien... depuis quelque temps personne ne la tient, la caisse.
FIORELLA.
Chut !... Maître Bracchi est là qui fait ses comptes... Attendez qu’il ait fini.
JACOPO.
Je ne sais pas s’il fait ses comptes... mais il y a diablement longtemps qu’il n’a fait le mien.
MARINI.
Est-il de bonne humeur aujourd’hui ?
FIORELLA.
Hum ! hum !... Ce n’est pas moi qui voudrais être la femme de cet homme-là !... En voilà une qui fait son purgatoire en ce monde !
JACOPO, à demi-voix.
Est-ce qu’on se querelle toujours ?
FIORELLA.
Dame ! quand ça va mal du coté des alaires, ça ne va guère mieux du côté de la bonne intelligence, et si ma maîtresse Luigina, qui est si bonne, n’avait pas quelquefois son fils Gennaro pour se placer entre elle et son mari... Tenez !... hier encore...
Tous les ouvriers bûcherons se groupent autour de Fiorella, qui a baissé la voix comme pour faire une confidence.
Ah ça ! vous me faites jaser là, vous autres, quand vous devriez faire votre besogne... Et puis, vous vous plaindrez !... Allons, allons ! au travail, car c’est moi qui donne des ordres aujourd’hui.
FLAVIO, entrant et portant un fagot.
En ce cas, faites-moi donc le plaisir de m’en donner deux.
FIORELLA.
Deux ordres à vous ! et lesquels ?...
FLAVIO.
D’abord de jeter ce fagot et de me reposer.
Il le jette.
Et ensuite, de vous prendre un baiser pour mon salaire.
Il l’embrasse ; et après un moment de silence.
Eh bien ? allons donc !...
FIORELLA.
Allons, quoi ?
FLAVIO.
Et ces deux ordres ?...
FIORELLA.
Il me semble que vous n’en avez pas besoin.
FLAVIO.
Si fait, pour recommencer... Et vrai, je mé rite cela ; c’est un rude métier que celui de bûcheron...
FIORELLA.
Vous aurez de la peine à vous y faire, monsieur le soldat... C’est que la hache est plus difficile à manier que l’épée.
TOUS.
C’est vrai, c’est vrai...
FLAVIO.
Vous croyez cela, vous autres !... Pour manier la hache, il ne faut que du bras... pour manier l’épée, il faut du cœur.
FIORELLA.
Et je crois que vous ne tarderez guère à reprendre l’arme que vous avez accrochée là à la muraille, quand vous êtes venu demander du travail et l’hospitalisé dans la maison des Bracchi...
FLAVIO, allant décrocher l’épée.
Ma fidèle compagne, ma seule amie... En elle sont toutes mes espérances, car elle est tout mon avenir...
JACOPO.
Comment !
FLAVIO.
Mon Dieu, oui ! mon père m’avait laissé pour tout héritage trois paroles mystérieuses et cette vaillante épée.
FIORELLA.
Ces trois paroles, quelles sont-elles ?...
FLAVIO, avec une gravité feinte.
Elles ne se prononcent que bien bas, bien bas...
FIORELLA.
Vraiment !... C’est donc bien terrible ? Voyons...
Elle approche l’oreille.
FLAVIO, l’embrassant.
Une !...
FIORELLA, s’éloignant.
Fi ! monsieur, c’est affreux...
FLAVIO.
Eh bien ! et les deux autres ?...
FIORELLA, se sauvant.
Merci, j’en sais assez comme ça...
Flavio la poursuit. Gennaro survient, qui se place entre eux deux. La jeune fille s’échappe. Les ouvriers saluent Gennaro et sortent.
Scène II
GENNARO, FLAVIO
GENNARO.
Tu auras ce baiser-là sur la conscience, Flavio !...
FLAVIO.
Est-ce que tu es jaloux, Gennaro ?...
GENNARO.
Moi !... de cette jeune fille !...
FLAVIO.
C’est juste... j’oublie que tu as d’autres amours. Eh bien ! où en es-tu de ces rêves que tu vas chercher sur le lac avec les vapeurs du matin ? Où en est arrivé ce songe si doux qui le fait l’échapper quelquefois la nuit, quand tu vas sur ton batelet prêter l’oreille aux mélodieuses ma tines du couvent de Sainte-Rosalie ?
GENNARO.
Ce songe si doux est devenu plus doux encore, ce rêve est devenu une réalité... Elle m’aime comme je l’aime !
FLAVIO.
Elle le l’a dit ?
GENNARO.
J’ai osé le lui demander à genoux... Ah ! mon ami, l’amour fait quelquefois des miracles, car elle, demoiselle de grande maison, elle a dit à Gennaro, qui n’a que sa carabine, comme tu n’as que ton épée, qu’il était aimé !
FLAVIO.
Vraiment !
GENNARO.
Tu es surpris de mon audace... Moi, le fils d’un simple forestier, amoureux d’une jeune fille noble...
FLAVIO.
Surpris, moi !... Mais je serais amoureux de la fille d’un roi, que je ne désespérerais pas de l’épouser.
GENNARO.
L’épouser ! tu es fou.
FLAVIO.
Pourquoi donc ? Elle posséderait les richesses d’une fille du sang royal, elle serait presque reine, je ne suis moi qu’un pauvre aventurier, il me semble que si ce que tu dis est vrai, si en effet l’amour fait des miracles, notre mariage en se rait un assez beau pour qu’il se donnât la peine de l’accomplir.
GENNARO.
Oh ! tu es toujours insouciant, toujours heureux, toi !
FLAVIO.
C’est le privilège de ceux qui n’ont rien... Enfant d’un pauvre soldat, j’ai parcouru avec lui l’Espagne, l’Angleterre et la France, puis mon père est allé là-haut, en m’imposant un saint de voir que je viens remplir dans ce pays, où tu m’as si cordialement tendu la main... Je suis heureux, parce que je suis libre... Je suis insouciant, parce que j’ai foi dans l’avenir... l’avenir qui peut tout me donner à moi qui n’ai rien, et qui ne peut rien m’enlever à moi qui ne possède rien.
Scène III
GENNARO, FLAVIO, BRACCHI, que l’on voit paraître en haut de l’escalier, tenant des papiers à la main
GENNARO.
Mon père !...
FLAVIO.
Salut à maître Bracchi.
GENNARO.
Bonjour, mon père.
BRACCHI, d’un ton rude.
Ah ! te voilà, toi... Fais venir ici la mère et tous les autres.
FLAVIO, à part.
Toujours la même rudesse !...
Gennaro est allé chercher sa mère ; puis, il ouvre la porte du milieu. On voit entrer par diverses issues Luigina et plusieurs ouvriers bûcherons. Gennaro a descendu la scène et s’est placé à la gauche de Bracchi. Luigina est à sa droite ; il y a un moment de silence.
BRACCHI.
Je vous ai assemblés pour vous annoncer une mauvaise nouvelle...
TOUS.
Une mauvaise nouvelle ?...
BRACCHI.
Mais d’abord, Gennaro, comment a été la chasse sur le lac ?
GENNARO, froidement.
Mauvaise, cette semaine.
BRACCHI.
Et toi, Luigina, me diras-tu si, cette semaine aussi, la soie que nous portons au marché sera abondante ?
LUIGINA, attristée.
L’orage d’hier a perdu la moitié de la récolte... Nous avons trouvé presque tous nos vers à soie morts sur leurs feuilles de mûrier.
BRACCHI, aux ouvriers.
Et vous, votre bras a-t-il été fort et votre cognée vigoureuse ?
FLAVIO.
Maître Bracchi, j’étais le compagnon de travail de ces braves gens, et nous avons fait une large clairière du massif d’arbres de haute futaie que vous nous aviez désigné.
BRACCHI, d’un air sombre.
Eh bien ! ce vigoureux travail que vous avez fait est inutile, et vous n’aurez pas eu plus de bonheur que ma femme et que mon fils.
LUIGINA.
Encore quelques nouveaux malheurs !
BRACCHI, avec amertume.
Parce qu’il a plu à notre gracieux souverain, Morena Pallavicini, de faire une perfidie aux Génois...
LUIGINA, voulant arrêter Bracchi.
Silence !
BRACCHI, vivement.
Eh ! que m’importe !... pourquoi ne pas dire tout haut ce que chacun pense tout bas ?
FLAVIO.
C’est vrai ; votre grand-duc me partout la haine, il ne doit pas s’attendre à récolter de l’affection.
BRACCHI.
Grâce à cette perfidie, les Génois nous déclarent la guerre, et ces arbres immenses qu’ils m’avaient demandés, ces charpentes pour leurs galères, ces mâtures pour leurs vaisseaux, tout cela restera pour mon compte...
Avec désespoir.
Je suis ruine !
Une émotion générale se manifeste. On s’empresse autour de Bracchi. Gennaro et Luigina ont cherché à lui prendre la main.
GENNARO.
Il faut du courage, mon père !... j’aurai mon travail.
BRACCHI, avec ironie.
Belle ressource vraiment ! Le travail d’un chasseur pour soutenir vingt ouvriers... le produit de la chasse à présenter à nos créanciers...
Aux ouvriers.
Si ces créanciers ne m’accordent pas de répit, s’ils exigent tout de suite le paiement des sommes qui leur sont dues, votre industrie est perdue, et, comme je vous le disais, je suis ruiné.
FLAVIO.
Ils vous donneront du temps.
BRACCHI.
Qu’on selle mon cheval... je vais à la ville, je reviendrai bientôt. C’est la vie ou la mort que j’y vais chercher.
Un bûcheron sort.
LUIGINA.
Dieu fasse que ce soit la vie, et surtout une vie plus heureuse...
BRACCHI, prenant la main de sa femme et la tirant à l’écart, lui dit à l’oreille, avec une voix dans laquelle il y a presque une menace.
Le malheur ne serait pas dans cette maison, si tu le voulais...
LUIGINA.
Moi ?...
BRACCHI.
Si la démarche que je vais faire ne réussit pas, à mon retour, femme, nous aurons une explication ensemble... la dernière !
Aux paroles de Bracchi, Luigina baisse tristement la tête ; Gennaro, revenu sur l’avant-scène, après avoir exécuté les ordres du forestier, a remarqué le double mouvement de sa mère et de Bracchi. Celui-ci sort, précédé des ouvriers. Luigina reste en scène ; elle paraît plongée dans ses réflexions.
Scène IV
GENNARO, LUIGINA
Gennaro vient doucement à sa mère qui, d’abord, ne le voit pas.
GENNARO, presqu’à voix basse.
Ma mère !
LUIGINA, comme réveillée en sursaut.
Ah !... c’est toi, Gennaro...
GENNARO.
Vous voilà bien triste, ma mère... Tout est-il donc plus désespéré que ne le disait mon père ?
LUIGINA.
Que peut-il y avoir de pire que ce qu’il a annoncé ?
GENNARO.
Je ne le sais pas, ma mère !... mais là, à l’instant, quand mon père vous a parlé bas ; quand sa main a saisi la vôtre, j’ai vu votre visage pâlir, j’ai vu votre front se baisser et tout votre corps frémir.
Luigina détourne la tête.
Il y a quel que chose, ma mère, car Bracchi...
LUIGINA.
Appelle-le ton père, Gennaro ; car il t’a aimé comme s’il l’était, car il t’en a servi aussi fidèlement que celui qui est dans le ciel.
GENNARO.
Mais aime-t-il ma mère ?... la rend-il heureuse comme celui qui n’est plus, et qu’il s’est engagé à remplacer ?
LUIGINA.
Je ne me plains pas, Gennaro ?
GENNARO.
Vous ne vous plaignez pas, ma mère ; mais vous souffrez... Vous ne vous plaignez pas ; mais je surprends souvent des larmes dans vos yeux... Oui, je vous ai vue pleurer, vous, la meilleure, la plus tendre des mères. Vous cherchiez, comme en ce moment, à me déguiser votre douleur ; vous cherchiez à me sourire comme vous le faites à présent... mais vous ne pouviez pas... mais tu ne peux pas me tromper, moi, vois-tu, ma mère ; je vois bien que tu souffres ; je vois bien que tu es malheureuse !...
Il se jette dans ses bras et l’embrasse.
LUIGINA, essuyant ses larmes.
Non, mon Gennaro... non, mon fils bien-aimé... je ne souffre pas, quand je suis ainsi près de toi ; je ne suis pas malheureuse, je ne redoute rien, quand je le tiens dans mes bras !...
GENNARO.
Mais quand il est là... sombre et menaçant, comme tout à l’heure ; quand vous tremblez à sa voix... quand vous pâlissez sous son regard... Oh ! que le ciel nous protège... car, alors, il me vient de terribles colères... et si je ne luttais contre moi- même, je me placerais en face de lai pour lui demander raison de vos douleurs !...
LUIGINA, vivement.
Malheureux... Tais-toi !... tais-toi ! étouffe de pareils sentiments. Déjà tu as laissé échapper des paroles qu’il eut fallu contenir... La paix ! la paix entre nous, mon Dieu ! si nous ne pouvons éviter le malheur.
GENNARO.
Soit, ma mère ! soit ; je ne chercherai pas à deviner un secret que vous voulez cacher... La pais donc !... mais que je ne voie plus vos souffrances.
Luigina s’est saisie de la main de son fils, comme pour le remercier. Celui-ci embrasse sa mère au front ; puis il va prendre son fusil et sort lentement.
Scène V
LUIGINA, seule un instant, puis FLAVIO, LES OUVRIERS, ensuite SOLDATS et CAMPEGGI
LUIGINA, regardant sortir Gennaro.
Son âme est grande et noble, mais son cœur est violent !... Mon Dieu ! que faire ? Si Bracchi n’a pas réussi, à son retour, la lutte que je soutiens depuis cinq années va recommencer encore... Et, cependant, il faut me souvenir de la plus sainte des promesses, il faut appeler toutes les forces de mon cœur pour contenir un secret que Bracchi a déjà voulu m’arracher.
Un grand bruit se fait entendre au dehors. Flavio entre suivi des ouvriers.
Qu’est-ce donc ?
FLAVIO, à Luigina qui a remonté la scène avec crainte.
Ne vous effrayez pas... c’est un homme qu’on poursuit... Il faut que ce soit quelque personnage important, car il y a assez de cavaliers, de soldats et d’officiers pour livrer une véritable bataille.
Campeggi paraît suivi de plusieurs officiers et de soldats.
CAMPEGGI, aux soldats.
Suivez la route, ballez la forêt ! Mort ou vivant, qu’on me l’amène...
Les soldats exécutent cet ordre ; Campeggi entre avec ses officiers.
De par Son Altesse le grand-duc, moi, marquis de Campeggi, capitaine de la Province, je fais connaître à tous que, sous peine de la vie, ordre est donné de n’accorder ni le repos ni l’asile au comte Torriani... ordre est donné à tous ceux qui le rencontreront de le tuer sur place...
TOUS.
Ah !
CAMPEGGI.
C’est près d’ici que nous avons perdu sa trace ; vous savez à quel danger vous vous exposez s’il pénétrait dans cette maison, qui est sur son passage ; vous surtout, madame, allez prévenir les gens de votre maison des ordres sévères dont ils pourraient être victimes.
Luigina fait un signe d’assentiment, et sort.
FLAVIO.
Mais on le dit merveilleusement rusé, ce seigneur Torriani, et il sera peut-être difficile de mettre la main sur lui.
Scène VI
LES MÊMES, UN INCONNU, un manteau sur le bras
L’INCONNU.
Je puis vous en donner des nouvelles ; et, d’abord, il ne saurait être dans cette maison, car je viens de le rencontrer ; il est même bien loin d’ici, car le coursier qu’il monte semble dévorer l’espace.
CAMPEGGI.
Expliquez-vous ?
L’INCONNU.
Oh ! mon Dieu ! la chose est bien simple ; je marchais paisiblement sur la route qui, de cette forêt, conduit à la mer ; j’ai vu passer devant moi un homme à cheval qui galopait à toute bride... L’homme était pâle et plein de terreur.
CAMPEGGI.
Cela se conçoit.
À part.
Faire courir sus à un gentilhomme comme à une bête fauve... c’est d’un exemple détestable.
Haut.
Après, Monsieur, après ?
L’INCONNU.
Le vent faisait flotter un manteau violet que portait le voyageur ; une valise de cuir, placée à la croupe de son cheval, se détachait... J’ai crié à cet homme qu’il allait perdre son trésor ; mais le cavalier n’a pas tenu compte de l’avertissement. À ce moment, le manteau qui flottait sur ses épaules en a glissé et est venu tomber sur la route ; alors, j’ai hâté ma course pour l’atteindre, mais j’ai vu, bien distinctement, la main droite de cet homme plonger dans la valise, puis, une bourse est tombée sur le chemin.
CAMPEGGI.
C’était pour vous tenter, pour vous empêcher de le poursuivre.
L’INCONNU.
C’est ce que j’ai pensé... Par malheur, il allait trop vite pour qu’il me fût possible de l’atteindre, et je m’arrêtai. Je ramassai la bourse, et, en revenant sur mes pas, je retrouvai le manteau... Comme je ne suis pas assez pauvre pour me couvrir du manteau d’autrui, voyez si celui-ci est bien au comte de Torriani.
Il déploie le manteau qu’il portait sous son bras, et le donne à Campeggi, qui le montre à ses officiers.
Comme je suis trop honnête homme pour garder l’argent qui n’est pas à moi, voyez si cette bourse ne pourrait pas appartenir à quelque grand seigneur.
L’inconnu jette la bourse sur la table.
CAMPEGGI.
Le manteau est conforme au signalement.
FLAVIO.
La bourse est pleine d’or ; et, quand il s’agit d’un homme qui a pressuré le peuple, c’est un signalement aussi.
CAMPEGGI.
Il n’en faut pas douter, c’est le comte Torriani.
À l’inconnu.
Par où est-il passé ? quelle est la route qu’il a suivie ?
L’INCONNU.
Je l’ai laissé dans la direction de la mer ; mais s’il presse toujours ainsi son cheval, tous deux tomberont bientôt épuisés de fatigue.
CAMPEGGI.
Merci, mon brave !...
Il va pour sortir ; puis, revenant sur ses pas.
Ah ! et la bourse de ce traitre...
Flavio la prend sur la table et la lui donne.
CAMPEGGI, pesant la bourse.
Tant que ça !...
Il la met dans sa poche.
Monsieur, ce que vous venez de faire est d’un honnête citoyen.
À ses officiers.
Alerte, vous autres ! Nous savons par où il faut passer... À cheval ! à cheval !
Scène VII
L’INCONNU, FLAVIO
Tout le monde est sorti à la suite de l’officier et des soldats. Flavio a décroché son épée suspendue à la muraille, et s’est croisé les bras ; il regarde l’inconnu.
L’INCONNU, assis et embarrassé des regards fixes de Flavio.
Vous me regardez bien, jeune homme !... Est ce que je ressemble à quelqu’un que vous con naissiez ?
FLAVIO.
Non, monsieur !... Dieu merci pour mes amis !
L’INCONNU.
Qu’est-ce à dire, monsieur ?...
FLAVIO.
C’est à dire que vous avez de la tête et de l’aplomb, seigneur comte de Torriani !
L’INCONNU, se levant et fouillant dans sa poitrine.
Moi !... vous trompez...
FLAVIO, qui a porté la main à son épée.
Alors, pourquoi cherchez-vous par là un poignard... Croyez-moi, laissez en repos cette petite lame ; que pourrait-elle contre celle-ci ?
Il montre son épée.
et convenons que vous n’êtes pas le comte de Torriani... Mais dites-moi donc, honnête voyageur, qui n’êtes pas le comte Torriani ! quand ce fugitif vous a jeté son manteau, vous lui avez donc jeté le vôtre, que je ne le vois pas sur vos épaules ?...
L’INCONNU, balbutiant.
Mon manteau...
FLAVIO.
Et votre bourse, vous l’avez donnée tout entière aux pauvres du chemin, sans doute, car je vous défie de m’en montrer une... maintenant que vous venez de donner celle du comte Torriani... Eh bien ?... Voyons !... cette bourse ?... Est-ce que vous voyagez sans argent comme sans manteau ?
TORRIANI, portant de nouveau la main à son poignard.
Vous avez le coup d’œil juste, jeune homme...
FLAVIO.
Et j’ai de plus la main ferme.
Lui dérangeant le bras.
Mais laissez donc votre petit poignard !... Je ne suis pas sujet de votre grand-duc, et je ne vous tuerai pas comme il l’ordonne ; pourtant comme la tête de ceux qui vous font accueil paraît assez sérieusement menacée, comme, pour des raisons à moi connues, je tiens beaucoup à la mienne, je me permettrai de prendre congé de votre Seigneurie... Restez assez de temps ici pour reprendre haleine, mais pas assez pour compromettre ceux qui habitent cette maison... Songez-y bien, monsieur le comte !
Il sort.
Scène VIII
TORRIANI, seul
Où aller ? de quel côté fuir ? De toutes parts, un mur de fer s’oppose à mon passage ; par une ironie atroce, le duc m’a ordonné de partir, puis, aussitôt, il m’a fait poursuivre, et pourtant cet homme est mon complice !... Il occupe un trône que ce poignard lui a donné. Ah ! imprudent que je suis de n’avoir pas pris mes sûretés... de n’a voir gardé dans mes mains aucune preuve... de n’avoir fait signer aucun pacte... Il m’échappe !... et maintenant que le vieux sénat s’agite autour de lui, il offre à sa sévérité mon exil comme un holocauste. Mon démon est parti, dit-il !... Non, prince Pallavicini, ton démon restera !... Il l’en chaînera de nouveau dans des liens que tu ne pourras plus rompre... Il faut... il faut... de l’hypocrisie... Écrivons une supplique toute pleine de repentir... une demande en grâce.
Il écrit.
Mais qui lui portera cet écrit ?...
Scène IX
TORRIANI, BRACCHI
BRACCHI, entrant sans voir Torriani, qui est toujours occupé à écrire.
Toutes mes démarches ont été vaines... plus de répit... Demain !... demain chassé de ma maison !
Bracchi s’est assis la tête penchée dans ses mains. Le comte a entendu ses dernières paroles.
TORRIANI, à part.
Un homme chassé de chez lui !... Eh mais... c’est Bracchi ; avec celui-ci, peut-être, je pourrai m’entendre.
Il va frapper sur l’épaule de Bracchi, qui se lève vivement, tout étonné, et qui interroge le comte du regard.
Ainsi, vous n’avez plus de ressources, maître Bracchi ?
BRACCHI, avec un soupir et le poing fermé.
Plus de ressources ! Mais vous, qui savez mon nom, qui êtes-vous ?...
TORRIANI.
Je suis le come Torriani.
BRACCHI, reculant.
Torriani !...
TORRIANI.
Je puis le sauver !... et, pour cela, je le demande tout simplement de porter cette lettre au grand duc.
BRACCHI.
C’est-à-dire, tout simplement d’être pendu ; car porter cette lettre, c’est prouver qu’on vous a vu, qu’on vous a parlé, qu’on vous a reçu enfin !
TORRIANI.
Raisonnons alors ! Si je connais bien la situation de les affaires, tu le serais pendu demain à quelque arbre de la forêt...
BRACCHI.
C’est vrai.
TORRANI.
Eh bien ! si le grand-duc prend la chose en mauvaise part, ce ne sera que changer de potence... et tu n’auras pas le désagrément de faire ton ouvrage toi-même ; mais s’il y a dans cet écrit telle chose qui force le grand-duc à de sérieuses réflexions, je te récompense largement... Je te fais riche !
BRACCHI, tenté.
Riche !...
Il a pris dans ses mains la supplique du comte ; il la regarde.
Mais comment, moi, pauvre forestier, pourrai-je parvenir jusqu’à son Altesse ?...
TORRIANI.
Je vais t’en donner le moyen... Il faut...
BRACCHI, entendant venir.
Quelqu’un... quelqu’un !... Je ne veux pas qu’on vous trouve ici... Allez m’attendre dans la forêt... À deux cents pas de la maison, vous trouverez une clairière... dans une heure j’y serai...
TORRIANI.
Soit ; je vais l’attendre.
BRACCHI, ouvrant la porte du hangar.
Sortez par là... Si vous aperceviez quelqu’un qui vous fût suspect, vous pourriez revenir sur vos pas et vous cacher sous ce hangar.
TORRIANI.
Dans une heure ?
BRACCHI.
Dans une heure...
Il fait sortir vivement Torriani, et tire ensuite la porte à lui. Voyant arriver Luigina.
Luigina ! si elle le voulait... c’est autre ment que je pourrais ressaisir la fortune...
Avec force.
Eh bien... il faut qu’elle veuille.
Scène X
BRACCHI, LUIGINA
LUIGINA, timidement.
Eh bien !... que s’est-il passé, Bracchi ?
BRACCHI.
Trouves-tu, femme, que mon visage porte une heureuse nouvelle ?
LUIGINA.
J’y trouve de la colère et du désespoir.
BRACCHI.
Et cette colère, et ce désespoir, qui crois-tu qui me les ait donnés, Luigina ?
LUIGINA.
Ceux qui viennent de repousser votre prière... ceux qui ne vous ont laissé aucune espérance.
BRACCHI.
Tu ne comprends pas, Luigina, ou tu feins de ne pas comprendre... Ceux que je viens de quitter ont été sans miséricorde... mais c’est leur droit.
Avec plus de force.
Et pourquoi ne m’auraient-ils pas repoussé, eux, qui me sont étrangers, lorsque, dans ma propre maison, la pitié me manque... quand ma prière n’a pas été entendue... quand ici même toute espérance m’a été ôtée ?...
LUIGINA.
Bracchi !...
BRACCHI.
Écoutez-moi bien, Luigina... Dans un endroit caché que vous connaissez, il y a un trésor, des richesses, qui rendraient à notre famille le bien être et le repos.
LUIGINA, cherchant à soutenir le regard de Bracchi.
Je ne sais ce que vous voulez dire, Bracchi !
BRACCHI.
Que s’est-il passé à l’heure de la mort de votre père ?... Pourquoi vous a-t-il voulu voir seule ? Pourquoi vous êtes-vous enfermée avec lui ?... N’avez-vous pas reçu une confidence qu’il n’a voulu faire qu’à vous... Ne le niez pas ! car, le lendemain, avant qu’il mourut, atteint d’une fièvre ardente, une partie de ce secret lui est échappée... Dans son délire, il a parlé de trésors, de joyaux, de pierres précieuses ?
LUIGINA.
Croyez-vous donc aux paroles d’un homme qui va mourir et dont la raison s’est éteinte avant la vie ?
BRACCHI.
Je crois aux paroles de cet homme, lorsque sa fille bien-aimée, agenouillée auprès de ce lit d’agonie, au lieu d’adresser à Dieu de ferventes invocations pour celui qui va la quitter, murmure aux oreilles du vieillard : « Taisez-vous, père, taisez-vous ! »
LUIGINA.
Mon Dieu !
BRACCHI.
Eh bien ! ce secret, qu’une obstination de cinq années a refusé de me livrer, aujourd’hui ; il faut que je le connaisse !
Luigina joint les mains. Bracchi continue toujours plus vivement.
Car il ne sera pas dit que, parce que vous l’avez voulu, nous serons chassés ignominieusement de chez nous...
LUIGINA.
Si, pour éviter cette honte, il faut vous faire une révélation qui m’est interdite, que les Bracchi trainent donc leur misère et tendent la main... ce n’est pas la pauvreté, c’est la trahison qui déshonore !
BRACCHI.
Mais sais-tu bien ce que je suis capable de faire, Luigina !
LUIGINA.
Je sais ce que je suis capable de souffrir, Bracchi !
BRACCHI, saisissant sa femme par la main.
Peut-être, femme obstinée, peut-être !
LUIGINA, s’écriant malgré elle.
Mon Dieu ! mon Dieu !
BRACCHI.
Ces richesses, où sont-elles ?... ou malheur à toi !
LUIGINA, résistant.
Si je vous le dis, Bracchi, honte sur moi-même !
BRACCHI, au dernier degré d’exaspération.
Honte et malheur donc, puisque tu le veux !
Bracchi pousse sa femme qui tombe par terre ; il s’avance sur elle pour la frapper. Luigina pousse un cri.
Scène XI
LUIGINA, BRACCHI, GENNARO, FIORELLA, FLAVIO
Au cri poussé par Luigina, Fiorella, épouvantée, entre vivement et descend la scène. Au même instant, Gennaro paraît à la porte de la maison et voit sa mère presque foulée aux pieds.
GENNARO, mettant Bracchi en joue.
Arrêtez ou je vous tue !
FLAVIO, paraît suivi de tous les ouvriers ; il s’élance sur Gennaro et détourne le fusil.
C’est votre père, Gennaro !
À ces mots, qui lui font une subite révolution, Gennaro jette avec terreur son fusil, et se précipite aux pieds de Bracchi.
GENNARO.
Lui, mon père !... Oh ! pardonnez-moi, monsieur... pardonnez-moi, mon père, d’avoir osé vous menacer... mais, en arrivant la, en voyant ce que j’ai vu, je ne sais ce qui s’est passé en moi... Grâce, mon Dieu !... grâce ! mais que ceci n’arrive plus ! car la main qui s’est levée sur ma mère m’a rendu fou, et si cette main retombait sur elle, elle me rendrait assassin !
BRACCHI, qui a cherché à se vaincre.
J’ai eu le premier tort, Luigina !... Je le pardonne, Gennaro... Un mauvais génie est sur nous !... Ce qui est arrivé devait arriver... Le malheur de notre maison n’eût pas été complet, si je ne m’étais encore une fois emporté contre toi, femme... si le fils adoptif n’eût fait une menace de mort à son père... Que tout ceci soit oublié... Quand nous nous reverrons...
Il prend la main de sa femme et celle de son fils.
ce sera avec plus de calme, je l’espère... Allons, Flavio !... allons, vous autres, à l’ouvrage !... et pas un mot de tout ceci.
Bracchi sort. Il est suivi à distance de tous les personnages de cette scène. Arrivé sur le seuil de la porte, il fait un signe à sa femme et à Gennaro, qui restent.
Scène XII
LUIGINA, GENNARO.
À peine tout le monde est-il sorti, que Luigina et Gennaro se précipitent dans les bras l’un de l’autre. Ils versent des larmes.
LUIGINA.
Béni soit Dieu, de ce qu’un affreux malheur ne soit pas arrivé !
GENNARO.
Ma mère !
LUIGINA.
Béni soit Dieu, de ce que les mains sont pures, Gennaro ! mais garde-toi de toi-même, garde-toi de cet amour pour lequel, pourtant, il faut qu’une mère te bénisse, car jusqu’à présent il m’a soutenue ! Tout à l’heure, quand Bracchi m’a menacée et quand la colère a voulu me défendre... j’ai cru que j’allais mourir !... Encore une scène pareille, encore de semblables terreurs, et il m’arracherait mon secret.
Mouvement de Gennaro. Luigina lui prend la main.
Oui, oui, ce secret que ton inquiète tendresse avait soupçonné, ce secret existe, il met entre Bracchi et moi le courroux et la désunion ; car je dois le lui cacher, car, pressé par le malheur, mon mari se déshonorerait, et, que Dieu me pardonne de parler ainsi devant l’enfant qui doit le respecter, Bracchi irait jusques au vol, peut-être !
GENNARO.
Que dites-vous, ma mère ?
LUIGINA.
Je dis qu’après la terrible scène qui vient de se passer, je sens que l’heure est venue où j’ai besoin de ton appui... Je vais tout le révéler !
GENNARO.
Parlez, ma mère, parlez.
LUIGINA regarde autour d’elle comme pour s’assurer si personne n’est là. Gennaro va fermer la porte de l’entrée principale, puis il revient vers Luigina.
Ceci est un étrange récit, mon fils, car ce n’est pas seulement des Bracchi que je dois te parler... Tu vas être surpris, en apprenant par quel lien mystérieux la fatalité rapproche le sujet du prince, et comment le malheur du puissant peut peser sur l’humble existence des gens du peuple. Tu étais bien jeune quand les événements dont je vais te parler se sont passés. Alors, ce n’était pas Morena Pallavicini qui régnait sur nous, mais Andreas, son frère aîné. On l’aimait, parce qu’il était juste et bon ; on le plaignait, parce que c’était un père malheureux. Trois de ses enfants, après avoir vécu quelques années, après avoir été la joie de la famille et l’espérance du peuple, moururent d’une inexplicable maladie de langueur ; on soupçonna le poison...
GENNARO.
Votre père m’a souvent conté les événements de cette époque... Il naquit à la duchesse un dernier enfant ; mais celui-là mourut quelque temps après.
LUIGINA.
Non, Gennaro ; malgré la croyance générale, ce dernier enfant n’est pas mort !
GENNARO.
Que dites-vous ?...
LUIGINA.
Le duc a trompé tout le monde afin de sauver son fils. Il a pensé que le poison qui avait tué chacun des autres enfants n’épargnerait pas ce dernier venu ; une cérémonie funèbre a eu lieu autour d’un cercueil vide, et pendant ce temps, l’héritier du duc, furtivement enlevé par un homme dévoué et fidèle, passait la frontière, traversait l’Italie et allait en Espagne, où le prince devait être élevé en secret jusqu’à un moment convenu. En même temps que ceci s’accomplissait, le duc écrivait son testament, qu’il déposait, avec d’autres objets sacrés pour lui, dans une cassette qu’il espérait confier à quelque sujet dévoué, et assez inconnu pour que la trahison ne pût l’atteindre ; et le sujet auquel le prince se confia, ce fut mon père !
GENNARO.
Vote père ?... Quoi ! cet homme du peuple si humble que j’ai vu bûcheron et qui fut soldat ?
LUIGINA.
Il fut soldat... et voilà par quelle voie se sont enchaînées des destinées pauvres et obscures à des destinées si élevées et si glorieuses... Or, cette cassette qui est en ma puissance, que Bracchi soupçonne, et dont il a voulu s’emparer, renferme, avec de précieux joyaux, le testament du grand-duc !... Là est écrite cette volonté dernière qui ne doit être connue que vingt ans après sa mort... et quand ces vingt années seront écoulées, le même jour, à la même heure, doivent se rencontrer, au même rendez-vous, trois personnes parties de trois points différents. C’est à la chapelle des Pallavicini, et sur la tombe vide du royal enfant qu’on a cru mort, que se réuniront ces trois personnes, qui ne se verront et ne se connaitront que lorsqu’elles seront à ce rendez-vous.
GENNARO.
Et ces trois personnes, ma mère ?...
LUIGINA.
La première, sortie d’une humble chaumière, sera le sujet fidèle, dépositaire du testament ; la seconde, sortie de son royal palais, sera la veuve du grand-duc, qui viendra reconnaître et retrouver son enfant, et la troisième enfin sera ce fils lui-même, qui, du fond de l’Espagne, doit apporter sur sa propre tombe un saint rosaire d’argent qui le fera reconnaître, qui lui fera dévoiler sa naissance, ses titres et sa famille.
La nuit commence.
GENNARO.
Oh ! je vois... je comprends tout maintenant.
LUIGINA.
Dans deux jours les vingt années seront accomplies ; dans deux jours, à l’heure où sonnera l’angélus, il faut que le coffret soit porté dans la chapelle ou le rendez-vous est donné ; le serment en a été fait par mon père et renouvelé par moi. Mais si j’allais ou ce dépôt est caché, si j’osais le porter où il faut qu’il soit remis, Bracchi serait sur mes pas, et Dieu sait ce qui arriverait... Je te confie, mon fils, la mission que mon père avait voulu me confier ; c’est toi qui le présenteras à la veuve de Pallavicini, c’est toi qui remettras à son fils le trésor que j’ai bien gardé.
GENNARO.
Et ce dépôt, ma mère, où dois-je l’aller chercher ?
LUIGINA.
À cinquante pas du lac, sur la rive qui borde la forêt, en tenant à sa droite le pensionnat de Sainte-Rosalie, se voit une rangée de chênes. Il y en a sept ; au pied du quatrième, soit qu’on arrive par un côté ou par l’autre de la forêt, se trouve une pierre qui semble être un siège pour le voyageur ; cette pierre est le premier obstacle qu’il faut enlever ; tu creuseras ensuite, et tu trouveras le trésor que tu dois prendre... Dans deux jours, mon fils, à la tombée de la nuit, trouve-toi là, agis pour moi et acquitte la promesse que j’ai faite.
GENNARO.
J’y serai, ma mère ; et je tiendrai fidèlement votre parole.
LUIGINA.
Maintenant, que Dieu me rappelle à lui ou que mon mari me tue, je puis paraître devant toi, mon père ! car notre sainte mission sera remplie.
Ils sortent. Nuit complète.
Scène XIII
TORRIANI, BRACCHI
À peine Luigina et Gennaro ont-ils disparu que la porte du hangar s’ouvre sur le devant ; une autre s’ouvre sur le petit escalier. La nuit est venue. D’un côté, c’est Bracchi qui paraît, de l’autre, c’est Torriani.
BRACCHI, bas.
Ah ! je savais bien qu’elle pouvait nous sauver...
TORRIANI, bas.
Duc de Pallavicini, j’aurai bientôt une revanche à prendre contre toi !...
Il aperçoit la carabine de Gennaro, et s’en empare.
Une arme !... elle me servira en cas de mauvaise rencontre !...
Bracchi descend l’escalier, son fusil à la main.
BRACCHI.
Je serai le premier dans la forêt !
TORRIANI.
Je m’emparerai du dépôt précieux ayant vous, Gennaro !
Bracchi et le comte sortent avec mystère, chacun de son côté.
ACTE II
Premier Tableau
La maison de Sainte-Rosalie ; vaste intérieur dans le style gothique. À droite et à gauche, perspectives de galeries à colonnes. Plusieurs tableaux en pied, représentant de pieux personnages. Le fond de la scène est occupé par trois ogives : celle du milieu, plus élevée que les autres, est fermée par un treillis doré à larges bandes ; intérieurement, un rideau tombe sur ce treillis ; les deux ogives de droite et de gauche sont la fin de deux escaliers à rampe de pierre ciselée. Plusieurs pupitres. Une table couverte d’un tapis à crépines. Des vases de fleurs sur la table. Des livres sur les pupitres.
Scène première
FENELLA, JEUNES PENSIONNNAIRES, vêtues du costume des pensionnaires de Sainte-Rosalie
Les jeunes filles sont diversement groupées et regardent au dehors. Quelques unes sont montées sur des sièges pour voir par dessus la tête des autres.
UNE JEUNE FILLE.
Que c’est beau !... Viens donc voir, Fenella.
FENELLA.
C’est bien facile à dire... Toutes ces demoiselles se sont emparées des croisées qui donnent sur la colline... On me fait toujours des injustices !
PREMIÈRE JEUNE FILLE.
La brillante cavalcade !... Comme les armes reluisent au soleil !... On ne peut pas voir encore le visage des cavaliers ; mais leurs habits sont superbes.
DEUXIÈME JEUNE FILLE.
Eh ! mais, voyez donc... ils escortent une litière.
FENELLA.
Une litière ?... C’est quelque châtelaine qui voyage.
PREMIÈRE JEUNE FILLE.
Ah ! des soldats, maintenant... Un cavalier, tout chamarré d’or, fait faire halte... Il regarde par ici... On semble l’entourer avec respect.
DEUXIÈME JEUNE FILLE.
Oh ! si je pouvais distinguer s’il est vieux ou jeune.
FENELLA.
Je vais vous le dire, moi.
DEUXIÈME JEUNE FILLE.
Non pas, non pas !... Je ne quitte pas ma place.
TOUTES.
Ni moi, ni moi !...
FENELLA.
Je vais vous le dire sans regarder... S’il est jeune, il s’approche respectueusement de la litière ; il a sa toque à la main, et il désigne, avec galanterie, à quelque dame, l’objet qu’il regarde... S’il est vieux, il a sa toque enfoncée sur la tête, et il regarde tout seul.
DEUXIÈME JEUNE FILLE.
Il regarde tout seul.
FENELLA, silencieusement.
Alors, il est vieux.
TOUTES.
Oui, il est vieux.
FENELLA.
Et c’est peut-être quelque illustre pensionnaire qu’on vient enfermer à Sainte-Rosalie.
DEUXIÈME JEUNE FILLE.
Si c’était vrai, quel bonheur !... Nous aurions un jour de vacances.
FENELLA, qui a entendu du bruit.
Vite, au travail !... la sous-maîtresse !...
Scène II
FENELLA, LES JEUNES PENSIONNNAIRES, UNE SOUS-MAÎTRESSE
À l’avertissement de Fenella, les pensionnaires quittent les fenêtres ; celles qui étaient montées sur des chaises s’y assoient ; on a repris des missels, des cartons, des métiers à broder qui étaient épars çà et là ; on fait semblant de lire, dessiner, travailler dans d’hypocrites attitudes.
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Très bien, mes enfants ! très bien !... je suis heureuse de voir que vous n’avez pas besoin de surveillante pour travailler.
FENELLA.
Certainement, madame, et si on nous surveillait jamais... ce serait toujours... comme tout à l’heure... N’est-ce pas, mesdemoiselles ?
TOUTES.
Oui, oui...
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Je rendrai compte à madame la directrice de votre assiduité et de votre bonne tenue... Avec de telles élèves, le pensionnat de Sainte-Rosalie, l’asile des filles nobles, ne perdra rien de sa belle renommée.
FENELLA, qui parcourt un livre in-folio.
Justement, j’en tiens la chronique ; la maison ou l’on reçoit les filles nobles n’a pas toujours été un paisible monastère. Jadis, ses épaisses murailles, sa solide porte de fer en avaient fait une prison.
LA SOUS-MAÎTRESSE.
C’est vrai, et plus d’une fois, on y a retenu de grands personnages.
FENELLA.
Mais à présent, on y retient des jeunes filles... c’est une bien forte cage pour de si frêles oiseaux.
TOUTES.
Oh ! oui.
LA SOUS-MAÎTRESSE, fronçant le sourcil et allant à Fenella.
Fenella, Fenella !... ceci est mal... Est-ce que le goût du monde vous aurait suivie jusqu’ici ?
FENELLA.
Le monde !... nous l’abhorrons toutes, le monde, et nous ne voudrions jamais sortir de cet asile, si on nous y permettait à chacune... une seule chose...
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Une seule chose... et laquelle, mes enfants ?... laquelle ?...
FENELLA.
Un mari.
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Un mari ?...
FENELLA.
Rien qu’un... n’est-ce pas, mesdemoiselles ?
TOUTES.
Oui, rien qu’on...
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Un mari !... Fi ! l’horreur !...
FENELLA.
Comment, l’horreur !... Vous n’avez donc jamais été mariée, dame Catherine ?...
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Jamais !... et je m’en fais gloire.
FENELLA.
Mais peut-être vous a-t-on fait la cour ?
LA SOUS-MAÎTRESSE.
La cour ?... à moi !...
FENELLA.
Oui, il y a longtemps ?... très longtemps !...
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Jamais, mademoiselle !
FENELLA.
Comment ! vous n’avez jamais vu là, à vos genoux, un jeune homme, un joli jeune homme, qui vous regardait avec tendresse... et qui vous disait...
LA SOUS-MAÎTRESSE, s’oubliant.
Et qui disait, quoi ?...
TOUTES.
Oui, oui, que disait-il ?
Elles se groupent autour de Fenella.
FENELLA.
Qui vous disait que vous étiez belle...
LA SOUS-MAÎTRESSE, soupirant.
À moi... Ah !
TOUTES.
Après ?... après ?...
FENELLA.
Plus belle que tous les anges.
LA SOUS-MAÎTRESSE, soupirant.
Ah !...
TOUTES.
Après ?... après ?...
FENELLA.
Qui, s’emparait de votre main... qui la couvrait de baisers...
LA SOUS-MAÎTRESSE, soupirant.
Ah !...
TOUTES.
Après ?... après ?...
FENELLA, animant le récit.
Et s’il jurait de vous aimer, de vous adorer toute sa vie... est-ce que vous le repousseriez avec colère ?...
LA SOUS-MAÎTRESSE, hésitant.
Mais...
FENELLA.
S’il menaçait de se tuer, de mourir à vos pieds de douleur et d’amour, est-ce que vous n’auriez pas un peu de compassion ?... un peu de charité ?...
LA SOUS-MAÎTRESSE, entraînée.
Ah ! si... si...
FENELLA.
Allons donc !... Vous voyez bien qu’il ne faut jamais dire : Un mari, fi, l’horreur !
Toutes les jeunes filles rient.
LA SOUS-MAÎTRESSE.
Chut ! silence !
À part.
Oh ! la petite rusée... Je me suis laissé prendre.
Haut.
Oubliez tout cela, mesdemoiselles !... Je vais auprès de la directrice, mes enfants... Je lui rendrai compte de l’assiduité dans laquelle je vous ai trouvées.
FENELLA, riant.
Et de nos sages pensées sur la retraite.
La sous-maîtresse sort, les pensionnaires l’ont saluée par une révérence ironique.
Scène III
FENELLA, LES PENSIONNAIRES
À peine la sous-maîtresse est-elle partie, que les jeunes filles reviennent en tumulte et reprennent leur gaité bruyante.
PREMIÈRE JEUNE FILLE.
Quel dommage qu’elle soit venue !... Si nous allions dans le dortoir... De là on aperçoit le bas de la colline, et nous pourrons voir encore.
Toutes les pensionnaires remontent la scène en même temps, en s’écriant : Au dortoir ! au dortoir !
UNE PENSIONNAIRE.
Tu ne viens pas, Fenella ?
FENELLA.
Non ; allez sans moi ; je vous avertirai si l’en nemi vient.
Scène IV
FENELLA, seule
Comptez là-dessus !... Ma foi, que chacune veille pour elle-même... Oui, courez regarder à travers les barreaux de la cage... Moi, je puis aller plus loin que vos regards ne peuvent s’étendre... L’épaisse muraille, la porte solide ne sont rien pour moi... je sors quand je veux... je vais, je viens !... je respire l’air, la fraicheur du bois, la brise du lac... je marche libre et heureuse !... oui, bien heureuse !... car depuis que je l’ai vu là, à mes genoux, joignant les mains et me disant : « Fenella, oh ! laissez-moi vous aimer comme on aime l’ange qui nous guide et qui nous soutient... Depuis ce jour, j’ai quelqu’un qui s’intéresse à ma destinée, et, bien plus, je puis faire la destinée de quelqu’un ! Un mot de ma bouche est écouté avec respect, mon moindre signe est obéi... Je suis plus qu’une reine... une reine qui n’a qu’un sujet ; mais un sujet qui l’aime bien... et toutes les royautés n’en ont pas autant... Parlons vite...
Elle marche doucement, et s’approché de la boiserie. Elle touche un des tableaux, dont le sujet est la Vierge tenant son fils entre ses bras, aussitôt, un panneau se dérange, glisse et laisse voir une ouverture. Au moment de passer, Fenella hésite.
C’est singulier ! chaque fois qu’il s’agit de franchir cette porte, j’ai peur. Bah ! la cage est ouverte... et l’oiseau s’envole !...
Scène V
LE DUC, BEATRIX, PLUSIEURS SOUS-MAÎTRESSES, CAMPEGGI, OFFICIERS de la suite du duc
LE DUC.
Allez avertir madame la directrice... qu’au nom du grand duc, je viens lui demander un asile
Montrant Beatrix.
pour madame la comtesse d’Amalfi.
Les sous-maîtresses s’inclinent, et sortent par la gauche. Le duc fait ensuite un signe aux officiers, qui se retirent par la droite.
LE DUC, à Beatrix.
Et maintenant, madame, vous voilà arrivée dans la retraite que j’ai voulu choisir pour vous... Je vous ai dit quelle était ma volonté... Pour tous, vous n’êtes ici que la comtesse d’Amalfi et non pas la duchesse... la douairière...
BEATRIX.
Puis-je au moins demander au grand-duc pour quoi la veuve de son frère a été secrètement en levée de sa résidence ?... Gardée à vue, surveillée par vous-même, je suis arrivée ici comme une criminelle qu’on cache.
LE DUC.
Eh bien ! madame... que ce soit aujourd’hui un jour d’explication franche et loyale entre nous... Depuis quelque temps, on agite sourdement le peuple, le sénat se révolte contre mon autorité. Or, dans un pareil moment, lorsque j’ai besoin de montrer à tous l’union de la famille souveraine, vous fuyez ma cour, et les mécontents se groupent autour de vous... Les conspirations commencent ainsi, madame !...
BEATRIX.
Et quand le prince Morena s’inquiète, il punit sur un rêve, il emprisonne sur un soupçon...
LE DUC.
Soupçons ou rêves, madame, je ne veux laissera nul rebelle ni prétexte, ni drapeau... Je vous conduis ici, où vous resterez enfermée pendant un mois.
BEATRIX, à part.
Un mois !... mais il faut que dans deux jours je sois libre.
Haut.
Songez-y, duc ! la veuve de votre frère a des droits aussi... Le sénat sera juge entre nous.
LE DUC.
Cette dernière parole, madame, vous fait réellement prisonnière.
BEATRIX, à part.
Mon Dieu !... soutenez-moi.
LE DUC, à ses officiers.
Qu’on appelle un capitaine de mes gardes...
Un officier sort.
Dans votre propre intérêt, Beatrix, il me faut votre silence, votre résignation...
Campeggi entre. Au même instant, la directrice, amenée par la sous-maîtresse, arrive du côté opposé.
Approchez...
CAMPEGGI.
Monseigneur m’a fait l’honneur...
LE DUC.
Monsieur le capitaine, nous allons vous charger d’une mission importante.
CAMPEGGI.
Son Altesse est trop bonne.
À part.
Il ignore comment j’ai rempli la première vis-à-vis de Torriani.
LE DUC.
Vous resterez pendant un mois, avec vingt hommes, dans cette demeure, et sur votre tête vous répondrez de madame.
CAMPEGGI.
Sur ma tête !...
LE DUC, à la directrice.
Madame, des raisons d’État forcent le prince de laisser une escorte à la comtesse d’Amalfi... Lorsqu’elle aura franchi la grille qui conduit à cet oratoire, souvenez-vous bien qu’elle n’en peut sortir que sur un nouvel ordre.
Il sort suivi de ses officiers, à droite. La directrice et les sous-maîtresses rentrent à gauche.
Scène VI
BEATRIX est restée debout, immobile et les yeux fixés devant elle
Ah ! que Dieu fasse payer à cet homme toutes les angoisses qu’il me donne... Prisonnière ! prisonnière... quand jamais je n’eus plus besoin d’être libre !... quand mon fils va m’attendre... mon fils qui a été, à la même heure, ma douleur et ma joie... Car on m’a dit, au moment où mon cœur s’inondait de tendresse et d’amour... « Il faut qu’il soit mort pour toi... Le premier baiser que tu lui donnes doit être en même temps et le baiser d’accueil et le baiser d’adieu. » Et quand l’heure est arrivée où je pourrais le reconnaître et lui crier enfin : Je suis ta mère ! on me dit : Vous ne sortirez pas de ces lieux !
En redescendant, elle se trouve devant le tableau placé à sa droite Elle tombe à genoux et prie.
Ô vous, qui avez si cruellement souffert de votre maternité, voyez, mon cœur se brise... Mère des mères, je vous invoque afin que mon fils soit sauvé !
À ce moment, le tableau devant lequel la duchesse prie glisse doucement et se déplace. Beatrix recule, effrayée.
Ma raison s’égare-t-elle ? ou Dieu fait-il on mi racle, envoie-t-il à mon secours ?
Fenella paraît par l’issue qu’elle a ouverte.
Scène VII
BEATRIX, FENELLA
FENELLA.
Dieu est toujours pour ceux qui pleurent, madame.
BEATRIX.
Vous qui venez à moi avec cette parole consolante, qui êtes-vous ?
FENELLA.
Ah ! je ne suis pas un ange ; mais une pauvre pensionnaire de cet asile... J’ai entendu vos derrières paroles : vous désirez sortir d’ici, et vous en sortirez.
BEATRIX.
Mais par quel moyen ?
FENELLA.
Je vais vous le dire, madame... Parmi les femmes renfermées ici, il y en avait une qui pleurait bien souvent, et dont j’étais devenue la meilleure amie... car moi, qui ris toujours, c’est étonnant... j’aime tous ceux qui pleurent... Depuis longtemps la pauvre recluse était malade... et une nuit que je veillais à son chevet, elle m’avoua qu’il y avait aux portes de cet asile quelqu’un qui l’attendait... quelqu’un qu’elle pouvait aller rejoindre, grâce à cette issue secrète... Mais comme elle se sentait trop faible pour marcher, elle voulut que j’allasse dire à celui qui l’aimait, de ne plus l’attendre et de prier pour elle... Voilà comment je suis devenue dépositaire d’un secret... voilà comment je suis libre dans cette maison où tout le monde est prisonnier... voilà comment, enfin, je puis vous sauver, madame...
BEATRIX.
Merci, merci, mon enfant !... C’est Dieu qui vous a envoyée à moi... Car si j’étais entrée là, si j’avais franchi le seuil de l’oratoire, je n’avais plus qu’à mourir...
FENELLA.
Avant que l’heure ne vienne où vous devez y entrer, madame, je saurai trouver un moment favorable.
BEATRIX.
Ainsi, ce chemin ?...
FÉNELLA.
Conduit au bord du lac.
BEATRIX.
Mais, arrivée là... je dois aller plus loin encore, et il me faudrait le traverser. Quand vous m’aurez quittée, trouverai-je quelque batelier qui voudra s’exposer à braver le danger qu’il y aurait à me servir et à me demeurer fidèle ?...
FENELLA.
J’en connais un très dévoué... très fidèle sur tout...
BEATRIX.
Oh !... je reconnaitrai son dévouement... je paierai sa fidélité...
FENELLA.
Non... pardon... vous reconnaîtrez son dévouement ; mais... sa fidélité, c’est... moi que cela regarde.
BEATRIX.
Vous l’aimez ?...
FENELLA.
Et de toute mon âme !... Vous qui me paraissez si noble et si digne, je vous ai fait cet aveu comme je le ferais à ma mère ; et, comme Gennaro et moi n’avons qu’un cœur, vous pourrez demander le dévouement de Gennaro, comme une mère pourrait le demander à son fils.
BEATRIX.
Mais ce jeune homme sera-t-il là à l’heure où vous pourrez m’y conduire ?...
FENELLA.
Il y sera ; car, au moment où vous m’avez vue, je venais de déposer un signal qui le fera s’y trouver, et ce signal, n’eût-il pas été placé à l’avance, il me semble qu’il s’y trouverait, parce que j’ai besoin de lui... Entre lui et moi, voyez-vous, il y a comme de mystérieux avertissements.
BEATRIX.
Pauvre enfant ! c’est l’amour dans sa pureté et dans sa première croyance.
Beatrix a pris la main de Fenella.
FENELLA, vivement.
Ah ! ne pensez pas que je sois folle, madame ! Tenez, à présent, au moment où je vous parle, il me semble que Gennaro nous écoute, qu’il sait ce que je veux et qu’il va s’offrir à vous comme pour confirmer ma parole...
La cloche de la porte du couvent se fait entendre. Fenella, recule, effrayée du bruit, puis elle se rassure et sourit.
Ah ! mon Dieu ! voyez ce que c’est que de se mettre de pareilles idées en tête : au bruit de cette cloche, je me suis prise à croire que c’était lui.
Une porte est poussée sur un des côtés du théâtre. On entend la voix de Gennaro.
GENNARO, au dehors.
Je vous assure que ce que je dis est la vérité.
FENELLA, tremblant d’étonnement et de bonheur.
C’est lui... mon Dieu ! c’est lui !... Eh bien ! qu’est-ce que je vous disais, madame ?...
Scène VIII
BEATRIX, FENELLA, GENNARO, CAMPEGGI
Gennaro entre le premier en scène ; il est rudement poussé par Campeggi.
FENELLA, triomphalement à l’oreille de la duchesse.
Maintenant, que notre bonne étoile nous l’envoie, laissez-moi faire.
Beatrix presse avec reconnaissance des mains de Fenella ; puis, ensuite, elle remonte la scène pour sortir, et passe devant Campeggi qui la salue respectueusement. Pendant ce mouvement, Gennaro s’est approché de Fenella.
GENNARO, bas, à Fenella.
Fenella, il faut que je vous parle...
FENELLA, de même, en voyant Campeggi qui descend la scène.
Silence !... Je vais renvoyer cet officier...
CAMPEGGI, à Gennaro.
À nous deux maintenant, mon drôle ! Et nous verrons si tu es réellement ce que tu prétends être... Ce n’est pas le marquis de Campeggi qu’on trompe !...
FENELLA.
Le marquis de Campeggi !... Oui, vraiment, c’est bien le marquis de Campeggi.
CAMPEGGI.
Hein ?... On sait mon nom ici... Que vois-je... Fenella... la charmante Fenella !...
GENNARO.
Ils se connaissent !...
Bas.
Eh quoi ! Fenella !...
FENELLA, bas.
Chut donc !
Haut.
Vous ne m’avez donc pas oubliée, monsieur le marquis ?
CAMPEGGI.
Vous oublier !... moi, dont le château avoisinait la maison de votre mère, moi, qui passais régulièrement dix fois par heure, ce qui fait cent vingt fois par jour, devant vos fenêtres... sous lesquelles je chantais des romances comme un...
GENNARO, d’un air moqueur.
Comme un troubadour...
CAMPEGGI.
C’est ce que j’allais dire... Moi, dont tout le bonheur était de vous entrevoir au milieu de vos fleurs... plus suave et plus fraiche qu’elles toutes... et semblable à...
GENNARO, même jeu.
À la rose...
CAMPEGGI.
C’est ce que j’allais dire... Moi enfin... qui ne pensais... qui ne rêvais qu’à vous... qui vous ai mais... qui vous adorais comme un...
GENNARO.
Comme un sot.
CAMPEGGI.
C’est ce que j’allais...
Se reprenant.
Drôle... manant !...
FENELLA.
Mais enfin, pourquoi vous querelliez-vous donc avec ce jeune homme ?...
CAMPEGGI.
Je l’ai trouvé cherchant à s’introduire furtivement dans cet asile, et...
GENNARO.
Furtivement !... Je vous ai dit que j’étais le fermier de la chasse du lac, et que j’avais besoin de parler à madame la directrice qui doit m’attendre...
CAMPEGGI.
Mensonge que tout cela...
FENELLA.
Certainement... cela doit être... cela peut être faux... Il est vrai que je vous reconnais pour Gennaro, le fermier du lac... mais on ne dérange pas ainsi madame la directrice, et j’approuve M. de Campeggi, qui refuse de vous conduire près d’elle.
CAMPEGGI.
Sans doute...
GENNARO.
Comment ?...
FENELLA.
Et ce n’est que lorsqu’il se sera convaincu par lui-même qu’elle vous attend, qu’il viendra vous reprendre ici... Allez, monsieur le marquis, je garderai votre prisonnier...
CAMPEGGI, bas.
Mais... laisser cet homme avec vous...
FENELLA.
Allez...
Bas.
et revenez bien vite... Vous devez avoir tant de choses à me dire.
CAMPEGGI.
J’y vole... mademoiselle, j’y vole avec transports !...
Il sort.
FENELLA.
Nous en voilà débarrassés !... Parlez vite, Gennaro...
GENNARO.
Fenella, je vous ai dit que le malheur menaçait ma famille ; ce malheur est arrivé.
FENELLA.
Pauvre Gennaro... Mais ensuite... ensuite ?...
GENNARO.
Je vous ai souvent parlé de ma mère, du saint amour que j’ai pour elle, et qui ne pourrait se comparer à aucun autre amour, si je ne vous aimais pas... Eh bien ! cette mère pieuse et bonne devra quitter l’humble demeure où elle a vu mourir son père et naître son enfant ; bientôt la misère nous chassera loin de ce pays... et je viens vous voir, Fenella... pour la dernière fois !...
FENELLA.
Pour... la... dernière fois... Est-ce que j’ai parlé de cela, moi, monsieur ?...
GENNARO.
Non, sans doute, mais...
FENELLA.
Mais... mais... puisque je ne l’ai pas dit, if me semble que cela ne doit pas être...
GENNARO.
Fenella, vous ne m’avez pas compris ; je vous ai dit que nous ne possédions plus rien...
FENELLA.
Mais je vous ai dit, moi, que je vous aimais, ce qui fait que vous avez maintenant beaucoup plus que vous ne possédiez autrefois...
GENNARO.
Mais il faudra que je parte !...
FENELLA.
Eh bien ! nous partirons !...
GENNARO.
Nous... partirons ?...
FENELLA.
Puisque je vous aime !... Il ne faut pas beaucoup de temps pour nous marier... Je suis orpheline, vous serez ma famille, et, je suis tranquille.
S’appuyant sur son bras.
Ma famille travaillera pour elle et pour moi ; elle est bien bonne ma famille !... mais je ne veux pas que ma famille s’attriste, je veux que ma famille rie... et tout de suite encore... Allons !...
GENNARO.
Chère Fenella ! près de vous, tous mes chagrins s’envolent...
FENELLA.
À la bonne heure. Nous partirons bientôt ; mais il ne faut pas que te soin de notre avenir nous rende égoïstes ; mon ami, ce n’est pas moi seule qu’il faudra arracher d’ici...
GENNARO.
Que veux-tu dire ?...
FENELLA.
Il y a dans cette demeure... une femme bien à plaindre, et à qui j’ai promis ton secours.
GENNARO.
Puisque ta as promis, Fenella, je suis prêt... Mais cette femme... quelle est-elle ?...
FENELLA.
La voici !...
Scène IX
FENELLA, GENNARO, BEATRIX
BEATRIX.
Eh bien ?...
FENELLA.
N’ayez plus de crainte, madame ; il vous sauvera l...
BEATRIX.
Soyez bénis, l’un et l’autre !... Oh ! oui, sois bénie, mon enfant !...
Elle embrasse Fenella.
GENNARO.
Madame, tout ce qu’une volonté forte, tout ce qu’un dévouement sans bornes peuvent accomplir, je l’accomplirai pour vous !...
BEATRIX.
C’est plus que la vie que je vous devrai... Mais à quel moment, et comment fuirons-nous ?...
FENELLA.
Tout à l’heure.
GENNARO.
Et par cette issue... connue de nous seuls... au bout de cette galerie...
Il ouvre le panneau secret.
est une sortie sur la campagne... et dans un instant...
À ce moment, on entend dans la galerie qu’il vient d’ouvrir la voix d’une sentinelle.
LA VOIX.
Sentinelles, veillez !...
GENNARO et FENELLA.
Grand Dieu...
BEATRIX.
Cette voix...
GENNARO.
Une sentinelle est placée là... des gardes veillent au dehors, comme ils veillent au dedans... Tout est perdu...
BEATRIX.
Seigneur ! Seigneur... vous voulez donc que je meure ici ?
FENELLA.
Mourir... Comment, monsieur, vous entendez cela, et vous ne trouvez rien ?
GENNARO.
Fenella, sa douleur me désespère ; mais que faire ?
FENELLA.
Je ne sais pas, moi, mais je la sauverai... Nous vous sauverons, madame.
GENNARO.
Fenella... ignorez-vous à quel danger tous expose ce généreux dévouement ?
FENELLA.
Qu’importe !... S’il n’y avait pas de danger, ou serait donc le mérite. C’est décidé... vous sortirez d’ici, madame.
BEATRIX.
Il y a donc encore un moyen de salut ?
FENELLA.
Peut-être !...
GENNARO.
Et ce moyen, quel est-il ?
FENELLA, apercevant Campeggi.
Le seigneur Campeggi ! c’est lui que je... Silence et laissez-moi seule avec lui.
Scène X
FENELLA, GENNARO, BEATRIX, CAMPEGGI
CAMPEGGI.
Le rustre disait vrai !...
À Gennaro.
Madame la directrice veut bien vous recevoir.
FENELLA, à Gennaro.
Alors, voilà votre chemin.
CAMPEGGI, à Beatrix qu’il salue.
Madame...
FENELLA, à part, à Gennaro.
Vous reviendrez ici...
GENNARO, de même.
Je reviendrai...
BEATRIX.
Voici bientôt l’heure où ma prison doit de venir plus sévère, et je vais me préparer à la retraite...
FENELLA, bas, à Beatrix, montrant la porte à droite.
Attendez-moi là... Je vous sauverai, madame !
Elle fait un signe à Béatrix et à Gennaro ; chacun sort d’un côté opposé.
Scène XI
FENELLA, CAMPEGGI
CAMPEGGI, à part.
Me voilà seul avec elle !... Comment entamerai-je ce doux entretien ?...
FENELLA.
Maintenant, quel moyen employer ?... Bon ! j’y suis...
CAMPEGGI.
Surtout n’effarouchons pas sa candeur...
FENELLA, à part.
Il est plein d’amour-propre et de fatuité... Allons...
Haut et avec décision.
Monsieur de Campeggi !
CAMPEGGI.
Mademoiselle ?...
FENELLA.
Monsieur de Campeggi... voulez-vous m’enlever ?
CAMPEGGI.
Hein ?... Plaît-il ?... Comment, vous enlever ?...
FENELLA.
Je ne sais pas comment ; je vous demande si vous voulez m’enlever ?
CAMPEGGI, à part.
Tudieu !... Et moi qui craignais d’effaroucher sa candeur !
FENELLA.
Comment !... vous hésitez ?...
CAMPEGGI.
Permettez, permettez, mademoiselle ; je... je réfléchis.
FENELLA, d’un ton affecté.
Réfléchir ! Ah ! ce n’est pas maintenant, monsieur... c’est lorsque vous passiez cent vingt fois par jour sous mes fenêtres, qu’il fallait réfléchir...
CAMPECGI.
Eh quoi ! ces simples promenades auraient touché votre cœur ?
FENELLA.
Et vos regards, monsieur !... vos regards que vous tourniez sans cesse de mon coté.
CAMPEGGI.
Ces regards auraient été compris ?... mes yeux auraient embrasé votre âme !... Oh ! dites-moi, dites-moi encore, belle Fenella, que vous n’éliez pas insensible à mon amour...
FENELLA, d’un air hypocrite.
Tout ce que je puis vous dire, monsieur, c’est que j’aime assez pour que cet asile soit devenu, à mes yeux, une odieuse prison. Tout ce que je puis vous dire, c’est que, si je n’obtiens pas que vous réalisiez le projet d’évasion que j’ai formé... il y aura ici bien des larmes répandues... bien des malheurs que vous aurez causés...
À part.
On ne pourra pas dire que j’aie menti !
CAMPEGGI.
Moi ! se peut-il... Ah ! trop heureux Campeggi ! Oh ! je n’hésite plus, Fenella ; ce soir même, je vous fais franchir les murs de cette prison !...
FENELLA.
Mais elle est à présent entourée de soldats !...
CAMPEGGI.
Ils sont tous placés sous mes ordres... Il nous faudrait seulement un homme intelligent et dé voué qui vous servit de guide, lorsque vous aurez dépassé nos postes.
FENELLA, ayant l’air de chercher.
Un homme dévoué... Attendez donc... Ce garçon... qui était là tout à l’heure ?...
CAMPEGGI.
Qui... ce rustre ?... ce... Gennaro ?
FENELLA.
Gennaro, justement... Vous êtes si adroit, qu’il sera bientôt, j’en suis sûre, dans nos intérêts.
CAMPEGGI.
C’est convenu... je le séduirai... Soyez seule ment prête à partir...
FENELLA.
À la tombée de la nuit, quand toutes mes camarades se réuniront ici pour prier, comme ce n’est que le voile baissé qu’on se rend à la chapelle, je m’approcherai de vous, et je vous dirai : « C’est moi, me voilà !... »
CAMPEGGI.
C’est convenu... chère Fenella...
Il veut lui baiser la main.
FENELLA, la retirant.
On vient... c’est Gennaro... Songez à le séduire... songez que mon bonheur est dans vos mains.
Elle s’éloigne.
CAMPEGGI, à part.
Ravissante !... adorable !... Et, comme je l’ai étourdie, fascinée... Voilà une conquête qui me fera bien de l’honneur...
FENELLA, qui, pendant ce temps, a parlé bas à Gennaro.
Quoi qu’il le commande, obéis sans hésiter.
Elle sort.
Scène XII
GENNARO, CAMPEGGI
À peine Fenella est-elle partie, que Campeggi s’approche vivement de Gennaro et lui frappe sur l’épaule.
CAMPEGGI.
Écoute, l’ami ; tu n’es pas riche ?...
GENNARO.
C’est vrai.
CAMPEGGI.
Donc, tu as besoin d’argent, et moi, j’ai besoin de toi.
GENNARO.
Et que faut-il faire pour le service de monsieur le marquis ?
CAMPEGGI.
M’aider en bon confrère.
GENNARO.
Comment ?
CAMPEGGI.
Eh ! oui, mon cher !... Comme tu es chasseur sur le lac, je suis chasseur, moi, dans les retraites où l’on renferme les jeunes et jolies filles.
GENNARO.
J’entends, et vous voulez que je mette à votre service mes rames et mon batelet...
CAMPEGGI.
Justement... Je me charge de faire traverser à ma belle les portes du pensionnat et les lignes de nos soldats... Mais il faut que tu l’attendes sur bords du lac...
GENNARO.
J’y serai, monseigneur.
CAMPEGGI.
Tu as une famille, j’ai pensé que tu ne refuserais pas de donner asile à cette jeune fille pendant quelques jours...
GENNARO.
Vous ne pouviez pas mieux vous adresser. Certes, monsieur le marquis, personne plus que moi n’aimera à vous rendre le service que vous me demandez.
CAMPEGGI.
À merveille ! Prends donc cet or, ce n’est qu’un simple à-compte ; car j’entends le payer généreusement.
GENNARO.
Pardon, monsieur le marquis !...mais si vous saviez tout le plaisir que j’éprouve à vous rendre ce service, vous comprendriez que je ne veuille pas être payé deux fois.
CAMPEGGI.
Vraiment !... c’est très bien, mon garçon... Ces gens-là ont quelquefois du cœur.
GENNARO.
Les grands seigneurs ont tout l’argent ; il faut bien qu’il nous reste quelque chose...
CAMPEGGI.
Écoute... on annonce la prière du soir... C’est l’instant qu’elle m’a indiqué... N’oublie pas... Tu l’attendras aux bords du lac.
GENNARO.
C’est convenu.
Ils sortent ensemble.
Scène XIII
FENELLA, BEATRIX, LA SUPÉRIEURE, SOUS-MAÎTRESSES, PENSIONNAIRES
Deux femmes sortent de la chambre où l’on a vu entrer la jeune pensionnaire ; à ses vêtements, l’une paraît être la duchesse, et c’est Fenella ; l’autre paraît être Fenella, et c’est la duchesse. Au moment où elles passent au milieu du théâtre, Beatrix chancelle et s’arrête.
BEATRIX, soulevant son voile.
Oh ! la force m’abandonne !
FENELLA, soulevant le sien.
Courage !... courage !... et vous êtes sauvée...
Elles laissent retomber leur voile. De toutes parts débouchent des pensionnaires. Peu à peu le fond de la scène se remplit. Le treillis doré s’est ouvert, et la prétendue Beatrix, dont le voile cache le visage, va se prosterner dans l’oratoire sur un prie-Dieu qui lui est réservé. L’orgue ou des chants peuvent annoncer la prière du soir. Campeggi rentre en scène.
BEATRIX, au moment où la prière finit, s’approche du marquis et lui dit à voix basse.
C’est moi, me voilà !...
CAMPEGGI.
Par là... par là !... Dans un instant, je vous conduirai.
À part.
Elle est à moi !
Il la conduit doucement dans la direction de la porte par laquelle elle va sortir.
LE DUC entre alors, et s’adressant à Campeggi.
Eh bien ?...
CAMPEGGI, montrant la faussé duchesse dans l’oratoire.
Voyez, monseigneur !
LE DUC.
Maintenant... me voilà tranquille pour tout un mois...
BEATRIX, à part, disparaissant par la droite.
Merci, mon Dieu, je reverrai mon fils !
Deuxième Tableau
Une forêt. À la droite, et presque sur l’avant-scène, une petite crique du lac sur le bord de laquelle flotte un batelet amarré au rivage ; sur la gauche est toute l’épaisseur de la forêt. De ce massif et jusqu’à l’autre côté du théâtre, qui s’élève en colline, s’étend une ligne de chênes. Au pied de celui du milieu se trouve un quartier de rochers qui peut servir de siège. Dans le fond, une éclaircie d’arbres laisse voir les lointains du lac.
Scène première
MARINI, JACOPO, BÛCHERONS, puis GENNARO
Au lever du rideau, les bûcherons ont la hache à la main. Dans le courant de la scène, ceux qui sont dans le fond s’en sont peu à peu, Marini et Jacopo, qui travaillent près des premiers plans, sont des derniers à l’ouvrage.
MARINI.
Ma hache est émoussée... voilà plus d’une de mi-heure que le soleil est couché... je vais en faire autant.
JACOPO, travaillant toujours.
Encore quelques copeaux !
MARINI.
Tu as ce soir bien du zèle au travail.
JACOPO.
J’adore le travail... Aussi, comme les copeaux sont à nous, je fais des copeaux.
GENNARO, entrant.
C’est ici le lieu du rendez-vous ! « Faites tout ce que vous commandera cet officier, m’a dit Fenella, et ayez confiance en moi. » J’ai obéi en aveugle, et maintenant il ne me reste plus qu’à attendre... Mais il faut à tout prix éloigner ces ouvriers...
Haut.
Salut, mes amis...
TOUS.
Salut, maître...
GENNARO.
Vous avez assez travaillé pour aujourd’hui... Il est temps de rentrer dans vos demeures...
MARINI.
Rien ne presse, maître ; la lune va bientôt se lever, et nous pourrons regagner notre logis sans crainte de nous égarer...
GENNARO, à part.
Il faut pourtant que je sois seul.
JACOPO.
Est-ce que vous allez à la chasse, ce soir ?
GENNARO, préoccupé.
Oui... je... vais à la chasse !... Mais en voilà assez, croyez-moi, rentrez... Songez que vos femmes vous attendent...
MARINI, bas.
On dirait qu’il veut nous renvoyer...
JACOPO, bas.
Il attend peut-être quelqu’un... une amourette...
GENNARO.
Allons, bonsoir, bonsoir ; mes braves...
MARINI, bas.
C’est bien ça...
JACOPO, de même.
Décidément, il nous renvoie...
MARINI.
Tenez, maître Gennaro, vous désirez être seul, n’est ce pas ?
GENNARO.
Moi... mais...
MARINI.
Il fallait nous le dire franchement ; nous vous aimons assez pour vous obéir tout de suite.
GENNARO.
Merci, merci, mes amis, et au revoir.
JACOPO, riant.
Bonsoir... et bonne chasse...
Les ouvriers sortent.
Scène II
GENNARO, seul
Le ciel aura-t-il écouté ma prière ?... aura-t-il secondé ses efforts ?... Oui, elles sont libres toutes les deux en ce moment... Je conduirai Fenella près de ma mère... c’est là qu’elle restera jus qu’à ce qu’un prêtre ait béni notre union, jus qu’à ce que j’aie rempli le serment de ma mère... C’est ici, près de moi, qu’est ce dépôt sacré confié à notre honneur... Dieu nous garde, sans doute, un meilleur avenir, puisqu’il a voulu nous associer à de si hautes destinées, puisqu’il a voulu que le pauvre bûcheron tint dans ses mains la fortune d’un prince les destins de tout un pays... Mais Fenella... elle ne vient pas... Ah ! je crois entendre... Oui, c’est un bruit de pas, sous ces allées... Je vois un voile blanc qui folle... C’est elle !...
Scène III
GENNARO, BEATRIX
GENNARO, courant au devant de Beatrix voilée.
Fenella ! ma Fenella !...
BEATRIX, soulevant son voile.
Ce n’est pas Fenella.
GENNARO.
Quoi ! madame...
BEATRIX.
Non, ce n’est pas celle que vous attendiez qui vient à vous... mais c’est une femme dont la reconnaissance sera éternelle, pour le service que vous lui rendez... Ma présence vous explique tout et vous fait tout comprendre... Touchée de cette douleur dont vous avez été témoin, Fenella s’est dévouée... Serez-vous moins généreux qu’elle ?
GENNARO.
Mais, quand la vérité sera conne, le plus grand danger la menacera.
BEATRIX.
Avant que ces dangers puissent l’atteindre, je l’aurai sauvée ; elle en a reçu la promesse... Je la renouvelle entre vos mains... Pardonnez-lui, par donnez-moi de vous avoir trompé !... D’impérieux motifs, qui ne peuvent être révélés encore, sont mon excuse... Fenella se confie à vous comme à un frère, et moi je m’y confie comme à un homme d’honneur et de courage.
GENNARO.
Puisque c’est sa volonté que vous m’apportez, madame, je suis prêt au départ, prêt à l’obéissance.
BEATRIX.
Bon et noble cœur !... Mais avant que nous partions, car chacun de mes moments est compté, un mot encore... Promettez-moi, comme vous le promettriez sur votre salut, que vous cacherez à tous le secret de cette fuite...
GENNARO.
Je vous le jure, madame !
BEATRIX.
Merci, Gennaro, merci !... Croyez que jamais vous ne trouverez de cour qui se souvienne plus que le mien.
GENNARO, qui entend du bruit.
Silence !... on vient par là.
BEATRIX.
Partons !
GENNARO.
Votre bras, madame, votre bras !...
La duchesse s’est appuyée sur le bras de Gennaro. Elle est entrée dans le batelet. Gennaro a pris la rame et commence à pousser au large.
BEATRIX.
Et, maintenant, que Dieu nous aide !
Le batelet disparaît.
Scène IV
BRACCHI, puis TORRIANI
À peine Gennaro et Beatrix sont-ils disparus, que l’on voit arriver Bracchi par la gauche ; il porte son fusil sous le bras. Après deux ou trois pas, il s’arrête brusquement.
BRACCHI, s’orientant.
À cinquante pas du lac, sur la rive qui borde la forêt... c’est bien ici !... J’ai à ma droite le pensionnat de Sainte-Rosalie... Par conséquent, devant moi doit se trouver la rangée de chênes.
Presque en même temps que le forestier, Torriani est entré par la droite, il a paru au haut de la colline ; il est armé du fusil de Gennaro. Comme Bracchi, il s’est arrêté en arrivant.
TORRIANI.
J’ai si bien écouté, et l’endroit a été si bien dé signé, qu’il est facile de le reconnaître... J’y suis !
BRACCHI, qui s’est avancé.
Cherchons le premier des sept chênes.
TORRIANI.
Soit qu’on arrive par un côté de la forêt, soit qu’on arrive par l’autre, en comptant ces arbres, c’est au quatrième que je trouverai ce que je viens chercher.
BRACCHI.
L’obscurité est grande.
Il touche un arbre.
Mais je le tiens !...
Il va du premier au deuxième arbre.
Deux...
Allant au troisième.
TORRIANI, qui en fait autant.
Deux !...
BRACCHI, s’arrêtant entre le troisième et le quatrième arbre.
Le cœur me bat !
TORRIANI.
À chaque pas qui me fait approcher du but, mon émotion redouble.
BRACCHI, s’élançant vers le troisième chêne.
Trois !...
TORRIANI, de même.
Trois !...
BRACCHI, écoutant.
J’ai entendu du bruit !...
TORRIANI.
Est-ce le vent ? ou bien quelqu’un vient-il ?
Moment de silence.
BRACCHI.
Rien... Deux pas de plus, le trésor est à moi.
TORRIANI.
Ici près est la puissance, la fortune !
BRACCHI et TORRIANT, presqu’en même temps.
Quatre !
TOUS DEUX.
Qui va là ?
Bracchi et Torriani se trouvent ensemble près du quatrième arbre ; chacun de son côté à posé un pied sur la pierre qui sert d’indice.
TORRIANI.
Encore une fois, qui êtes-vous ?
BRACCHI.
Quelqu’un qui ne recule pas quand il a pris une résolution.
TORRIANI.
C’est la voix de Bracchi !
BRACCHI, le reconnaissant.
Le comte !... Mais vous vous êtes trompé, monseigneur, ce n’est pas ici que je vous ai donne rendez-vous.
TORRIANI.
Vraiment ?... tu... tu crois ?...
BRACCHI.
J’en suis sûr... Je connais un peu la forêt... vous vous êtes égaré... Tenez, voilà là-bas votre chemin... Au revoir !
TORRIANI.
Comment ! au revoir... mais je n’allais là-bas que pour l’y attendre, et puisque te voilà, je reste.
BRACCHI, à part.
Ah ! diable !...
TORRIANI.
Mais, si je me suis trompé en venant ici, tu t’es donc égaré aussi, puisque je t’y trouve ?
BRACCHI.
Moi... c’est... c’est que...
TORRIANI.
Enfin, n’importe : nous y voilà tous les deux, parlons de la commission et va bien vite la remplir...
BRACCHI.
Non, merci, allez-y vous-même. J’ai d’autres moyens de m’enrichir...
TORRIANI.
Comment... tu refuses ?...
BRACCHI, lui remettant le papier.
Entièrement ; et voilà votre lettre que je vous rends... Adieu...
TORRIANI, sans bouger.
Adieu donc !...
BRACCHI, de même.
Adieu, monsieur le comte.
TORRIANI.
Adieu ! adieu !... Mais tu ne bouges pas !
BRACCHI.
Vous n’avez pas l’air de vouloir vous aller...
TORRIANI.
C’est qu’en effet, je désire rester ici...
BRACCHI.
Ah bah !... et moi aussi.
TORRIANI.
Mais... je désire y rester seul...
BRACCHI.
Et... et moi aussi...
TORRIANI.
Mais, tu te rappelleras qui je suis, et tu me céderas le pas, je l’espère.
BRACCHI.
Dans la forêt, monseigneur, le bûcheron est chez lui ; il ne cède le pas à personne.
TORRIANI.
Écoute, Bracchi... j’attends ici quelqu’un... Consens à l’éloigner, et, demain, je le fais plus riche que tu n’étais naguère...
BRACCHI.
Vraiment ? Eh bien ! moi, je n’attends personne, et je n’ai besoin de personne pour m’enrichir... La fortune doit vous venir ici, c’est ici que je viens la chercher.
TORRIANI.
Ici ? Mais tu sais donc...
BRACCHI, posant fortement la crosse de son fusil sur la pierre.
Ce qui est sous la crosse de cette carabine est à moi !
TORRIANI, de même.
Il faudra auparavant soulever la crosse de la mienne.
BRACCHI.
Ainsi, monsieur le comte, vous avez écouté aux portes ! et dans une maison où vous avez reçu l’hospitalité... Ah ! c’est mal, monseigneur.
TORRIANI.
Ainsi, maître Bracchi, vous avez écouté une confidence qu’on ne vous faisait pas !
Bracchi recule et commence à charger son fusil avec sang-froid.
BRACCHI.
À cette question, je vais faire ma réponse.
TORRIANI, de même.
Ah ! fort bien ! je commence à comprendre comment nous allons dialoguer.
BRACCHI.
Monsieur le comte, il y a dans cette carabine une chevrotine de chasse, et je vais y ajouter deux balles de bon calibre...
TORRIANI.
Maître Bracchi, il y a dans cette carabine une charge qui est suffisante, et je viens d’y ajouter trois chevrotines.
Il a reculé comme Bracchi, et il continue à charger son fusil avec la même impassibilité.-Lui montrant la lettre que Bracchi lui a remise.
Tu n’as pas voulu porter cette lettre au grand duc, tu l’emporteras chez le diable !...
Il en fait une bourre.
BRACCHI.
C’est ce que nous verrons !
Chacun ensuite, fait jouer la batterie de son fusil, et tous deux se mettent silencieusement en joue.
Prenez-y garde ! celui des deux qui manquera l’autre, ce ne sera pas moi !... À soixante pas, j’abats un daim à la course ! et un grand seigneur n’est pas plus difficile à abattre qu’un daim...
TORRIANI.
Un instant !... Je ne suis pas si sûr de moi, et je te propose un arrangement...
BRACCHI.
Lequel ?...
TORRIANI.
À nous deux le trésor, à nous deux le secret, à nous deux la fortune...
BRACCHI.
Vous aimez mieux ça que... ceci ?
Il montre son fusil.
TORRIANI, même jeu.
Et toi ?...
BRACCHI.
Va donc comme il est dit...
TORRIANI.
À l’ouvrage, alors...
BRACCHI.
À l’ouvrage...
TORRIANI.
Dépose donc la carabine.
BRACCHI.
Après vous, monseigneur...
TORRIANI.
Moi... du tout ; je n’en ferai rien...
BRACCHI.
Eh bien ! alors... ensemble...
TORRIANI.
Ensemble... je le veux bien...
Ils s’observent et viennent déposer leurs fusils l’un près de l’autre.
BRACCHI.
À présent, ne perdons pas de temps...
TORRIANI.
Enlevons d’abord cette pierre...
BRACCHI, l’aidant à soulever la pierre.
Elle est lourde ; mais nous en viendrons à bout...
TORRIANI.
Là... voici la place du trésor.
BRACCHI, prenant une houe.
Je creuserai avec cette houe.
Il creuse. Après que quelques coups de houe ont été donnés, on doit voir que, tout à coup, une pensée vient à Torriani, dont Bracchi ne doit pas s’apercevoir. Le jeu bref et muet de l’acteur doit faire connaître que c’est une pensée de trahison.
TORRIANI, se jetant sur son fusil.
Arrête... j’entends des pas...
BRACCHI.
Quelqu’un... quelqu’un !... Malédiction !
TORRIANI.
Silence !...
Il va à pas de loups jusqu’aux arbres de la forêt et écoute.
BRACCHI.
Eh bien ?
TORRIANI.
Chut !... on s’éloigne... les pas se perdent tout à fait... Je n’entends plus rien.
BRACCHI.
Continuons alors...
TORRIANI, le couchant en joue.
Oui, mais je continuerai seul...
Il tire, et l’étend mort.
BRACCHI, tombant et poussant un grand cri.
Ah !
TORRIANI.
Un succès comme celui-là ne pouvait appartenir à deux hommes à la fois, maître Bracchi !...
Il s’est mis au travail qu’avait commencé Bracchi.
Hâtons-nous... C’est un rude travail et dans un moment difficile...
S’excitant.
Allons, allons... ah ! j’en viendrai à bout.
Il soulève la cassette et l’ouvre.
Oh ! les papiers seulement !
Il enlève les papiers.
Ceci se glisse sous les plis du vêtement, et peut se cacher à tous les yeux ; quant à cette cassette... le lac est profond... je ne me chargerai pas d’un poids inutile...
Il remet la terre ; puis la pierre.
Faisons disparaître tous ces indices. À moi la puissance, à moi la grandeur !
Il veut s’éloigner par la gauche ; mais, tout à coup, des voix se font entendre qui partent de la forêt.
Ces cris ! ces torches allumées !...
Il écoute avec effroi.
Ce sont les bûcherons dont les cabanes sont éparses dans la forêt... c’est ce coup de feu... c’est le cri qu’a poussé cet homme qui les attire ici !... Par où m’échapper ?...
Il remonte la colline. À ce moment, Luigina entre en scène avec les autres.
Scène V
LUIGINA, MARINI, JACOPO, BÛCHERONS
LUIGINA.
Qu’est-il arrivé ?... C’était comme un cri de mort... et Gennaro n’est pas rentré... et Bracchi a dépassé l’heure où il revient à la maison... C’est ici que mon fils abrite sa barque...
Elle appelle.
Gennaro ! Gennaro !... Pas de réponse...
Elle aperçoit le corps de Bracchi qu’elle ne reconnaît pas encore.
Horreur !... un homme est là... Voyez !...
On approche les torches ; elle regarde le cadavre et reconnaît Bracchi. Elle se jette sur lui avec un cri déchirant.
Mon mari ! Bracchi ! Bracchi... réponds-moi !... Parle, parle ! c’est Luigina !... Ah ! sa bouche est muette... ses mains sont glacées !... il est mort !
TOUS.
Mort !
LUIGINA.
Voyez, mon Dieu ! voyez !
MARINI, examinant Bracchi.
Mort assassiné !... frappé d’une balle !
LUIGINA, presque en délire.
Frappé d’une balle !
Elle se presse le front de ses deux mains.
Ô mon Dieu ! écartez de mon esprit cette horrible pensée... Frappé ici... c’est à l’endroit que j’ai indiqué à Gennaro, que mon mari est tombé.
On a écouté.
MARINI, s’avançant vivement vers Luigina.
Que voulez-vous dire ?
LUIGINA, encore troublée, mais revenant à elle.
Rien, rien !
Elle éclate en sanglots.
Rien, je suis folle... Écoutez-vous les paroles d’une femme en délire ?
MARINI, s’avançant.
Mais Bracchi a dû trouver ici quelqu’un que nous y avions laissé...
LUIGINA.
Quelqu’un ?... Ah ! ce n’est pas lui... ce n’est pas lui !
MARINI.
Vous le savez donc ?... nous n’avons nommé personne.
LUIGINA.
Moi !... non... Je croyais... Mais alors, celui qui était là...
MARINI.
C’était votre fils...
LUIGINA.
Mon fils !
MARINI.
Oui, Gennaro, qui était impatient de nous voir partir et qui voulait à tout prix se trouver seul.
LUIGINA.
Vous mentez... vous mentez !... ce n’était pas mon fils, entendez-vous !
MARINI.
Ce matin encore, il a menacé Bracchi.
LUIGINA.
Taisez-vous, Marini, taisez-vous !... Dieu maudit ceux qui accusent l’innocent.
MARINI.
Dieu maudit les assassins, Luigina !
LUIGINA, dont la main a rencontré l’arquebuse, la regarde et pousse un cri.
Ah !...
TOUS.
Qu’est-ce donc ?
LUIGINA, cachant la carabine.
Rien... rien...
À part.
La carabine de Gennaro !
La cachant dans les broussailles.
Ah ! qu’ils ne la voient pas du moins...
Tombant à genoux.
Mon Dieu ! mon Dieu ! ayez pitié de moi.
ACTE III
Une des chambres de la maison de Bracchi. Deux portes dans les angles à pans coupés : fenêtre au milieu, dont les volets sont fermés ; quand ils s’ouvrent, ils donnent sur un chemin qui va de la forêt au lac. Quelques sièges de bois. Une table, et tout ce qu’il faut pour écrire. La chambre est éclairée par une lanterne posée sur la table.
Scène première
FIORELLA, FLAVIO
FLAVIO.
Ce que vous dites est impossible !
FIORELLA.
Vous voyez bien que ça est pourtant. Il n’y a personne dans la maison.
FLAVIO.
C’est étrange !
FIORELLA.
J’ai entendu du bruit... le bruit d’une arque buse, je me suis réveillée en sursaut... J’ai couru vers la chambre de Luigina, cette chambre était vide... J’ai eu peur, et j’ai été frapper à la porte de Gennaro ; la porte n’était pas fermée... la chambre était vide aussi !...
FLAVIO.
Il n’est pas rentré ?
FIORELLA.
Alors je suis venue dans cette chambre où nous sommes, espérant y trouver maître Bracchi... vous voyez, il n’y a personne non plus.
FLAVIO.
Maudit soit le sommeil qui m’a retenu sur mon lit... Il est à peine trois heures du matin... Allons, allons, je ne resterai pas ici à attendre ce que je veux connaître.
Il va pour sortir. Deux grands coups se font entendre à la porte extérieure.
FIORELLA, effrayée.
Ah ! mon Dieu !
FLAVIO.
On frappe, il faut ouvrir... J’y vais.
FIORELLA, le retenant.
Restez, restez ; jamais maître Bracchi, ni personne de la maison n’a frappé ainsi.
FLAVIO, encore retenu par Fiorella, a remonté la scène ; il se trouve près de la fenêtre.
Voyons à qui nous avons affaire...
Deux coups retentissent au dehors, en même temps ; Flavio a ouvert la fenêtre.
C’est votre maîtresse, hâtez-vous, Fiorella, allez.
Fiorella sort.
Que s’est-il passé ?... ce magistrat, ce peuple, ce lugubre cortège ?... et cette civière sur laquelle est jeté le cadavre d’un homme ?...
Il se frappe le front.
Quelle affreuse lumière !... Bracchi, poussé au désespoir, aurait-il attenté à sa vie ?... Ah ! courons !...
Scène II
FLAVIO, LUIGINA
Flavio s’est élancé vers la porte. Tout à coup, par la porte opposée, rentre Luigina ; elle va prendre la main de Flavio, et le retient.
FLAVIO, se retournant étonné.
Vous !
LUIGINA, mettant la main sur la bouche de Flavio et lui parlant à voix basse et entrecoupée.
Silence !... oh ! qu’on n’entende pas ce que je vais vous dire... c’est peut-être la mort de Gennaro.
FLAVIO.
Gennaro ?... Que signifie ?... Expliquez-vous ?...
LUIGINA.
Eh bien ! un crime horrible a été commis... Bracchi a été assassiné !
FLAVIO.
Assassiné ?...
LUIGINA.
Oui, près d’ici, au bord du lac, à l’endroit même ou Gennaro abrite son batelet.
FLAVIO.
Mais le meurtrier ?...
LUIGINA.
Oh ! je n’ai pas le courage de vous dire le nom de celui qu’on accuse...
FLAVIO.
Grand Dieu !...
LUIGINA.
Mais, si vous avez aimé mon fils, s’il y a dans votre cœur quelque reconnaissance...
Les mains jointes.
oh ! quelque humanité seulement...
FLAVIO, porte la main sur son cœur.
Parlez, parlez !...
LUIGINA.
Il faut trouver Gennaro, il faut lui annoncer ce qui se passe, il faut qu’il se prépare à se défendre s’il est innocent, il faut qu’il parte s’il est coupable !
FLAVIO.
Coupable ?... lui !... Non, non, vous ne le croyez pas, Luigina, vous ne le croyez pas !
LUIGINA.
Je voudrais arracher le soupçon de mon âme !... mais ce que j’ai vu, mon Dieu !...
FLAVIO.
Ah ! repoussez, repoussez toute funeste pensée. Ce matin, dans un transport de colère, à l’aspect de Bracchi levant la main sur vous, Gennaro a pu menacer son père, mais se souiller d’un meurtre, lui... le meilleur, le plus noble des hommes oh ! non, non, Luigina ; et cette voix ne me trompe pas, qui, du fond de mon cœur, me crie : défends-le, Flavio, défends-le, car il est innocent.
LUIGINA.
Oh ! oui, oui, il est innocent, n’est-ce pas ? Mais n’importe, vous le verrez, vous lui parlerez...
FLAVIO.
Je ferai mieux, Luigina, je découvrirai le coupable...
LUIGINA.
Mais par quel moyen ?
FLAVIO.
Je ne sais pas ; mille souvenirs, mille pensées se heurtent dans ma tête... J’ignore ce que je vais entreprendre ou chercher ; mais je sens là, pauvre mère, que je vous rendrai votre fils...
Il sort.
LUIGINA.
Allez, allez et que le ciel vous seconde !... Pas par là, vous les rencontreriez... Entendez-vous ! ils se répandent dans toute la maison. Par ici... par ici !...
Scène III
LUIGINA, un moment seule, puis LE PODESTAT, FIORELLA, MARINI, BÛCHERONS, FEMMES
LUIGINA, regardant partir Flavio.
Noble cœur !... Non, mon fils n’est pas coupable... Mais que n’aurais-je pas à craindre du jugement des hommes, quand, moi, sa mère, qui connais son âme, je n’ai pu dans, mon désespoir me défendre de cette horrible pensée ?
Elle tombe à genoux.
Ô mon Dieu, pardonnez-la-moi !... Oh ! n’est-ce pas, mon Dieu, n’est-ce pas que mon fils n’est pas un assassin.
À ce moment, les deux assesseurs du podestat entrent ; ils précèdent celui-ci ; ils désignent Luigina au magistrat. Pendant qu’il s’avance vers Luigina encore à genoux, tout le monde entre et se groupe.
LE PODESTAT.
On vous cherchait, Luigina ; votre devoir était de rester où nous étions.
LUIGINA, en se levant.
Vous le voyez, je priais !... Cet appareil, ce peuple... j’étais venue chercher un peu de calme loin du spectacle qui me tue.
LE PODESTAT.
Prenez des forces, pauvre femme ! car il vous faudra répondre aux questions que je serai forcé de vous adresser.
Sur un signe du podestat, Fiorella avance un siège sur lequel Luigina s’assied. Le podestat s’est assis auprès de la table ; un des assesseurs est à ses côtés, la plume à la main et un papier devant lui. Il doit écrire l’interrogatoire pendant la durée de la scène.
LE PODESTAT.
D’après ce qu’on connaissait de la situation de ses affaires, on a cru d’abord que votre mari s’était débarrassé de la vie ; mais sa carabine, que nous avons rapportée, a été trouvée près de lui, et elle est encore chargée... Bracchi est donc mort assassiné...
Luigina pose sa tête sur ses mains et sanglote.
Découvrir qui a commis le crime, et quel intérêt on avait à le commettre, voilà la tâche qui nous est prescrite, et pour laquelle il faut que nous vous veniez en aide...
LUIGINA.
Je suis prête à répondre.
LE PODESTAT.
On sait que Bracchi avait été dans la matinée voir ses créanciers ; il leur devait une somme considérable... Cette somme, l’avait-il sur lui, et vous avait-il dit qu’il dût la leur porter ?
LUIGINA.
Nous étions à bout de ressources, monsieur le podestat ; et, sans savoir pour quel motif mon mari était sorti, je puis vous affirmer qu’il n’avait sur lui aucune somme d’argent.
LE PODESTAT.
Ainsi, vous ne croyez pas que la mort de maître Bracchi puisse être attribuée à la cupidité de quelqu’un ?... Il s’agissait donc d’une vengeance ?
LUIGINA.
D’une... vengeance...
LE PODESTAT.
D’une haine longtemps contenue, peut-être...
LUIGINA.
Je... l’ignore... Je ne saurais vous dire...
LE PODESTAT.
Mais, parmi vos ouvriers, quelqu’un sans doute pourra répondre à cette question ?
Mouvement parmi les bûcherons.
Quel est celui d’entre vous qui se nomme Marini ?
MARINI, approchant.
Me voilà, monsieur le podestat.
LE PODESTAT.
Vous êtes un de ceux que Bracchi a employés depuis longtemps ; lui connaissiez-vous quelque ennemi ?
MARINI.
Aucun... Tant que l’ouvrage allait bien, il nous traitait en camarades ; quand ça mal été, il nous grondait ; il était même un peu brutal ; mais, la main tournée, il n’y paraissait plus.
JACOPO.
Ah ! ça, c’est vrai.
LE PODESTAT.
Silence ! on vous interrogera à votre tour... Ainsi, votre conviction est que Bracchi n’avait pas d’ennemis ?
MARINI.
Je le croyais... Mais il fallait bien qu’il en eût, puisqu’on l’a tué.
Il retourne à sa place, et Jacopo s’avance.
LE PODESTAT.
Quel est celui qui parlait tout à l’heure ?
JACOPO.
C’est moi...
LE PODESTAT.
Et avez-vous été témoin que maître Bracchi ait eu quelques querelles, chez lui ou ailleurs... avec quelqu’un de ses ouvriers, par exemple ?
JACOPO.
Avec ses ouvriers, jamais !... Est-ce que les ouvriers tuent ceux qui les font vivre ?... Allons donc... L’ouvrier peut s’emporter ; il peut se quereller, se battre... mais il n’assassine pas !...
LE PODESTAT.
Ainsi, vous n’avez été témoin d’aucune querelle ?
JACOPO.
Jamais !... Car les querelles qu’on a avec femme, ou avec un enfant qui est presque le notre, ça ne compte pas.
LE PODESTAT.
Il y avait donc de la mésintelligence ici ?
JACOPO.
Oui...
LUIGINA.
Jacopo !...
JACOPO, se reprenant.
Non, non... C’est-à-dire on se querelle le matin et on se raccommode le soir... D’ailleurs, pour notre maîtresse Luigina, c’est ben connu, c’est la patience et la résignation même.
LE PODESTAT.
Mais son fils Gennaro était-il moins patient et moins résigné que sa mère ?
JACOPO.
Oh ! dame !... quand on est homme... quand on est jeune, le sang vous bout plus facilement dans les veines... et puis, maître Bracchi n’était que le beau-père de Gennaro.
LUIGINA, interrompant vivement.
Malheureux !...
LE PODESTAT, se retournant avec la même vivacité vers Luigina.
Luigina, il y a quelqu’un qui devrait être ici, et que nous ne voyons pas ?
LUIGINA, cherchant à se contraindre.
Quelqu’un ?
LE PODESTAT.
Votre fils... La nuit est bien avancée, et cette absence est au moins étrange dans les circonstances actuelles.
LUIGINA.
Mais mon fils s’absente souvent ainsi... Il est à la chasse sur le lac... il ne peut rien savoir ; on ne peut donc rien augurer de cette absence...
LE PODESTAT.
Peut-être... car la rumeur publique assure que ce matin même Gennaro s’est emporté contre son père, et l’a menacé de mort.
LUIGINA.
Oui ; mais la rumeur publique vous a-t-elle dit son désespoir ! Vous a-t-elle dit quel a été son repentir ? et combien de larmes il a versées ? Presque tous ceux qui sont ici ont été témoins de cette scène... Qu’ils parlent !... Le plus coupable... oh ! que Dieu me pardonne de le dire !... le plus coupable n’était pas Gennaro...
LE PODESTAT.
La justice doit interroger jusqu’aux moindres indices !... et voyez, la nuit s’écoule, et Gennaro ne rentre pas...
LUIGINA.
Qu’osez-vous soupçonner ? mon Dieu !
LE PODESTAT.
Rien que l’absence de votre fils ne justifie.
LUIGINA.
Mais il viendra... il se justifiera !
MARINI, regardant par la croisée.
Monsieur le podestat, Gennaro vient de descendre de sa barque ; il se dirige de ce côté...
LUIGINA.
Il vient... Ah ! je vous le disais bien, qu’il n’était pas coupable.
LE PODESTAT.
Silence !... Que tout le monde se retire... Il faut que Gennaro rentre, et qu’il se croie seul.
LUIGINA.
Est-ce donc un piège que vous lui tendez ?...
LE PODESTAT.
S’il est innocent, à quel piège votre fils pourrait-il se laisser prendre ; un magistrat ne cherche pas de coupable, il cherche la vérité !... Éloignez-vous tous...
LUIGINA, à part.
Mon Dieu ! mon Dieu ! pourvu que Flavio puisse le prévenir.
Sur un signe que fait le podestat, tout le monde se retire en marchant doucement. Luigina sort, en jetant un regard désolé sur la porte par où doit entrer son fils.
Scène IV
GENNARO, puis LES MÊMES
GENNARO entre mystérieusement, et prête un instant l’oreille.
Tout dort ici !... On s’est couché à l’heure ordinaire, sans doute ; il n’y aura pas d’inquiétude sur mon compte... Mais quel est ce papier que m’a jeté Fenella ?... L’obscurité de la nuit m’a empêché de le lire... Voyons ce qu’elle m’écrit...
LE PODESTAT, au fond.
Un papier...
GENNARO, lisant.
Que vois-je ?... Tout est découvert !... Déjà !... Oh ! puisse-t-elle ne pas être compromise !...
Lisant.
Il faut fuir... Elle veut que je parte !... que je parte sans elle !... que je l’abandonne au danger qui la menace ! Si je m’éloigne, Fenella, ce ne sera qu’avec toi...
Il remonte vers le fond.
LE PODESTAT, paraissant, suivi de tout le monde.
Arrêtez, Gennaro !...
LUIGINA, perçant la foule, et venant jusque auprès de Gennaro.
Mon fils !... mon fils !...
GENNARO, au comble de l’étonnement.
Qu’y a-t-il donc, ma mère ?...
LUIGINA.
Il y a qu’ils osent t’accuser !...
LE PODESTAT.
Taisez-vous, madame !... pour son salut, taisez-vous !... Gennaro, d’où venez-vous en ce moment ?...
GENNARO.
D’où... je viens ?... Mais pourquoi cette question ?... Que fait ici monsieur le podestat ?...
LE PODESTAT.
Ne m’interrogez pas, répondez... D’où venez-vous ?...
GENNARO.
Je ne puis le dire...
LUIGINA.
Mon fils...
LE PODESTAT.
Nous direz-vous du moins ce que vous faisiez, et ou vous étiez à l’heure de la prière ?...
GENNARO, à part.
Fenella disait vrai, tout est découvert !
Haut.
Je crois comprendre, monsieur, le motif de vos questions ; mais il n’est impossible d’y répondre.
LUIGINA.
Malheureux !... mais tu te perds !...
LE PODESTAT.
Vous avouez donc que vous êtes coupable ?...
GENNARO.
Puisque vous savez tout, et votre présence le dit assez... j’avoue, monsieur le podestat...
LUIGINA.
Arrête, Gennaro !... Mais sais-tu bien de quoi ils l’accusent ?... Sais-tu bien que c’est d’un meurtre...
GENNARO.
Un meurtre !...
LE PODESTAT.
Silence, Luigina...
LUIGINA.
Vous voulez qu’une mère se taise quand son enfant se perd et se livre en aveugle !... Oui, un meurtre, un assassinat a été commis...
GENNARO.
Mais sur qui donc ?...
LUIGINA.
Sur ton père... Tiens ! regarde...
GENNARO.
Mon père !...
LUIGINA, écartant ceux qui obstruent le passage, pousse la porte de droite, et attirant son fils.
Et ils disent que c’est toi qui l’as assassiné !...
GENNARO.
Horreur !... Moi !... moi l’assassin de mon père !...
Gennaro veut s’élancer sur le corps de Bracchi, mais des hommes armés, qui étaient autour de la civière, l’empêchent d’avancer en formant devant lui une file qui s’avance vers la porte que Luigina a ouverte, et occupe ainsi le fond de la scène.
LUIGINA.
Je le savais bien, qu’il n’était pas coupable !...
LE PODESTAT.
Vous obstinerez-vous encore à garder le silence ?... Nous direz-vous enfin d’où vous venez, et où vous étiez, il y a quelques heures ?...
GENNARO.
Je ne le dirai pas.
LUIGINA.
Oh ! justifie-toi, mon fils !... Tu sais à présent quelle horrible accusation pèse sur la tête ; tu comprends qu’il faut tout dire... d’où tu viens... et où tu étais à l’heure de la prière...
GENNARO.
Quand j’en devrais mourir, je me tairais, ma mère !...
À part.
Car je l’ai juré !
LE PODESTAT.
Prenez garde ! il y a plus que la mort ici... il y a sur vous le nom de parricide !
GENNARO.
Parricide !... Moi !... Devant Dieu, je suis innocent !
LE PODESTAT.
Nous direz-vous du moins, quel est ce papier, quelle est cette lettre que vous avez reçue !
GENNARO.
Un papier !... j’ignore... je ne sais ce que vous voulez dire.
LE PODESTAT.
Qu’on le fouille !
GENNARO.
Arrêtez !... épargnez-moi cette honte.
Remet tant la lettre, il dit à part.
Ah ! Fenella !... Fenella ! je garderai ton secret !
LE PODESTAT, lisant.
« Tout est découvert, Gennaro ; si l’on te soupçonne, si l’on apprend la vérité, tu es perdu... Il faut partir, il faut fuir au plus vite... »
LUIGINA.
Oh ! non, il n’y a pas cela... Ce n’est pas à toi qu’on a écrit une pareille lettre.
GENNARO.
Ma mère !... ma pauvre mère !... C’est à moi qu’elle a été écrite.
Au podestat.
Mais ce n’est pas de ce crime horrible qu’elle m’accuse, ce n’est pas du meurtre de mon père qu’il s’agit.
LE PODESTAT.
Dites nous donc, alors, de quelle autre faute vous parle ce billet... dites-nous qui vous l’a adressé.
GENNARO, à part.
Si je la nomme, Fenella est perdue... Pour quiconque m’aura sauvé, c’est la mort.
LUIGINA.
Mais parle donc !
GENNARO.
Impossible.
LUIGINA.
Toujours ! toujours cette réponse qui le perd.
LE PODESTAT.
Qu’on s’empare de lui.
FLAVIO, entrant.
Arrêtez ! Gennaro est innocent !
TOUS.
Que dit-il ?
FLAVIO.
Il est innocent !... Je vous le disais bien, Luigina... Et quel que soit le coupable, il sera découvert.
LUIGINA.
Mais, parlez, parlez, alors !
FLAVIO.
J’ai voulu voir le lieu du crime ! Cette place où avait succombé ton père, j’ai voulu rechercher quelque indice, et pour que l’on crût à mes paroles, je me suis fait accompagner de trois hommes du village...
GENNARO.
Et tu as découvert ?...
FLAVIO.
Une preuve irrécusable !... l’arme qui a servi à commettre le meurtre !
LUIGINA.
Grand Dieu !...
GENNARO.
Oh ! merci, merci, frère !...
FLAVIO.
Cette arme qui porte encore la marque de la poudre, cette arme trouvée à quelques pas du lieu ou fut commis le crime...
Allant prendre un fusil des mains d’un paysan.
la voilà !...
LUIGINA.
Ah !... perdu... il est perdu !...
GENNARO.
Qu’ai-je vu... Cette carabine... dis-tu... était sur le lieu où fut commis le crime ?...
FLAVIO.
Oui...
LE PODESTAT.
La reconnaissez-vous ?...
LUIGINA.
Tais-toi ! Gennaro, tais-toi !...
GENNARO.
Je ne mentirai pas, ma mère : cette carabine est à moi...
FLAVIO.
Ah ! tais-toi !... Est-il possible !...
GENNARO.
Cette carabine est à moi...
TOUS.
Ah !
FLAVIO.
Mais je ne suis pas coupable...
LE PODESTAT.
Assez de preuves l’accusent ; les juges prononceront.
On s’avance pour lier les mains de Gennaro. Luigina pousse un cri.
FLAVIO.
Et c’est moi, malheureux, moi qui l’aurai perdu !... Mais, il y a là un horrible mystère !... Oui, quand toutes les preuves l’accableraient, je dirais encore : il est innocent... Voyez, monsieur le podestat, tous sont consternés comme moi... Voyez cette pauvre mère dont les mains pressent les vôtres, parce que la parole se brise sur ses lèvres, parce que ses forces sont insuffisantes pour tant de douleurs... Les mères comme celle-ci forment leurs fils dans la vertu, les mères comme celle-ci n’ont pas d’enfants assassins !...
LE PODESTAT.
S’il est innocent, il n’a rien à redouter de la justice... Qu’on exécute mes ordres.
FLAVIO, écartant les soldats.
Nous ne souffrirons pas...
TOUS.
Non !... non !...
GENNARO.
Pas de violence, Flavio... Monsieur le podestat, un mot, un seul mot à ma mère.
Le podestat paraît hésiter.
Si ce n’est pas pour moi, que ce soit pour elle.
Le podestat fait reculer jusqu’au fond tous les spectateurs de cette scène. Luigina et Gennaro se trouvent en quelque sorte seuls.
Je suis toujours digne de votre tendresse, ma mère. Vous ne voulez pas que votre fils meure, il ne mourra pas !... Tout s’éclaircira pour vous, comme pour les juges.
LUIGINA.
Serait-il vrai, Gennaro ?...
GENNARO.
C’est vrai ! Si je me suis tu devant eux, c’est que j’ai fait un serment ; mais devant vous le ciel me dégage... parler à sa mère, c’est parler à Dieu lui-même.
LUIGINA.
Oh ! sois béni, mon enfant, si ce que tu vas me dire leur prouve ton innocence.
GENNARO.
Je puis prouver que je n’étais pas sur le lieu du crime à l’instant où le crime s’est commis... Oui, ma mère, quand le coup de feu s’est entendu, nous étions deux dans ma barque ; c’était une femme... je ne sais pas son nom, mais son âme est noble, sa parole pleine d’autorité, elle viendra parler devant mes juges.
LUIGINA.
Mais quand ?... mais comment ?...
GENNARO.
Demain, à la fin du jour, elle se trouvera sur l’autre rive... Je devais y être, vous y serez pour moi... Un mouchoir agité sera le signal... Allez à elle ; dites-lui mon danger, dites-lui vos souffrances...
LUIGINA.
Et tu es sauvé ?... et tu m’es rendu ?... Elle viendra devant les juges ?... tu en es sûr ?...
GENNARO.
Elle viendra, ma mère !... Et maintenant que je vous laisse avec une douleur de moins, allez prier sur le corps de votre époux ; mes prières se joindront aux vôtres.
Se tournant vers le podestat.
Je suis prêt à vous suivre !... Adieu !...
Il embrasse sa mère.
Flavio, tu veilleras sur elle...
FLAVIO.
Comme sur ma mère...
ACTE IV
LA FALAISE DE SESSIA
Le théâtre est presque entièrement occupé par des rochers, taillés à pic du côté du lac. Sur le flanc de ces rochers, et s’élevant par une pente insensible, un étroit chemin paraît en suivre la ligne et tourner subitement d’un côté où l’on doit pressentir le lac. À la gauche, des massifs de haute futaie indiquant l’extrémité de la forêt ; plus loin un village, indiqué par les toits des maisons et par la pointe d’un clocher.
Scène première
TORRIANI, puis CAMPEGGI
Au lever du rideau, on entend des fanfares de cor dans un très grand éloignement. Torriani dort adossé contre un arbre. Peu à peu les fanfares se rapprochent et se répondent comme par écho.
TORRIANI, que la fanfare à réveillé en sursaut.
Maudit soit le sommeil !... je pouvais me laisser surprendre... Ce papier, ce précieux papier ! pendant que je dormais là, on aurait pu me l’enlever.
Il cherche sur lui et retrouve le testament du grand-duc.
Ah ! le voilà !... Voilà qui forcera les portes de votre palais, monseigneur ! Voilà qui me fera plus duc que vous-même !... Mais, si je vous le montrais, vous pourriez vous en emparer... l’anéantir... Il faut donc que vous ne le voyiez que lorsque nos conditions seront faites.
Il s’assied et se met à lire les papiers.
Regardons si tout y est bien...
CAMPEGGI, débouchant tout à coup par le petit chemin qui tourne sur le lac.
Allons ! il est décidé que je ne trouverai pas une issue pour m’échapper... Du côté du lac, pas un batelier... du côté de la forêt, des chasseurs... Il faut convenir que, pour un homme d’esprit, je me suis diablement laissé jouer... et par qui ?... par un enfant... C’est qu’à présent ma vie, mon honneur, tout est en danger ! Ma foi, courons au plus pressé... Sauve d’abord la vie, pauvre Campeggi !
TORRIANI, qui a écouté, s’approchant de lui.
Campeggi !...
CAMPEGGI.
Oh ! qui que vous soyez, monsieur, ne me perdez pas, ne me livrez pas !...
TORRIANI.
Ma foi, capitaine, j’aurais pu vous adresser la même prière...
CAMPEGGI.
Vous !... Mais je vous reconnais... l’homme qui a rapporté la bourse et le manteau du comte Torriani.
TORRIANI.
Mieux que cela... et puisque vous êtes proscrit, je puis, sans danger, me nommer... Je suis Torriani lui-même...
CAMPEGGI.
Vous !... Alors vous m’avez habillement glissé entre les doigts.
TORRIANI.
Allons au fait. Que vous est-il arrivé ?...
CAMPEGGI.
Hélas !... comme la vôtre, ma vie est en danger.
TORRIANI.
Vivat !
CAMPEGGI, fâché.
Hein ?
TORRIANI, vivement.
Ne faites pas attention ; deux mots seulement : quel est votre crime ?
CAMPEGGI.
La duchesse douairière m’avait été mystérieusement confiée sous le nom de comtesse d’Amalfi...
Poussant un soupir.
On m’a tendu un piège, je l’ai laissé s’échapper : c’est la seconde mission que je remplis comme ça...
TORRIANI.
Vivat, vous dis-je ! demain, je serai premier ministre... voulez-vous être le troisième de l’État ?
CAMPEGGI.
Moi ? mais je vous ferai observer que ma tête ne tient pas mieux sur mes épaules que la vôtre.
TORRIANI.
Ah ! c’est que vous ne savez pas tout ce qu’on peut faire de solide avec deux têtes qui ont l’air de pas tenir ; quand elles sont compromises à ce point, on ne redoute plus de les voir tomber. L’audace la plus grande, le courage le plus sublime, sont quelquefois enfants du désespoir.
CAMPEGGI.
Parfaitement parlé !... Mais, pour le moment, à quoi peut vous servir mon désespoir, et qu’ai-je à espérer du vôtre ?...
TORRIANI.
Tout !... La situation dans laquelle je me trouve vous donne à moi, comme celle où vous me trouvez me donne à vous... Nous nous tenons par un danger commun ; nous nous serons fidèles par le besoin de nous en tirer.
CAMPEGGI.
C’est-à-dire ?...
TORRIANI.
C’est-à-dire qu’en d’autres circonstances, je n’aurais peut-être pas à me fier à votre adresse, et qu’aujourd’hui je compte beaucoup sur votre peur.
CAMPEGGI.
S’il ne vous faut que cela pour vous donner confiance, je suis votre homme... que puis-je faire ?
TORRIANI.
Prendre ces papiers, et les garder précieusement pendant que j’irai me présenter au duc.
CAMPEGGI.
Vous n’aurez pas loin à aller pour cela, car ce bruit de chasse que vous venez d’entendre...
TORRIANI.
Eh bien ?
CAMPEGGI.
C’est le grand-duc qui courre le cerf ; j’ai reconnu les piqueurs et la livrée, et j’ai fait plus de circuits que le cerf pour arriver jusqu’ici.
TORRIANI.
Je ne l’éviterai pas, moi, car je vais droit à lui.
CAMPEGGI.
Et si vous réussissez !
TORRIANI.
Si je réussis, vous avez ma promesse que vous serez le premier après moi ; mais s’il m’arrivait malheur, si, au lieu de m’écouter, vous appreniez que le duc m’a fait arrêter, prenez ces papiers que je vous confie, et portez-les au sénat, sans hésitation et sans crainte.
CAMPEGGI.
Sans hésitation... je ne promets que ça.
TORRIANI.
À présent, tout est bien convenu... quillons nous... Adieu.
Campeggi va pour s’en aller, puis il revient sur ses pas.
CAMPEGGI.
Entendons-nous bien, car je tiens à ne pas faire une troisième sottise... Il est convenu que, si vous me faites appeler, j’apporte ces papiers : si l’on vous arrête, je les livre au sénat.
TORRIANI.
C’est bien cela. Souvenez-vous !
CAMPEGGI.
Soyez tranquille, j’ai bien mal rempli mes deux premières missions ; mais je réponds de la troisième.
Torriani désigne à Campeggi l’étroit vallon qui est entre la forêt et le lac.
Scène II
TORRIANI, puis LE DUC et LES SEIGNEURS
TORRIANI.
Ils viennent... partez vite !... Maintenant, oublions le passé, soyons tout à l’avenir !...
Il écoute une charge de cor, cette fois plus rapprochée, qui annonce que le cerf est aux abois.
Oui, monseigneur, faites sonner vos royales fanfares ! annoncez vos batailles d’enfants à vos flatteurs... je vais vous en livrer une à laquelle Votre Altesse ne s’attendait pas.
En ce moment, le halali sonne. On voit apparaître des piqueurs qui portent la livrée du duc. Un grand tumulte annonce que lui-même arrive. Torriani va se placer derrière l’angle du rocher qui peut empêcher de l’apercevoir. Le duc et les seigneurs s’avancent.
PREMIER COURTISAN.
C’est un coup adroit, monseigneur !
DEUXIÈME COURTISAN.
Voilà une victoire qui est d’un favorable augure, quand nous nous disposons à la guerre contre les Génois.
PREMIER COURTISAN.
Tous les augures sont favorables à Votre Altesse, depuis qu’elle a chassé l’homme qui l’obsédait.
TORRIANI, à part.
Ah ! l’on s’occupe de moi.
LE DUC.
Vous me parlez de ce misérable Torriani... Dieu soit loué ! nous en sommes débarrassés. Je dois une récompense à ceux qui ont le plus aidé à me détromper... Messieurs, présenter au grand duc la tête du cerf abattu est un honneur... Voici mon couteau de chasse... Que celui qui a le plus haï Torriani vienne le prendre.
Tous les courtisans font un pas en avant. Torriani paraît.
TORRIANI.
À merveille... Voilà bien des ennemis contre un seul homme !...
Cri général d’étonnement.
Vous me faites plus d’honneur que je n’en mérite, messieurs !
LE DUC.
Torriani !... Quelle audace !
TORRIANI.
J’ai bien l’honneur de saluer Son Altesse !
LE DUC.
Qu’on se saisisse de lui !
TORRIANI, s’avançant.
Un instant, messieurs.
Il se rapproche du duc et lui dit à l’oreille, et accentuant ses paroles.
Si vous me faites arrêter maintenant, bientôt vous descendrez de votre trône ; si vous me faites tuer aujourd’hui, vous serez mort demain.
LE DUC.
Tu veux m’épouvanter...
TORRIANI.
Non !
LE DUC.
Alors, des preuves ?...
TORRIANI, bas.
Des preuves !... Voyons, tu me connais depuis vingt ans ; est-ce que je serais venu me livrer comme un enfant, si je n’en avais pas ?...
LE DUC, à part.
C’est vrai...
TORRIANI.
Si je n’en avais pas, est-ce que je ne me serais pas déjà vengé de vous, monseigneur, depuis le temps que je vous parle à la distance d’un poignard ?
Le duc réfléchit.
DEUXIÈME COURTISAN.
Qu’ordonne monseigneur ?
LE DUC, avec une émotion à peine contenue.
Qu’on s’éloigne... je vous ferai rappeler.
TORRIANI, avec une civilité ironique.
C’est moi qui aurai cet honneur.
Scène III
TORRIANI, LE DUC
LE DUC, avec une fermeté feinte.
Songez, monsieur, que je ne fais qu’ajourner ma justice... songez que je ne vous accorde que quelques instants...
TORRIANI.
C’est plus qu’il n’en faut, monseigneur ; car, tout à l’heure, vous allez rappeler vos courtisans et leur dire que vous me rendez toute votre faveur... Tout à l’heure, vous allez déclarer que je suis le soutien du trône et la vertu calomniée... et, pour toutes ces choses, je ne viens pas les mains vides, monseigneur.
LE DUC.
Et qu’apporte donc le comte de Torriani ?
TORRIANI.
Nous avons été trompés, monseigneur... le dernier enfant de votre frère n’est pas mort...
LE DUC.
C’est impossible !...
TORRIANI.
J’en ai les preuves !... Le duc a laissé un testament que le hasard et mon courage ont mis en ma puissance.
LE DUC.
Et ce testament... tu viens me le donner ?...
TORRIANI.
Non !... Je viens vous le vendre, monseigneur, et vous le vendre cher... car, pour le posséder, j’ai tué un homme.
LE DUC.
Et ce testament est entre les mains ?... Oh ! pour cet écrit, je te donnerai plus que tu n’as demandé, plus que tu n’as voulu... Voyons, voyons, donne !...
TORRIANI.
Pardon ; mais comme Votre Altesse ne m’a jamais épargné les vérités, elle me permettra aujourd’hui de lui en dire une... Monseigneur est sujet à manquer de mémoire pour les services passés ; j’ai voulu m’assurer le prix des services présents... Je suis maître du testament, mais je ne le porte pas sur moi.
LE DUC.
Qui me prouvera que ce n’est pas une ruse ?
TORRIANI.
Faites ouvrir le cercueil du royal enfant, et vous le trouverez vide !
LE DUC, s’écriant.
Vide !...
TORRIANI.
Vide, te dis-je, Morena ! tu as bien de la peine à comprendre... et près de ce cercueil une solennelle rencontre, depuis vingt ans préparée, doit avoir lieu, ce soir, à l’heure où sonnera l’Angelus... Écoute bien, car ce sont les termes mêmes du testament de ton frère : « Sur cette tombe se réuniront trois personnes : la première sera le sujet, fidèle dépositaire du testament ; la seconde sera la veuve, la douairière, qui viendra reconnaître et retrouver son enfant, et la troisième enfin sera ce fils lui-même, qui n’apprendra qu’alors sa naissance, ses titres et sa famille... » Eh bien ! croyez-vous encore que je vous ai menti, monseigneur ?
LE DUC.
Mais la duchesse au moins ne s’y rendra pas !... elle est prisonnière au pensionnat de Sainte-Rosalie.
TORRIANI.
Beatrix n’est plus en votre puissance... Beatrix s’est enfuie de sa prison.
LE DUC.
Se peut-il ?... Mais alors il faut agir promptement ?
TORRIANI.
Ceci me regarde !...
LE DUC.
Toi ?...
TORRIANI.
Sans doute ! en qualité de premier ministre !...
Appelant.
Messeigneurs !...
Les seigneurs rentrent.
LE DUC.
Plus de plaisirs, plus de chasse, que chacun écoute...
Montrant Torriani.
et exécute nos ordres !
TORRIANI, avec intention.
Nos ordres, messieurs !
LE DUC.
Vous, monsieur le comte, partez avec vos gens ; qu’à l’heure où va sonner l’Angélus la chapelle de Pallavicini soit mystérieusement entourée ; que toute femme qui s’y rencontrera nous soit amenée ; que tout homme soit tué sur place !
TORRIANI.
Monsieur le comte... sous peine de haute trahison, que tout ceci soit conduit avec prudence et mystère.
Le comte s’incline avec respect ; les seigneurs et les gens qu’ils commandent partent.
LE DUC.
Laissez-nous...
Tous sortent.
Scène IV
LE DUC, TORRIANI
LE DUC.
Que tout soit oublié entre nous, Torriani ; tu es désormais mon seul ami, mon confident uni que ; c’est entre nous un pacte qui ne doit finir qu’à la mort.
TORRIANI.
Monseigneur, c’est le troisième que nous faisons comme ça... jusqu’à la mort... Mais je m’arrangerai, cette fois, pour le faire durer le plus longtemps possible.
Scène V
TORRIANI, LE DUC, BEATRIX, puis FLAVIO
BEATRIX.
C’est bien ici l’endroit que m’a désigné Gennaro !
LE DUC.
Quelqu’un !...
BEATRIX, apercevant le duc et Torriani.
Grand Dieu ! le duc !...
Elle baisse son voile.
TORRIANI.
Une femme qui porte le costume des dames de Sainte-Rosalie...
LE DUC, allant à Beatrix, qui cherche à fuir.
Rassurez-vous, madame ; vous n’avez rien à craindre de nous, qui vous servirions, au besoin, de chevaliers.
TORRIANI.
Nous sommes prêts à vous protéger et à vous défendre... Un mot seulement.
En parlant, le duc et Torriani ont placé peu à peu la duchesse entre eux deux.
BEATRIX, à part.
Mon Dieu !
TORRIANI.
Votre costume nous désigne l’une des dames de Sainte-Rosalie... Venez-vous de cette de meure ?...
BEATRIX, presque bas.
Un pieux devoir m’en a éloignée depuis hier.
LE DUC.
Mais savez-vous, madame, qu’un grand scandale y a eu lieu hier soir ?
TORRIANI.
Savez-vous que, depuis hier soir, aucune femme n’avait le droit de s’en éloigner ?
LE DUC.
Aussi, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous prions de vouloir bien soulever le voile qui vous cache.
La duchesse s’éloigne en tremblant, Le duc, impatient, veut soulever le voile.
BEATRIX.
Je ne le puis.
LE DUC.
Cette voix... Serait-ce elle ?...
Avec force.
Je veux voir votre visage, madame ! moi, grand-duc, souverain du pays, devant qui doit tomber toute volonté, je vous ordonne de lever ce voile...
BEATRIX.
Jamais !...
LE DUC.
Eh bien ! arrachez-le-lui, comte Torriani !...
BEATRIX.
Au secours !... au secours !...
Torriani s’avance vers Beatrix. Tout à coup Flavio paraît, et s’élance entre le comte et la duchesse, de façon à ce que celle-ci se trouve placée sur le petit chemin qui borde le lac.
Scène VI
TORRIANI, LE DUC, BEATRIX, FLAVIO
FLAVIO, repoussant violemment Torriani.
Arrière, comte de Torriani !... Dieu soit loué, j’arrive à temps pour vous empêcher de joindre une lâcheté à tous vos anciens crimes !
LE DUC, à Flavio.
Savez-vous devant qui vous parlez ?...
FLAVIO.
Non, mais je sais dans quelle compagnie je vous trouve, et quelle action vous alliez commettre ; et, si vous ne valez pas moins que le comte, je suis certain que vous ne valez guère mieux.
BEATRIX, bas.
Oh ! prenez garde, prenez garde, monsieur !...
LE DUC, avec hauteur et colère.
Je vous ordonne de vous éloigner !...
FLAVIO, froidement.
Je vois, monseigneur, que vous avez l’habitude de commander... Mais regardez-moi en face, et vous verrez que je n’ai pas l’habitude d’obéir...
TORRIANI.
Finissons !
FLAVIO.
Soit... Mais je vous jure sur l’honneur que de vous deux un seul pourra voir le visage de cette noble dame... car, tandis qu’il s’approchera d’elle...
Tirant son épée.
moi, je tuerai l’autre !
LA DUCHESSE.
Grand Dieu !...
TORRIANI.
Insensé !...
FLAVIO.
Oh ! tenez... ne me poussez pas à bout ; vous ne savez pas quelle douleur je porte dans mon cœur... Tout parle en moi contre vous, comte de Torriani : un grand malheur est arrivé dans la maison où vous étiez hier ! et je ne sais quoi me dit que votre passage en a été cause.
TORRIANI.
Que dites-vous ?...
LE DUC.
Que signifie ?...
FLAVIO.
Je dis qu’il est des hommes réprouvés dont la présence est un malheur... Dans cette maison, où vous n’avez fait que mettre le pied, le père est mort assassiné !...
Torriani recule effrayé.
assassiné, vous dis-je ! et le fils a été accusé de la mort du père.
TORRIANI, hypocritement.
Est-il possible !...
LE DUC, bas, au comte.
Que dit-il ?... Serait-ce !...
TORRIANI, bas.
Silence, monseigneur !...
Haut.
Vous êtes prompt à tirer l’épée, jeune homme ; mais je me souviens qu’hier vous pouviez me livrer, et que vous ne l’avez pas fait... Nous n’appellerons donc pas, pour vous punir, les gardes qui sont ici près...
À part, au duc.
Éloignons-nous, monseigneur...
LE DUC.
Mais si cette femme est celle que nous soupçonnons...
TORRIANI, bas.
Qu’importe ?... N’avez-vous pas envoyé, pour l’attendre, à la chapelle des Pallavicini ?... Ici, vous ne prendrez qu’elle seule... là-bas... dans une heure, nous les aurons tous...
LE DUC, bas.
C’est vrai... Parlons...
Haut.
Remerciez le comte Torriani, monsieur ; sans lui, vous auriez payé cher votre insolente audace...
Ils sortent.
FLAVIO, les regardant sortir.
Allez, messeigneurs, je me soucie de votre pitié... autant que de vos menaces !...
Scène VII
LA DUCHESSE, FLAVIO
LA DUCHESSE.
Il faut que vous soyez un noble cœur, vous qui êtes ainsi venu à la défense d’une inconnue...
FLAVIO.
Je n’ai fait que mon devoir, madame...
LA DUCHESSE.
Merci de votre secours ; sans vous, j’étais perdue... Mais fuyez, car vous ne savez pas ce que peu vent ces deux hommes...
FLAVIO.
Je sais que, malgré leur tranquillité apparente, ils ont tremblé devant moi, et que je ne fuirai pas devant eux.
LA DUCHESSE.
Mais ils sont puissants... Croyez-moi, parlez, monsieur... parlez !... Et si un jour vous avez besoin de ma reconnaissance, regardez-moi bien... pour vous rappeler de qui vous devez la réclamer.
FLAVIO, contemplant la duchesse.
Oh ! je bénis le ciel qui m’a amené à votre secours, madame... C’est un noble visage que le vôtre. Ce seul regard qui vient de tomber sur moi est toute une récompense ; ce regard inspire le respect et le dévouement... Qu’exigez-vous de moi, madame ?... Car, maintenant que je vous ai vue, je sens là que je serais heureux de vous protéger... de vous défendre...
LA DUCHESSE.
Et moi, monsieur, il me semble que je me confierais à vous avec joie... Mais, en ce moment, je n’ai plus qu’à vous remercier de ce que vous avez fait... et à vous demander de me laisser seule.
FLAVIO.
Seule !...
LA DUCHESSE.
Je vous en prie... j’attends ici quelqu’un...
FLAVIO.
J’obéis, madame... Mais ne craignez rien du retour de ces deux hommes... De loin, je veillerai sur vous...
Il baise la main de la duchesse, et sort du côté par où sont partis le duc et Torriani.
Scène VIII
BEATRIX, puis LUIGINA
BEATRIX.
Oui, ce jeune homme m’a sauvé plus que la vie... car si le duc m’avait reconnue, j’étais de nouveau prisonnière, et, tout à l’heure, je ne me serais pas trouvée à ce rendez-vous d’où dépend mon bonheur et le bonheur de tout un peuple... Mais le temps se passe, et Gennaro ne revient pas !... Quelque obstacle l’aurait-il retenu ?... Ah ! je me souviens : le signal...
Beatrix monte sur la falaise ; elle agite son mouchoir.
Oui, là bas... une barque fait force de rames, quelqu’un répond à mon signal...
Elle descend de la falaise.
On arrive enfin !... Ciel !... une femme !...
Luigina est arrivée avec sa barque jusqu’au tournant de la falaise. Elle a jeté sur la corniche la chaine de fer dont le poids retient le batelet. Elle s’avance ensuite vers Beatrix.
LUIGINA, haletant.
C’est vous, madame, qui, du haut de la falaise, avez agité votre mouchoir vers le lac ?...
LA DUCHESSE, hésitant.
Moi... mais... non...
LUIGINA.
Oh !... c’est vous, madame !... vous, qui attendez ici un jeune homme...
LA DUCHESSE.
Comment... vous savez ?...
LUIGINA.
Je suis sa mère...
LA DUCHESSE.
Sa mère ?...
LUIGINA.
Oui, madame, je suis la mère de Gennaro, de celui qui vous a sauvée, et que vous ne refuserez pas de sauver à votre tour...
LA DUCHESSE.
Que puis-je faire pour lui ?... Parlez vite... je suis prête... Quel danger le menace ?...
LUIGINA.
Écoutez... Un meurtre a été commis hier ; hier on a assassiné mon mari et ils ont accusé Gennaro de ce crime.
BEATRIX.
Ô ciel !
LUIGINA.
Mais vous étiez avec lui au moment où mon mari tombait. Gennaro et vous-même avez entendu le coup d’arquebuse.
BEATRIX, se rappelant.
Attendez, je me souviens... Oui, nous étions sur le lac, et moi-même, effrayée de ce bruit, j’ai cru qu’on nous poursuivait.
LUIGINA.
C’est cela, c’est bien cela !... Vous vous souvenez ! Vous vous souvenez, madame, et ce que vous venez de dire, vous le répéterez devant les magistrats, n’est-ce pas ?
BEATRIX.
Oui, oui ; et je remercie le ciel qui me permet de m’acquitter envers mon sauveur.
LUIGINA.
Ah ! venez, venez vite, madame !
BEATRIX.
Arrêtez !... Pour ce moment, c’est impossible.
LUIGINA.
Impossible ?
BEATRIX.
Plus tard, je serai libre... mais...
LUIGINA.
Mais alors, madame, Gennaro sera mort !
BEATRIX.
Que dite-vous ?
LUIGINA.
Je dis qu’ils le jugent en ce moment, et qu’ils le tueront demain !
BEATRIX.
Grand Dieu !
LUIGINA.
Vous voyez bien que c’est à présent, que c’est tout de suite qu’il faut venir.
BEATRIX.
Mais moi, je ne puis aujourd’hui paraître devant aucun tribunal ; il faut que je me cache aux yeux des magistrats, aux yeux du grand-duc, aux yeux de tous, car il faut que je reste libre.
LUIGINA.
Oh ! vous ne refuserez pas de parler, vous ne condamnerez pas l’un et l’autre.
BEATRIX.
Mais pour sauver votre enfant, pauvre mère, il faut que je perde... Oh ! vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous me demandez là !
LUIGINA.
Ce que je vous demande ?... mais c’est un mot qui arrache un innocent à la mort... ce que je vous demande ? mais...
BEATRIX.
Écoutez, écoutez-moi, pauvre mère...vous aimez votre fils, n’est-ce pas ?
LUIGINA.
Si je l’aime ?...
BEATRIX.
Eh bien ! si quelqu’un venait vous dire maintenant... au moment où ce fils est en danger : Il faut vous séparer de lui, il faut renoncer à le sauver...
LUIGINA.
Y renoncer ?... je refuserais.
BEATRIX.
Mais si on ajoutait : Les soins, la tendresse, dévouement que tu donnes à ce fils compromettent la vie d’un autre.
LUIGINA.
D’un autre ?... eh ! que m’importe ?
BEATRIX.
Si on vous disait enfin : Il faut abandonner, il faut perdre ce fils bien-aimé pour le salut d’un autre.
LUIGINA, avec force.
Jamais ! jamais ! que Dieu sauve les autres, moi je veux sauver mon enfant !
BEATRIX.
Ah ! c’est vous qui avez prononcé... Eh bien ! sachez-le donc : pour que je sauve votre Gennaro, il faut que je compromette la vie de mon propre fils.
LUIGINA.
Vous ?...
BEATRIX.
Pour que je justifie votre fils, il faut que je perde le mien.
LUIGINA.
Mon Dieu !... mais vous ne pouvez pas refuser de dire la vérité, madame... le sang que vous lais seriez répandre, le ciel le ferait tomber sur votre propre fils.
BEATRIX.
Non. Dieu n’écoutera pas les veux injustes ; il voit mon cœur, qu’il me juge et qu’il vous vienne en aide... Mais, vous l’avez dit vous-même : que Dieu sauve les autres, moi, je veux sauver mon enfant !
Elle veut s’arracher des mains de Luigina.
LUIGINA.
Arrêtez !... arrêtez !... Je ne vous laisserai pas partir.
Scène XI
BEATRIX, LUIGINA, FLAVIO.
FLAVIO.
Qu’y a-t-il ?... que se passe-t-il donc ?...
LUIGINA.
Flavio !...
BEATRIX.
Ah ! venez à mon aide... Sauvez-moi de sa douleur, sauvez-moi de ses larmes !...
FLAVIO.
Vous, Luigina !...
LUIGINA.
Flavio, c’est elle qui peut me rendre mon Gennaro, et elle ne le veut pas... entends-tu ?
FLAVIO.
Eh, quoi ! vous, madame ?... Mais Gennaro est mon ami, mon frère... et quand je viens de vous défendre, vous le laisseriez mourir ?... Non, non, c’est impossible !
BEATRIX.
Mais si je parle pour arracher son enfant à la mort, mon fils à moi est perdu !
FLAVIO.
Votre fils !... mais sait-il bien ce qui se passe ?... Sait-il bien que, pour lui, une mère tue l’enfant d’une autre mère ?... Votre fils ! est-ce quelque ennemi qui le menace ?... Je lui offrirai mon bras et mon épée... si on veut le frapper, je me placerai entre l’arme et sa poitrine ; mais qu’il vienne, qu’il vous disc de parler ; qu’il vous dégage, en fin, car c’est vous dégager du crime, c’est vous dégager du remords... c’est vous dégager de l’infamie !
BEATRIX.
Ah ! ne m’accablez pas de ces terribles paroles !... Je voudrais le sauver, mais, en ce moment, je ne le puis, car il faut que je m’éloigne... il faut que je parle.
FLAVIO.
Vous ne partirez pas, madame !... Vous ne partirez pas !
BEATRIX.
Mais, il le faut, mon Dieu !... il le faut... Monsieur, au nom de ce que vous avez de plus cher, écoutez mes paroles... Le devoir le plus saint, le plus sacré m’appelle ailleurs...
FLAVIO.
Un devoir sacré me réclame aussi, et je reste pourtant. Je reste, car le premier de tous les devoirs est de sauver un innocent.
BEATRIX.
Mais le temps marche, l’heure approche...
LUIGINA, rappelant ses souvenirs, à part.
Que signifie ?...
FLAVIO.
Vous ne partirez pas, vous dis-je !...
On entend sonner l’Angélus. Tous les personnages s’arrêtent et écoutent. Solennel silence. Au sixième tintement, ils disent ensemble.
TOUS.
L’Angélus !
FLAVIO, se découvrant.
Ô mon père ! pardonne-moi de te désobéir !
LUIGINA, à part.
Et mon serment, mon Dieu !
BEATRIX.
Vous avez entendu !... c’est l’heure, monsieur, et l’on m’attend.
LUIGINA.
Vous ! madame...
FLAVIO.
C’est aussi le jour et l’heure ou je devais me rendre de l’autre côté du lac, dans une sainte chapelle et auprès d’une tombe. Je l’ai juré à mon père et je reste, madame.
LUIGINA et BEATRIX.
Que dit-il ?
BEATRIX, avec une émotion toujours croissante qui se communique à Flavio et à Luigina.
Et c’est aujourd’hui que vous devez aller sur cette tombe ?
FLAVIO.
C’est à présent, madame.
BEATRIX.
La chapelle de Pallavicini, n’est-ce pas ?
FLAVIO.
D’où le savez-vous ?
BEATRIX.
C’est aussi là que j’allais chercher mon fils, moi !
LUIGINA et FLAVIO.
Son fils ?
LUIGINA.
Mais... vous êtes donc ?...
BEATRIX.
La veuve d’Andreas !... la duchesse de Pallavicini.
FLAVIO et LUIGINA.
La duchesse !...
LUIGINA.
Eh bien ! vous, Flavio, ce n’est pas un vœu stérile que vous allez remplir, car à ce rendez vous, c’est une sainte relique, c’est un rosaire que vous allez porter.
FLAVIO.
C’est vrai.
BEATRIX.
Un rosaire d’argent, n’est-ce pas ?
FLAVIO.
Oui.
LUIGINA.
Et cette relique devait vous faire reconnaître de votre mère ?...
FLAVIO.
De ma mère ?...
BEATRIX.
Oui, oui, de ta mère, Flavio !
FLAVIO.
Mon Dieu !... que dites-vous ?... Cette émotion... ces larmes...
LUIGINA.
Mais embrasse-la donc, Flavio.
FLAVIO.
Ma mère !...
BEATRIX.
Mon fils !...
LUIGINA.
Ah ! mon Gennaro, ils te sauveront maintenant...
FLAVIO.
Vous !... vous ma mère... Mais pourquoi le mystère qui m’a environné ?
BEATRIX.
C’est qu’un danger pesait sur la vie, jusqu’au jour...
LUIGINA.
Jusqu’au jour où s’élèveraient devant vous les degrés du trône.
FLAVIO.
Le trône !... vous ne me trompez pas !... Ils ne me trompaient donc pas non plus ces nobles élans que je sentais là... il ne me trompait donc pas non plus cet amour de la justice, cet amour de la liberté, qui me faisaient battre le cœur !
BEATRIX.
Ah ! c’est le digne fils d’Andreas !
FLAVIO, à Luigina.
Je sécherai vos larmes, pauvre mère !... je sauverai Gennaro.
BEATRIX.
Tu comprends pourquoi j’étais forcée de me taire... mais maintenant que dois-je faire, mon fils ?
FLAVIO.
Ce qui est juste, ma mère, ce que j’exigeais, quand j’ignorais qu’il s’agissait de moi-même. Pour l’enfant royal, comme pour l’enfant du peuple, il n’y a qu’une balance et qu’un Dieu, et puisque je dois régner, je ne monterai pas sur le trône couvert du sang d’un innocent. Mon devoir est de vous crier plus haut encore... Justice, ma mère... justice ayant tout !
BEATRIX.
Oui, à présent que tu m’es rendu, que je puisse aire connaître tes droits au sénat et au peuple, que je puisse prouver la naissance, et Gennaro est sauvé.
LUIGINA.
Et vous réussirez, madame, car ces preuves qui vous manquent encore, ce testament royal, c’est moi qui devais le porter à la sainte chapelle.
FLAVIO.
Vous ! Luigina ?...
LUIGINA.
Et maintenant qu’avec mes espérances, mes forces me sont revenues, je cours vous les chercher.
FLAVIO.
Oui, parlez, Luigina !... et nous, ma mère, au palais du grand-duc.
BEATRIX, à Flavio.
Au palais !
ACTE V
Une grande salle du palais du duc, ouverte au fond, et donnant sur une galerie. À droite du public, l’entrée du tribunal, élevée de quelques degrés. À gauche, entrée des appartements du duc. Un guéridon.
Scène première
LE DUC, OFFICIERS, GARDES, puis TORRIANI
Au lever du rideau, des sentinelles sont posées aux portes. Des officiers se promènent dans la galerie. Le duc sort de ses appartements.
LE DUC, à un officier.
Mes ordres ont-ils été exécutés ?
L’OFFICIER.
Oui, monseigneur ; on a doublé la garde du palais.
LE DUC, s’adressant à un autre.
Le comte Torriani a-t-il paru ?
L’OFFICIER.
Pas encore, monseigneur.
LE DUC.
Dès qu’il viendra, qu’on m’avertisse à l’instant... entendez-vous, à l’instant !
L’officier sort.
Mes inquiétudes sont au comble... Cet homme qu’on a jugé... Ce peuple qui murmure... Si l’on était près de la vérité !... Et Torriani qui ne paraît pas !... Que se passe-t-il ?...
Il aperçoit Torriani dans la galerie ; il est amené par l’officier.
Eh bien ! que viens-tu m’apprendre ?... M’amène-t-on la duchesse ?... Son fils, qu’en a-t-on fait ?
TORRIANI.
Personne n’est venu au rendez-vous.
LE DUC.
Personne !
TORRIANI.
Personne, monseigneur. La chapelle a été entourée, nos soldats sont restés fidèles à leurs postes... Personne n’est venu.
LE DUC.
Nous avons été trahis !... Nous ne tenons pas tous les secrets de la douairière... et, si elle tient les nôtres, nous devons tout craindre d’elle et de cet enfant de mon frère.
TORRIANI.
Du calme, monseigneur, du calme ; qu’avons-nous, après tout, à redouter de cet aventurier, de cet imposteur, qui se pare d’un nom d’emprunt, d’un titre qu’il a volé ?
LE DUC.
Volé !
TORRIANI.
Mais, oui, volé. Car tout homme qui possède, doit prouver qu’il possède légitimement ; or, comment prouvera-t-il sa naissance, puisque ses titres sont entre mes mains ?
LE DUC.
Mais, es-tu bien certain de les posséder encore ?
TORRIANI.
Attendez...
À un officier.
Que dans un instant, Campeggi soit près de moi, allez !
L’officier sort.
Tout à l’heure, le testament sera en votre pouvoir.
UN OFFICIER, entrant.
Monseigneur, c’est une jeune fille du pensionnat de Sainte-Rosalie, que M. le comte Torriani avait donné ordre d’amener au palais.
LE DUC, à Torriani.
Celle qui a favorisé l’évasion de Beatrix ?
TORRIANI.
C’est elle, monseigneur... J’ai appris qu’elle aime Gennaro, et peut-être, pour le sauver, fera-t-elle connaître l’asile de la duchesse.
LE DUC.
Tu viendras m’en instruire.
Il rentre dans ses appartements.
TORRIANI, à l’officier.
Faites entrer cette jeune fille.
Il va s’asseoir à gauche, près du guéridon. L’officier conduit Fenella.
Scène II
TORRIANI, assis, FENELLA
FENELLA, à l’officier.
Me direz-vous, monsieur, devant qui vous me conduisez ?
TORRIANI.
Approchez, mademoiselle.
L’officier sort.
FENELLA.
Ah ! voilà donc enfin quelqu’un qui parle.
TORRIANI.
Préparez-vous me répondre, et songez à ne pas mentir.
FENELLA.
Soyez tranquille, monseigneur ; on m’a très mal élevée, et mentir est une des choses qu’on ne m’a pas apprises.
TORRIANI.
Vous êtes accusée d’une faute très grave. On assure que vous avez fait évader la grande-duchesse.
FENELLA.
La grande-duchesse !... Comment, monseigneur, c’était la grande-duchesse ?
TORRIANI, à part.
Elle ignorait !...
Haut.
Enfin, vous avez aidé à la fuite d’une prisonnière.
FENELLA.
Oui ; mais, puisque c’était la duchesse, je n’ai rien à me reprocher, car, personne, je pense, n’a le droit d’emprisonner Son Altesse.
TORRIANI.
Ne raillez pas, mademoiselle, et tremblez au contraire.
FENELLA.
Trembler ? impossible ! monsieur. Mon père était soldat, et trembler est encore une chose qu’il a oublié de m’apprendre.
TORRIANI.
Croyez-moi, ne vous obstinez pas à vous taire. Dites-nous dans quelle retraite s’est retirée la duchesse.
FENELLA.
On ne l’a donc pas arrêtée ?...
À part.
Gennaro a réussi.
Haut.
Je vous remercie, monsieur de ce que vous venez de me dire.
TORRIANI.
Moi !
FENELLA.
Seulement, je fais une réflexion.
TORRIANI.
Laquelle ?
FENELLA.
C’est que vous n’avez pas une grande habitude de questionner ; car c’est moi qu’on interroge, et c’est vous qui m’apprenez tout ce que j’ignore.
TORRIANI.
Cette obstination à vous taire pourra nuire à quelqu’un que vous auriez pu sauver peut-être.
FENELLA.
Quelqu’un que j’aurais pu sauver... Que voulez vous dire ?
TORRIANI, froidement.
Rien, rien... puisque le silence est un parti pris chez vous.
FENELLA, avec inquiétude.
Mais encore, monseigneur...
TORRIANI.
Oh ! il s’agit d’un jeune homme, du fils d’un simple forestier.
FENELLA.
Gennaro !
TORRIANI.
Vous savez son nom !... Eh bien, ce Gennaro, accusé d’un meurtre, condamné au dernier supplice...
FENELLA.
Lui ?... c’est impossible !... cela n’est pas... cela ne peut pas être.
TORRIANI.
Cela est. Ce jeune homme protestait de son innocence... Pressé de questions... emporté par le désir de vivre... il a dit qu’une femme pourrait le sauver. Or, je sais, moi, que cette femme est la duchesse...
Avec négligence.
Mais vous vous êtes sans doute engagée à ne pas dire où est Beatrix... Gennaro mourra.
FENELLA.
Oh ! non... c’est un rêve... Ah ! monseigneur, dites, dites que vous me trompez...
TORRIANI.
Vous ne raillez donc plus maintenant !...
Bruit extérieur.
Tenez, écoutez ces clameurs !... entendez ces cris du peuple...
Bruit du beffroi.
Écoutez ce glas funèbre !... ils vous parlent autrement que moi...
Avec force.
Où est la duchesse, Fenella ?...
FENELLA, à ses genoux.
Je ne le sais pas, monseigneur...
TORRIANI.
Eh bien donc ! que la destinée de Gennaro s’accomplisse...
Les cris entendus au dehors redoublent. La galerie est envahie par le peuple, qui entre en criant : Justice ! justice !
FENELLA.
Que signifie !... grand Dieu !...
Gennaro, entouré de soldats, descend du tribunal. Fenella s’élance vers lui.
Gennaro !...
GENNARO.
Fenella !...
FENELLA.
Toi !... c’est bien toi !... Mais ce qu’ils disent est donc vrai ?...
GENNARO.
Seigneur !... Vous avez donc voulu m’ôter tout courage ?...
FENELLA.
Gennaro... aide-moi à rassembler mes idées... à rappeler ma raison, car j’ai mal entendu, n’est ce pas ?... Cette horrible accusation ne pèse pas sur la tête !... Ta bouche reste muette... tes yeux se remplissent de larmes... tu pleures sans me répondre...
GENNARO.
Hélas ! Fenella... tout mon espoir et toute ma vie étaient entre les mains de cette noble dame, que tu m’avais dit de sauver...
FENELLA.
La duchesse !...
GENNARO.
Elle seule pouvait m’arracher à l’infamie... à la mort... Ma mère était allée l’implorer, et je n’ai revu ni elle, ni ma mère...
FENELLA.
Mais tu n’es pas coupable ?...
GENNARO.
Non. Mais je ne puis prouver mon innocence.
LE PEUPLE.
Le sénat !... le sénat !...
GENNARO.
C’est mon arrêt qu’ils apportent...
FENELLA.
Ton arrêt !...
GENNARO.
Du courage, Fenella...
Scène III
TORRIANI, FENELLA, MARCO, puis LE DUC, SEIGNEURS, GARDES, PEUPLE
MARCO, à un officier.
Avertissez Son Altesse le grand-duc !...
FENELLA.
Mon Dieu !... nous abandonnerez-vous...
Le duc, Torriani, et plusieurs seigneurs sortent des appartements.
L’OFFICIER, annonçant.
Le grand-duc...
MARCO.
Monseigneur, un crime a été commis, et les juges ont prononcé leur sentence ; mais, pour que l’acte soit exécuté, il faut qu’il soit signé de Votre Altesse...
LE DUC.
Eh quoi ! n’est-ce pas assez, messieurs, de la sanction du tribunal et de la vôtre ?...
TORRIANI, bas, au duc.
Signez, monseigneur, il le faut...
Il a pris la sentence des mains de Marco, et l’a placée sur le guéridon.
MARCO.
La loi exige encore celle du prince.
TORRIANI, déterminant le duc.
Allons ! c’est notre salut à tous deux...
Le duc signe.
LE PEUPLE.
Grâce !... grâce !...
GENNARO.
Tout est fini pour moi.
FENELLA, se jetant dans ses bras.
Gennaro !...
GENNARO.
Fenella ! souviens-toi que tu dois me survivre... me remplacer près de ma mère...
Sur un signe du duc, un officier jette un voile noir sur la tête de Gennaro. Bruit de beffroi. Les gardes font un mouvement pour s’emparer de lui. Alors la voix de Flavio se fait entendre. Il perce la foule, et entre vivement avec la duchesse. Il arrache violemment le voile.
Scène IV
LES MÊMES, FLAVIO, LA DUCHESSE
FLAVIO.
Arrêtez !... Loin de lui le voile des parricides !... arrêtez !...
LE PEUPLE.
Ah !...
LE DUC.
Que veut cet homme !... quel est-il ?...
FENELLA.
La duchesse !...
GENNARO.
Vous, madame !... Ah ! Dieu ne m’a donc pas abandonné !
FLAVIO.
Nous venons le sauver, Gennaro...
TOUS.
Le sauver !...
TORRIANI, bas, au duc.
Flavio !... et la duchesse l’accompagne... C’est lui... c’est son fils !...
LE DUC.
Lui !...
FLAVIO, au duc.
Monseigneur, vous me reconnaissez, n’est-ce pas ?... Oui, vous me reconnaissez, car vous avez déjà pâli devant moi, vous et votre digne ministre.
LE DUC.
Insolent !...
TORRIANI.
Gardes, approchez...
LA DUCHESSE.
Arrêtez !... Que nul ne porte la main sur lui, c’est le fils du duc Andreas, c’est mon enfant à moi...
TOUS.
Son fils !...
LE DUC.
Imposture !...
GENNARO.
Toi !... toi, Flavio ?...
FLAVIO.
Oui, moi, Gennaro !... moi, qui déclare devant tous que tu n’es pas le meurtrier de Bracchi, puisque, à l’heure ou se commettait ce crime, tu conduisais ma mère au rendez-vous où je devais l’attendre.
GENNARO, à Marco.
Vous l’entendez, monseigneur, je ne vous trompais pas... Voilà cette noble dame, dont j’invoquais le témoignage...
MARCO, à la duchesse.
Votre Altesse affirme-t-elle que les paroles de cet homme sont vraies ?...
LA DUCHESSE, avec force et solennité.
Sur mon salut et sur ma vie, je jure que tout ce que vous venez d’entendre est la vérité...
LE DUC, avec mépris.
La vérité !...
FLAVIO.
La vérité, monseigneur ; car elle n’a pas menti, peuple, cette noble veuve de votre duc Andreas ; ce qu’elle a dit est vrai, monseigneur, de même qu’il est vrai que vous avez tué mon père et volé sa couronne !...
TOUS.
Ah !...
LE DUC.
Misérable !... voilà donc les complots tramés contre moi... Un fils supposé... un imposteur qui vient prendre le nom du dernier enfant mort de mon frère.
FLAVIO.
Mort, dites-vous ?... Mais, cette nuit, vous avez fait ouvrir sa tombe, et vous savez bien qu’elle était vide...
TORRIANI.
Et quelles preuves avez-vous de votre naissance ?...
FLAVIO.
Des preuves !... vous en aurez bientôt...
LE DUC, bas.
Que dit-il ?... S’il était vrai...
TORRIANI, bas.
Non, c’est impossible !
LUIGINA, au dehors.
Mon fils !... Gennaro !... mon fils !...
GENNARO.
C’est la voix de ma mère !
LA DUCHESSE, à Luigina, qui paraît.
Luigina !... ah ! venez vite...
LUIGINA, se jetant dans les bras de Gennaro.
Vivant encore !
Scène V
LES MÊMES, LUIGINA
FLAVIO.
Ah ! parlez vite, Luigina, cette cassette, ces papiers ?...
LUIGINA.
Volés !... on me les a volés !...
TOUS.
Volés !
FLAVIO.
Mais le testament de mon père ?
LUIGINA.
On me l’a volé, vous dis-je !...
LA DUCHESSE.
Ah ! malheureuse !... malheureuse !...
TORRIANI.
Eh bien ! messeigneurs, comprenez-vous, maintenant, ce tissu d’impostures et de mensonges ?
LUIGINA.
Qui parle de mensonge ?... qui parle d’imposture ?... Ces preuves, ces titres sacrés... je les ai eus, entendez-vous ?... Je les avais cachés à l’endroit où l’on a tué Bracchi, et c’est pour les voler qu’on l’a assassine !...
GENNARO.
Que dites-vous, ma mère ?... Mais vous connaissez donc l’auteur de ce crime ?...
LUIGINA.
Je le connais, Gennaro, c’est Dieu lui-même qui me l’a dévoilé.
TORRIANI.
Que veut-elle dire ?...
FLAVIO.
Parlez... parlez !...
MARCO.
Oui, parlez, madame !...
LUIGINA.
Après être vainement allée interroger le lieu où j’avais caché la précieuse cassette, je suis revenue brisée et le cœur rempli de désespoir près du corps de mon mari. J’inondais son visage de mes larmes... On va tuer mon enfant ! m’écriais-je, entends-tu ? on va tuer mon enfant !... Mais demande donc au ciel d’avoir pitié de moi, pitié de l’innocent ; car ce n’est pas lui, n’est-ce pas ?... ce n’est pas lui qui t’a frappé là ?... et dans ma folie, mes regards ne pouvaient s’arracher de l’horrible plaie... Tout à coup, parmi ses vêtements, tout près de sa blessure, ma main touche un papier... un papier traversé par une balle et à demi brûlé...
Avec la plus grande force.
C’était la bourre dont s’était servi l’assassin.
TORRIANI, à part.
Grand Dieu !
GENNARO.
Et ce papier, ma mère ?...
LUIGINA, le présentant vivement à Marco.
Regardez-le, monseigneur, vous, le chef du sénat, vous, le grand-justicier... Lisez ces caractères et voyez cette signature, c’est une supplique adressée au grand-duc et signée comte Torriani.
TOUS.
Torriani !
TORRIANI.
Non, ce n’est pas vrai, c’est impossible...
MARCO, qui a lu.
Voyez, voyez vous-même !...
FLAVIO.
Tu es sauvé, Gennaro.
LUIGINA.
Oui ; mais on m’a volé ce testament, et je ne puis sauver votre fils, madame.
MARCO.
Qu’ordonne monseigneur le grand-duc ?
LE DUC.
Attendez...
TORRIANI, bas.
Qu’allez-vous faire ?
LE DUC, bas, à Torriani.
Flatter un instant leur justice pour assurer ma vengeance, te perdre aujourd’hui pour le sauver demain.
Haut.
Que l’on s’empare de cet imposteur.
Il désigne Flavio.
LE PEUPLE.
Ah !
LA DUCHESSE.
Grand Dieu !
FLAVIO.
Qui donc oserait porter la main sur le fils du duc Andreas ?...
LE PEUPLE.
Non ! non !
LE DUC.
Silence !
Murmures.
Silence, tous !...
Scène VI
LES MÊMES, CAMPEGGI, amené par l’officier
CAMPEGGI, au fond.
Ah ça ! pourquoi m’amène-t-on au milieu de tout ce monde ?
LE DUC.
Et, comme notre justice est égale pour chacun, arrêtez aussi le comte Torriani !
CAMPEGGI.
L’arrêter !... Ah ! je comprends.
Il descend en scène.
Monseigneur, à vous ces précieux papiers.
Il remet les papiers à Marco.
TORRIANI.
Campeggi !... que fais-tu malheureux ?...
CAMPEGGI.
J’exécute vos ordres... et j’espère que, cette fois, je n’ai pas mal réussi,
TORRIANI.
Perdus !... nous sommes perdus !...
LE DUC.
Comment ?...
MARCO, qui a examiné les papiers.
Qu’ai-je lu !... Ceci est le testament du feu duc... Vive le duc Andreas...
LE PEUPLE.
Vive le duc Andreas !...
LA DUCHESSE.
Peuple ! je vous le disais bien que c’était mon fils !...
GENNARO, à Fabio.
Monseigneur...
FLAVIO.
Non... ton ami, Gennaro !... Torriani, je vous ferai justice...
Au duc.
Monseigneur, je serai plus cruel envers vous...
Avec mépris.
Je vous fais grâce.
CAMPEGGI.
Vive le grand-duc !...
TOUS.
Vive le nouveau grand-duc !...