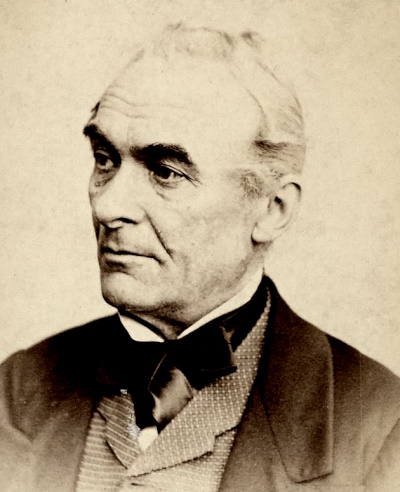L’Amour africain (Prosper MÉRIMÉE)
Comédie en un acte.
Éditée dans Le Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, 1830.
Personnages
HADGI NOUMAN
ZEÏN-BEN-HUMEÏDA
BABA-MUSTAFA
MOJANA
La scène est à Cordoue, sous le règne d’Abdérame.
Un kiosque dans les jardins de Hadgi Nouman.
HADGI NOUMAN.
Eh bien ! qu’est devenu Zeïn ?
BABA-MUSTAFA.
Omar, le garde du calife, vient à l’instant de m’en donner des nouvelles.
HADGI NOUMAN.
Parle.
BABA-MUSTAFA.
Il l’a vu hier au marché des esclaves. Ton ami a parlé à l’un des marchands ; puis, tout à coup, il s’est élancé sur son cheval, et est sorti au galop par la porte de Djemdjem.
HADGI NOUMAN.
Et ce marchand d’esclaves, quel est-il ?
BABA-MUSTAFA.
Seigneur, je crois que c’est le vieux Abou-Taher, celui qui t’a vendu hier la belle Mojana.
HADGI NOUMAN.
Tu lui as parlé ?
BABA-MUSTAFA.
Je n’ai pu le trouver ; il était chez le cadi.
HADGI NOUMAN.
D’où vient cette fuite soudaine ? Que peut-il être arrivé à Zeïn ?
BABA-MUSTAFA.
Comme il est sorti par la porte de Djemdjem, je crois qu’il est allé aux tentes de Semelalia, à l’armée du vizir.
HADGI NOUMAN.
Eh quoi ! aurait-il été combattre les infidèles sans avoir embrassé son ami ?
BABA-MUSTAFA.
Si tu le veux, je retournerai chez Abou-Taher.
HADGI NOUMAN.
Tout à l’heure. – Écoute. As-tu porté à Mojana les présents que j’ai achetés pour elle ?
BABA-MUSTAFA.
Oui, seigneur, et je l’ai revêtue moi-même de sa nouvelle parure. Allah ! qu’elle était belle ! Certes, j’ai vu dans ma vie beaucoup de belles femmes, mais jamais je n’ai trouvé l’égale de Mojana. Ah ! si tu voulais la revendre, bien qu’elle ait perdu hier cette qualité que vous estimez tant, tu en retirerais encore les dix mille dinars qu’elle t’a coûté.
HADGI NOUMAN.
Jamais je ne la vendrai, Mustafa ; et, si le calife mon seigneur me la faisait demander, je la lui refuserais, dussé-je fuir chez les Bédouins de Zeïn, et vivre en excommunié. – A-t-elle paru satisfaite de mes présents ?
BABA-MUSTAFA.
Elle a dit qu’elle se réjouissait de posséder tant de belles choses, si elle en paraissait plus aimable à tes yeux.
HADGI NOUMAN.
Charmante créature !
BABA-MUSTAFA.
Quelle différence entre nos femmes et celles des infidèles ! Quand j’étais prisonnier à Léon, j’ai vu leurs femmes et leurs mœurs. Chez nous, toutes sont soumises ; elles s’efforcent à l’envi de plaire à leur seigneur ; avec deux eunuques on gouverne vingt femmes... mais allez chez les Espagnols, une femme gouverne vingt hommes...
HADGI NOUMAN.
Apporte ici du sorbet et des fruits, je veux que Mojana vienne dans ce pavillon me tenir compagnie.
BABA-MUSTAFA.
Entendre, c’est obéir.
Il sort.
HADGI NOUMAN.
Zeïn, tu seras toujours un Bédouin. – Toujours occupé de l’idée du moment, il oublie ses amis et leurs invitations pour courir où son caprice l’appelle... Je pense que la fantaisie l’aura pris d’aller rompre une lance avec quelque chevalier nazaréen. Puisse Allah le protéger !
BABA-MUSTAFA, rentrant.
Seigneur, seigneur, ton ami Zeïn descend de cheval à ta porte... Par Allah ! je crains bien qu’il ne lui soit arrivé quelque malheur, car Abjer n’a plus sa belle selle brodée... peut-être...
Entre Zeïn habillé très simplement.
HADGI NOUMAN.
Zeïn-ben-Humeïda, que Dieu soit avec toi !
ZEÏN.
Hadgi Nouman, que Dieu soit avec toi ! As-tu cinq mille dinars à me donner ?
HADGI NOUMAN.
Oui. Te les faut-il tout de suite ?
ZEÏN.
Le plus vite possible.
HADGI NOUMAN, donnant une clef à Mustafa.
Mustafa !
BABA-MUSTAFA.
Dans l’instant.
Il sort.
HADGI NOUMAN.
Tu as vu les tentes du vizir ? Le Bédouin est déjà las de la vie de Cordoue ?...
ZEÏN.
Je suis retourné à l’armée pour affaires pressantes. J’ai trafiqué, Hadgi Nouman ; mais peut-être ai-je trafiqué en Bédouin.
HADGI NOUMAN.
Aurais-tu attaqué une caravane ?
ZEÏN.
Depuis que je sers Abdérame, j’ai oublié ces exploits du désert. Je suis allé vendre mes chevaux, mes bijoux, pour faire de l’argent.
HADGI NOUMAN.
Eh ! pourquoi ne pas t’adresser à moi ?
ZEÏN.
J’y ai bien pensé, mais trop tard.
HADGI NOUMAN.
Si je ne me trompe, tu as vendu jusqu’aux pierreries de ton khandjar ?
ZEÏN.
Oui, et tous mes chevaux, excepté Abjer, qui, tant que je vivrai, partagera jusqu’à mon dernier morceau de pain. – Mais dis-moi si l’on m’a trompé. Combien valait la monture de ce poignard que m’a donné notre glorieux calife ?
HADGI NOUMAN.
Neuf à dix mille dinars. Peut-être plus.
ZEÏN.
Dix mille coups de bâton à mon juif ! Puisse Nékir le couper de dix mille coups de faux ! Je fais vœu, par la sainte Caaba la prohibée, parles tombeaux des prophètes, de couper la tête à douze juifs dans la première ville espagnole où j’entrerai...
HADGI NOUMAN.
À cette colère, on voit que tu as fait un mauvais marché.
ZEÏN.
Il m’a donné quinze cents dinars.
HADGI NOUMAN.
Es-tu fou, Bédouin, de faire des affaires avec un juif ?
ZEÏN.
Il me fallait à toute force de l’argent. – En passant dans le Bézestein, j’ai vu ce vieux coquin d’Abou-Taher qui faisait crier des esclaves à vendre. Une d’entre elles m’a frappé, et il en voulait neuf mille dinars... Hadgi Nouman, jusqu’alors j’aurais appelé fou celui qui paie une femme plus qu’un cheval de bataille ; mais que la vue de cette femme m’a fait changer d’idée ! J’aurais presque troqué Abjer contre cette créature, cette houri échappée du paradis. Mais j’ai mieux aimé courir à Sémélalia ; j’ai vendu tout ce que je possédais, excepté mes armes et Abjer, et avec tout cela je n’ai pu faire que quatre mille dinars. Je compte sur toi pour le reste.
HADGI NOUMAN, riant.
Ah, ah, ah ! fils du désert, te voilà pris à ‘a fin. – Et que je reconnais bien là mon Bédouin, qui agit avant de penser ! Malheureux, tu vas acheter une esclave, et il ne te reste plus de quoi vivre ! Comment feras-tu pour l’entretenir, elle et Abjer ?
ZEÏN.
N’ai-je pas un ami ?
HADGI NOUMAN.
Oui, qui pensera pour toi. Il te faut dix mille dinars au lieu de cinq mille, tu vas les avoir.
ZEÏN.
Je te remercie, frère. Tu ne te lasseras jamais de me combler de biens ?
HADGI NOUMAN.
Ah ! Zeïn, je serai toujours en reste avec toi ! Te rappelles-tu comment nous fîmes connaissance ?
ZEÏN.
Il m’en souvient assez.
HADGI NOUMAN.
Je me trouvais assez embarrassé de poursuivre mon pèlerinage à La Mecque ; tu versas sur-moi ton outre tout entière, sans en garder une goutte pour toi. Combien tu as dû souffrir !
ZEÏN.
Nous autres Arabes, nous savons souffrir mieux que vous autres seigneurs des villes. Et puis tu étais étendu sur le sable, abandonné, noir comme un scorpion desséché... quel musulman n’aurait fait ce que je fis alors ?
BABA-MUSTAFA, rentrant.
Seigneur, les cinq mille dinars sont en sacs sous le vestibule. Si tu veux les compter...
ZEÏN.
Non, non. Prépare-moi un âne pour les porter, et aie soin d’en compter encore autant. Il y aura cent dinars pour toi.
Il sort.
HADGI NOUMAN.
Mustafa !
BABA-MUSTAFA.
Seigneur !
HADGI NOUMAN.
Un autre esclave fera ce que veut Zeïn. Toi, va me chercher Mojana.
Mustafa sort.
Le pauvre Zeïn ! son nouvel amour lui a fait perdre la tête. Il voulait troquer Abjer contre cette femme ! Il faut qu’elle ait fait une grande impression sur lui ! Malheur à qui enchérira sur l’esclave ! Zeïn a vendu les pierreries de son khandjar, mais il lui reste encore la lame.
Entre Mojana, conduite par Baba-Mustafa.
Approche, reine de beauté. Ôte ce voile trop épais. Il n’y a ici que ton seigneur pour contempler tes attraits.
MOJANA, après avoir ôté son voile.
Que veut mon lion ?
HADGI NOUMAN.
Viens, Mojana, assieds-toi à côté de moi sur ce sofa. – Esclave, apporte la collation. Eh bien ! Mojana, es-tu contente des parures que je t’ai envoyées ?
MOJANA.
Seigneur, tu as comblé de tes dons ton humble esclave, qui ne sait comment t’en témoigner sa reconnaissance.
HADGI NOUMAN.
Dans peu tu auras quelque chose de mieux que ces bagatelles.
MOJANA.
Ah ! Seigneur, tant que j’aurai ton amour, je me croirai assez heureuse.
HADGI NOUMAN.
Aimable enfant, je suis riche et puissant. Ma richesse et ma puissance t’appartiennent. Souhaite, et tes souhaits seront exaucés.
MOJANA.
Ah mon lion ! oserai-je te demander une grâce avant de l’avoir méritée ?
HADGI NOUMAN.
Demande, et tu auras. Ne me demande pas cependant le cheval Abjer de mon ami Zeïn.
MOJANA.
Seigneur, ton esclave est si heureuse avec son lion, qu’elle n’a plus qu’un seul souhait à former. Je suis née dans un pays que je crois fort éloigné d’ici, près d’une ville que l’on nomme Damas. Mon père était un marchand ; mais, parce qu’il avait manqué d’aller à La Mecque, ainsi qu’il en avait fait vœu, Allah lui a retiré sa faveur. En une année il perdit tout son bien. Mon frère fut tué par les Kurdes ; ma mère mourut de maladie. Mon père, pour vivre et faire vivre mes trois sœurs, fut obligé de me vendre. Ô mon seigneur ! permets que je leur envoie une petite partie des dons que tu m’as faits, que je partage avec eux le bonheur que tu me fais goûter auprès de toi.
HADGI NOUMAN.
Bon cœur ! n’est-ce que cela que tu demandes ? Ton père et tes sœurs viendront en cette ville, et je marierai richement tes sœurs, n’eussent-elles qu’une faible partie de ta beauté.
MOJANA.
Je me prosterne à tes pieds.
ZEÏN, derrière la scène.
Esclave, retire-toi, ou je te tue.
HADGI NOUMAN.
Qui ose pénétrer ici ? Mojana, mets ton voile.
Entre Zeïn le poignard à la main ; Mojana se cache derrière le sofa.
Est-ce Zeïn qui entre ainsi quand son ami est avec son esclave ?
ZEÏN.
Hadgi Nouman, quand je t’ai donné l’hospitalité dans ma tente de feutre, ai-je sauvé un crocodile qui devait un jour me mordre et rire de sa morsure ?
HADGI NOUMAN.
Que veux-tu dire, Zeïn ?
ZEÏN.
Qui t’a donné la hardiesse d’insulter Zeïn, le fils d’Amrou, le scheick des Humeïdas ?
HADGI NOUMAN.
Eh ! qui de nous deux est insulté ?
ZEÏN.
Maure rusé, pourquoi m’offrais-tu ton argent, quand tu m’avais enlevé celle que j’estimais plus que le trésor du calife ?
HADGI NOUMAN.
Moi !
ZEÏN.
N’as-tu pas acheté l’esclave d’Abou-Taher ?
HADGI NOUMAN.
Eh ! quels droits avais-tu sur elle ?
ZEÏN, levant son poignard.
Tu vas les voir.
MOJANA, se jetant entre eux deux ; son voile tombe.
Arrête, méchant ! tu me tueras avant lui.
HADGI NOUMAN.
Tu as donc perdu la raison, Zeïn ? toi lever le poignard sur Nouman ! Que t’ai-je fait ? N’avais-je pas les mêmes droits que toi sur cette esclave ? Ne l’ai-je pas achetée de mon argent ? Est-ce ma faute, si tu as été si lent à conclure ton marché ?
ZEÏN, regardant fixement Mojana, d’un air égaré.
Tu as raison.
HADGI NOUMAN.
Voilà donc tes folies. Et si cette femme ne se fût jetée entre nous deux, tu aurais tué ton frère !
ZEÏN.
Moi, je ne pourrais jamais te tuer ; Gabriel te couvre de son bouclier. Tu es son favori, et moi je suis voué à Éblis.
HADGI NOUMAN.
Je te pardonne, Zeïn, mais...
ZEÏN.
Imbécile, dis donc à cette femme de mettre son voile, ou je ne réponds pas de moi. Nouman, je te prie de me pardonner. Mais le Simoûn n’est pas plus brûlant et plus impétueux que l’amour d’un Arabe.
HADGI NOUMAN.
Tu es bien agité...
ZEÏN.
Écoute, quand je te sauvai la vie, tu me dis de te demander quelque chose... que tu me l’accorderais. T’ai-je demandé encore quelque chose ? dis.
HADGI NOUMAN.
Non.
ZEÏN.
Donne-moi cette femme.
HADGI NOUMAN.
Sais-tu combien je l’aime ?
ZEÏN.
L’aimes-tu comme moi ? Ferais-tu cela pour elle ?
Il se perce le bras de son poignard.
HADGI NOUMAN.
Tigre féroce, que feras-tu de cette timide gazelle ?
ZEÏN.
Allons !
HADGI NOUMAN.
Je ne puis !
ZEÏN.
Dans le désert on respecte ses serments.
HADGI NOUMAN.
Prends tous mes biens. Je te donne tout...
ZEÏN.
Plaisant échange !... c’est à Zeïn que tu le proposes, à Zeïn qui donna au vieux El-Faradje tout le butin de la tribu des Zinebis pour le seul cheval Abjer ! Eh bien ! moi, Zeïn, je t’offre Abjer et le khandjar d’Amrou, si tu veux me donner cette esclave.
HADGI NOUMAN, d’un ton suppliant.
Zeïn !
ZEÏN.
N’as-tu pas juré par la Caaba la prohibée, par les tombeaux des prophètes, par ton sabre, de m’accorder ma première demande ?
HADGI NOUMAN.
Que ferais-tu à ma place ?
ZEÏN, hésitant.
Ce que je ferais ?...
HADGI NOUMAN.
Oui, toi, Zeïn ?
ZEÏN.
Je... Je te tuerais ! tire ton khandjar !
HADGI NOUMAN.
Non, je ne puis me battre contre celui qui m’a sauvé la vie dans le désert. – Écoute, Bédouin. Il est un moyen de nous arranger. Que Mojana choisisse son maître. Si elle te préfère, elle est à toi.
ZEÏN.
Est-ce là remplir ta parole ?
HADGI NOUMAN.
Mojana, choisis.
MOJANA.
Hésiterai-je entre mon bien-aimé et ce sauvage farouche ! Ô mon seigneur ! ton esclave t’aimera toujours.
Elle se jette dans les bras de Hadgi Nouman.
HADGI NOUMAN.
Ô Mojana ! Zeïn, tu m’ôterais une esclave qui m’aime tant !
ZEÏN, accablé.
Vous êtes faits l’un pour l’autre... et moi, que je suis malheureux ! En naissant j’ai donné la mort à ma mère. À douze ans, j’ai crevé un œil à mon frère d’un coup de flèche... et voilà qu’aujourd’hui j’ai voulu tuer mon ami. Je lui ai reproché un bienfait... Oh ! cela est indigne d’un Arabe. – Adieu, Hadgi Nouman.
HADGI NOUMAN.
Zeïn, demande-moi quelque chose que je puisse te donner.
ZEÏN.
Je n’ai besoin de rien. Je retourne à mes tentes du désert.
HADGI NOUMAN.
Reste auprès de ton ami.
ZEÏN.
Je ne puis.
HADGI NOUMAN.
Pourquoi me fuis-tu ?
ZEÏN.
Un jour peut-être je te tuerais. Je me connais bien.
HADGI NOUMAN.
Tu as le droit de me tuer, je mérite toute ta colère...
ZEÏN.
Quoi ! c’est une femme qui l’a rendu parjure, qui m’a presque rendu assassin ! Mais, moi, pour posséder quelques chameaux, n’ai-je pas rendu plus d’une épouse veuve, et plus d’un enfant orphelin !
HADGI NOUMAN.
Reste avec moi, ou je te suivrai au désert.
ZEÏN.
Et cette esclave, y viendra-t-elle ?
HADGI NOUMAN.
J’ai une sœur qui est belle, Zeïn. Je te la donnerai...
ZEÏN.
Frère, dis à ton esclave d’ôter son voile, que la voie encore une fois avant de partir.
HADGI NOUMAN.
Mojana, fais ce qu’il souhaite. Jette un regard d’amour sur Zeïn, car il est mon ami...
ZEÏN.
Hadgi Nouman, qu’Allah !...
Avec fureur.
Tiens, battons-nous, et que le sabre en décide !
HADGI NOUMAN.
Voilà ta frénésie qui te reprend ! Mojana, retire-toi.
ZEÏN, se met devant la porte.
Non, arrête, Mojana.
À Hadgi Nouman.
Parjure ! lâche ! traître ! infâme parjure, tu ne m’échapperas pas !...
HADGI NOUMAN.
Malheureux Zeïn, que fais-tu ?
ZEÏN.
Cette femme est à moi. Que m’importe qu’elle m’aime ou me déteste ? N’ai-je pas dompté plus d’un étalon farouche ? je saurai bien réduire cette pouliche. Mojana, suis ton maître, ou je te coupe la tête.
MOJANA, se jetant dans les bras de Hadgi Nouman.
Seigneur, mon lion, défends-moi !
HADGI NOUMAN.
Arrête.
ZEÏN.
Tire ton sabre.
HADGI NOUMAN.
Tu ne peux te défendre... ta main tremble.
ZEÏN, le blessant.
Que dis-tu de ce coup-là ?
HADGI NOUMAN, le frappant.
Et toi de celui-ci...
ZEÏN, renversé.
Réjouis-toi, Cordouan, tu as renversé le héros de l’Yémen.
HADGI NOUMAN.
Malheureux ! j’ai tué celui qui m’a sauvé la vie !
ZEÏN.
Et moi, j’ai combattu contre mon hôte ! moi, scheick des Humeïdas les hospitaliers ! Allah ! Allah ! tu es juste !
HADGI NOUMAN.
Et moi, quels tourments ne mérité-je pas ! je me suis parjuré par la Caaba la prohibée, et j’ai tué mon ami.
MOJANA.
Seigneur !...
HADGI NOUMAN.
Misérable ! c’est toi qui l’as tué. Tu n’es pas une femme, tu es quelque Afrite... Éblis lui-même.
ZEÏN.
Éblis... il m’attend !... Adieu, frère... Abjer... ne l’oublie pas... Il y a une négresse de Dongola qui est grosse de moi...
Il meurt.
HADGI NOUMAN.
Mon frère ! Zeïn, Zeïn !
MOJANA.
Seigneur, permets à ton esclave...
HADGI NOUMAN, lui donnant un coup de poignard.
Tiens, malheureuse ! c’est le sang de Zeïn qui se mêle au tien... Allons, Zeïn, nous restons amis. Cette femme est morte... Zeïn ? Zeïn ?... Tu ne réponds pas, frère ?
BABA-MUSTAFA, entrant.
Seigneur, le souper est prêt et la pièce finie.
HADGI NOUMAN.
Ah ! cela est différent.
Tous se relèvent.
MOJANA.
Mesdames et messieurs,
C’est ainsi que finit l’AMOUR AFRICAIN, COMÉDIE, ou, si vous voulez, TRAGÉDIE, comme l’on dit maintenant. Vous allez vous écrier que voilà deux cavaliers bien peu galants. J’en conviens, et notre auteur a eu tort de ne pas donner à son Bédouin des sentiments plus espagnols. À cela, il ose répondre en prétendant que les Bédouins ne sont pas dans l’usage d’aller apprendre leur monde à Madrid, et que leur amour se ressent de la chaleur du Sahara. – Que pensez-vous de l’argument ? – Pensez-en ce que vous voudrez, mais excusez les fautes de l’auteur.