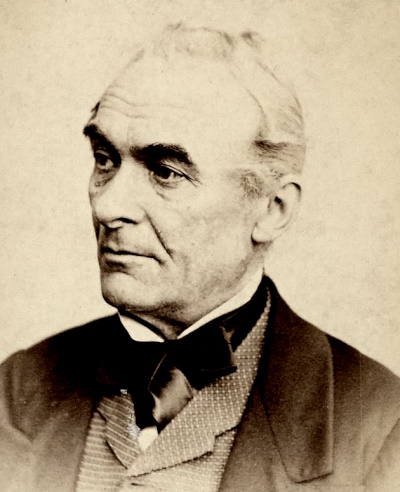La Jaquerie (Prosper MÉRIMÉE)
- PRÉFACE
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- Scène XI
- Scène XII
- Scène XIII
- Scène XIV
- Scène XV
- Scène XVI
- Scène XVII
- Scène XVIII
- Scène XIX
- Scène XX
- Scène XXI
- Scène XXII
- Scène XXIII
- Scène XXIV
- Scène XXV
- Scène XXVI
- Scène XXVII
- Scène XXVIII
- Scène XXIX
- Scène XXX
- Scène XXXI
- Scène XXXII
- Scène XXXIII
- Scène XXXIV
- Scène XXXV
- Scène XXXVI
Scènes féodales.
Éditées en 1828.
Personnages
GILBERT, BARON D’APREMONT, seigneur de Beauvoisis
LE BARON DE MONTREUIL, seigneur de Beauvoisis
LE SÉNÉCHAL DU VEXIN, seigneur de Beauvoisis
FLORIMONT DE COURSY, seigneur de Beauvoisis
ENGUERRAND DE BOUSSIES, seigneur de Beauvoisis
GAUTIER DE SAINTE-CROIX, seigneur de Beauvoisis
PERCEVAL DE LA LOGE, seigneur de Beauvoisis
LE SÉNÉCHAL du baron d’Apremont
LE SIRE DE BELLISLE, chevalier de l’hôtel du roi
SIWARD, capitaine d’aventuriers anglais
BROWN, capitaine d’archers anglais
PERDUCAS D’ACUÑA, chevalier navarrais, capitaine d’aventuriers
EUSTACHE DE LANCIGNAC, chevalier gascon, capitaine d’aventuriers
MAÎTRE YVAIN LANGOYRANT, docteur en droit
L’ABBÉ HONORÉ D’APREMONT,
FRÈRE JEAN, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis
FRÈRE IGNACE, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis
FRÈRE SULPICE, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis
FRÈRE GODERAN, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis
BOURRÉ, bourgeois de Beauvais
COUPELAUD, bourgeois de Beauvais
LAGUYART, bourgeois de Beauvais
MAILLY, bourgeois de Beauvais
PIERRE, homme d’armes du baron d’Apremont
LE LOUP-GAROU, chef de voleurs
RENAUD, paysan de Beauvoisis
SIMON, paysan de Beauvoisis
MANCEL, paysan de Beauvoisis
MORAND, paysan de Beauvoisis
BARTHÉLÉMY, paysan de Beauvoisis
THOMAS, paysan de Beauvoisis
GAILLON, paysan de Beauvoisis
CONRAD, âgé de dix ans, fils du baron d’Apremont
MAÎTRE BONNIN, son gouverneur
ISABELLE, fille du baron d’Apremont
MARION, sa sœur de lait
JEANNETTE, paysanne, sœur de Renaud
GENS de toute condition
La scène est principalement dans les environs de Beauvais.
PRÉFACE
Il n’existe presque aucun renseignement historique sur la Jaquerie. Dans Froissard, on ne trouve que peu de détails et beaucoup de partialité. – Une révolte de paysans semble inspirer un profond dégoût à cet historien, qui se complaît à célébrer les beaux coups de lance et les prouesses de nobles chevaliers.
Quant aux causes qui produisirent la Jaquerie, il n’est pas difficile de les deviner. Les excès de la féodalité durent amener d’autres excès. Il est à remarquer que, presque dans le même temps, de semblables insurrections éclatèrent en Flandre, en Angleterre et dans le nord de l’Allemagne.
En supposant qu’un moine fut le chef des révoltés, je ne crois pas avoir péché contre la vraisemblance historique. De fréquentes querelles divisaient alors le clergé et la noblesse. – L’insurrection d’Angleterre fut dirigée par un prêtre nommé John Ball. J’ai tâché de donner une idée des mœurs atroces du quatorzième siècle, et je crois avoir plutôt adouci que rembruni les couleurs de mon tableau.
Scène première
LE LOUP-GAROU, LE LIEUTENANT, LE RÉCIPIENDAIRE, BRIGANDS, etc.
Une ravine profonde dans une forêt. Le soleil couchant éclaire à peine la cime des arbres.
Des brigands, couverts de peaux d’animaux sauvages, paraissent de tous les côtés, descendent dans la ravine, et s’assolent en cercle.
Le Loup-Garou, une peau de loup sur les épaules et un arc à la main, reste debout au milieu d’eux.
LE LOUP-GAROU.
Les loups se sont-ils réunis ?
LE LIEUTENANT, se levant.
Tous, excepté Bordier qui fait sentinelle, et Wilfrid le roux qui est allé battre l’estrade.
LE LOUP-GAROU.
Loups, mes compagnons, Étienne Durer que voici
Un brigand se lève.
demande à devenir loup. Depuis six mois qu’il est avec nous, il s’est comporté bravement. Il a des griffes et des dents ; il est fidèle ; il lèche qui lui donne du pain, il mord qui lui jette des pierres. Voulez-vous de lui pour votre camarade ?
BRIGANDS.
Oui, qu’il soit loup comme nous !
LE LOUP-GAROU.
Préparez-vous donc à le recevoir. Faites le signe de la croix, et tirez vos coutelas. – Toi, Godefroid le louche, tu lui serviras de parrain. Avancez tous deux dans le cercle.
Au récipiendaire.
– Qui es-tu ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Je ne suis ni mouton ni loup, mais je voudrais devenir loup.
LE LOUP-GAROU.
Sais-tu les devoirs d’un loup ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Chasser aux moutons, mordre les chiens manger les bergers.
LE LOUP-GAROU.
Qui sont les moutons ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Les serfs qui travaillent pour leurs seigneurs.
LE LOUP-GAROU.
Et les chiens ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Les garde-chasses, les sénéchaux, les hommes d’armes, et les moines, excepté un seul.
LE LOUP-GAROU.
Nomme-le.
LE RÉCIPIENDAIRE.
Frère Jean de Saint-Leufroy. Il a guéri le Loup-Garou du mal Saint-Quenet[1], et le Loup-Garou a dit : « Jamais la flèche d’un loup ne percera son froc, jamais le couteau d’un loup ne fendra sa tonsure. »
LE LOUP-GAROU.
Qui sont les bergers ?
LE RECIPIENDAIRE.
Les seigneurs.
LE LOUP-GAROU.
De ces bergers quel est le pire ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Gilbert d’Apremont, trois fois maudit, qui se dit le maître de cette terre.
LE LOUP-GAROU.
Qui sont les loups ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
Les plus libres des habitants de la forêt, n’obéissant qu’au chef qu’ils se choisissent librement, ne travaillant que pour eux, vivant en bons frères ; aussi tout ce pays leur appartient.
LE LOUP-GAROU.
Qu’as-tu fait pour être loup ?
LE RÉCIPIENDAIRE.
J’ai pris aux bergers tout ce que j’ai pu, et j’ai tué un chien.
LE PARRAIN.
Oui, il a bravement décousu le vieux garde Mathieu, sur qui nous avions déjà fait la croix[2] pour la pendaison de Petit-Jean l’écorcheur.
LE LOUP-GAROU.
Puisqu’il en est ainsi, nous te recevons dans notre compagnie. Tu es loup, si tu jures d’observer nos lois. Jure de faire une guerre mortelle aux bergers, aux moutons, aux chiens, c’est-à-dire aux seigneurs, aux serfs, aux garde-chasses.
LE RÉCIPIENDAIRE.
Je le jure.
LE LOUP-GAROU.
Jure d’aider, de secourir les loups, c’est-à-dire les hommes libres de la forêt, de ton arc, de ton couteau, de ta main droite, de ton œil droit.
LE RÉCIPIENDAIRE.
Je le jure.
LE LOUP-GAROU.
Tu ne mangeras jamais de la chair de loup ni d’ours, car ils font comme toi la guerre aux bergers et aux moutons. De plus, tu jeûneras le samedi jusqu’à midi, car c’est un samedi que le premier loup a cherché la liberté dans les bois.
LE RÉCIPIENDAIRE.
Je jure d’observer ces commandements.
LE LOUP-GAROU.
Donc, de par saint Ferréol d’Abbeville, de par Golfarin, neveu de Mahom[3], saint Nicolas et sainte Marie la gente, je te fais loup, et je te donne ces bois avec cet arc et cette hache pour les défendre. Frappe un coup sur ce pieu, et dis : Ainsi saint Ferréol puisse-t-il faire à Gilbert d’Apremont !
LE RÉCIPIENDAIRE.
Ainsi saint Ferréol puisse-t-il faire à Gilbert d’Apremont !
LE LOUP-GAROU.
Godefroid le louche, quel nom portera-t-il parmi les loups ?
LE PARRAIN.
Étienne à la longue dent.
LE LOUP-GAROU.
Étienne à la longue dent, soit ! Godefroid, dis-lui tout bas la parole. – Mes frères, nous avons un frère de plus !
BRIGANDS.
Noël ! Noël[4] !
LE LOUP-GAROU.
Allons boire au nouveau frère. – Silence ! quelqu’un marche dans les feuilles sèches. Que personne ne bouge : mon chien remue la queue ; c’est un ami.
LE LIEUTENANT.
C’est Wilfrid qui revient.
LE LOUP-GAROU.
Quelles nouvelles de la plaine ?
WILFRID.
Ni bonnes ni mauvaises. Je viens de la Saullaie ; le capitaine Siward, le plus grand routier[5] du pays, s’y préparait à une expédition.
LE LOUP-GAROU.
As-tu vu quels hommes étaient avec lui ?
WILFRID.
Il a renforcé sa compagnie d’aventure. J’ai compté quarante armures de fer[6], et quatre-vingts archers. J’ai causé avec eux au cabaret, déguisé en tailleur de tourbe. Il y a parmi eux de grands coquins tout nouvellement arrivés d’Angleterre, ne sachant pas un mot de français, mais forts, bien bâtis, toujours altérés, désirant beaucoup s’enrichir en ce pays, comme ont fait avant eux leurs camarades.
LE LOUP-GAROU.
C’est sans doute Apremont qu’ils veulent courrir[7]. Qu’en penses-tu lieutenant ?
LE LIEUTENANT.
Je pense comme toi. C’est demain la Saint-Leufroy ; tous les serfs à cause de la fête se gorgeront de bière et de vin, et, quand ils en seront soûls. comme des cochons de glands, le capitaine Siward en aura bon marché.
WILFRID.
Cet Anglais en veut à Gilbert, et je sais que ses archers convoitent fort ses belles vaches.
LE LOUP-GAROU.
Par les cornes du diable ! ses vaches sont belles, et ce serait péché de les laisser prendre par ces voleurs anglais. Mettons-nous de la partie, ventre Saint-Quenet ! C’est en eau trouble qu’on attrape du poisson !
LE LIEUTENANT.
Parbleu ! le capitaine a raison. Pendant que les Anglais et les chiens d’Apremont joueront des couteaux, nous pourrons, nous, faire un bon coup.
WILFRID.
Ah ! si nous pouvions enlever quelque gros moine de l’abbaye de Saint-Leufroy, nous en tirerions une fameuse rançon, en envoyant aux autres seulement une oreille du prisonnier.
LE LOUP-GAROU.
Nous prendrons ce que saint Nicolas[8] nous enverra. Laisse-moi faire, tu verras si je m’y épargne. – Enfants, hier nous avons campé dans cette ravine, et vous savez nos usages. Nous coucherons cette nuit dans la grande caverne auprès du torrent. Là nous pourrons rire et boire à notre aise sans crainte d’être surpris par les gardes. Allons, partons ! En avant les éclaireurs ! emportez les chaudrons et le gibier ; vite, vite !
Tous les brigands se chargent de leurs différents ustensiles et se mettent en marchent. Restent le Loup-Garou, Wilfrid et le Lieutenant.
WILFRID.
Un mot, Loup-Garou.
LE LOUP-GAROU.
Que me veux-tu ?
WILFRID.
Je ne t’ai pas dit toutes les nouvelles que je sais. J’attendais qu’ils fussent partis.
LE LOUP-GAROU.
Parle.
LE LIEUTENANT.
Il est arrivé quelque malheur ?
WILFRID.
Girart le charron a été découvert. Les gendarmes d’Apremont sont à ses trousses.
LE LIEUTENANT.
Notre espion ? tant pis ! Où s’est-il réfugié ?
WILFRID.
À l’abbaye de Saint-Leufroy.
LE LOUP-GAROU.
L’imbécile ! au lieu de venir à la forêt.
LE LIEUTENANT.
Les moines le livreront, ou Gilbert ne respectera pas la franchise[9]. Girart est un homme mort. Il sera pendu. Qu’en dis-tu, Loup-Garou ?
LE LOUP-GAROU.
C’est une mort comme une autre.
LE LIEUTENANT.
Il faudra garder quelque chose sur la première prise que nous ferons, afin de faire dire une messe pour le repos de son âme.
LE LOUP-GAROU, après un moment de silence.
Je lui dirai une messe de sang, moi. Je serai le prêtre, et voici l’instrument avec lequel j’officierai.
Il montre sa masse d’armes.
Sus à la caverne ! J’ai le gosier aussi brûlant que l’était ma forge autrefois. Allons boire un coup.
Il sort en chantant.
WILFRID.
Mauvaise nouvelle, lieutenant.
LE LIEUTENANT.
Il ne faut pas s’attrister. Aujourd’hui l’un, demain l’autre. Allons souper.
Ils sortent.
Scène II
FRÈRE IGNACE, FRÈRE GODERAN, FRÈRE SULPICE
Une salle gothique dans l’abbaye de Saint-Leufroy ; elle est éclairée par un grand nombre de flambeaux, et magnifiquement décorée.
Chapitre de moines assemblés pour l’élection d’un abbé.
Sur le devant de la scène.
FRÈRE IGNACE, une lettre à la main.
Il s’explique clairement : « Choisissez pour abbé mon cousin, » nous dit-il. La lettre est pressante, elle est scellée de ses armes, et voici sa croix pour signature[10]. Que devons-nous faire ?
FRÈRE GODERAN.
Ce que fait le roseau quand le vent souffle ; nous sommes un faible roseau, et Gilbert d’Apremont est plus impétueux que l’aquilon.
FRÈRE IGNACE.
Oui, Goderan, vous n’êtes pas pour les partis extrêmes ; cependant, il doit vous en souvenir, nous avons juré à feu l’abbé Boniface, à son lit de mort, d’élire frère Jean, son protégé, et depuis n’avons-nous pas confirmé ce serment à frère Jean lui-même ?
FRÈRE SULPICE.
Voilà de beaux scrupules, ma foi ! Quant à moi, j’ai dit tout bas, en front[11], en parlant à feu l’abbé ; et puis, d’ailleurs, ce frère Jean n’est qu’un vilain, et ce n’est point un vilain qu’il nous faut pour abbé.
FRÈRE IGNACE.
Doucement ; il est fort utile à la communauté.
FRÈRE GODERAN.
Et Gilbert d’Apremont nous est encore plus utile. C’est notre chien de garde, notre homme d’armes. Croyez-moi, si nous sommes sages, nous nommerons pour abbé frère Honoré, son cousin, comme il le souhaite.
FRÈRE SULPICE.
Après tout, ne saurait-on se passer de frère Jean ? Est-il donc si utile à cette abbaye ?
FRÈRE IGNACE.
Sans doute ; sa science nous vaut de bons écus au soleil.
FRÈRE SULPICE.
À la bonne heure ; mais il veut tout gouverner, tout faire aller à sa tête. Il faisait faire tout ce qu’il voulait à feu l’abbé Boniface (Dieu veuille avoir son âme !). Il est temps que les autres aient leur tour. Enfin, je le répète, nous autres, il nous faudrait obéir à un homme de si bas lieu !
FRÈRE GODERAN.
Où est-il maintenant ?
FRÈRE SULPICE.
Dans son laboratoire, entouré de ses cornues.
Ironiquement.
Sa modestie l’empêche d’assister au chapitre où il croit qu’on va le nommer.
FRÈRE IGNACE.
Et frère Honoré ?
FRÈRE GODERAN.
Belle demande ! Il est dans sa cellule à prier. Il ne fait pas autre chose tant que le jour dure.
FRÈRE IGNACE.
Oui ; et j’ai peur, s’il devient jamais notre abbé, qu’il ne rende notre règle bien sévère. Frère Jean du moins nous laisserait du bon temps.
FRÈRE SULPICE.
Qui sait ? peut-être serait-il pire que l’autre.
FRÈRE GODERAN.
Voyez-vous, Ignace, nous avons une ressource avec frère Honoré. Il ne s’occupera que de son salut, et cependant vous, Sulpice et moi, nous le mènerons par le nez.
FRÈRE SULPICE.
Ce qui serait impossible avec frère Jean.
FRÈRE GODERAN.
Le voici. Je pensais bien qu’il s’impatiente. rait à nous attendre. FRÈRE JEAN, entrant.
Eh bien ! mes révérends pères, il ya bien longtemps que vous êtes ici. N’avez-vous encore rien décidé ?
FRÈRE IGNACE, à Frère Jean.
Voici une lettre de messire d’Apremont qui nous a arrêtés tout court.
Il lui donne la lettre.
FRÈRE JEAN, après avoir lu.
Quoi ! ne savez-vous que lui répondre ?
FRÈRE GODERAN.
Mais c’est là ce qui est difficile.
FRÈRE JEAN.
Comment ! difficile ? Qu’il se mêle de ses affaires, Sommes-nous donc ses vassaux pour lui obéir ? et qu’y a-t-il de commun entre l’illustre abbaye de Saint-Leufroy et un Gilbert d’Apremont ?
FRÈRE SULPICE.
Si nous nous faisons un ennemi de ce Gilbert d’Apremont, qui nous protégera contre les Anglais, les Navarrais[12], les Tard-Venus[13], et tous les malandrins[14] qui courent la campagne ?
FRÈRE GODERAN.
Sans parler du Loup-Garou notre voisin.
FRÈRE JEAN.
Et, de par saint Leufroy, quel besoin avons-nous de sa protection ? N’avons-nous pas de hautes murailles ? Ne sommes-nous pas ici quatre-vingts en état de faire le coup de flèche avec la plus rude compagnie franche[15] ?
FRÈRE SULPICE.
Vous dites cela, frère Jean, parce que vous avez été soldat ; mais nous autres, nous savons prier, et nous n’aimons pas à faire le coup de flèche. On peut être bon religieux et ne pas savoir faire le coup de flèche.
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! si vous craignez les flèches, vous avez Jacques Bonhomme[16] qui se battra pour vous : traitez bien vos serfs, et vous en ferez des soldats dévoués. Mais laissons cela. Je devine ce qui vous fait manquer à votre parole ; Honoré, que vous voulez élire à ma place, est fils d’un gentilhomme.
FRÈRE IGNACE.
En vérité, frère Jean, ce n’est pas là notre motif.
FRÈRE GODERAN.
Ne sommes-nous pas tous frères ici-bas, et surtout dans l’abbaye de Saint-Leufroy ?
FRÈRE JEAN.
Allez, quittez ces feintises avec moi, je vous connais trop bien. Vous, Goderan, vous êtes fils d’un hobereau de l’Artois, et vous, Ignace, et vous, Sulpice, vous êtes bâtards de quelque baron, comme vous osez vous en vanter. Vous ne voudriez pas obéir à un fils de vilain comme moi. Je suis fils de vilain, mais je puis parler de ma mère sans rougir.
Il se promène à grands pas, donnant des signes de colère.
FRÈRE GODERAN, bas à Ignace.
Voyez quel caractère violent ! Il en vient tout de suite aux injures.
À Sulpice.
Recueillez les votes, il faut en finir.
FRÈRE JEAN.
Honoré !... frère Honoré, abbé de Saint-Leufroy ! Et croyez-vous qu’il puisse seulement lire sa messe ?
FRÈRE IGNACE.
Ah ! si l’on choisissait un abbé pour la science, sans doute que l’on vous élirait. Frère Goderan. Mais il faut vivre en bonne intelligence avec ses voisins. La paix avant tout.
FRÈRE JEAN.
Honoré ! en vérité, cela me fait rire ! Dites-moi, de grâce, est-ce lui qui vous gagnera de l’argent en éblouissant nobles et vilains ? Franchement, qui de vous sait faire des miracles ? Quel autre que moi aurait pu faire la châsse de saint Leufroy qui sue tous les ans le jour de sa fête ? Et la couronne d’épines, qui sait la faire fleurir à Pâques ? Ne vous rapporte-t-elle pas cinq cents bons florins par an ? Seul j’ai le secret des miracles : sans miracles point de religion dans ce temps-ci, point d’offrandes au tronc de Saint-Leufroy. Tenez, les dames de Sainte-Radegonde, à dix lieues d’ici, ont une couronne d’épines. Eh bien ! comme elles ne savent pas l’alchimie, elle ne leur rapporte pas un sou.
FRÈRE IGNACE.
Nous espérons que vous voudrez bien nous continuer vos bons offices, dans l’intérêt de la religion et de la communauté.
FRÈRE JEAN.
Vous avez compté sans votre hôte ! Suis-je donc un serf pour travailler pour mes seigneurs ?
FRÈRE SULPICE, qui a recueilli les votes.
Toutes les voix sont pour le frère Honoré ; vos trois votes seuls manquent encore.
FRÈRE IGNACE, à Frère Jean.
Vous le voyez, je n’y puis rien. Je vote donc pour le frère Honoré.
FRÈRE GODERAN.
Et moi de même.
FRÈRE SULPICE.
Très révérends pères en Dieu, par l’inspiration du Saint-Esprit, nous avons nommé à l’unanimité frère Honoré d’Apremont abbé de cette abbaye. Que Notre-Dame et saint Leufroy le prennent en leur garde !
TOUS, excepté Frère Jean.
Amen !
FRÈRE JEAN, avec un sourire amer.
À l’unanimité ! je n’ai pas donné mon vote.
À Frère Sulpice.
Pourquoi ne me l’avez-vous pas demandé ?
FRÈRE SULPICE.
Ah ! pardon, c’est un oubli.
FRÈRE JEAN.
Je donne ma voix au révérend père Sulpice.
FRÈRE SULPICE.
Grand merci ! mais elle m’est inutile, et frère Honoré n’en est pas moins notre abbé. Allons lui porter les insignes en cérémonie. Mais le voici lui-même.
Entre Frère Honoré.
Très révérend père, le chapitre assemblé vous supplie humblement de vouloir bien être notre abbé, et d’accepter les insignes de cette illustre charge.
FRÈRE HONORÉ.
Votre choix aurait pu tomber sur un plus digne ; mais je m’efforcerai de mériter l’honneur que le chapitre veut bien me conférer.
FRÈRE JEAN, à Frère Ignace.
Voilà donc celui qui représentera l’ordre dans un concile[17] !
FRÈRE HONORÉ.
Avec l’aide du Saint-Esprit, les bègues deviennent éloquents.
FRÈRE JEAN, ironiquement.
Oui, nous verrons des miracles au prochain concile !
FRÈRE HONORÉ.
Suivez-moi à l’église, mes pères ; j’ai besoin d’élever au Seigneur une courte prière d’actions de grâces, et d’ailleurs nous devons nous préparer à la fête de demain.
FRÈRE IGNACE, à Frère Honoré.
Mais, sire abbé, il est temps de souper.
FRÈRE HONORÉ.
Mon père, il en sera toujours temps.
UN MOINE, entrant.
Ah ! mes pères, vit-on jamais rien de pareil ? Bien heureux l’abbé Boniface, qui est mort avant un tel sacrilège !
FRÈRE HONORÉ.
Qu’est-ce ? quel sacrilège ? C’est à moi qu’il faut porter plainte pour obtenir redressement : je suis l’abbé.
LE MOINE.
Hélas ! sire abbé, je suis encore tout tremblant ; les gendarmes du seigneur d’Apremont viennent d’enfoncer la porte de la chapelle, pour en arracher Girart le charron qui s’y était réfugié.
FRÈRE JEAN.
Violer notre franchise !
FRÈRE HONORÉ.
Que m’avez-vous dit ? votre voix est tellement tremblante, que je vous ai à peine entendu.
LE MOINE.
Les gendarmes du sire d’Apremont ont saisi Girart dans la franchise, aux pieds mêmes de la statue de monsieur saint Leufroy !
FRÈRE IGNACE.
Après avoir enfoncé la porte !
FRÈRE JEAN, aux moines.
Vous n’avez que ce que vous méritez. Vous avez recherché bassement la protection du sire d’Apremont ; voilà comment il vous l’accorde. Adieu les privilèges de notre abbaye ! ah, ah, ah !
Il sort en riant. Silence.
FRÈRE IGNACE, à Frère Honoré.
Mais, sire abbé, c’est un excès épouvantable et qui mériterait une excommunication ! Si les franchises de la chapelle ne sont pas respectées, tous les serfs poursuivis par leurs seigneurs iront se joindre au Loup-Garou.
FRÈRE GODERAN.
Et d’ailleurs, cela nous ferait perdre le revenu de la franchise, qui n’est pas à dédaigner.
FRÈRE HONORÉ, après avoir réfléchi.
J’en écrirai au sire d’Apremont.
LE MOINE.
Mais, sire abbé, il sera trop tard. Le coupe-tête était avec les gendarmes, et Girart est peut-être mort à l’heure qu’il est.
FRÈRE HONORÉ.
Alors nous dirons une messe pour le repos de son âme. Allons à l’église.
Il sort ; tous les moines le suivent ; Frère Ignace, Frère Sulpice, Frère Goderan restent les derniers.
FRÈRE IGNACE.
Voilà un mauvais commencement.
FRÈRE SULPICE.
Nous y mettrons bon ordre.
FRÈRE GODERAN.
Nous avons été un peu vite en besogne, Sulpice ; je commence à le craindre.
FRÈRE SULPICE.
Vous vous effrayez trop vite. Mais la cloche sonne : nous devrions déjà être au chœur.
FRÈRE GODERAN.
Pourvu que les actions de grâces ne durent pas trop longtemps ; car mon estomac m’avertit qu’il est déjà bien tard.
Ils sortent.
Scène III
CONRAD, MAÎTRE BONNIN, son précepteur
Une salle gothique du château d’Apremont.
CONRAD.
Conte-moi encore quelque belle histoire du temps des preux.
LE PRÉCEPTEUR.
Monseigneur, voulez-vous entendre l’histoire du grand chevalier Hector le Troyen ou du noble baron Themistoclès[18] ?
CONRAD.
Je sais tout cela. C’est celui-là qui s’empoisonna parce que le roi de Perse voulait qu’il se fit Turc.
LE PRÉCEPTEUR.
Précisément ; et voulez-vous que je vous entretienne du bon roi Lycurgue de Laconie ?
CONRAD.
Tu n’as jamais que la même chose à me conter. Je sais l’histoire du roi Lycurgue aussi bien que celle du roi Artus.
LE PRÉCEPTEUR.
Et vous souvient-il de la règle de l’ordre de chevalerie qu’il institua ?
CONRAD.
Sans doute ; l’ordre de Sainte-Sparte.
LE PRÉCEPTEUR.
Quelle mémoire pour un âge si tendre ! En vérité, monseigneur, vous en savez plus que moi, et bientôt je serai obligé de prendre vos leçons. Voudriez-vous être un chevalier de Sainte-Sparte ?
CONRAD.
Oui dà. Ce qui me plaît dans cet ordre-là, c’est que, si les damoisels dérobaient un pâté ou des confitures n’importe où, on ne leur disait rien, et c’était pour eux ; et puis, comme ils s’amusaient avec leurs serfs ! Comment les appelaient-ils déjà ?
LE PRÉCEPTEUR.
Des ilotes, monseigneur.
CONRAD.
Ah ! oui, des ilotes. Quand je serai grand, et que je serai page, j’irai, comme eux, à la chasse aux vilains.
LE PRÉCEPTEUR.
Quel prodige ! il n’oublie rien. Je voudrais bien que monseigneur le baron, qui se moque de l’instruction que je vous donne, fût ici présent pour vous entendre. Retenir jusqu’aux noms les plus barbares ! Ah ! monseigneur, quel chevalier vous ferez !
CONRAD.
C’est que je ne crains rien. Quand je joue à la bataille avec mes paysans, je ne crains pas cinq ou six petits vilains. À grands coups de bâton je les fais courir comme des lièvres.
LE PRÉCEPTEUR.
Écoutez-moi, monseigneur ; ne soyez pas téméraire. Monsieur le sénéchal a défendu à ces petits vauriens de vous rendre les coups que vous leur donnez ; cependant cette gent est si encline à mal faire, qu’ils pourraient bien un jour avoir l’audace de vous résister. Prenez y garde.
CONRAD.
Oh, ouiche ! Je ne craindrais pas dix mille vilains, moi. Je ne crains que les araignées et les grenouilles.
LE PRÉCEPTEUR.
Je ne demande à Dieu que de vivre assez longtemps pour pouvoir écrire les prouesses que vous ferez un jour. Vous ferez oublier les exploits d’Amadis de Gaule.
Entrent Isabelle et Marion.
CONRAD.
Ah ! voici ma sœur. Bonjour, sœur Isabeau ; donne-moi de ce que tu manges.
ISABELLE.
Je ne mange rien.
CONRAD.
Tiens, je croyais... Est-ce que tu n’as rien dans la boîte que mon ami Montreuil t’a donnée ?
ISABELLE.
Gourmand ! tu te fais mal à force de manger des friandises, et l’on m’a dit que tu dérobes tout ce que tu trouves chez nos pauvres vassaux.
CONRAD.
Est-ce que tout ce qu’ils ont ne nous appartient pas ?
ISABELLE.
Maître Bonnin, vous devriez bien lui donner d’autres leçons.
Entrent d’Apremont et son sénéchal.
D’APREMONT.
Qu’on le pende sur-le-champ ; qu’on le mette en quartiers, et qu’on l’attache à un arbre !
CONRAD.
Quoi donc, papa ?
D’APREMONT.
Ce coquin de Girart, qui avait cru se tirer d’affaire en se sauvant dans la chapelle de Saint-Leufroy.
CONRAD, au précepteur.
Vite, mène-moi le voir pendre.
ISABELLE.
Quelle horreur ! Mon père, défendez-lui d’y aller.
D’APREMONT.
Au contraire, ma fille, un gentilhomme doit de bonne heure s’accoutumer à voir la mort de près, afin qu’il ne soit plus étonné en voyant le sang couler dans un combat[19].
ISABELLE.
Mais voir périr un pauvre misérable désarmé cela ne peut inspirer que de la cruauté.
D’APREMONT.
Il ne faut pas qu’un homme soit élevé comme une femme.
CONRAD.
C’est cela : mêle-toi de ta quenouille.
LE SÉNÉCHAL.
Monseigneur, si nous attendions à demain pour le pendre ? L’exécution se ferait avec bien plus de pompe.
D’APREMONT.
Non ; c’est demain la Saint-Leufroy. Il y a trop de paysans oisifs rassemblés, Il faut ménager Jacques Bonhomme ; depuis quelque temps il gronde quand on le frappe.
LE SÉNÉCHAL.
Je vais faire pendre l’homme.
D’APREMONT.
Faites attacher les quartiers quelque part au loin ; que l’on n’en ait ni la vue ni l’odeur au château.
CONRAD.
Attendez-moi donc, monsieur le sénéchal.
Sortent Conrad, le précepteur et le sénéchal.
D’APREMONT, se frottant les mains.
Ils ont nommé notre cousin abbé. – J’ai fait une belle chasse aujourd’hui, et je souperai bien. – Et Montreuil, t’a-t-il bien parlé d’amour aujourd’hui ?
ISABELLE, souriant.
Hé !... pas plus qu’à son ordinaire.
D’APREMONT.
S’il ne sait pas dire des fadaises comme un troubadour, il sait ce que doit savoir un bon chevalier, et cela vaut mieux. Où est-il maintenant ?
ISABELLE.
Dans la salle basse. Tout à l’heure il s’escrimait avec Pierre, de l’épée à deux mains.
D’APREMONT.
Que te disais-je ? voilà un vrai gentilhomme ! toujours s’exerçant aux armes ! N’es-tu pas contente, Isabelle, de voir si galant et si rude champion celui qui doit être un jour ton mari !
ISABELLE.
Oui, mon père ; seulement je voudrais qu’il sût encore mieux tenir son épée. J’étais à les voir faire sortir du feu de leurs armes, quand Pierre, d’un revers, lui a fait sauter son épée de la main ; peu s’en est fallu qu’elle ne me tombât sur la tête. Je me suis sauvée bien vite, car à de tels jeux les spectateurs sont les plus exposés.
D’APREMONT.
Cela peut arriver au plus habile. Mais je n’aime pas à voir Montreuil s’escrimer toujours avec un simple vilain. N’ai-je donc pas dans mon château plus d’un gentilhomme qui sache faire des armes ? Un jour Pierre peut oublier dans la chaleur d’un assaut le respect qu’il doit à un chevalier.
ISABELLE.
Il est trop bien appris, je l’espère.
D’APREMONT.
Bien appris ! oui, le père Jean en a fait un clerc. Mais sa clergie[20] peut lui donner de l’insolence. C’est une sottise de donner à un vilain l’éducation d’un chancelier.
ISABELLE.
Oui, mais vous êtes bien plus coupable que le père Jean. C’est vous, mon père, qui lui avez appris à manier l’épée.
D’APREMONT, souriant.
Et il a profité de mes leçons. Dans le fait, c’est un bon soldat, et je lui ferai du bien. – Ah ! voici Montreuil.
Entre de Montreuil.
DE MONTREUIL.
C’est quelqu’un de la bande du Loup-Garou que l’on va pendre ?
D’APREMONT.
Presque ; c’est leur espion. Ah ! vertu Dieu ! dans ce temps-ci, il est bien difficile à un gentilhomme de vivre en paix dans son château.
ISABELLE.
Mon père, j’avais promis à une pauvre femme du village de vous prier...
D’APREMONT.
Allons ! encore quelque grâce à demander !
ISABELLE.
C’est qu’elle ne peut payer la taille. Sa vache a été prise par le Loup-Garou, et...
D’APREMONT.
Bah ! bah ! toutes disent la même chose. À les en croire, il faudrait leur donner de l’argent au lieu de leur en demander.
ISABELLE.
Mais l’année dernière a été malheureuse, vous le savez, mon père.
D’APREMONT.
Vraiment, Isabelle, c’est vous que je consulterai pour mes affaires ! Que diriez-vous de moi, si j’allais me mêler de vos tapisseries ? Eh ! n’ai-je pas eu mes malheurs aussi ? Par Saint-George ! il faut que je me dédommage de ce que j’ai perdu à Poitiers[21]. Nous y avons perdu un peu plus qu’à une mauvaise récolte. Qu’en dis-tu, Montreuil ?
DE MONTREUIL.
Ah ! mes huit mille florins de rançon, combien je vous regrette !
D’APREMONT, à de Montreuil.
Plût à Dieu que tu en eusses perdu huit mille autres, et moi dix fois autant, et que nous eussions gagné la bataille ! notre brave roi ne serait pas prisonnier à Londres au moment où nous parlons. – Allons, ne pensons plus à cela. Que l’on nous donne à laver, et allons souper.
Entre un écuyer.
L’ÉCUYER.
Monseigneur, un écuyer vient d’apporter cette lettre d’Arras.
D’APREMONT, regardant le cachet.
De gueule au lion rampant ? c’est de Boëmond de la Source.
ISABELLE.
Sans doute il vous remercie d’avoir payé sa rançon.
D’APREMONT.
Je pense qu’il a quelque chose de plus important à me demander. Lis-moi cette lettre, Isabelle ; je suis tout aussi ignorant que feu monsieur mon père qui n’a jamais su lire ses prières ; mais, par la sainte croix ! ce n’est point parmi nos jeunes chevaliers si savants que l’on trouverait son pareil.
ISABELLE, lisant.
« À haut et puissant seigneur, noble homme Gilbert, baron d’Apremont, Boëmond, seigneur de la Source, son serviteur et ami, salut. Au moment où j’avais perdu toute espérance de revoir jamais mon pays, j’ai appris avec autant de surprise que de reconnaissance... »
D’APREMONT.
De surprise ?
ISABELLE continuant.
« Que tu venais de payer ma rançon, et que j’étais libre d’aller me jeter à tes pieds pour... »
D’APREMONT.
Se jeter à mes pieds ! lis-tu ce qui est écrit ?
ISABELLE.
Oui, mon père... « Pour te remercier autant que je le puis... »
D’APREMONT.
Passe ces fades compliments et viens-en au fait. Des chevaliers devraient garder ces niaiseries pour les dames.
ISABELLE.
La lettre ne contient que des remercîments, des protestations d’amitié et de dévouement.
D’APREMONT, prenant la lettre.
Voilà du beau parchemin perdu. Et c’est là ce qu’on apprend avec les clercs ! Un chevalier s’étonne que son frère d’armes paye sa rançon, et il lui écrit une page pleine de traits noirs pour l’en remercier ! De mon temps un chevalier disait à son ami : « Je n’ai point d’argent, donne-moi ta bourse. » Cette franchise de nos pères valait mieux que notre politesse d’aujourd’hui.
ISABELLE.
Son intention était bonne. Boëmond vous est très attaché.
DE MONTREUIL.
Et la somme que vous avez déboursée pour lui méritait des remercîments.
D’APREMONT.
Il faut être incapable d’une action généreuse pour témoigner sa reconnaissance en termes si pompeux. Mais ainsi va le monde. Les vieilles coutumes se perdent, et avec elles aussi les vertus de nos ancêtres.
ISABELLE.
N’oublions pas l’ancienne coutume de souper. Je vois l’aiguière qui nous attend là-bas.
D’APREMONT.
Tu as raison, allons souper.
Ils sortent.
Scène IV
BROWN, RENAUD, MORAND, GAILLON
La place du village d’Apremont. Des tables sont dressées, et beaucoup de paysans sont assis à boire. Sur le devant, assis à la même table : Brown, Renaud, Morand et Gaillon. Brown est habillé comme un simple archer.
BROWN, frappant sur la table.
Du vin ! du vin ! Veut-on nous faire mourir de soif ? Je suis le roi de l’arc, et c’est moi qui paye.
GAILLON.
Foi d’honnête homme, sire archer, vous êtes un bon garçon pour un Anglais.
RENAUD.
C’est vrai, et je lui pardonne d’avoir gagné le prix.
BROWN, montrant son arc.
Voilà ce qui s’appelle un arc ! Six pieds de bois d’if sans nœuds, et droit comme une lance quand il est débandé. Tenez la corde de la main droite à la hauteur de l’œil, poussez l’arc de la main gauche jusqu’à trois pouces du fer, et vous lancerez une flèche dont on parlera[22].
MORAND.
Nous avons vu que vous avez l’œil et le bras bien exercés.
BROWN.
Parbleu ! je le crois. Savez-vous que tout le monde ne bande pas un arc anglais ? au lieu que de vos arcs le plus fort casserait sous une flèche anglaise.
RENAUD.
Autrefois il y avait ici quelqu’un dont l’arc vous aurait peut-être fait venir des ampoules aux mains.
BROWN.
Par le chef de saint George ! je serais bien aise de voir cette rareté.
RENAUD.
Cet arc n’est plus dans le pays, et, si l’archer qui savait le tendre s’y trouvait encore, vous n’auriez pas si aisément gagné la coupe et le baudrier[23]. – À votre santé, compère !
BROWN.
Et qu’est-il devenu cet archer-là ? Je ferais douze lieues à pied pour le voir.
RENAUD.
Il n’est peut-être pas loin de nous.
MORAND, se signant.
Dieu le sait !
BROWN.
Enfin où est-il, où peut-on le voir ?
RENAUD.
Le voir ? Ne le voit pas qui veut.
GAILLON.
Et qui ne veut pas le voir le voit. C’est là le pis.
MORAND.
Avez-vous entendu parler du Loup-Garou ?
BROWN.
Oui, un peu.
MORAND.
Eh bien ! tâchez de ne pas le rencontrer sur votre chemin.
BROWN.
Comment ! c’est ce chef de voleurs qui tire si bien de l’arc ?
GAILLON.
Voleur, ce ne serait rien, mais on vous dit qu’il est loup-garou.
BROWN.
J’irais voir le diable, si je savais qu’il tirât mieux que moi. Et n’a-t-il pas un autre nom, celui que vous appelez le Loup-Garou ?
MORAND.
Il se nommait Chrétien Franque quand il était encore de ce monde.
BROWN.
Il est donc mort ?
MORAND, se signant encore.
Non, mais il est devenu loup-garou.
BROWN.
Vous vous moquez de moi. Parlez donc plus clairement et n’ayez pas l’air si effrayé. Qu’est-ce qu’a fait cet homme pour que vous l’appeliez Loup-Garou ?
MORAND, bas.
Attendez que ce gendarme de monseigneur se soit éloigné. – Écoutez ; il y aura deux ans à la Saint-Nicolas que Franque, qui de son métier était maréchal ferrant, rentrant chez lui après avoir été donner une médecine au cheval de mon compère Henriot, ne trouva pas sa femme à la maison. Un voisin, il y en a toujours de ces âmes charitables, lui dit que monseigneur l’avait fait appeler au château, qu’elle lui avait plu ; et elle, la femme de Franque, ne valait pas mieux qu’une autre ; elle était bien aise qu’un seigneur la mît dans son lit. Franque ne dit rien. Finalement elle revint. Il était à sa forge, il la voit entrer : « Ah ! te voilà ? dit-il. – Oui, dit-elle. – Tiens, dit-il, » et d’un seul coup de son gros marteau il lui fit sauter la cervelle.
BROWN.
Oui, une masse est une bonne arme, après l’arc s’entend.
MORAND.
Oh ! il lui cassa la tête comme je casserais un œuf. Monseigneur le fit mettre au cachot ; il voulait le faire pendre, mais je ne sais si Franque s’est donné au diable, qui l’a emporté, ou bien s’il avait un sort pour les serrures dans sa poche...
RENAUD.
Moi, je crois que c’est son garçon qui lui a jeté par le soupirail une lime avec laquelle il a scié un barreau.
MORAND.
Tant y a qu’il s’est sauvé dans les bois. Là, ce vieux loup blanc, que le père de monseigneur n’a jamais pu tuer, un vieux loup qui a plus de... bah ! plus de deux cents ans ; tout le monde le connaît : ce vieux loup blanc l’a regardé avant que Franque ne l’aperçût[24], et il est devenu aussitôt loup-garou. Il est tout couvert de poils, il mord tout ce qui l’approche, et ceux qui n’en meurent pas deviennent loups-garous comme lui et font mille horreurs dans le pays.
GAILLON.
Il y a six mois qu’Étienne Durer l’a vu, et depuis ce temps il est devenu enragé.
RENAUD.
Je ne crois pas qu’il soit un véritable loup-garou, mais il est aussi dangereux. Il n’y a pas deux semaines que nous avons trouvé le vieux garde-chasse Mathieu tout déchiqueté par ces diables-là.
MORAND.
Le jour, ils ont encore la figure d’hommes ; mais la nuit, ils deviennent comme des loups et marchent à quatre pattes. Pas plus tard qu’hier au soir, je les ai entendus hurler.
BROWN.
Et vous croyez tous ces contes de vieilles ? Votre loup-garou est un gaillard qui a du cœur, et qui s’est fait voleur pour se venger. Il aurait mieux fait de se faire archer dans une compagnie franche, mais pour cela il faudrait voir comment il tire.
MORAND.
Soyez persuadé qu’il tire si bien, que monseigneur ne va jamais à la chasse sans être bien accompagné, et qu’il porte encore une cotte de mailles sous son jupon de velours.
BROWN.
Il n’y a qu’une cotte de mailles de Milan, pardessus un gambison[25] bien épais, qui résiste à une flèche anglaise. – Sus, buvons. – À ce que je vois, vous n’aimez pas trop votre seigneur : c’est comme partout.
RENAUD.
Oui, partout. J’en sais un à Genêts qui...
MORAND.
Chut ! on t’écoute là-bas.
BROWN.
On vous traite comme des bêtes.
GAILLON.
Pis, car ils pansent leurs chevaux et les nourrissent bien.
BROWN.
Aussi faut-il dire que vous avez plus de docilité que les chevaux.
MORAND.
De la docilité ?
BROWN.
Oui, vous êtes plus dociles, plus patients que des chevaux ; vous souffrez les coups et vous ne ruez pas. Dans mon pays, on n’est pas si endurant. Quand je salue un seigneur, il m’ôte son bonnet, et, si le premier lord d’Angleterre s’avisait de coucher avec ma femme, je lui ferais payer une amende de deux cents francs, bien heureux si je ne lui plantais pas une flèche dans le corps.
MORAND.
Ah ! ah ! les paysans sont donc les maîtres chez vous ?
GAILLON.
Qui donc travaille aux champs dans votre pays ?
BROWN.
Chacun travaille pour soi, mon garçon, chacun garde ce qu’il gagne. Nous sommes tous libres, entends-tu, et buvons à la gloire de la vieille Angleterre !
GAILLON.
Buvons. J’ai toujours soif avec des amis ; et il y a si longtemps que je n’ai bu de vin ! Nous sommes trop misérables pour en acheter.
RENAUD.
Je ne boirai pas à la gloire de l’Angleterre ; cette bataille de Poitiers me pèse sur la poitrine.
MORAND.
Et moi, je boirai à la santé du roi de l’arc, qui est un bon compagnon ; car enfin il faut boire, il paye le vin, et nous ne pouvons pas nous régaler tous les jours.
BROWN.
C’est parler, cela ! Buvons, mes maîtres ; oubliez vos chagrins : Anglais et Français, nous sommes maintenant amis pour six mois[26]. Et vous, là-bas, remplissez votre verre et ne pensez plus à Poitiers.
RENAUD, à Brown.
Ce sont les seigneurs qui ont laissé prendre le roi.
BROWN.
Ah ! si vous aviez vu ces messieurs bardés de fer, comme ils tombaient sous nos flèches, il y avait de quoi faire crever de rire.
GAILLON, à Brown.
Vous auriez bien dû en garder une pour monseigneur d’Apremont.
MORAND, à Gaillon.
Prends garde, Gaillon ; tu parles trop haut, quand tu bois.
GAILLON.
Je m’en moque ! Qu’est-ce que cela me fait à moi ? Je veux parler, je veux aller en Angleterre, et je veux que Gilbert d’Apremont m’ôte son bonnet.
MORAND.
Il est ivre !
RENAUD, à Brown.
On m’a dit que nos archers s’étaient bien battus à Poitiers, mais que les seigneurs avaient tout perdu.
BROWN.
C’est vrai.
GAILLON.
Oui, c’est vrai, ils perdent tout. Qui ose dire le contraire ?
MORAND.
Mais tais-toi donc !
BROWN.
Vos archers avaient envie de bien faire ; mais des arcs comme les leurs, cela n’est bon que contre les moineaux.
GAILLON.
Sire archer, menez-moi en Angleterre, je veux être maître à mon tour.
BROWN.
Le veux-tu, mon brave ? prends un arc, va trouver un capitaine que je te nommerai, et tu seras plus libre et plus heureux qu’un roi.
GAILLON.
Oui, c’est cela, je veux être roi, par le ventre de saint Ferréol !
BROWN.
Et vous, mes compères, voilà ce que vous devriez faire ; avec des bras et des épaules comme les vôtres, n’avez-vous pas de honte de travailler à la terre ? Mettez-vous une épée au côté, une targe sur le dos, et l’univers est à vous.
RENAUD.
J’aime mon pays, bien que j’y sois misérable.
MORAND.
Comme si nous pouvions quitter les terres de monseigneur ! il nous ferait bien vite reprendre le manche de la charrue, et j’ai mal au dos rien qu’en pensant à la manière dont il punirait notre équipée.
BROWN.
Le roi ne te ferait pas sortir d’une compagnie d’aventure ; nous ne recevons d’ordres que du capitaine, nous nous choisissons.
RENAUD.
Quand même nous serions libres, nous n’irions pas courir le monde. On aime la cabane où l’on est né.
BROWN.
Voilà comme ils sont, tous ces Français. Toujours ils se plaignent, et jamais ils n’ont le courage de se rendre libres.
MORAND.
Vous en parlez bien à votre aise, camarade.
Entre Simon.
RENAUD.
Qu’est-ce qu’a donc Simon ? Eh ! Simon ! par ici ! Qu’as-tu donc ? Tu as l’air malade.
SIMON.
Ah ! ce que j’ai vu suffirait bien pour me rendre malade. Le corps de Girart est là-bas, coupé en morceaux, auprès d’un arbre, et les chiens de monseigneur sont en train de le manger.
TOUS, excepté Gaillon qui est assoupi.
Quelle horreur !
BROWN.
Comment ! par saint George ! il nourrit ses chiens de chair humaine !
SIMON.
J’ai jeté des pierres aux chiens, et je voulais enterrer le corps, mais le sénéchal a passé ; il m’a dit que je méritais d’être pendu, pour battre les chiens de monseigneur et troubler la justice de la baronnie.
BROWN.
Ah ! s’il se trouve jamais à un jet d’arc de moi...
MORAND.
Vit-on jamais pareille impiété ! c’est pour cela que la châsse de monsieur saint Leufroy n’a pas sué. C’est cela qui l’a irrité.
GAILLON, se réveillant.
Qu’est-ce que vous dites donc ? – Pourquoi ne buvez-vous pas ?
BROWN.
Faire manger aux chiens de la chair humaine !
GAILLON.
Qui donc parle de manger ? j’en suis ; mais il faut boire en mangeant, ou l’on s’étrangle.
RENAUD.
Savez-vous ce qu’il faut faire, mes amis ?
SIMON.
Qu’est-ce ?
RENAUD.
Allons tous ensemble enterrer ce cadavre.
MORAND.
Nenni, je n’en suis pas. Je vois d’ici le sénéchal qui s’avance avec une douzaine de sergents.
SIMON.
J’ai déjà reçu des coups de bâton pour avoir essayé.
RENAUD.
Lâches que vous êtes, un jour il vous en arrivera peut-être autant à vous-mêmes.
BROWN, à Renaud.
Écoute, mon garçon, allons-y ensemble, et je mets mon arc sous mon bras.
Ils sortent.
MORAND.
Plaise à Dieu qu’ils ne trouvent personne pour les en empêcher !
SIMON.
Voici le sénéchal qui vient de ce côté, allons-nous-en.
Ils sortent.
GAILLON.
Eh bien ! tout le monde s’en va, et personne ne veut me tenir compagnie. Il faut donc que je boive ces bouteilles-là tout seul.
Entrent le sénéchal, Pierre et quelques hommes d’armes.
Holà ! monsieur le sénéchal, ôtez donc votre bonnet quand vous passez devant les gens.
LE SÉNÉCHAL.
Que dit ce maraud ?
UN HOMME D’ARMES.
Ôte ton bonnet, imbécile ; ne vois-tu pas monsieur le sénéchal ?
GAILLON.
Sénéchal ou baron, donne-moi deux cents francs d’amende, ou je te plante une flèche dans le corps.
LE SÉNÉCHAL.
Ah ! coquin, c’est ainsi que tu oses me parler ! Tu vas bien vite changer de ton. – Saisissez ce drôle. et me l’émouchez avec vos ceintures de cuir, du côté de la boucle.
PIERRE.
Monsieur le sénéchal, c’est un enfant qui a bu un peu trop de vin et qui s’est enivré. Renvoyez-le dans sa maison ; il sera sage quand il aura dormi.
LE SÉNÉCHAL.
Ivre ou non, qu’on le fustige ; d’ailleurs, cette canaille est trop insolente, elle a besoin d’un exemple.
PIERRE.
Vous en trouverez d’autres plus coupables.
LE SÉNÉCHAL.
Alors ils auront le double de coups.
Aux hommes d’armes qui battent Gaillon.
Allons, compères, frappez à tour de bras ! Jacques Bonhomme a le cuir dur.
GAILLON, battu.
Au secours ! à l’aide ! je suis mort ! au meurtre !
LE SÉNÉCHAL.
Plus fort donc ! vous ne faites qu’épousseter son habit.
SIMON, revenant.
Qu’est-ce donc qu’y a-t-il ?
GAILLON.
À mon secours, Simon, mon ami ! ils veulent me tuer.
MORAND, revenant.
Quoi ! c’est ce pauvre Gaillon que l’on bat si cruellement ! qu’a-t-il donc fait ?
GAILLON.
Je n’ai rien fait ! je n’ai rien fait ! Au secours ! au meurtre !
Entre une foule de paysans.
BARTHÉLÉMY.
Comment ! battre un homme le jour de la Saint-Leufroy !
AUTRE PAYSAN.
C’est un jour de franchise ; cela crie vengeance.
AUTRE PAYSAN.
Est-ce que nous le laisserons assommer sous nos yeux ?
LE SÉNÉCHAL.
Hors d’ici, canaille, ou je vous ferai couper les oreilles !
GAILLON.
Tirez-moi de leurs mains, mes amis ! Je suis innocent.
FOULE DE PAYSANS.
Qu’on le mette en liberté ! – Délivrons-le.
BARTHÉLÉMY.
Aux bâtons ! sus aux bâtons ! Leufroy !
PAYSANS.
Aux bâtons ! aux bâtons !
LE SÉNÉCHAL, à ses gendarmes.
Enfants ! flamberge au vent ! chargez-moi ces ivrognes.
PAYSANS.
Assommons-les à coups de pierres ! – Ils ne sont qu’une douzaine. – Nous allons en venir à bout. Allons chercher nos arcs au cabaret. – À nous les archers d’Apremont !
Tumulte ; entre le Frère Jean.
FRÈRE JEAN, à part.
Que vois-je ! ils attaquent le sénéchal ! Le vin leur a donc montré leurs forces. Encore si c’était ces moines qu’ils voulussent lapider !
Haut.
Enfants ! quel scandale ! Le jour de la Saint-Leufroy ! Arrêtez, ou je vous excommunie !
PAYSANS.
Arrêtez, arrêtez ! c’est le père Jean qui nous soigne quand nous sommes malades. – Ne jetez pas de pierres.
LE SÉNÉCHAL.
Parbleu, mon père, mêlez-vous de vos affaires ; vous n’êtes point ici sur les terres de votre abbaye, et, quand vous y seriez, vous n’êtes point abbé. Allez-vous-en dire votre bréviaire, et laissez-nous.
FRÈRE JEAN.
Sénéchal ! vous oubliez que vous parlez à un ministre du Seigneur.
PAYSANS.
En avant ! le père Jean est pour nous !
FRÈRE JEAN.
Jadis, le jour de la Saint-Leufroy, il était défendu de punir un criminel, et c’est un enfant innocent que vous traitez avec tant de cruauté ?
Entrent Isabelle, de Montreuil, suite.
LE SÉNÉCHAL.
À moi, sire chevalier ! aidez-nous à châtier ces insolents ! Courage ! ils sont à nous.
Les paysans prennent la fuite.
ISABELLE.
Grand Dieu ! d’où vient ce tumulte ? Arrêtez, au nom du ciel ! Sénéchal, ne poursuivez pas ces pauvres gens.
DE MONTREUIL.
Pourquoi ce tapage ?
LE SÉNÉCHAL.
Je faisais corriger un de ces vilains, et ses camarades ont voulu nous l’enlever. Ils m’ont lancé des pierres, et voici deux flèches qui sont tombées près de moi. Je saurai qui les a tirées.
ISABELLE, montrant Gaillon.
C’est ce pauvre enfant que l’on battait. Il a l’air si doux. Monsieur le sénéchal, pardonnez-lui, je vous en prie, à cause de moi.
LE SÉNÉCHAL.
Voilà le moyen de les rendre intraitables.
À Gaillon.
Sauve-toi, coquin.
Il lui donne un grand coup de plat d’épée, Gaillon s’enfuit.
DE MONTREUIL.
Belle cousine, vous êtes trop bonne pour vos serfs. Cette espèce est comme les chiens qui vous mordraient si l’on n’avait toujours le fouet à la main.
ISABELLE.
Fi donc, monseigneur ! Comment pouvez-vous donner le nom d’un animal à des chrétiens ?
PIERRE, à demi-voix.
Vive notre bonne maîtresse !
ISABELLE, à de Montreuil.
Vous le voyez, le père Jean leur a parlé, ils se retirent en silence. Les voilà redevenus doux comme des moutons.
DE MONTREUIL.
Ah ! que vous connaissez peu cette engeance ! Ils ont pris la fuite, les ribauds, parce qu’ils m’ont vu venir avec mes sergents.
LE SÉNÉCHAL.
C’est notre douceur qui les enhardit à mal faire.
Entre une femme qui se met à genoux devant Isabelle.
LA FEMME.
Noble demoiselle, ayez pitié d’une malheureuse veuve qui n’a pas de quoi donner à manger à quatre petits enfants.
LE SÉNÉCHAL.
Allons, houste, hors d’ici la vieille.
ISABELLE.
Sénéchal, ne repoussez pas cette pauvre femme. C’est à moi qu’elle parle. – Qui es-tu, ma bonne mère ?
LA FEMME.
Je suis la veuve de Girart, qu’on a pendu hier par l’ordre de monseigneur. Il gagnait du pain pour mes enfants ; comment ferai-je pour les nourrir, toute seule ?
LE SÉNÉCHAL.
File du chanvre, c’est la saison.
ISABELLE.
Pauvre femme !
LA FEMME, au sénéchal.
Je n’ai pas un denier pour en acheter.
ISABELLE.
Prenez ces quatre florins, ma bonne. Je suis fâchée de n’avoir pas davantage à vous donner.
LA FEMME.
Que Dieu vous le rende, ma noble demoiselle ; que Dieu vous bénisse !
À part.
Puisse-t-il pardonner à son père à cause d’elle !
Haut.
J’ai encore une grâce à vous demander, noble demoiselle.
ISABELLE.
Parlez.
LA FEMME.
Permettez qu’on enlève mon pauvre mari : il est là-bas étendu par terre, et monsieur le sénéchal a défendu qu’on jetât un peu de terre sur lui.
ISABELLE.
Est-il possible ?
LE SÉNÉCHAL.
C’est l’ordre de monseigneur.
Rentre Brown.
ISABELLE.
Mon père n’a pu donner cet ordre !
À sa suite.
Allez, vous autres, enterrer ce cadavre.
PIERRE.
J’y cours.
BROWN.
C’est déjà fait.
LE SÉNÉCHAL.
Et qui l’a fait ?
BROWN.
Moi ; je n’aime pas à voir les chiens manger de la chair humaine ?
LE SÉNÉCHAL.
Pourquoi te mêler de ce qui ne te regarde pas ? Que viens-tu faire ici ?
BROWN.
Tirer de l’arc... et vous savez que je m’y entends ?
ISABELLE, à Brown.
Vous êtes un brave homme, sire roi de l’arc, et un bon chrétien. Dieu vous le rendra.
LA FEMME, à Brown.
Oh ! monsieur l’archer, que je vous remercie ! c’est mon mari que vous avez enterré.
BROWN.
Il n’y a pas de quoi, la mère, ce sont de ces services que l’on rend à charge de revanche. Tenez, voici un florin pourboire à ma santé.
Entre un Anglais habillé en paysan.
L’ANGLAIS, bas à Brown.
Eh bien ?
BROWN, bas.
J’ai vu Gilbert descendre du château. Il n’est armé que d’un jacque[27] et n’a que cinq hommes avec lui. Voici sa fille. Cours au capitaine Siward, et dis-lui qu’il est temps.
Ils sortent.
LE SÉNÉCHAL.
Cet homme m’a tout l’air d’un bandit.
DE MONTREUIL.
Il s’est dit archer du capitaine Dillon.
ISABELLE.
Quel qu’il soit, il s’est comporté en brave homme. Je regrette que mon père n’ait pas beaucoup d’aussi bons serviteurs.
DE MONTREUIL.
Dites d’aussi bons archers.
LE SÉNÉCHAL.
Il a donné de l’argent à cette vieille mendiante par pure fierté ; et qui sait s’il n’a pas volé hier le florin qu’il donne aujourd’hui ?
ISABELLE.
Vous voyez tout en mal.
DE MONTREUIL.
Allons un peu de ce côté, les vilains vont courir la quintaine. Je ne connais rien de si amusant que de voir ces gros lourdauds tomber rudement sur le sable, en recevant un bon coup sur les épaules.
LE SÉNÉCHAL.
D’où vient donc ce bruit de chevaux ? il y a des cavaliers qui galopent dans la grande avenue.
ISABELLE.
Ce n’est pas mon père, car je le vois là-bas.
DE MONTREUIL.
J’entends comme... un cri de guerre.
ISABELLE.
Vous me faites trembler ! ne faites donc pas de ces plaisanteries-là.
PAYSANS.
Les Anglais ! les Anglais ! Alarme !
ISABELLE.
Dieu ! les Anglais ! Où fuir ? Et mon père !
DE MONTREUIL.
C’est ici qu’il faut être leste, tâchons de gagner le pont-levis avant eux. En arrière ! en arrière ! Sire sénéchal, prenez la main de ma cousine, pendant que je tâcherai de protéger votre retraite.
Entre une foule d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant de tous les côtés, emmenant leurs bestiaux, etc.
MORAND, à de Montreuil.
Ah ! monseigneur ! Venez à notre aide, autrement c’est fait de nous.
LE SÉNÉCHAL.
Ah ! tu penses à nous maintenant. Va prendre ta cognée, coquin, et viens nous aider.
PIERRE, à de Montreuil.
Monseigneur, il est impossible de nous retirer au château. Voyez ces vingt hommes habillés de vert, ce sont leurs archers qui nous ont coupé le chemin.
LE SÉNÉCHAL.
Oui, par Notre-Dame de Beauvais ! Et voici à leur tête ce traître qui a gagné le prix.
DE MONTREUIL.
Sainte Vierge ! et nous n’avons pas de cuirasses !
La suite de Montreuil et quelques paysans se serrent en peloton, et tâchent de se faire un abri avec les tables et les bancs. On voit dans le fond Siward, Brown et les Anglais, pillant et emmenant les bestiaux.
ISABELLE.
Sainte Vierge, que deviendrons-nous ?
PIERRE, à Isabelle.
Madame, entrez dans cette cabane, vous y serez à l’abri, en attendant que nous soyons secourus. Je resterai à la porte, et, tant que je serai vivant, personne n’entrera.
DE MONTREUIL, à Isabelle.
Oui, oui, cachez-vous quelque part.
Aux siens.
Ferme, mes amis !
ISABELLE.
Je me meurs, je ne sais si j’aurai la force d’aller jusque-là.
PIERRE.
Souffrez que je vous porte.
À un de ses camarades.
Geoffroy, tiens cette table devant elle, que les flèches de ces brigands ne la blessent pas.
Il emporte Isabelle dans la maison.
ANGLAIS.
Siward en avant ! ville gagnée !
DE MONTREUIL.
Ferme ici, mes prudhommes ! Vilains, armez-vous.
Combat ; entre Frère Jean.
FRÈRE JEAN.
Malgré ma haine pour d’Apremont, mon sang bouillonne quand je vois un village français saccagé par des Anglais. J’ai bonne envie de reprendre mon ancien métier. Oui, voici une pique par terre, cela est trop tentant. À moi, mes amis ! saint Leufroy nous délivrera de ces mauvais chrétiens[28].
Il se mêle aux combattants.
BRIGANDS, derrière la scène.
Hou ! hou ! Loup-Garou !
PAYSANS.
Voici le Loup-Garou pour nous achever ! Nous sommes perdus !
Entrent le Loup-Garou et sa troupe.
LE LOUP-GAROU.
Ils sont à nous ! Anglais et Français, à mort tous ! Jetez du feu sur les toits ! Hou ! hou ! Loup-Garou !
Un brigand s’apprête à jeter un brandon allumé sur la cabane où est Isabelle ; Pierre, qui est resté à la porte, le tue. Quelques combats partiels. La troupe de Montreuil s’augmente à chaque instant de paysans qui viennent s’y réfugier. Gilbert d’Apremont, qui est parvenu à se dégager des Anglais qui l’entouraient, vient se mettre à la tête des siens.
D’APREMONT.
À moi, mes braves amis ! C’est pour vos maisons, c’est pour votre seigneur que vous combattez !
LE SÉNÉCHAL.
Ils se dispersent pour piller ! Si les vilains avaient du cœur, nous pourrions nous tirer d’affaire.
FRÈRE JEAN.
Courage, enfants ! vous le voyez, les loups attaquent aussi les Anglais.
DE MONTREUIL.
Ah ! si nos gens du château voulaient se dépêcher !
D’APREMONT.
Montreuil, qu’as-tu fait de ma fille ?
DE MONTREUIL.
Elle est en sûreté, je crois. Par saint George ! pensons avant tout à nous battre, et à nous garantir de leurs flèches.
SIWARD, aux siens.
Derrick, que l’on chasse les bœufs sur le grand chemin. Que personne ne s’amuse encore à piller. Gilbert doit être dans cette petite troupe, et je veux l’avoir, sa rançon sera belle.
Combat.
FRÈRE JEAN, aux paysans.
Appuyez vos piques contre terre, et dirigez-les au nez des chevaux.
DE MONTREUIL.
Gloria tibi, Domine ! Le pont-levis s’abaisse, nous allons être secourus.
D’APREMONT.
Saint-Denis ! Notre-Dame d’Apremont[29] !
SIWARD.
Siward en avant !
LE LOUP-GAROU, aux brigands.
Voici toute la meute qui débouche du château. Nous en avons assez fait, le village est en feu ! Sauvons notre butin. En retraite, à la forêt ! À moi les loups !
Il sort suivi des siens.
BROWN, à Siward.
En retraite, capitaine ! voici un gros de gendarmes qui s’avance pour nous charger. Nos gens sont si âpres à la curée, qu’ils ne veulent pas garder d’ordre.
SIWARD.
Siward ne quitte pas sitôt la partie. Sont-ils nombreux, ces gendarmes français ?
BROWN.
Sans doute, et bardés de fer ; nos flèches rebondissent sur leurs cuirasses comme sur une enclume. En retraite, de par le diable !
SIWARD.
Rassemble les archers, je les recevrai avec mes gendarmes.
BROWN.
Vos gendarmes sont à piller ! en retraite, vous dis-je.
GENDARMES d’Apremont, derrière la scène.
Saint-Denis ! Notre-Dame d’Apremont ! d’Apremont à la rescousse[30] !
D’APREMONT.
C’est trop longtemps se défendre ! chargeons-les à notre tour ! Suivez votre seigneur ! Suivez Gilbert d’Apremont.
SIWARD.
Je vois d’Apremont. Voici l’instant que j’attendais. À moi, Gilbert, un coup de lance en l’honneur des dames !
Ils courent l’un sur l’autre, d’Apremont est renversé. Pierre, d’un coup d’épée, coupe les jarrets du cheval de Siward, qui tombe à son tour.
PIERRE.
Rendez-vous, capitaine, ou je vous enfonce ma miséricorde dans le corps[31].
SIWARD.
Je ne me rends pas à un vilain. Où est ton maître ?
PIERRE.
Eh bien ! meurs donc !
Il va pour le percer.
D’APREMONT, qui s’est relevé.
Arrête, Pierre ! il vaut son pesant d’or. Rendez-vous, capitaine.
SIWARD.
Voici mon épée.
BROWN, dans le fond.
Bonsoir, capitaine. Vous m’en croirez une autre fois. Voici pour celui qui vous a pris.
PIERRE, frappé d’une flèche.
Jésus ! je suis mort.
Il tombe.
D’APREMONT.
Montreuil, prends mon cheval et conduis nos gendarmes à la poursuite de ces pillards. Les voilà qui fuient en désordre. – Où est ma fille ? Sénéchal, l’avez-vous vue ?
PIERRE.
Dans cette cabane... Faites-la sortir... le feu s’étend de ce côté.
D’APREMONT, entrant dans la cabane.
Isabelle ! ma fille, où es-tu ?
FRÈRE JEAN.
Courez au feu, mes enfants. Laissez les gendarmes poursuivre les Anglais. Abattez cette maison pour arrêter le feu ; faites sonner les cloches.
Il butte contre le corps de Pierre.
Eh ! c’est toi, mon pauvre Pierre, que voilà percé d’un grand coup. Parle. Es-tu encore vivant ? Ne me reconnais-tu pas ?
PIERRE.
Quoi ! c’est vous, madame... Vous daignez... Mais où suis-je ?
FRÈRE JEAN.
Pauvre garçon ! il a le délire. Rassure-toi, ta blessure n’est pas mortelle. La moitié du fer est hors de la plaie, et ton baudrier de buffle a un peu amorti le coup.
D’APREMONT, sortant de la cabane.
Holà ! Pierre... aide-moi... ah ! il est mort. Tant pis. Jacob, Meunier, faites une litière avec des lances et vos manteaux ; ma fille est évanouie, et il faut la porter au château. Frère Jean, venez vite avec moi ; ma fille est malade, et nous avons besoin de votre clergie[32].
FRÈRE JEAN.
Voici un homme qui en a plus besoin qu’elle.
D’APREMONT.
Morbleu ! voulez-vous comparer la vie de ma fille avec celle de mon serf ? Venez, je vous payerai bien.
Il sort ; on emporte Isabelle évanouie.
FRÈRE JEAN, à un paysan.
Apporte-moi de l’eau.
Il fait boire Pierre.
Tiens, bois, mon ami ; comment te trouves-tu maintenant ?
PIERRE.
Un peu mieux... et les Anglais ?...
FRÈRE JEAN.
Ils sont en fuite.
PIERRE, regardant la cabane où était Isabelle.
Cette porte est ouverte... où est madame Isabelle ?
FRÈRE JEAN.
Son père l’a emmenée au château. Elle est évanouie, et il voulait m’obliger à te quitter pour lui donner mes soins...
PIERRE.
Courez vite, mon père... Elle est peut-être blessée !
FRÈRE JEAN.
Non, non. La peur a causé tout son mal. Ta blessure n’est rien, prends courage.
Il panse sa blessure.
MONTREUIL, revenant avec ses gendarmes et des paysans.
Victoire ! nous leur avons repris leur butin.
SIMON.
Oh ! mes pauvres vaches, vous voilà donc ! vous ne serez point mangées par les Anglais.
MORAND, à un de ses bœufs.
Te revoilà, Fauveau à la raie noire, mon garçon ; tu as dû avoir bien peur.
LE SÉNÉCHAL, à Simon.
Simon, ces vaches étaient à toi, n’est-ce pas ?
SIMON.
Oui, monsieur le sénéchal, toutes les six.
LE SÉNÉCHAL, à ses gendarmes.
Une, deux, trois ; une, deux, trois. Ces deux-là appartiennent à monseigneur ; emmenez-les.
SIMON.
Comment donc ? Que dites-vous là ?
LE SÉNÉCHAL.
Oui, par droit de rescousse, nous les avons bien gagnées[33].
SIMON.
Mais...
LE SÉNÉCHAL.
Je te les revendrai à bon compte. Je sais que tu as de l’argent.
SIMON.
Mais, monsieur le sénéchal...
LE SÉNÉCHAL.
Silence, bonhomme. Que l’on prenne le tiers de ces bestiaux ; demain nous réglerons ensemble à quel prix vous les pourrez racheter.
PAYSANS.
C’est une abomination ; c’est nous qui les avons reprises !
BARTHÉLÉMY, tuant une vache.
On ne me prendra pas celle-là.
LE SÉNÉCHAL.
Ah ! coquins, vous apprendrez à me connaître ; vous verrez si je sais châtier les insolents. Vous payerez cher les pierres que vous m’avez lancées. Gendarmes, que l’on chasse cette canaille qui murmure toujours.
SIWARD.
Courage ! frappez fort ! J’aurais presque envie de rire en voyant des Français s’entrebattre.
DE MONTREUIL.
Hors d’ici, vilains ! ou nous allons vous embrocher de nos lances.
Les paysans s’enfuient.
LE SÉNÉCHAL.
La journée a été chaude : une quinzaine de morts.
Poussant du pied un cadavre
Tenez, voilà un de ces voleurs, un de ces loups, comme ils les appellent. Ils se sont sauvés aussi vite qu’ils étaient venus.
DE MONTREUIL.
Le feu s’est éteint, il faut rentrer. Trompette, sonne la retraite.
À Siward.
Sire chevalier, il faut nous suivre, s’il vous plaît.
FRÈRE JEAN, tenant un cheval par la bride.
Voici un cheval sans maître. Tiens, Pierre, monte-le si tu en as la force.
SIWARD, à de Montreuil.
Me laisserez-vous aller à pied comme un varlet ? Est-ce ainsi que l’on traite un chevalier ?
LE SÉNÉCHAL.
Pierre, donne ton cheval à ce gentilhomme.
PIERRE.
Mais moi, je suis blessé.
LE SÉNÉCHAL.
Point de réplique, obéis... Ce maraud, parce qu’il sait lire, tranche de l’homme d’importance, et voudrait presque traiter ses maîtres comme ses égaux.
Siward monte sur le cheval de Pierre, et sort avec de Montreuil et les gendarmes.
FRÈRE JEAN.
Mais, monsieur le sénéchal, jamais cet homme ne pourra revenir à pied au château.
LE SÉNÉCHAL.
Qu’il s’arrange comme il pourra.
Il sort.
FRÈRE JEAN.
Voilà ce que l’on gagne à servir les grands. Tu leur sauves la vie, et ils t’abandonnent comme un cheval estropié.
PIERRE.
Je crois que je pourrai marcher jusqu’au château.
FRÈRE JEAN.
Non, viens avec moi au couvent ; tu feras mieux. On nous prêtera bien un âne pour t’y conduire.
Aux paysans qui se tiennent éloignés.
Holà ! par ici, mes amis !
Rentrent Simon, Renaud, Morand, paysans.
SIMON.
C’est un de ces chiens d’hommes d’armes. Qu’il crève !
FRÈRE JEAN.
C’est un brave garçon qui ne vous a jamais fait que du bien. Aidez-moi à le transporter au couvent, où je panserai sa blessure.
MORAND.
Eh ! parbleu, c’est Pierre Lambron, le fils de Lambron, mon compère. Pauvre diable ! Est-ce dangereux ?
FRÈRE JEAN.
Il a sauvé la fille du baron, et, pour la peine, messire Gilbert l’a laissé là perdant tout son sang, et il voulait encore que je le quittasse.
SIMON.
Ah ! mon bon père Jean, vous êtes notre providence, et nous avons bon besoin de vous pour nous consoler ; car nos seigneurs nous rendent bien malheureux par le temps qui court.
RENAUD.
Chaque jour nouvelle souffrance.
MORAND.
Aujourd’hui pillés, brûlés par les Anglais ! pillés et battus par nos maîtres !
FRÈRE JEAN.
Vous vous plaignez avec raison, mais ce n’est pas là tout ce que vous auriez à faire. Ah ! si j’étais comme vous maltraité par...
SIMON.
Comment ?
FRÈRE JEAN.
Qu’ont-ils donc de plus que vous, pour vous rendre misérables ?
N’êtes-vous pas comme eux enfants d’Adam ? N’êtes-vous pas des hommes de la même chair que ces seigneurs si orgueilleux ? D’où vient donc que vous êtes livrés à leur merci, comme les agneaux aux loups ?
SIMON.
Vous nous faites toutes ces questions, mon père, comme si nous étions en état d’y répondre. Nous sommes de simples gens de village qui ne savons rien ; mais cependant il faut bien qu’il y ait une raison pour que nous soyons misérables, puisque cela est ainsi.
FRÈRE JEAN.
Et moi, je vous dirai pourquoi vous êtes si misérables. Vous êtes misérables, parce que vous êtes lâches. N’êtes-vous pas aussi adroits, aussi forts que vos maîtres ? Y en a-t-il beaucoup parmi eux qui lèveraient un marteau aussi lourd que le tien, Morand ?
MORAND.
Ah ! c’est vrai, mon marteau est lourd.
FRÈRE JEAN.
Qui peut donc enhardir à ce point ceux qui vous oppriment ? Votre lâcheté, vous dis-je. C’est sur elle qu’ils comptent. Voyez-vous un chien attaquer un autre chien qui lui montre les dents ? Le premier qui prend la fuite est aussitôt mordu, car le plus lâche reprend du cœur en voyant fuir son ennemi. Il est aisé d’avoir du courage avec des gens à cœur de lièvre qui tremblent à la vue d’un hoqueton chargé d’armoiries. Mais je perds ici mon temps, et Pierre a besoin de moi. Allons, qui me prêtera un âne pour le porter ? Le sénéchal vous a-t-il laissé un âne ?
Il sort avec Pierre et quelques paysans.
SIMON.
Je l’aime beaucoup, ce père Jean. Il nous parle à nous autres comme nous parlerions vous et moi. Ce n’est pas comme feu l’abbé Boniface, (Dieu veuille avoir son âme !). Il nous faisait des sermons où le diable n’aurait rien compris.
RENAUD.
Avez-vous vu, tout moine qu’il est, comme il a pris une pique et comme il s’est démené ? C’est qu’il est aussi brave que savant.
SIMON.
Il nous a dit et répété ce que cet archer anglais a dit ce matin.
MORAND.
Oui ; mais cet archer était un traître, comme nous l’avons vu.
RENAUD.
D’accord ; mais il a bien pu dire la vérité.
SIMON.
Je le crois, et je commence à y réfléchir sérieusement.
RENAUD.
Moi, il y a longtemps que j’y pense.
MORAND.
Je sais bien à quoi tu penses, et j’y pense autant que toi.
SIMON.
Un homme d’armes et un clerc ont parlé de même sans s’être donné le mot.
RENAUD.
Il nous a dit notre fait. Nous sommes des lâches de nous laisser tondre la laine sur le dos par des gens qui ne sont pas plus forts que nous.
MORAND.
Comment disait-il donc, qu’un chien n’attaque pas un autre chien qui lui montre les dents ?
SIMON.
Il disait aussi que nous avions peur d’un hoqueton chargé d’armoiries. Hein ! pourtant, si je voulais, je couperais cet arbre en deux d’un seul coup de hache ; cela ne serait pas bien plus difficile de couper une tête.
MORAND.
Nous nous sommes laissé prendre, comme des niais, je ne sais combien de belles vaches.
SIMON.
Et moi, mon pauvre taureau, ils vont le manger.
RENAUD.
Ah ! si tout le monde pensait de même !
SIMON.
Renaud, je crois t’entendre. J’ai un arc assez bon, n’en déplaise à cet Anglais ; si jamais tu risquais quelque chose, je serais avec mon arc à tes côtés.
MORAND.
Aussi bien, nos arcs, voilà à peu près ce qui nous reste, car on nous a quasi tout pris.
Ils sortent.
Scène V
RENAUD, SIMON, JEANNETTE, assis autour d’un lit, sur lequel est une femme morte
Une chaumière de paysan.
SIMON.
Elle est morte, ma pauvre Élisabeth, et mon enfant est mort avec elle.
JEANNETTE.
Elle est morte sans sacrements !
RENAUD.
Maudit soit celui qui l’a fait mourir !
SIMON.
Encore si le bon père Jean était venu assez à temps pour lui donner quelque potion, ou du moins pour la confesser !
RENAUD, à Jeannette.
Ma sœur, ne reste pas ici. Ce spectacle n’est pas fait pour une femme.
SIMON.
Oui, va-t’en, Jeannette. Va chez les Morand ; ce sont de bonnes âmes et de dignes chrétiens. Ils te recevront bien.
JEANNETTE.
Non, je ne la quitterai pas que je n’aie vu jeter de la terre sur sa bière : j’ai du courage aussi. Je veux la coudre moi-même dans son linceul.
SIMON.
Je ne sais si j’aurai de quoi la faire enterrer honorablement.
RENAUD.
Le père Jean dira une messe à moitié prix pour le repos de son âme.
SIMON.
Non, cela ne vaut rien, une messe à moitié prix. Je veux qu’il y ait deux cierges et un drap noir avec un galon de soie. Ma pauvre Élisabeth verra combien je l’aimais.
JEANNETTE.
Et moi, je l’envelopperai dans mon beau voile blanc, et on l’enterrera avec. Dussé-je être une année à en filer un autre, on ne dira pas que ma sœur a été enterrée sans un voile blanc.
SIMON.
Bonne sœur ! sainte Catherine te le rende !
RENAUD.
Voici le père Jean.
FRÈRE JEAN, entrant.
Hé bien, mes enfants, la malade ?
RENAUD.
Elle n’a plus besoin de vos secours.
JEANNETTE.
Hélas ! mon père, regardez bien. Est-elle bien morte ? Elle est chaude encore. Il me semble la voir encore respirer.
FRÈRE JEAN.
Non... tout est fini. Vous m’avez envoyé chercher trop tard, et je n’ai pu venir aussitôt que je l’aurais désiré. C’était l’heure de la prière, et notre abbé ne veut pas que l’on quitte l’église, même pour un devoir de charité. Pourquoi ne m’a-t-on pas prévenu plus tôt ?
SIMON.
Mon père, c’est qu’elle ne s’est plainte qu’hier au soir. Vous savez combien elle avait de courage.
FRÈRE JEAN.
Et ce que l’on m’a dit est-il vrai ?
RENAUD.
Oui, mon père c’est le sénéchal qui l’a tuée.
FRÈRE JEAN.
Le scélérat !
RENAUD.
Hier, c’était un samedi. C’était un jour de corvée, et elle était allée glaner par ordre du baron...
FRÈRE JEAN.
Glaner ! vit-on jamais avarice pareille ! voler le pain des pauvres !
JEANNETTE.
Et faire glaner une femme grosse de huit mois, mon père !
RENAUD.
Elle était très fatiguée, et elle se reposait un instant sur une gerbe. Le sénéchal arrive, et... Ô ma pauvre sœur !
FRÈRE JEAN.
Mes enfants, du courage ! Dieu ne laissera pas un tel crime impuni.
SIMON.
Le sénéchal lui a donné un grand coup de pied dans le ventre, à une femme grosse de huit mois !
JEANNETTE.
Je l’ai vu de mes yeux. J’étais à côté d’elle. Oh ! le Loup-Garou n’aurait pas fait cela.
SIMON.
D’abord elle ne parut pas s’en ressentir, mais cette nuit elle souffrit beaucoup ; ce matin elle est accouchée d’un enfant mort, et elle est morte quand on sonnait pour vêpres.
JEANNETTE.
Elle se plaignait toujours d’avoir froid. J’ai mis sa main dans mon sein, et je sens encore comme si j’y avais mis de la glace.
SIMON.
Nous avons récité les prières des agonisants ; nous ne pouvions faire autre chose.
FRÈRE JEAN.
Mes enfants, votre bonne Élisabeth est entrée tout droit en paradis. Quant à son assassin, il faut en avoir justice. J’en parlerai à messire Gilbert.
RENAUD.
Cela serait bien inutile. Jeannette lui a raconté comment tout cela s’était passé ; mais, comme le sénéchal l’avait déjà prévenu par ses menteries, Jeannette a été durement repoussée, avec des injures que je n’oserais répéter.
FRÈRE JEAN.
Tous ces coquins de gentilshommes se ressemblent.
RENAUD.
C’est bien vrai.
SIMON.
Mon père, voudriez-vous dire vous-même la messe pour le repos de son âme ? Nous la paierons cinq sous, car nous voulons qu’elle soit honorable.
FRÈRE JEAN.
Gardez votre argent, pauvres gens. Je suis plus riche que vous. Je chanterai sa messe, et, tenez, prenez cet argent ; c’est pour vous acheter des habits de deuil.
SIMON, baisant la main de Frère Jean.
Ah ! mon père, vous êtes un ange du ciel ! Ma pauvre femme, le meilleur prêtre de France te chantera une belle messe !
JEANNETTE.
Vous êtes notre sauveur à tous. Sans vous, ce pays serait un enfer.
RENAUD, bas à Simon.
Simon ?
SIMON.
Quoi ?
RENAUD.
Prendrons-nous cet argent ?
SIMON.
Oui, certes ! Ma pauvre Élisabeth ! quelle joie elle aura dans le paradis, quand elle verra que l’on porte son deuil avec des habits neufs.
RENAUD.
Soit ! – Simon, il faut aller chez le fossoyeur pour lui commander la fosse. Toi, Jeannette, va chercher ton voile.
SIMON.
Adieu, mon bien bon père Jean, tout le monde saura votre générosité.
JEANNETTE.
Elle fera honte à monseigneur.
Elle sort avec Simon.
FRÈRE JEAN.
Taisez-vous ! je vous l’ordonne. – Allons, Renaud, mon ami, ne te laisse pas abattre par la douleur... Viendra peut-être un temps plus heureux.
RENAUD.
Je ne vis que dans cette espérance.
FRÈRE JEAN.
Donne-moi ta main. – Tu as la fièvre, mon garçon ; tu es malade.
RENAUD.
Non, je ne suis pas malade. – Mais, avant de partir, dites-moi encore un mot, mon père. – Cette semaine, un frère prêcheur a passé dans ce village ; il a parlé du tombeau de Notre-Seigneur, des païens qui le profanent, et du saint roi qui a gagné la couronne céleste en s’efforçant de le délivrer. Il a dit qu’on doit imiter un si noble exemple, et courir sus aux païens et aux Sarrasins.
FRÈRE JEAN.
Toujours le même sermon !
RENAUD.
Hé bien, mon père, quelles gens sont les Sarrasins ?
FRÈRE JEAN.
Des coquins qui ne croient pas en Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui adorent Mahomet, et ne veulent pas manger du cochon.
RENAUD.
Mais aussi ce sont des gens cruels qui font endurer mille tourments à leurs esclaves chrétiens ?
FRÈRE JEAN.
Sans doute ; mais pourquoi toutes ces questions ? Serais-tu assez sot ou assez désespéré pour aller te faire tuer dans la Palestine ? Va, crois-moi, reste dans ton village, et vis en bon chrétien.
RENAUD.
Je ne pense pas au voyage de Palestine, mon père. Mais encore une question : un homme qui est dur et méchant... c’est qu’il n’adore pas Jésus-Christ ? c’est un païen ?
FRÈRE JEAN.
Oui ; que veux-tu dire ?
RENAUD.
Quand même il mangerait du cochon, quand même il ferait semblant d’aller à la messe, cet homme-là, s’il est avare, cruel et méchant, cet homme-là est un Sarrasin, un païen.
FRÈRE JEAN.
Il y a, dit-on, de ces coquins-là dans la Provence ; que le feu Saint-Antoine les arde[34] !
RENAUD.
J’étais bien aise de comprendre ce que disait le bon frère prêcheur.
FRÈRE JEAN.
Renaud, mon ami, il y a plus d’un païen qui porte une croix sur sa casaque. Adieu ! prends courage, et le ciel aura pitié de toi.
Il sort.
RENAUD, seul, s’agenouille devant le cadavre.
Ma bonne sœur, ma chère Élisabeth, reçois ici mon serment. Tu seras vengée du méchant, du païen qui t’a tuée. Si personne ne veut m’aider, seul je te vengerai ; je te le jure sur ma part du paradis.
Scène VI
GILBERT D’APREMONT, ISABELLE, MARION
Une salle du château d’Apremont.
ISABELLE.
Eh bien ! est-il enfin revenu, ce pauvre Pierre ?
MARION.
Oui, madame. Pauvre garçon ! il est revenu ce matin bien pâle encore ; mais cela lui va bien, on dirait qu’on voit la peau d’une demoiselle. Il est blanc, blanc !... jamais je n’ai vu d’homme avoir une si belle peau !
ISABELLE.
Qu’on le fasse venir.
Marion sort.
Que nous sommes heureux d’avoir des serviteurs aussi fidèles ! Ce brave jeune homme, c’est en me défendant, c’est en vous sauvant la vie qu’il a été blessé.
D’APREMONT.
Pour m’avoir sauvé la vie... qu’il ne s’en vante pas. J’étais sur pied avant que cet Anglais eût fait une volte pour venir me charger. Je l’attendais au coup d’estoc que je sais et qui ne m’a jamais manqué. Au reste, j’aime Pierre ; il monte bien à cheval, il est intelligent, il a du cœur ; je ne lui trouve qu’un défaut, c’est qu’il sait lire et écrire.
ISABELLE.
Mais, moi aussi, j’ai ce défaut.
D’APREMONT.
Toi, à la bonne heure, tu es noble ; mais je n’aime pas qu’un vilain en sache plus que moi.
ISABELLE.
Et croyez-vous qu’on s’avisera jamais de comparer la science d’un clerc avec la noblesse d’un chevalier ?
D’APREMONT.
N’importe ; je veux le récompenser, et je te le donne pour écuyer. Tu peux le prévenir de ma part que désormais il t’appartient.
ISABELLE.
Je l’accepte avec plaisir.
D’Apremont sort ; entrent Pierre et Marion.
PIERRE.
Madame !...
Il se met à genoux.
ISABELLE.
Mon sauveur ! mon cher Pierre ! que de grâces j’ai à te rendre ! Je te dois la vie.
PIERRE.
J’ai fait le devoir d’un vassal...
ISABELLE.
Et ta blessure te fait-elle encore souffrir ?
PIERRE.
Je ne m’en ressens plus, grâce à Dieu et au bon père Jean.
ISABELLE.
Quand tu seras tout à fait rétabli, tu seras mon écuyer ; mon père...
PIERRE, avec joie.
Votre écuyer !...
ISABELLE.
Mon père le veut bien, j’en suis bien aise ; et toi ?
PIERRE.
Moi, madame !... Oh ! comment vous exprimerai-je ma reconnaissance ! Je voudrais me battre pour vous... je voudrais verser tout mon sang à votre service.
ISABELLE, souriant.
Je t’en dispense.
PIERRE.
Je me trouve si bien aujourd’hui, madame, que je puis dès à présent commencer mon service.
ISABELLE.
Eh bien ! j’y consens ; je ne te fatiguerai pas. Tu me porteras mon livre à la messe, et, à souper, tu me serviras à boire. Tu connais mon hanap ?
PIERRE.
Oui, madame.
MARION, bas.
Je t’y ai vu boire du vin que tu avais volé.
ISABELLE.
Comme je veux avoir un écuyer bien armé dans ce vilain temps de guerre, voici un poignard de Tolède assez beau ; Montreuil le dit excellent, je te le donne.
PIERRE.
À moi... madame !...
ISABELLE.
Prends encore cette bourse ; je l’ai brodée moi-même ; il y a quelques écus pour t’acheter un pourpoint garni de vair[35] : mais l’heure approche, prends mon livre, et suis-moi à la chapelle.
Elle sort avec Marion.
PIERRE, seul.
Ce poignard... cette bourse qu’elle a faite elle-même... à moi ! Jésus ! Je ne sais si je suis bien éveillé, ou si tout cela va disparaître comme un songe... Non, ce n’est point un rêve, elle me parlait tout à l’heure... Si mes désirs les plus téméraires allaient être exaucés ?... Une sorcière m’a prédit que je commanderais un jour, moi qui suis né pour servir... Une si grande dame !... et moi un misérable serf !...
MARION, rentrant.
Pierre ! Pierre ! Eh bien ! que fais-tu là, immobile comme les saints de la chapelle ?
PIERRE.
Je viens ; me voici.
Ils sortent.
Scène VII
FRÈRE JEAN, FRÈRE IGNACE
L’Abbaye de Saint-Leufroy. La cellule de Frère Jean.
FRÈRE JEAN.
Puisse le tonnerre tomber sur cette abbaye, et brûler tous les cafards qu’elle renferme !
FRÈRE IGNACE.
D’abord, monsieur l’abbé était dans une colère épouvantable ; il ne parlait de rien moins que de vous envoyer au cachot, les fers aux pieds[36].
FRÈRE JEAN.
Qu’il s’en avise ! Il verra s’il me reste encore quelque vigueur.
FRÈRE IGNACE.
Là-dessus, nous nous sommes tous récriés, et frère Goderan a bien montré dans cette occasion combien-il est votre ami ; car il a parlé très vertement à monsieur l’abbé, et n’a pas peu contribué à lui faire changer de résolution.
FRÈRE JEAN.
Oui ! il est bien temps de se montrer mon ami. C’était au chapitre qu’il devait le prouver.
FRÈRE IGNACE.
Quoi qu’il en soit, tout s’est arrangé par notre entremise. Voici ce que nous avons arrêté. Nous avons promis que vous feriez maigre pendant un mois, que vous réciteriez matin et soir les sept psaumes de la pénitence...
FRÈRE JEAN.
Le diable m’emporte si j’y consens jamais !...
FRÈRE IGNACE.
Quant à cela, vous le savez bien, vous n’en ferez que ce que vous voudrez. L’abbé n’ira pas lui-même vous faire réciter vos prières.
FRÈRE JEAN.
Comme cela, à la bonne heure ; cependant il m’en coûte de paraître obéir à cet imbécile.
FRÈRE IGNACE.
La seule chose à laquelle il tienne avec opiniâtreté, c’est que vous lui demandiez pardon à genoux, au milieu du chœur, de votre indiscipline et de votre irréligion...
FRÈRE JEAN, avec fureur.
Moi !... à genoux !
FRÈRE IGNACE.
Il l’exige, et nous vous en supplions.
FRÈRE JEAN.
Me mettre à genoux devant lui... moi, devant ce cafard ?... J’aimerais mieux mettre le feu au couvent, et m’aller faire le chapelain du Loup-Garou !
FRÈRE IGNACE.
Voyez-vous, mon cher ami, il est notre abbé, notre supérieur : il peut nous faire tout le mal qu’il lui plaira.
FRÈRE JEAN.
Maudits soient les imbéciles qui l’ont nommé !
FRÈRE IGNACE.
Hélas ! ce qui est fait est fait. Il n’y faut plus songer. Maintenant il peut vous jeter dans un cul de bassefosse pour le reste de votre vie. Voilà ce qu’il faut vous mettre devant les yeux.
FRÈRE JEAN.
Oh ! si je pouvais un jour me venger !
FRÈRE IGNACE.
Il ne manque pas ici de gens qui vous détestent à cause de votre savoir, et qui pousseront l’abbé à user de rigueur à votre égard. Le parti le plus sage est, selon moi...
FRÈRE JEAN.
Je jetterai ce froc, vertu Dieu ! et je reprendrai la cuirasse.
FRÈRE IGNACE.
On ne sort pas d’ici comme l’on veut, et sans doute vous n’avez pas oublié le sort de ce pauvre Collet, qui avait voulu se défroquer aussi. Tenez, j’ai trouvé un biais pour vous ôter une partie des désagréments de la cérémonie. À l’heure de la prière vous descendrez à l’église, vous vous présenterez devant lui. Moi, je ferai sonner la sonnette, et naturellement vous vous mettrez à genoux ; il sera bien obligé d’en faire autant, de sorte que, si vous lui dites alors deux ou trois mots entre vos dents, l’affaire sera finie, et votre honneur sauf, puisque vous pourrez dire que ce n’est point à cause de lui que vous vous êtes mis à genoux.
FRÈRE JEAN.
Belle invention !
FRÈRE IGNACE.
La prison, le pain de pénitence, les chaînes, la discipline d’un côté ; de l’autre, cette invention qui excite vos mépris. Choisissez ; je vous laisse, et je viendrai tantôt savoir votre résolution. Adieu.
FRÈRE JEAN.
J’ai l’enfer dans le cœur, je ne sais encore ce que je ferai ; mais cependant je vous remercie, Ignace.
Frère Ignace sort.
FRÈRE JEAN, seul.
Il faut que je me venge ou que je meure. Je ne puis plus longtemps souffrir les insultes d’un extravagant.
On frappe à la porte.
Qui vient encore m’importuner ?
UN FRÈRE SERVANT, entrant.
Mon père, quelques vilains du village d’Apremont sont ici, et demandent à vous parler.
FRÈRE JEAN.
Eh ! que me veulent-ils ? Faut-il être dérangé à chaque instant par des marauds qui demandent à se confesser ?
LE FRÈRE SERVANT.
Ils disent qu’ils ont à vous communiquer une affaire importante.
FRÈRE JEAN.
Qu’ils entrent ! Quel ennui ! c’est sans doute un procès qu’ils veulent me faire arranger ; mais il faut ménager le paysan.
Entrent Simon, Morand, Barthélémy, Gaillon, Thomas. Le frère servant sort.
SIMON.
Pardon de la hardiesse, mon révérend père ; mais nous sommes venus ici pour vous confier un grand secret. N’est-ce pas, vous autres, que c’est un grand secret ?
TOUS.
Oui, un grand secret.
FRÈRE JEAN.
Parlez vite, je n’ai pas de temps à perdre.
SIMON.
Ce secret... Tenez, c’est Morand qui va vous le dire.
MORAND.
Non, parle, toi, tu as commencé.
SIMON.
Non, tu diras mieux que moi.
FRÈRE JEAN.
Finirez-vous ? Parle, toi, Morand, et dis-moi ce que vous me voulez.
MORAND.
Mon père, c’est que voilà un homme de Genêts, qui s’appelle Thomas, et qui est le frère de la femme de mon cousin, le charron de Genêts.
FRÈRE JEAN.
Hé bien ?
MORAND.
C’est qu’il vient de Genêts, et il dit comme cela, que tout le monde meurt de faim (vous savez que l’année est mauvaise), et qu’on est enragé.
FRÈRE JEAN, avec impatience.
Hé bien ?
MORAND.
Eh bien ! on est enragé contre monseigneur Philippe de Batefol, le seigneur de Genêts.
SIMON.
Et contre tous les seigneurs généralement.
À part.
C’est hardi d’avoir dit cela.
FRÈRE JEAN, avec une distraction affectée.
Hé bien ?
MORAND.
Eh bien ! je voudrais que vous lui dissiez quelques-unes des belles choses que vous nous avez dites tantôt. Vous savez ? vous nous disiez que « nous étions des lâches de nous laisser maltraiter par des gens qui ne sont ni plus forts ni plus adroits que nous. »
FRÈRE JEAN.
Qu’ai-je besoin de vous répéter ce que vous avez si bien retenu ?
THOMAS.
Tenez, mon père, je vous dirai tout fin, tout net, que, dans notre pays, il y a bien des gens qui frapperaient un bon coup, s’ils avaient quelqu’un pour leur dire : « Frappe ! »
FRÈRE JEAN, à part.
Le nuage va crever.
MORAND.
C’est tout de même chez nous, et à Roseval, à Bernilly, à Lasource, dans tous les villages du Beauvoisis, partout, quoi... On pense que les seigneurs sont pour nous encore pires que les charançons.
FRÈRE JEAN.
C’est-à-dire que vous avez fait une conspiration... que vous avez comploté tous ensemble de vous faire libres ?
SIMON.
C’est cela même. Nous sommes tous du même avis.
FRÈRE JEAN.
Et vous oseriez risquer un coup de lance pour vous faire libres ?
MORAND.
Oui ; depuis qu’ils m’ont pris mes bœufs, je me sens du courage comme un homme d’armes. Je n’ai plus peur d’un coup de lance.
SIMON.
Moi, pourvu que je puisse me venger de ce traître de sénéchal, je veux bien recevoir un coup de lance, ou de n’importe quoi.
TOUS LES PAYSANS.
Oui morbleu, nous oserons donner des coups, et nous ne craindrons pas d’en recevoir.
FRÈRE JEAN.
Vous voilà dans de bonnes dispositions. Mais que voulez-vous de moi ? vous avez pris vos mesures probablement, et il ne m’appartient pas...
SIMON.
Nous sommes bien convenus de nos faits ; mais nous n’avons pas de chef...
MORAND.
C’est un chef qu’il nous faudrait.
THOMAS.
Un homme connu.
BARTHÉLÉMY.
Au fait, si vous vouliez seulement nous diriger... vous qui êtes déjà notre providence ?...
SIMON.
Oui, soyez notre chef.
FRÈRE JEAN.
Je suis moine, mes enfants.
SIMON.
À la bonne heure, mais vous avez porté la cuirasse, vous savez l’alchimie, vous savez lire et écrire, vous êtes le plus savant et le meilleur homme des environs.
MORAND.
Et, malgré tout cela, on vous préfère un cousin de messire d’Apremont. N’est-ce pas une honte qu’il soit abbé à votre place ?
FRÈRE JEAN.
Pouvez-vous compter que beaucoup de vilains vous suivront ?
BARTHÉLÉMY.
Criez tant seulement : Franchise aux vilains ! à bas les seigneurs ! et tout le pays se lèvera.
MORAND.
J’en réponds.
TOUS.
Criez seulement : Franchise ! et vous aurez une armée.
FRÈRE JEAN.
Et vous jurerez à votre chef fidélité et discrétion à toute épreuve ?
SIMON.
Cela va sans dire.
MORAND.
Nous risquons plus que vous.
BARTHÉLÉMY.
Ainsi, vous êtes notre chef. Voilà qui est dit.
FRÈRE JEAN.
Étendez la main vers ce crucifix.
LES PAYSANS.
Nous jurons de vous obéir.
FRÈRE JEAN.
Songez que j’aurais des moyens de punir les parjures, fussent-ils à cent lieues de moi. Voyez-vous ces instruments ?... voyez-vous ces livres ?
MORAND, effrayé.
Ne les ouvrez pas... c’est inutile.
FRÈRE JEAN.
Et vous aurez le courage d’exécuter tout ce que je vous commanderai ?
MORAND.
Nous sommes disposés à tout oser.
THOMAS.
Or çà, mon père, nous vous avons donné notre foi ; ne nous donnerez-vous pas la vôtre ?
FRÈRE JEAN.
Sur ce même crucifix, je jure d’employer tous mes soins, toutes mes ressources à l’affranchissement des serfs du Beauvoisis. Que je sois privé du paradis, si je manque à mon serment !
SIMON.
Maintenant expliquez-nous ce qu’il faut faire.
FRÈRE JEAN.
Il faut que chacun de vous sache précisément de combien d’hommes il peut disposer. La première fois que nous nous réunirons, je veux savoir quelles sont vos forces.
BARTHÉLÉMY.
Cela ne sera pas difficile.
FRÈRE JEAN.
Pourquoi Renaud n’est-il pas avec vous ?
SIMON.
Il ne veut se mêler de rien. Il dit qu’il a ses idées à lui.
FRÈRE JEAN.
Qui de vous a du courage ?
MORAND.
Nous en avons tous.
BARTHÉLÉMY.
Me voici, moi. J’ai jeté la première pierre, le jour où le sénéchal a si bien fait étriller Gaillon... Mais ne le répétez pas.
GAILLON.
Moi aussi, je suis bon pour me battre.
FRÈRE JEAN, avec un peu de mépris.
À merveille, mes enfants. Or donc, je m’en vais charger Barthélémy, qui est si brave, d’un message pour le Loup-Garou.
BARTHÉLÉMY.
Le Loup-Garou ! Jésus ! Maria !
TOUS.
Le Loup-Garou !
FRÈRE JEAN.
Eh quoi ! vous pâlissez déjà, lâches que vous êtes ?
BARTHÉLÉMY.
Mais le Loup-Garou...
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! le Loup-Garou est Chrétien Franque que tu as connu ; as-tu peur de lui ?
BARTHÉLÉMY.
Je n’aurais pas peur de Chrétien Franque, car il était mon ami. Mais il a renoncé à son âme, et il est ensorcelé... Il est loup-garou.
FRÈRE JEAN.
Imbécile ! Franque était un homme de cœur. Il s’est fait libre, et c’est ce que vous n’avez pas le courage de tenter.
BARTHÉLÉMY.
Tenez, donnez-moi un sort pour qu’il ne me charme pas par son regard, et j’irai lui parler.
FRÈRE JEAN.
Le charme que je te donne est ce chapelet. Franque le reconnaîtra. Dis-lui que le père Jean de Saint-Leufroy lui commande de l’attendre cette nuit, trois heures après le couvre-feu, sous le second chêne à partir de la croix Saint-Étienne.
BARTHÉLÉMY, timidement.
Je lui dirai... s’il le faut.
SIMON.
Mais quel besoin de parler au Loup-Garou ?
FRÈRE JEAN.
Il sera pour nous un allié sûr et utile. Je lui ai rendu quelques services, je l’ai guéri d’une maladie, et il se souviendra de moi. – Avez-vous des armes ?
MORAND.
Nous avons presque tous des arcs.
FRÈRE JEAN, prenant de l’argent dans un coffre.
Achetez des armes avec cet argent, je vous le donne. Mais, si vous osiez l’employer à d’autres usages, je ferais fondre ce métal dans vos mains, et il vous brûlerait jusqu’à la moelle.
MORAND.
Foi d’honnêtes gens, nous en achèterons des armes jusqu’au dernier sou.
FRÈRE JEAN.
Achetez-en à Beauvais, le jour du marché ; mais allez chez plusieurs armuriers, de peur d’éveiller les soupçons.
MORAND.
Laissez-nous faire : nous ne sommes pas si bêtes.
SIMON.
Ayez confiance en nous.
FRÈRE JEAN.
Demain j’irai chez Morand après vêpres, et je vous ferai part de mes projets. Adieu, je vous donnerai sans doute des nouvelles de Franque. Pax vobiscum, mes enfants !
LES PAYSANS.
Amen ! Nous nous recommandons à vos prières.
MORAND, aux autres, en sortant.
Je vous disais bien qu’il savait faire de l’or.
Ils sortent.
Scène VIII
ISABELLE, MARION
La chambre d’Isabelle.
MARION, regardant à la fenêtre.
Quel temps affreux ! On ne peut pas sortir, même dans le jardin. Ah ! que je m’ennuie !
ISABELLE.
Eh bien ! ne voilà-t-il pas qu’au lieu de me divertir, tu veux encore que je t’amuse ! Veux-tu bien ne pas bâiller comme cela !
MARION.
Madame, voulez-vous que je vous dise ce qu’il faut faire ? Vous avez un écuyer qui ne vous sert à rien. Faites-le venir : il vous contera des histoires, ou bien il vous lira un fabliau.
ISABELLE.
En effet, Pierre sait lire.
MARION.
Et écrire, madame. C’est notre bon père Jean qui lui a fait part de toute sa clergie. Il écrit, il lit, il joue de la mandore et de la sambuque. En fait de gaie science[37], il en sait autant qu’un ménestrel de Toulouse.
ISABELLE.
Je ne savais pas, en le prenant pour écuyer, avoir fait une si bonne acquisition.
MARION.
Voulez-vous que de votre part je lui dise d’entrer ?
ISABELLE.
Oui, je ne demande pas mieux.
Marion sort et rentre aussitôt suivie de Pierre.
MARION.
Tenez, le voici. Quand on parle du loup... Il était derrière la porte.
ISABELLE.
On dit, Pierre, que tu es un grand clerc.
PIERRE.
Madame a bien de la bonté. Le révérend père Jean s’est plu à m’apprendre quelque chose. J’ai fait de mon mieux pour profiter de ses leçons.
ISABELLE.
Voilà qui est admirable : ah çà ! dis-moi, puisque tu sais tant de choses, peut-être sauras-tu le moyen d’amuser deux filles qui s’ennuient.
PIERRE.
Madame...
MARION.
Amuse-nous tout de suite.
ISABELLE.
Tu as un livre à la main, lis-nous quelque chose.
MARION.
Une histoire gaie, une histoire, là... qui fasse rire.
PIERRE ; après avoir cherché quelque temps dans son livre.
Voulez- vous que je lise le fabliau « de la Damoiselle, du Prêtre et du Vilain ? »
ISABELLE.
Voyons.
PIERRE, faisant semblant de lire.
« Une noble et riche damoiselle était aimée d’un prêtre, d’un chevalier et d’un pauvre vilain...[38] »
ISABELLE.
Restes-en là. Je devine de quelle espèce est ce fabliau. Je n’aime pas que l’on se permette de dire du mal des prêtres.
PIERRE.
Mais, madame, il n’y a rien dans ce fabliau qui...
ISABELLE.
N’importe. L’auteur est un insolent. Jamais un prêtre n’aime comme un laïque. Lis un autre conte ; cependant, je vais tâcher de finir l’écharpe de monsieur de Montreuil.
MARION.
Ah ! madame, les fabliaux sur les moines sont toujours si amusants !
ISABELLE.
Taisez-vous, sotte que vous êtes. Et toi, Pierre, lis-moi une histoire de chevalerie, s’il y en a dans ton livre.
PIERRE, après avoir feuilleté son livre.
Lirai-je l’histoire de Flamme-des-cœurs et de Danain le vilain ?
ISABELLE.
Oui, le titre pique ma curiosité.
PIERRE, hésitant d’abord.
« Il y avait une fois... une haute et puissante dame... douée... d'une si grande beauté... qu'on la nomma Flamme-des-cœurs... Plus de dix chevaliers de la Table ronde étaient morts d'amour... pour elle... ou étaient entrés en religion... car elle était aussi insensible... et dédaigneuse... que jolie et de doux langage... On avait beau rompre pour elle des fagots de lances dans les tournois... »
ISABELLE.
Il lit vraiment assez bien . Pour un vilain c'est incroyable .
PIERRE, se rassurant par degrés.
« ...Dans les tournois, on n'en obtenait pas même un sourire d'encouragement. Sa mère lui présenta en vain plusieurs partis très sortables ; mais elle les refusa tous, disant qu'elle voulait conserver sa liberté... et qu'elle était bien aise d'avoir tant de serviteurs . Ses parents, désolés de cet entêtement, allèrent consulter le fameux Merlin, qui était alors dans le pays. Merlin, après avoir ouvert ses livres de géomance, leur dit d'une voix terrible : Votre fille a refusé tous les nobles hommes de France, le sort la destine à épouser un vilain. En disant ces mots, il monta sur son chariot traîné de quatre dragons bleus, et bientôt il se perdit dans les nuages. Vous jugerez facilement du chagrin des parents, qui étaient d'une grande noblesse. Pour rendre nuls, s'il était possible, les effets de la prophétie, ils enfermèrent Flamme-des-cœurs dans une tour qui avait cent pieds de haut, et qui était ceinte de tous côtés d'un fossé à fond de cuve d'égale profondeur. Ils placèrent aussi dans cette tour trente hommes d'armes, tous gentilshommes et chevaliers bannerets[39] pour la plupart... Or advint que le roi des Turcs, Agimorato, débarqua en Touraine avec deux cent mille soldats, et porta le fer et le feu jusqu'au cœur du royaume. Le roi, touché des plaintes de ses sujets, leva partout des gendarmes, et marcha contre les « vilains Turcs...[40] Il avait dans son armée un archer fort adroit... fils d'un pauvre paysan... nommé Danain... Le sort voulut que la bataille se donnât justement tout contre la tour où Flamme-des-cœurs était renfermée. De prime abord les infidèles nous lancèrent tant de flèches avec leurs arcs de corne de buffle, que l'air en était obscurci, et qu'il n'était ni corselet, ni pavois, ni cuirasse qui n'en fussent traversés. Aussi bientôt, effrayés de cette tempête, gendarmes et archers commencèrent-ils à tourner le dos, et quelques-uns à se sauver jusque dans la tour. Les Turcs, ayant comblé le fossé de corps morts, escaladent la tour, tuent les trente chevaliers, et allaient emmener prisonnière Flamme-des-cœurs, qui poussait des cris affreux...
S'animant.
quand Danain, qui combattait près de là, s'élance dans la tour, une masse d'armes à la main. Où êtes-vous, chevaliers? criait-il . Abandonnerez- vous ainsi Fleur-de-beauté ? Mais nul ne l'écoutait ; chevaliers et écuyers gagnaient la plaine. « Eh bien ! moi seul je la délivrerai . » Alors il charge les Turcs à grands coups de masse. Ils tombent devant lui comme des noix en automne. Il fait fuir ceux qu'il ne tue pas... Il délivre Isabelle...
Se reprenant.
Flamme-des-cœurs ... et... et... délivre le roi, à qui les infidèles allaient couper la tête, et la coupe lui-même au cruel Agimorato. On estime que, dans cette journée, il tua bien mille Sarrasins. Flamme-des-cœurs était cependant sur la plate-forme, témoin de tous ses exploits ; et les flèches qui tombaient quelquefois auprès d'elle ne pouvaient l'empêcher d'avoir toujours les yeux fixés sur Danain. Elle poussait un soupir à chaque rencontre du brave vilain, et toujours un feu secret allait s'allumant dans son cœur. Bref, à la fin du combat, l'insensible était folle de lui. Le roi, pour récompenser Danain, lui permit de choisir parmi toutes les filles du royaume celle qui lui plairait le plus, fût-ce sa propre fille. Mais Danain ne se donna garde d'y penser. Il avait vu Flamme-des-cœurs, et la voir c'était l'aimer. Or il la demanda à ses parents, qui n'osèrent la lui refuser à cause du serment du roi. Il l'épousa donc, et le roi le fit chevalier et lui donna des fiefs . Dans la suite il devint sénéchal de l'Artois, et fut l'ornement de la cour du grand empereur Charles. Il eut de braves fils et de belles filles ; il fut riche et heureux; il fonda des monastères et vécut en odeur de sainteté. Ainsi Dieu récompense ses élus. Amen ! »
ISABELLE.
Et voilà la fin ?
PIERRE.
Oui, madame.
ISABELLE.
Voilà un sot conte. Quel en est l’auteur ?
PIERRE, confus.
Je ne sais.
ISABELLE.
Il est vrai qu’on ne doit pas s’attendre à trouver beaucoup de raison dans un fabliau, mais encore il y a des bornes qu’on ne devrait jamais dépasser. Qui peut avoir l’effronterie de dire qu’une dame noble peut éprouver de l’amour pour un vilain ? Autant vaudrait dire qu’une aigle peut aimer un hibou.
PIERRE.
Vous croyez que c’est impossible ?
ISABELLE.
Il est vrai qu’on ne peut parler que pour soi ; mais le plus bel homme de France et le plus rude champion eût-il tué dix mille Turcs, m’eût-il tirée des mains des Sarrasins ou des griffes de Lucifer ; s’il était vilain, il ne devrait attendre de moi d’autre sentiment que de la reconnaissance.
PIERRE, soupirant.
Je crains d’importuner madame ; je me retire.
ISABELLE.
Attends, donne-moi le livre où sont ces beaux fabliaux.
PIERRE, troublé.
Mon livre ?
ISABELLE.
Oui.
PIERRE,
Madame... mais...
ISABELLE.
Donne-le-moi. – Je le veux. – Pourquoi ce trouble ?
PIERRE, donnant le livre.
Madame... c’est qu’il n’y a rien d’écrit dans mon livre... J’ai fait semblant de lire, et je vous ai raconté une vieille chronique dont je me suis souvenu.
ISABELLE, parcourant le livre.
Vous avez de la mémoire, à ce que je vois... Qu’est-ce que cela ? « Trente mesures d’avoine... paille pour litière... »
PIERRE.
C’est le livre où j’écris la dépense de l’écurie.
ISABELLE.
Ah ! voici des vers, ce me semble.
PIERRE.
Ah ! madame, ne les lisez pas.
ISABELLE, lit en souriant.
« À la plus belle des belles, haute et puissante dame, damoiselle... »
PIERRE, à part.
Je suis perdu !
Elle s’interrompt tout à coup.
ISABELLE, après avoir lu, avec un froid glacial.
Vous faites aussi des vers ? Ils expliquent votre fabliau... Pierre, savez-vous ce qui est advenu à l’écuyer de la comtesse Blanche de Ramel ?
PIERRE.
Non... madame...
ISABELLE.
Allez à Laon... et vous verrez sa tête dans une cage, au-dessus de la porte de Saint-Jacques. – Marion, apporte-moi ma cassette.
Elle l’ouvre et en tire de l’argent.
Pierre, prenez ces vingt florins, quittez cette livrée ; je vous fais libre, et sortez de ces terres.
PIERRE, à genoux.
Madame... au nom du ciel... faites-moi mourir plutôt.
ISABELLE.
Ne répliquez pas. Obéir est le devoir d’un vassal ! Sortez.
Pierre sort.
MARION.
Mais, madame, qu’est-ce donc ?
ISABELLE.
Paix ! – Vit-on jamais semblable hardiesse ! Certes, il faut que j’aie été bien légère dans ma conduite pour qu’un misérable... Quelle humiliation !... J’en pleurerais presque de rage !
MARION.
Madame... est-ce que Pierre par hasard... serait amoureux de vous ?
ISABELLE.
Taisez-vous, impertinente : ne m’importunez pas davantage. – Allez, et, si vous tenez à votre peau, n’ouvrez jamais la bouche sur ce que vous venez d’entendre.
Elles sortent.
Scène IX
FRÈRE JEAN, seul
Un chemin. Il est nuit.
L’heure est passée. Il n’y a pas de confiance à fonder sur cette vile espèce. Je crains de m’être déjà trop compromis, et la soif de la vengeance m’a peut-être aveuglé. Mais j’entends du bruit... Qui va là ?
LE LOUP-GAROU, entrant un chapelet à la main.
Un diable qui dit son chapelet.
FRÈRE JEAN.
C’est la voix de Franque.
LE LOUP-GAROU, grossissant sa voix.
Franque n’est plus parmi les hommes.
FRÈRE JEAN.
Holà ! maître voleur, garde tes contes pour d’autres que pour moi. Crois-tu m’effrayer avec la peau de loup qui te couvre ? et est-il bien brave à toi de venir armé jusqu’aux dents au rendez-vous que te donne un moine en camail ?
LE LOUP-GAROU.
Si mes armes vous effrayent, beau père, je vais les jeter. Je ne veux point vous faire de mal.
FRÈRE JEAN.
Non, garde-les, et parlons d’affaires. Quelle cause t’a fait prendre le genre de vie que tu mènes ?
LE LOUP-GAROU.
Ventre de bœuf ! pourquoi voulez-vous me faire dire ce que vous savez aussi bien que moi ?
FRÈRE JEAN.
On dit que le désir de la vengeance t’a conduit dans les forêts.
LE LOUP-GAROU.
Oui, j’ai juré guerre à mort aux seigneurs.
FRÈRE JEAN.
Ainsi, les ennemis des seigneurs doivent être tes amis.
LE LOUP-GAROU.
Eh ! oui, de par le diable ! Mais où voulez-vous en venir ?
FRÈRE JEAN.
Si bien que si quelques bons garçons s’apprêtaient à jouer un tour aux seigneurs, tu te mettrais volontiers de la partie.
LE LOUP-GAROU.
Faut-il le demander !
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! mon fils, les bonnes gens de ce pays se lassent d’être foulés et volés par leurs seigneurs, et ils ont résolu de se lever contre eux et de s’en défaire une bonne fois.
LE LOUP-GAROU.
Et c’est vous qui me l’annoncez !
FRÈRE JEAN.
Oui, moi-même. Et moi aussi je cherche à me venger.
LE LOUP-GAROU.
Oh bien ! mon père, ne vous fiez pas aux gens de ce pays. Ce n’est qu’un tas de poltrons qui pâlissent à la seule vue d’un éperon doré. Venez plutôt avec nous dans les bois ; vous y trouverez des braves.
FRÈRE JEAN.
Tu sais qu’un poltron poussé à bout devient un héros. Un chat enfermé se laisse donner trois coups de fouet ; au quatrième il vous saute aux yeux.
LE LOUP-GAROU.
Fort bien. Mais enfin quels sont les braves que vous avez ?
FRÈRE JEAN.
Morand, Simon, Gaillon...
LE LOUP-GAROU.
Voilà des chats qui ont besoin de coups de fouet pour se battre, et de bons coups de fouet.
FRÈRE JEAN.
Barthélémy...
LE LOUP-GAROU.
Il a du cœur celui-là.
FRÈRE JEAN.
Thomas de Genêts et une infinité d’autres. Je suis sûr de tous les vilains à deux lieues à la ronde. J’espère avoir Pierre, l’écuyer de madame Isabelle.
LE LOUP-GAROU.
Un coquin qui fait le fier parce qu’il sait lire, et que Gilbert lui a donné une jupe neuve à ses armoiries ! D’un esclave n’attendez rien de bon.
FRÈRE JEAN.
C’est un brave garçon, crois-moi : il peut nous être utile ; il dispose de toutes les clefs du château.
LE LOUP-GAROU.
Vous ne me parlez pas de Renaud.
FRÈRE JEAN.
Renaud ne veut pas encore se joindre à nous. Depuis la mort de sa sœur, il ne veut se mêler de rien. Il passe des journées entière à rêver, la tête cachée dans ses mains. Je crains qu’il ne devienne fou.
LE LOUP-GAROU.
Il faudrait l’avoir.
FRÈRE JEAN.
Une fois la première flèche tirée, il est à nous. Combien as-tu d’hommes sous tes ordres ?
LE LOUP-GAROU.
Soixante et douze, pas davantage ; mais chacun en vaut dix des vôtres. Je vous les donne pour de vrais diables.
FRÈRE JEAN.
Je m’en rapporte à toi pour les avoir choisis. Eh bien ! Franque, mon ami, tu es des nôtres ; mais, pour plus de sûreté, tu vas me donner ta foi, en jurant sur ce crucifix.
LE LOUP-GAROU, reculant.
Doucement, beau-père, je ne jure plus sur un crucifix. Le diable m’emporte si je suis encore chrétien !
FRÈRE JEAN.
Comment ! coquin, que dis-tu là ?
LE LOUP-GAROU.
Oui, le feu Saint-Antoine m’arde ! Je ne crois plus à ce que croient les seigneurs. Il n’y a plus que la sainte Vierge dont je me soucie encore[41].
FRÈRE JEAN.
Cela est fort heureux. Je n’ai pas maintenant le temps de te convertir ; ainsi, donne-moi ta parole, et jure par ce que tu voudras.
LE LOUP-GAROU.
Voici ma main, donnez-moi la vôtre. Ce serment-là en vaut bien un autre, n’est-ce pas ?
FRÈRE JEAN.
Je compte sur toi. Bientôt tu auras de mes nouvelles, et je reviendrai, avec nos amis, tenir conseil au milieu de tes bois.
LE LOUP-GAROU.
Je suis à vous, à toute heure. Adieu.
Ils sortent.
Scène X
PIERRE seul, habillé en paysan
Un chemin près des fossés du château. Il fait nuit.
Je veux les voir encore une fois, ces vieilles tours !... Je suis vilain ; elle est noble ! – Insensé que j’étais ! comment ai-je pu croire ? Élever mes yeux vers celle dont les plus hauts barons de France ambitionnent la main ?... Ces mots qui retentissent encore à mes oreilles, et que j’ai pris pour des paroles d’amour... Elle me parlait comme elle aurait parlé à son chien... Et cette bourse... c’est pour l’or qu’elle me l’a donnée...Et si j’étais admis auprès d’elle quand elle aurait rougi de se trouver avec un noble homme[42], c’est que je n’étais à ses yeux qu’une espèce d’animal sans conséquence... J’étais moins qu’un chien pour elle... j’étais un vilain... Ah ! ce mot me brûle le cœur !... Je voudrais pouvoir faire disparaître de la terre tous ces porteurs d’éperons dorés ! Et le baron de Montreuil ! Ô rage ! qu’il est heureux ! le ciel l’a comblé de ses faveurs ! Il est noble... Il sera son mari... Lui, il est noble, chevalier, banneret... et moi... je suis vilain... Il est noble... et cependant je suis plus ferme que lui sur les arçons... et, si nous baissions nos lances l’un contre l’autre, la mienne saurait bien entrer dans sa visière[43]. Dans un tournois, il a le droit de combattre pour se faire renverser ! moi, je n’ai pas le droit de vaincre[44] ! Montreuil ! lui !... quel chevalier ! Il ne sait ni lire ni écrire ; il ne se connaît qu’en chevaux... Moi je possède la gaie science, mais je suis vilain ! Puissances du ciel, que n’est-il devant moi !
FRÈRE JEAN, entrant.
Holà ! qui êtes-vous qui gesticulez ainsi ?
PIERRE.
À cette voix c’est le père Jean.
FRÈRE JEAN.
C’est toi, Pierre. Que fais-tu ici à cette heure ?
PIERRE.
Je maudis ma destinée, le père qui m’a engendré, et le ciel qui m’a fait naître vilain.
FRÈRE JEAN.
Pierre ! il ya plus d’un homme qui souffre comme toi ; mais ceux qui ont quelque force d’âme n’accusent pas le ciel, ils lui demandent seulement de les aider.
PIERRE.
Mon malheur est sans remède. Je suis chassé du château.
FRÈRE JEAN.
Tu appelles cela un malheur ? tu ne serviras plus.
PIERRE.
Pendant longtemps j’ai cru que je pourrais être heureux dans ce manoir.
FRÈRE JEAN.
Qu’as-tu fait ?
PIERRE.
Maudite soit la science que je tiens de vous ! Je m’en suis enorgueilli ; j’ai oublié que je n’étais qu’un misérable, qu’un chien. – J’ai parlé d’amour à la damoiselle qui habite là.
FRÈRE JEAN.
Sainte Vierge ! trahison au premier chef !
PIERRE.
Je suis chassé, et demain je dois être hors des limites de la baronnie.
FRÈRE JEAN.
Et cette lourde bête qui se fait appeler le baron de Montreuil doit épouser la dame.
PIERRE.
Oh ! ne me dites pas cela !
FRÈRE JEAN.
Ne le sais-tu pas ?
PIERRE.
Oui, je le sais ; mais, quand je l’entends dire, il me prend envie de mettre le feu à ce château.
FRÈRE JEAN.
Cela vaudrait mieux que de s’en aller piteusement comme un coquin.
PIERRE, après un silence.
Pourquoi penser à ces rêves-là ?
FRÈRE JEAN.
Qui te dit que ce sont des rêves ?
PIERRE.
Les vilains ont des cœurs de boue, et ils n’oseraient jamais lever la tête pour demander compte à leurs maîtres des cruels traitements qu’ils endurent.
FRÈRE JEAN.
On m’a dit cependant que quelques hommes courageux s’étaient enfin avisés qu’ils pouvaient par la force se débarrasser de leurs maîtres, et que déjà ils travaillaient à cette œuvre.
PIERRE.
Que dites-vous ?
FRÈRE JEAN.
Si tous les serfs de la baronnie prenaient les armes, si ce château était en feu, si Montreuil avait la tête cassée, si tu tenais dans tes bras madame Isabelle, crois-tu qu’elle pourrait te dire alors : « Retire-toi, vilain ! »
PIERRE.
Vous faites bouillonner mon sang.
FRÈRE JEAN.
Ces nobles sont venus dans ce pays avec le roi Francus[45] ; ils ont vaincu nos pères avec leurs chevaux bardés et leurs armures de fer forgé[46] ; ils nous ont faits esclaves... Mais, si nous reprenions les armes, si nous les attaquions à notre tour, crois-tu que nous ne pourrions pas montrer que notre vieux sang gaulois est aussi bon que le leur ?
PIERRE.
Oui, par saint George ! nous saurions le leur prouver !
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! veux-tu te réunir à ceux qui tenteront cette noble entreprise ?
PIERRE.
Si je le veux ! Disposez de mon corps, de mon âme ! Mais sur quel fondement me dites-vous cela ?
FRÈRE JEAN.
Ce que je dis pourra bien arriver, et peut-être que damoiselle Isabelle d’Apremont deviendra la femme de Pierre Lambron.
PIERRE.
Oh ! de par saint Leufroy ! dites-moi comment cela peut arriver.
FRÈRE JEAN.
Viens avec moi jusqu’à l’abbaye, l’endroit n’est pas sûr. En chemin j’aurai bien des choses à t’apprendre.
Ils sortent.
Scène XI
SIMON, MANCEL, armés de haches, sont assis auprès d’un tas de bois, RENAUD
Un chemin sur la lisière d’une forêt.
RENAUD entre précipitamment, à Simon.
Le voici. Es-tu avec moi, oui ou non ?
SIMON.
Tu ne veux donc point attendre le père Jean ?
RENAUD.
Qui attend l’aide d’autrui compte sans son hôte. Voici ma hache et mon bras, voilà mes vrais amis. Ils ne me tromperont pas.
SIMON.
Seulement, si tu voulais patienter encore une semaine.
RENAUD.
Es-tu avec moi ? Réponds oui ou non.
SIMON.
Eh bien ! oui. Advienne que pourra. On ne dira pas que j’ai laissé mon beau-frère à l’heure du danger.
RENAUD.
Pour toi, Mancel, tu nous as accompagnés sans connaître notre dessein... Tu n’es que le cousin d’Élisabeth... Nous allons nous embarquer dans une aventure périlleuse... Tu peux te retirer, et je t’y invite.
MANCEL.
Simon vient de me dire à peu près ce dont il s’agit. Vous allez courir un danger, je reste.
RENAUD.
Soit ! Voici des crêpes noirs, vous allez vous en couvrir le visage pour n’être pas reconnus.
SIMON.
Mais...
RENAUD.
Faites ce que je dis. Aussitôt que cette affaire sera finie, prenez le chemin de l’étang, et sauvez-vous à toutes jambes au village, où vous ferez les empressés comme si vous aviez fort à faire dans vos maisons. Ne vous embarrassez pas de moi.
SIMON, regardant du côté du chemin.
Renaud, il y a un homme avec lui.
RENAUD.
Oui, un moine.
MANCEL, bas.
Diable, est-ce qu’il faut le tuer aussi ?
RENAUD.
Non ; c’est Dieu qui lui a envoyé ce prêtre.
SIMON.
Pour le sauver.
RENAUD.
Pour l’exhorter à la mort. Dieu ne veut pas que je tue son âme.
SIMON.
Et si nous sommes reconnus par le prêtre ?
RENAUD.
Il ne pourrait vous reconnaître sous les crêpes dont vous allez vous couvrir.
À Simon.
Ta hache est aiguisée, n’est-ce pas ?
SIMON.
Oui.
RENAUD, à Mancel.
Et la tienne ?
MANCEL.
Oui.
RENAUD.
Ne frappez que s’il fait résistance. – Empêchez seulement le prêtre de fuir. – Moi, je tuerai le sénéchal.
SIMON.
Notre-Dame, soyez-nous en aide !
RENAUD.
Mettez-vous derrière ce tas de bois pour qu’ils ne voient pas vos crêpes noirs. Aussitôt que j’aurai mis la main sur l’épée du sénéchal, venez à moi. – Ils sont entrés dans l’allée. Les voici.
Entrent le sénéchal et l’abbé Honoré. Renaud aiguise sa hache, comme s’il venait de couper du bois.
LE SÉNÉCHAL, à l’abbé.
Quant à ces arbres que vous dites à vous, nous avons un titre qui prouve les droits de monseigneur.
L’ABBÉ.
Sénéchal, vous vous trompez, et vous avez été bien prompt à les faire abattre. Ils ont été donnés à l’abbaye par Eustache d’Apremont, le grand-père de Gilbert.
Renaud, voyant le sénéchal auprès de lui, lui arrache son épée. Simon et Mancel accourent la hache levée.
RENAUD.
À mort, sénéchal !
LE SÉNÉCHAL.
Ah ! traître !
L’ABBÉ.
À l’aide ! au secours !
SIMON, déguisant sa voix.
Si tu pousses un cri, tu es mort !
L’ABBÉ.
Ayez pitié de nous !
RENAUD.
Sénéchal, il faut mourir. As-tu entendu la messe ce matin ?
LE SÉNÉCHAL.
C’est toi, Renaud ! Ne tue pas un homme désarmé. Prends ma bourse, et laisse-moi la vie.
RENAUD.
C’est ton sang qu’il me faut !
LE SÉNÉCHAL.
Que t’ai-je fait ?
RENAUD.
Souviens-toi d’Élisabeth.
Montrant l’abbé.
Voici ton confesseur ; prépare-toi.
LE SÉNÉCHAL.
Je te ferai libre, si tu me donnes la vie, je te le jure...
RENAUD.
Le soleil baisse. Vois l’ombre de ce bouleau ; quand elle touchera cette pierre, tu mourras.
LE SÉNÉCHAL, à l’abbé.
Mon père, priez-le de m’épargner.
RENAUD.
Pense à ton âme. – Camarades, retirons-nous à quelque distance, pour qu’il puisse se confesser, s’il veut mourir en chrétien.
LE SÉNÉCHAL, à l’abbé.
Mon père, essayez de les toucher.
L’ABBÉ.
Je puis à peine parler... Mes genoux ne peuvent me soutenir.
LE SÉNÉCHAL, à Simon et à Mancel.
Au nom du ciel ! mes amis... ayez pitié de nous... Vous êtes humains, j’en suis sûr.
L’ABBÉ.
Si vous êtes chrétiens, ne le tuez pas.
LE SÉNÉCHAL, à l’abbé.
Menacez-les de les excommunier.
L’ABBÉ.
Je n’ose ; ils me tueraient peut-être.
LE SÉNÉCHAL.
Si vous m’assassinez, le baron d’Apremont vengera ma mort. S’il ne peut vous découvrir, il fera décimer le village, et peut-être que le sort tombera sur vos pères, sur vos frères, sur vos enfants... L’abbé que voici vous excommuniera...
L’ABBÉ.
Que dites-vous, sénéchal ?... Messeigneurs, je n’ai rien dit.
RENAUD.
L’ombre approche de la pierre.
LE SÉNÉCHAL.
Barbares ! vous avez le cœur plus dur que cette pierre. Quoi ! rien que ma mort ne peut vous satisfaire ? Je vous jure que, si vous me laissez la vie, je quitterai le pays, ou je me ferai moine, si vous l’aimez mieux... Je donnerai tous mes biens pour fonder un hôpital... Mais au nom de la sainte Mère de Dieu !...
RENAUD, levant sa hache.
L’ombre est sur la pierre.
LE SÉNÉCHAL, embrassant l’abbé.
Miséricorde !... Renaud, ayez pitié !... Mon père ! mon père !
L’ABBÉ.
Ne me tuez pas, mes bons amis ! ne me tuez pas, je ne vous ai rien fait !
RENAUD, frappant le sénéchal.
Va dans l’enfer ! Tu verras Élisabeth dans le sein d’Abraham.
LE SÉNÉCHAL.
Jésus ! Notre-Dame de bon secours !...
Il meurt.
L’ABBÉ, à genoux.
Notre-Dame de Beauvais, venez à mon aide !
À Renaud.
Monseigneur... je suis sûr que vous n’avez point à vous plaindre de moi.
SIMON, bas à Renaud.
Il sait ton nom ; sauve-toi auprès du Loup-Garou.
RENAUD.
Non ; tu as entendu ce qu’il a dit : le village serait décimé si le meurtrier n’était point connu.
Il parle bas à Simon et à Mancel.
L’ABBÉ, toujours à genoux.
Monseigneur saint Leufroy, si vous me faites cette grâce que je puisse rentrer ce soir dans votre abbaye sain et sans blessure, je fais vœu de vous donner la plus belle robe de brocart qui se puisse trouver en Flandre.
SIMON, pleurant, à Renaud.
Mon pauvre ami !
RENAUD.
Sauvez-vous, le temps presse.
SIMON.
Donne-moi ta main.
RENAUD.
Adieu, et toi aussi, Mancel... Si quelque jour...
Il parle bas.
alors ne m’oubliez pas.
SIMON.
Jamais nous ne t’oublierons.
RENAUD.
Adieu donc ! – Ah ! écoutez ;
Bas.
Mon chien... prenez-en soin.
Haut.
Adieu, galants, remerciez le Loup-Garou du bon secours qu’il m’a donné.
SIMON et MANCEL.
Adieu, la fleur des braves !
Ils sortent en courant.
RENAUD.
Eh bien ! mon père...
L’ABBÉ.
Je suis ecclésiastique, voyez ma tonsure, monsieur le Loup-Garou ; vous commettriez un grand crime en touchant une personne consacrée au Seigneur... – Ah ! Dieu, que fait-il ?
RENAUD, après avoir coupé la tête du sénéchal qu’il prend à la main.
Ton corps sera traité comme celui d’un assassin.
À l’abbé.
Marchons !
L’ABBÉ.
Grâce ! grâce ! monsieur le Loup-Garou, ne m’emmenez pas dans votre caverne.
RENAUD.
Nous allons au château d’Apremont.
L’ABBÉ.
Au château !...
RENAUD.
Venez avec moi.
L’ABBÉ.
Jésus ! Maria ! je ne puis marcher !
RENAUD.
Prenez mon bras.
L’ABBÉ.
Ô ciel !... Je marcherai bien tout seul... Monseigneur saint Leufroy, intercédez, s’il vous plaît, pour l’abbé de votre abbaye[47] !
Ils sortent.
Scène XII
L’ÉCUYER DE SIWARD, BROWN, EUSTACHE DE LANCIGNAC, PERDUCAS D’ACUÑA
Une salle du château de Siward.
L’ÉCUYER.
Décidez-vous promptement, chevaliers. J’ai promis à monseigneur de lui rapporter aujourd’hui même votre réponse.
EUSTACHE.
Dix mille francs, dis-tu ?
L’ÉCUYER.
Dix mille francs.
EUSTACHE.
Dix mille fièvres tierces puissent le serrer, ce chien d’Apremont ! A-t-on jamais demandé dix mille francs pour la rançon d’un pauvre capitaine d’aventure qui n’a pour tout bien que sa lance et son cheval ?
PERDUCAS.
J’en ai été quitte pour cinq cents florins avec le sire de Maulevrier, qui cependant aime les espèces autant qu’un autre.
BROWN.
Le capitaine doit savoir que nous n’avons pas ici dix mille francs à jeter par la fenêtre.
L’ÉCUYER, à Brown.
Mais il espérait que ses deux nobles amis se joindraient à vous et feraient quelque chose pour l’aider dans sa mésaventure.
PERDUCAS.
Par saint Jacques ! j’aime Siward ; c’est une bonne lance, un bon compagnon ; mais dix mille francs, c’est diablement cher.
L’ÉCUYER.
C’est pour cela qu’il s’adresse à vous.
BROWN.
Mort Dieu que ne m’en croyait il quand je lui criais de faire retraite ! mais il veut toujours en faire à sa tête !
L’ÉCUYER, à Perducas et à Eustache.
Mon maître pense que si vous vouliez lui prêter chacun mille écus...
PERDUCAS.
Comment ! mille écus ! mille écus ! mais c’est trois mille francs !
BROWN.
Tout autant.
EUSTACHE.
L’année est mauvaise ; les scélérats cachent leur argent je ne sais où. On ne trouve ici rien à faire.
PERDUCAS.
Ma troupe est nombreuse, et je crains d’être forcé, faute d’argent, d’en congédier la moitié.
BROWN.
Et moi, il faut que je paye mes archers.
EUSTACHE.
Pierre d’Estouteville, ce vieux ribaud, m’a gagné avant-hier deux mille francs au jeu.
PERDUCAS.
À propos de perte, vous savez bien, mon cheval fleur de pêcher ?
EUSTACHE.
Oui.
PERDUCAS.
Dans ma dernière chevauchée du côté de Laon, un gros coquin de meunier dont nous emmenions les bœufs, lui a donné un coup de fourche dans le grasset. La pauvre bête s’est abattue, je n’ai pu la relever, et cependant le drôle a redoublé sur moi aidé de deux de ses pareils. Sainte Vierge ! c’est qu’ils frappaient sur mon dos comme sur une enclume ! Heureusement mes gens sont venus, sans quoi ces vilains me faussaient mon armure.
EUSTACHE.
Et Chandos ? n’était-ce pas le nom de votre cheval ?
PERDUCAS.
Que voulez-vous ? il n’y avait pas de remède. Je l’ai fait écorcher, et l’on me tanne sa peau pour m’en faire une selle. Ah ! ce pauvre Chandos, je le regretterai longtemps !
L’ÉCUYER.
Il est sans doute malheureux de perdre un bon cheval de bataille ; mais, pour en revenir au sujet qui m’amène ici, le seigneur d’Apremont a proposé à messire Siward de lui rabattre cinq mille francs sur sa rançon s’il consentait à le servir pendant une année avec sa compagnie[48]. Dans le cas où je ne pourrais me procurer de l’argent, mon maître m’a chargé de vous demander, messire Brown, si la proposition vous convenait.
EUSTACHE.
Ah ! voilà un accommodement.
PERDUCAS.
Cinq mille francs, c’est bien peu pour une année.
L’ÉCUYER.
Hé bien, maître Brown ?
BROWN.
D’abord, c’est se moquer que de compter pour cinq mille francs les services de toute une compagnie comme la nôtre ; ensuite je sais comment se font en pareil cas les partages de butin : d’Apremont aurait tout, nous rien. Enfin les trêves finissent dans six mois, et de véritables Anglais comme nous ne peuvent s’engager pour un an au service d’un baron français.
EUSTACHE.
Cependant Siward paraît consentir à cet arrangement.
BROWN.
Oh ! le capitaine peut faire ce qu’il lui plaira : qu’il engage sa lance et celle des gendarmes qui voudront le suivre. Quant à moi, s’il se met au service du duc de Normandie[49], ou de ses barons, j’irai trouver messire Jean Chandos, sous qui j’ai combattu à Poitiers ; mes archers me suivront, et le capitaine Siward connaîtra alors ce qu’on peut faire sans archers. Quand même il aurait avec lui tous ses gendarmes, je lui garantis que, sans archers, il ne gagnera pas mille francs dans son année.
L’ÉCUYER.
C’est là votre réponse, beau sire ?
BROWN.
Oui, gentil écuyer. J’en suis fâché pour le capitaine ; mais je ne sais qu’y faire. Si quelque jour nous attrapons un baron français, nous ferons un échange.
PERDUCAS.
Pauvre Siward ! Ainsi, il reste en cage.
EUSTACHE.
Du moins, le traite-t-on bien ?
L’ÉCUYER.
En chevalier prisonnier ; c’est tout dire. Le baron d’Apremont est un noble seigneur ; sa cuisine est assez bonne, et son vin vaut encore mieux que celui que nous buvions ici.
EUSTACHE.
Alors je le plains moins.
PERDUCAS.
Dis-lui, pour le consoler, que je lui achèterai son guilledin alezan, s’il veut le vendre. Je lui en donnerai jusqu’à six cents francs[50].
EUSTACHE.
Et moi, j’irai fourrager chez Gilbert d’Apremont. Il verra que je n’oublie pas mes amis.
L’ÉCUYER.
Il sera bien sensible à cette preuve d’amitié. Pas d’argent, c’est votre dernier mot ?
PERDUCAS.
Corps du Christ ! il n’y a plus d’argent en France depuis la bataille de Poitiers.
BROWN.
Allons, messieurs ; occupons-nous de cette chevauchée que nous devons faire en commun ; et, comme rien n’est meilleur pour ouvrir les idées qu’un verre de bon vin, allons dans la salle à manger, et là, les coudes sur la table, devant les bouteilles, nous arrêterons nos plans de campagne.
À l’écuyer.
L’ami, veux-tu venir avec nous boire à la santé de ton maître ?
L’ÉCUYER.
Non, je ne puis. Il m’attend, et la traite est longue d’ici au château d’Apremont.
BROWN.
Bon voyage, donc !
PERDUCAS.
Mes amitiés à Siward. N’oublie pas surtout le guilledin alezan. Six cents francs : retiens bien...
EUSTACHE.
Allons vider quelques bouteilles, et puis à cheval.
Ils sortent.
Scène XIII
GILBERT D’APREMONT, DE MONTREUIL, SIWARD, L’ABBÉ HONORÉ, CONRAD D’APREMONT, UN PROCUREUR, HOMMES D’ARMES et PAYSANS
La grande salle du château d’Apremont.
D’APREMONT.
Prenez place, messire de Siward, pourvu que cela vous amuse. Vous verrez comme nous rendons la justice en France.
SIWARD.
Volontiers ; je suis bien aise de voir la mine d’un si hardi coquin.
Ils s’assoient.
CONRAD, à Gilbert d’Apremont.
Papa, n’est-ce pas qu’on lui donnera la question ?
D’APREMONT.
Nous verrons cela.
CONRAD.
On lui donnera la question !
D’APREMONT.
Eh bien ! commençons.
À quelques hommes d’armes.
Vous, amenez l’assassin.
Entre Renaud enchaîné.
SIWARD.
Un gaillard bien découplé, ma foi ! de larges épaules, l’air assuré ! Il aurait bonne grâce, un arc à la main et une trousse au côté[51].
D’APREMONT.
Te voilà, misérable ! Tu oses encore lever les yeux !
DE MONTREUIL.
On voit bien, à sa mine, de quels crimes il est capable.
L’ABBÉ.
Sa vue me donne la fièvre.
D’APREMONT, après avoir parlé bas au procureur.
Réponds, brigand ; quel démon t’a poussé à assassiner si méchamment notre bon sénéchal ?
RENAUD.
Je vous l’ai déjà dit. Il avait fait mourir ma sœur.
D’APREMONT.
Est-ce là une raison pour qu’un vassal ose lever la main sur son maître ?
RENAUD.
Oui, pour moi.
D’APREMONT.
Il se glorifie de son crime ! Y a-t-il un châtiment assez rigoureux pour un tel scélérat ? Tu baisses la tête maintenant. Tu essayes de pleurer. Oui, je te le conseille, feins un peu le repentir avec moi ; tu vas voir où cela te mènera.
RENAUD.
Je ne me repens point.
D’APREMONT.
Comment ! infâme, tu ne te repens pas ! Pourquoi donc es-tu venu te livrer à notre justice ?
RENAUD.
J’avais peur que des innocents ne fussent punis pour un seul coupable. Vous auriez peut-être fait décimer le village, ou bien on aurait donné la question aux femmes et aux enfants, comme cela s’est fait, l’année dernière, au Bourg-Neuf. Je me suis livré pour éviter ce malheur.
DE MONTREUIL.
L’imbécile !
D’APREMONT, bas à Siward.
Je suis presque honteux de voir à ce misérable plus de courage que n’en ont certains gentilshommes !
L’ABBÉ.
Il est possédé !
DE MONTREUIL, à Siward.
Avez-vous en Angleterre des coquins de cette espèce ?
SIWARD.
Par la lance de saint George ! l’audace du drôle me plaît. Je voudrais qu’il fût Anglais et l’un de mes gendarmes.
L’ABBÉ, bas.
Qui se ressemble s’assemble.
LE PROCUREUR, à d’Apremont.
Monseigneur, avec votre permission, il serait opportun de lui demander s’il avait des complices.
RENAUD.
J’en avais deux.
D’APREMONT.
Nomme-les.
RENAUD.
Je ne le puis.
D’APREMONT.
Sais-tu que j’ai le moyen de te faire parler ?
CONRAD.
Ah ! ah ! on va lui donner la question.
DE MONTREUIL.
Tais-toi, nous allons voir.
D’APREMONT.
As-tu fait tes réflexions ? me les nommeras-tu ?
RENAUD.
Comment le pourrais-je ? les deux hommes qui m’ont aidé sont des gens du Loup-Garou ; je ne les connais point.
D’APREMONT.
Je puis te faire donner la question.
RENAUD.
Je ne pourrai vous en dire davantage.
L’ABBÉ.
Les deux hommes qui l’ont aidé dans ce meurtre détestable étaient tout noirs comme des diables, et, en effet, il leur a dit quelques mots pour le Loup-Garou.
D’APREMONT.
Qu’a-t-il dit, cousin ?
L’ABBÉ.
J’étais si troublé que je n’ai rien entendu.
D’APREMONT, levant les épaules.
Au fait, vous n’êtes point obligé par profession d’avoir du courage.
À Renaud.
Qu’as-tu dit ?
RENAUD.
J’ai prié ces deux hommes de remercier leur chef, le Loup-Garou.
D’APREMONT.
Et comment connais-tu le bandit qui se fait appeler le Loup-Garou ?
RENAUD.
Je l’ai rencontré un jour dans les bois. J’étais affligé de la mort de ma sœur. Je lui ai demandé de m’aider dans la vengeance que je méditais. Il me la promis, et m’a donné deux de ses gens.
D’APREMONT.
Où est le Loup-Garou maintenant ?
RENAUD.
Je ne sais. On dit qu’il ne campe jamais deux nuits de suite au même endroit.
D’APREMONT.
Cela est vrai.
Au procureur.
Maître Hugues, que dis-tu de cela ?
LE PROCUREUR.
L’affaire est claire, monseigneur ; il avoue le meurtre, il désigne ses complices : les témoins corroborent ses réponses. Il n’y a plus qu’à prononcer la peine.
D’APREMONT.
Ainsi, il n’y a point lieu à lui donner la question ?
LE PROCUREUR.
Si monseigneur le veut, il le peut certainement ; mais cet homme a dit tout ce qu’il était nécessaire de savoir.
D’APREMONT.
À la bonne heure.
CONRAD.
Comment ! papa, est-ce qu’on ne le mettra pas à la question ? on m’avait dit qu’on lui donnerait l’estrapade.
D’APREMONT.
Tais-toi, petit vaurien. Va tirer de l’arc dans la cour, au lieu de passer ton temps assis sur une chaise, ici, où tu n’as que faire. – Hé bien, maître Hugues, comment ferons-nous mourir ce coquin ?
LE PROCUREUR.
Monseigneur, en de tels cas la coutume veut que le coupable soit pendu après avoir eu le poing et la langue coupés.
DE MONTREUIL.
On devrait le brûler vif.
CONRAD.
Ah ! oui, je n’ai jamais vu brûler vif.
LE PROCUREUR.
Cela n’est pas l’usage.
L’ABBÉ.
Comment, le brûler vif ! et que feriez-vous donc à celui qui aurait tué un ecclésiastique ?
D’APREMONT.
Mon cousin l’abbé a raison ; il soutient toujours les privilèges du clergé. – Maîtres Hugues, arrange la sentence à ta mode. Ce misérable a du cœur. Je ne puis me défendre de quelque pitié. D’ailleurs, je n’aime pas à faire souffrir inutilement une créature de Dieu. Quand j’ai couru longtemps un brave sanglier qui s’est bien défendu, qui m’a éventré plus d’un chien, je tâche de lui plonger mon épieu dans le cœur pour l’abattre d’un seul coup. Cet homme a tué mon sénéchal ; il sera pendu, mais je ne veux point qu’on le démembre avant de le faire mourir.
RENAUD.
Monseigneur, je vous remercie humblement.
D’APREMONT.
Nous verrons si tu conserveras ton beau sang-froid quand tu monteras à l’échelle.
Entre un écuyer tranchant.
L’ÉCUYER.
Monseigneur, le garde de messire Philippe de Batefol vient d’apporter un beau cerf gras que son maître vous envoie en présent. Madame Isabelle demande comment vous voulez qu’on l’accommode.
D’APREMONT.
Demande à ces messieurs.
SIWARD.
Est-il gras ?
L’ÉCUYER.
Un pouce et demi de graisse sous la peau.
SIWARD.
Le filet à la broche. Je ne connais pas de meilleur rôti quand la bête est grasse.
DE MONTREUIL.
Vous avez raison, et il faut avec cela une sauce verte et force épices.
CONRAD.
Je veux avoir le pied du cerf pour faire un manche de fouet.
D’APREMONT.
Tu ne le mérites pas, car tu sais à peine te tenir à cheval.
CONRAD.
Ce n’est pas pour monter à cheval, c’est pour fouetter les chiens.
D’APREMONT.
Allons, finissons-en ; qu’on emmène l’homme. Je mettrai mon sceau au jugement quand le clerc l’aura écrit.
RENAUD.
Monseigneur, faites-moi la grâce de m’accorder un confesseur.
D’APREMONT.
Un confesseur ? Et qu’en feras-tu, damné brigand ? Espères-tu te réconcilier avec le ciel ?
L’ABBÉ.
Beau cousin, à tout péché miséricorde. Cet homme conserve encore quelque respect pour les gens d’Église, on ne peut lui refuser un confesseur.
D’APREMONT.
Une heure avant d’avoir affaire à maître Claude le coupe-tête, on t’enverra l’aumônier du château.
RENAUD.
J’aimerais mieux le révérend père Jean, si vous l’aviez pour agréable.
D’APREMONT.
Je remarque que tous les vauriens de ce pays connaissent le père Jean et se confessent à lui.
L’ABBÉ.
Hélas ! il faut le dire, le père Jean n’est pas un sujet d’édification pour la communauté.
D’APREMONT.
C’est dans un de ses sermons qu’il aura soufflé à ce vilain l’idée diabolique de tuer mon sénéchal.
RENAUD.
Je n’ai pris conseil que de moi-même.
D’APREMONT.
Sire abbé, si j’étais à votre place, je surveillerais de près la conduite de ce moine. Il est toujours fourré parmi les vilains, et je doute fort qu’il les instruise dans l’obéissance féodale.
À Renaud.
Pour toi, tu auras le frater du château ; trop heureux qu’on prenne quelque souci d’une âme comme la tienne. – Quel jour se tient le marché ?
LE PROCUREUR.
Jeudi prochain.
D’APREMONT.
Eh bien ! prépare-toi pour jeudi, fils de Barrabas ! Qu’on l’emmène !
Renaud sort.
CONRAD.
Elle n’est guère amusante, la justice féodale. Je m’en vais à la cuisine chercher le pied du cerf.
D’APREMONT.
Va dire au sommelier qu’il monte quatre bouteilles de vin d’Espagne. Cela va bien avec la venaison.
SIWARD.
Petit, dis qu’on en monte plutôt six que quatre.
D’APREMONT.
Six ?... à la bonne heure ; vous êtes un dur compagnon, messire Siward.
Scène XIV
SIWARD, UN PAGE
Une autre salle du château d’Apremont.
LE PAGE, auprès de la fenêtre.
Tout cela, jusqu’au clocher là-bas, est à monseigneur.
SIWARD.
C’est une belle baronnie, ma foi ! Et c’est ce petit garçon si gourmand qui héritera de tout cela ?
LE PAGE.
Oui, monseigneur.
SIWARD.
Quel dommage que la damoiselle de céans ne soit pas fille unique ! ce serait une dot de princesse.
LE PAGE.
Oh ! pour sa dot, elle sera belle, je vous en réponds. Sa grand’mère lui a laissé dans l’Artois un beau fief qui rapporte, m’a-t-on dit, plus de dix mille florins.
SIWARD.
Et ces dix mille bons florins et la demoiselle sont destinés, dit-on, à ce gros joufflu à la plume verte ? Par saint George ! je connais un homme à qui ils iraient mieux.
LE PAGE.
Messire de Montreuil aura beaucoup de bien du côté de son oncle.
SIWARD.
Tant pis, car il n’en saura pas faire un noble usage : c’est un ladre vert.
LE PAGE.
Monseigneur, il faut que je vous quitte pour aller à mon service.
SIWARD, lui donnant de l’argent.
Grand merci, mon garçon. Tiens, voici pour boire à ma santé.
Le page sort.
Dix mille florins de rente ! voilà de quoi entretenir une belle compagnie ! Si Gilbert s’unissait à moi, nous ferions la loi à tout le Beauvoisis. Lui mort, tout serait à moi ; car ce petit imbécile...
Entrent Isabelle et Marion.
ISABELLE.
Beau sire, vous regardez tristement par la fenêtre ; vous semblez soupirer pour quitter nos vieilles murailles et chevaucher encore dans ce beau pays à la tête de vos gendarmes.
SIWARD.
Non, belle damoiselle, je ne pensais pas à mes gendarmes ; je songeais combien il me serait doux de chevaucher par cette plaine, un épervier sur le poing, en compagnie de madame Isabelle.
ISABELLE.
C’est un plaisir qu’il n’est pas difficile de vous procurer. Mon père ne veut point priver ses prisonniers d’aucun des passe-temps qui peuvent adoucir l’ennui de leur captivité.
SIWARD.
Par ma foi ! la prison est douce avec si gentil geôlier.
ISABELLE.
Et aurons-nous longtemps l’honneur de vous garder, monseigneur ?
SIWARD.
Je crois que j’aurai quelque temps encore le bonheur d’être auprès de vous, car je ne puis m’entendre avec votre père. Il me demande une rançon de roi, et ma bourse avec celle de mes amis ne peut y suffire.
ISABELLE.
Ah ! monseigneur, si les damoiselles d’Angleterre savaient votre prison, je suis sûre qu’elles vendraient bagues et épingles d’or pour délivrer messire Siward.
SIWARD.
Si les damoiselles d’Angleterre avaient vu la châtelaine qui me tient prisonnier, elles penseraient que je les ai oubliées.
ISABELLE.
Comment, sire chevalier, n’avez-vous pas su leur donner une meilleure idée de votre constance ?
SIWARD.
Eh ! madame, quel Amadis pourrait être constant en voyant vos beaux yeux ! Toute la Table ronde...
ISABELLE.
Ah ! trêve de flatteries ! Je vous reconnais là, messieurs les capitaines d’aventures ; quand vous ne pouvez plus courir le pays, emmenant bœufs et chevaux, alors vous nous faites la grâce de penser à nous autres, pauvres damoiselles, et vous tâchez de nous amorcer par vos paroles courtoises.
SIWARD.
Hélas ! pauvres chevaliers d’aventures ! tout le monde nous en veut ! Les dames se rient de nous, parce que chevauchant en toute saison, le bassinet sur la tête, nous n’avons pas le temps d’apprendre la douce langue d’amour. Les chevaliers qui se couvrent plus souvent de soie que de fer gagnent le cœur des belles, qu’ils n’oseraient nous disputer la lance au poing.
ISABELLE.
Pour la langue d’amour, messire Siward, vous montrez assez que vous avez eu le temps de l’apprendre.
SIWARD.
Plût au ciel que je pusse vous paraître éloquent !
ISABELLE.
Brisons, là, monseigneur. Vous savez que je suis fiancée, et je n’aurais pas dû prêter l’oreille à tous les doux propos que vous venez de me conter.
SIWARD.
Fiancée ! Mais est-ce un engagement irrévocable ?
ISABELLE.
Irrévocable ? pas tout à fait.
SIWARD, à part.
Ville gagnée !
Haut.
Se pourrait-il ?...
ISABELLE.
Je puis le rompre... mais à une petite condition...
SIWARD.
Quelle est-elle ? Parlez, de par Notre-Dame !
ISABELLE.
C’est que, si je n’épousais pas le sire de Montreuil, mon fief en Artois, qui fait tout mon bien, cesserait de m’appartenir.
SIWARD, à part.
Diable !
ISABELLE.
Qu’avez-vous, monseigneur ? Vous semblez un peu... interdit.
SIWARD.
C’est... que... l’on est bien malheureux... de... de... C’est une singulière condition... – Il me semble que l’on dine bien tard aujourd’hui. Il me tarde de goûter de la venaison que l’on vient de vous envoyer.
ISABELLE.
Dans un moment la cloche va sonner.
SIWARD.
Je vois messire d’Apremont qui traverse la galerie... je crois qu’il me fait signe de venir.
Il sort.
ISABELLE.
Ah ! ah ! ah ! voilà sa courtoisie disparue. Le conte que je lui ai fait a coupé court le fil de ses compliments.
MARION.
Voilà bien un fier chevalier, pour prétendre à la main d’une damoiselle possédant un noble fief ! Un capitaine de voleurs qui n’a pour tout bien qu’un cheval et une vieille armure !
ISABELLE.
Tais-toi ; messire Siward est un gentilhomme, et ce n’est pas à toi à en dire du mal.
MARION.
Lui, gentilhomme ! Il l’est comme tous les malandrins ses pareils, qui se fabriquent des armoiries aussitôt qu’ils ont rassemblé dix coquins armés. Ma foi, j’aimerais mieux pour serviteur ce pauvre Pierre que vous avez chassé.
ISABELLE.
Je croyais avoir défendu que l’on me parlât davantage de cet homme.
Elles sortent.
Scène XV
FRÈRE JEAN, SIMON, MANCEL, BARTHÉLÉMY, THOMAS, MORAND, GAILLON, LE LOUP-GAROU, PAYSANS, VOLEURS
Une clairière dans une forêt, avec un grand chêne au milieu. Il est nuit.
LE LOUP-GAROU, à Frère Jean.
À tout seigneur tout honneur. Révérend père, asseyez-vous sous ce chêne, sur cette botte de paille. Cela ne vaut pas un beau fauteuil sculpté, comme il y en a dans votre abbaye ; mais c’est tout ce que nous avons à vous offrir.
Aux autres.
Quant à vous, je vous invite à faire comme moi.
Il s’assied par terre, tous s’assoient de même.
Ne craignez pas d’être surpris ; j’ai posté moi-même des loups qui feront bonne guette ; bien habile qui les mettrait en défaut.
FRÈRE JEAN.
Mes très chers enfants et mes très chers compatriotes, je vous ai réunis dans ce lieu pour que nous convenions de la manière dont il nous faut agir. J’invite chacun à donner son avis, et à déclarer franchement son opinion. Avant tout, cependant, sachons un peu ce qu’ont fait les bonnes gens des autres villages. – Où en sont nos amis de Genêts ?
THOMAS.
Très révérend père, et vous tous, mes seigneurs et amis, ce que j’ai à vous dire, c’est que tous les honnêtes gens de Genêts, vilains et manants, sont prêts à tordre le cou à messire Philippe de Batefol, et à vous donner un coup de main, si besoin est, pour en faire de même chez vous. Demandez plutôt à ces trois hommes que voilà, et qui sont de Genêts, si je vous ai menti d’un mot.
TROIS PAYSANS.
Pour cela, oui ; c’est vrai que nous aurons du plaisir à lui tordre le cou.
FRÈRE JEAN.
Avez-vous des armes ?
THOMAS.
À peu près autant qu’il nous en faut. J’ai acheté quelques épées et des piques, et tout cela est caché dans un trou, sous un rocher, bien enveloppé, de peur de la rouille.
FRÈRE JEAN.
Voilà qui est bien.
À d’autres paysans.
Vous autres, vous êtes de Bernilly, je crois, et vous, de Lasource ; vous...
UN PAYSAN.
Nous sommes de Val-au-Cormier.
FRÈRE JEAN.
Quelles nouvelles nous donnerez-vous ?
UN PAYSAN.
Tout est prêt, les chefs sont choisis. Nous ferons le coup quand vous voudrez.
SECOND PAYSAN.
Nous avons des armes.
TROISIÈME PAYSAN.
Dites-nous le jour, et nous marcherons.
FRÈRE JEAN.
À ce qu’il me paraît, vous êtes tous disposés à bien faire. Or donc, avisons au meilleur moyen de nous défaire des barons et des seigneurs de ce pays. – Quelqu’un a-t-il un avis à proposer ?
LE LOUP-GAROU, se levant.
Loups... je veux dire mes amis, vous savez tous que le château d’Apremont est le plus fort du Beauvoisis. Nous autres gens de ce fief, nous avons la besogne la plus difficile sur les bras, et il me semble que vous autres, qui n’avez qu’un ou deux hommes à tuer, et une maison sans défense à brûler, vous devez nous prêter la main pour prendre le château d’Apremont.
THOMAS.
Aussi ferons-nous ; et si vous voulez cent hommes de chez nous, vous n’avez qu’à parler.
SIMON.
Tout cela s’arrangera tantôt ; mais ce qu’il faut savoir, c’est comment nous nous y prendrons pour entrer dans ce château-là, et quel jour ?
MORAND.
Il me semble, mon révérend père... et toute la compagnie, que je salue... il me semble qu’il vaut mieux attendre encore quelque temps, jusqu’à ce que tous les vilains du Beauvoisis soient entrés dans notre ligue. Au moins alors nous saurions notre force...
LE LOUP-GAROU.
Par la tête-dieu ! pourquoi attendre plus longtemps ? Nous sommes assez nombreux, commençons ; les autres auront du cœur, quand ils verront le bel exemple que nous leur aurons donné. Ainsi, haut la masse, tue, assomme ! voilà mon avis.
SIMON.
D’ailleurs, mes bons messieurs, un homme que vous aimez tous, Renaud d’Apremont, mon beau-frère, est en prison, sur le point d’être justicié : ce serait une honte à nous de le laisser mourir sans secours.
BARTHÉLÉMY.
Oui, Renaud mérite bien qu’on fasse quelque chose pour lui.
MANCEL.
Vous connaissez tous sa conduite généreuse. Après avoir tué le méchant sénéchal, il s’est livré pour que les gens de son pays ne fussent pas décimés ou mis à la gêne.
LE LOUP-GAROU.
C’est cela un luron, corps d’un bœuf ! et rien que pour le délivrer nous ferions bien d’assommer tous les nobles hommes de France. – Or sus, prenons nos armes dès demain, allons tous au château, tâchons d’enfoncer les portes, et...
MORAND.
Oui-dà, as-tu oublié la garde et le pont-levis ?
BARTHÉLÉMY.
Si, la nuit prochaine, nous essayions de surprendre...
MORAND.
Il faudrait des échelles pour escalader le mur, et nous n’en avons point.
GAILLON.
J’ai bien une échelle pour monter à notre grenier. Je la prêterai volontiers.
MORAND.
Imbécile ! ton échelle n’a pas quinze pieds, et les murs en ont plus de quarante.
BARTHÉLÉMY.
Alors, par le sang de Notre-Dame ! faisons tous des échelles ; coupons des gaules...
MORAND.
Comment empêcher qu’on ne s’en aperçoive ?
SIMON.
Et puis nous n’en avons pas le temps. Renaud sera exécuté jeudi, le jour du marché.
BARTHÉLÉMY.
Alors le diable m’emporte si je sais comment faire !
LE LOUP-GAROU.
Si Gilbert ou sa fille sortaient, nous pourrions peut-être...
FRÈRE JEAN.
Vous dites que Renaud doit être exécuté jeudi ?
SIMON.
Jeudi.
FRÈRE JEAN.
Sur la place du marché ?
SIMON.
Sur la place du marché. On dresse maintenant la potence.
FRÈRE JEAN.
C’est jeudi qu’il faut le délivrer. Il sera sur la place gardé par une vingtaine d’hommes d’armes tout au plus. Gilbert, sans doute, sera présent à l’exécution. Il aime de tels spectacles. L’occasion sera belle : en plaine, cent contre un ; le succès n’est pas douteux.
LE LOUP-GAROU.
Voilà ce qu’il y a de mieux à faire, et c’est notre père Jean qui l’a trouvé !
FRÈRE JEAN.
Aussitôt que les hommes d’armes auront passé le pont-levis, cent d’entre vous qui se seront cachés derrière la maison de Morand, courront aux barrières, et sans doute il ne sera pas difficile de les forcer, dans le premier moment de surprise. En tout cas, nous nous saisirons de Gilbert ; et une fois qu’il sera dans nos mains, le château sera bientôt à nous.
SIMON.
Et nous délivrerons Renaud. Tous. Le père Jean a raison ; il dit bien.
BARTHÉLÉMY.
Je me charge, si vous voulez, d’aller assaillir les barrières.
FRÈRE JEAN.
Bon. – Morand, tu seras avec lui, et avec Pierre, qui va venir ici tout à l’heure. Il connaît le château, il vous servira de guide. – Toi, Franque, tu te tiendras sur la lisière du bois avec tes braves loups, prêts à paraître au premier signal.
LE LOUP-GAROU.
Vous ne m’attendrez pas longtemps.
FRÈRE JEAN.
Thomas vous partirez de Genêts de grand matin avec vos cent hommes. Comme ce sera jour de marché, votre nombre n’excitera pas de soupçons. – Cachez vos armes dans des charrettes de paille. –
À d’autres paysans.
Vous, restez et chargez-vous de Philippe de Batefol ; et ne manquez pas d’allumer sur votre clocher un feu de fagots en signe de victoire.
UN PAYSAN.
J’aiguise ma cognée tous les jours, je ne le manquerai pas.
FRÈRE JEAN.
Vous, bonnes gens de Lasource, de Bernilly et de Val-au-Cornier, envoyez-nous vos braves, et faites main basse chez vous sur tout ce qui porte une jupe armoriée. N’oubliez pas non plus de nous apprendre vos succès en allumant des feux sur les endroits élevés.
UN AUTRE PAYSAN.
Je viendrai, mon frère restera.
UN AUTRE PAYSAN.
Je viendrai avec une soixantaine de gaillards déterminés.
MORAND, se levant.
Chut ! j’entends du bruit. Nous sommes découverts !
LE LOUP-GAROU.
Poltron ! ne vois-tu pas que c’est un de mes loups ?
MORAND.
Oui, mais il y a d’autres hommes avec lui.
FRÈRE JEAN.
C’est Pierre, ce sont nos amis. Je les ai envoyés acheter des armes à Beauvais, et ils nous les apportent.
Entre Pierre avec des paysans portant des armes.
PIERRE.
Tenez, voilà de quoi armer la plus nombreuse compagnie de France.
FRÈRE JEAN, à Pierre.
Quelles nouvelles de Beauvais ?
PIERRE.
Messire Enguerrand de Boussies n’a pas plus de quarante lances et de cent archers ; il ne pourra rien entreprendre contre nous.
FRÈRE JEAN.
A-t-on paru surpris de te voir acheter tant d’armes ?
PIERRE.
Nullement. J’en ai souvent acheté pour monseigneur. D’ailleurs, tout le monde se pourvoit à cause des aventuriers et des voleurs qui désolent le pays.
LE LOUP-GAROU, bas à son lieutenant.
Ce gendarme cassé a une figure qui ne me revient pas.
FRÈRE JEAN.
Tout se dispose pour la fête... Jeudi sera le jour...
MORAND, bas à Frère Jean.
Êtes-vous sûr de Pierre ?
FRÈRE JEAN, bas.
Comme de moi-même.
Haut.
Pierre, combien d’hommes y a-t-il de garde à la porte du château ?
PIERRE.
Jamais plus de dix. La moitié est toujours désarmée, couchée sur les bancs, à dormir ou à jouer.
FRÈRE JEAN, aux autres.
Vous l’entendez ? – Pierre, tu iras avec cent de ces braves gens t’emparer de la porte et du pont-levis, pendant que nous délivrerons Renaud. Je t’expliquerai mon plan plus en détail.
PIERRE.
Surtout, mes amis, jurez-moi de ne point faire de mal aux femmes. Pas la moindre insulte à ces...
LE LOUP-GAROU, brusquement.
Que dit-il, ce valet de Gilbert ? Tout ce qui est noble est condamné.
PIERRE.
Oui, condamné par toi, loup enragé ; mais heureusement que tous ces braves gens ne te ressemblent pas.
LE LOUP-GAROU.
Mon beau ménestrel, je m’en vais te faire chanter une chanson, et je battrai la mesure sur ta tête avec cette masse.
PIERRE, tirant son épée.
Viens ici, scélérat !
FRÈRE JEAN.
Arrête, Franque ; que signifie ce débat dans une assemblée comme la nôtre ? Ne savez-vous pas que la damoiselle d’Apremont est une bonne et charitable dame ? Ya-t-il ici quelqu’un qui dise le contraire ?
LES PAYSANS.
Personne, personne ! Malheur à qui fera tomber un cheveu de sa tête !
LE LOUP-GAROU.
À la bonne heure, passe pour celle-là ; mais allons rondement en besogne !
Il se rassied ; Pierre remet son épée dans le fourreau.
MORAND.
Nous allons nous embarquer dans une grande entreprise ; il faudrait donner un nom à notre troupe.
LE LOUP-GAROU.
Morand a raison, et j’avais quelque chose à vous dire là-dessus. Mes amis, vous savez que j’ai été le premier à faire la guerre aux seigneurs ; ainsi, j’aurais quelque droit à donner un nom à notre ligue. Je pourrais vous proposer de vous appeler les Loups ; c’est un nom déjà illustre, mais cela pourrait faire des jalousies parmi nous. Ainsi, prenons un autre nom. Appelons-nous la Compagnie des ours enragés, par exemple, ou la Compagnie de la mort ; cela fera un bon effet, avec une bannière noire et deux potences blanches dessus.
PIERRE.
Quelle horreur ! vraie bannière de brigands !
LE LOUP-GAROU.
Pierre, il faut absolument que je te fasse une saignée ; tu es trop vif pour que nous puissions causer tranquillement ensemble.
FRÈRE JEAN.
Paix ! encore une fois, je vous l’ordonne. Les noms que nous propose notre ami Franque ne peuvent convenir à une cause aussi sainte. Que voulons-nous ? – être délivrés de la tyrannie des seigneurs, former des communes franches. Appelons-nous donc la Ligue des communes ; et pour cri, quel nom pourrait être meilleur que celui de monsieur saint Leufroy, le patron de ce pays ?
PAYSANS.
Oui ! oui ! Communes ! Leufroy ! Leufroy !
LE LOUP-GAROU.
Un nom de saint ! cela fait pitié.
PAYSANS.
Communes ! Franchise ! Leufroy ! Leufroy !
LE LOUP-GAROU.
Eh bien ! Leufroy ! à la bonne heure ; il y a encore manière de faire valoir ce cri-là. Leufroy ! Leufroy ! Tue ! tue ! Leufroy !
FRÈRE JEAN.
Qui de vous sait donner du cor ?
GAILLON.
Je m’y entends passablement, mon père, et mes pourceaux (Dieu soit avec nous !) reconnaîtraient mon cor d’une demi-lieue.
FRÈRE JEAN.
Bien. Tu sonneras quand je t’en donnerai l’ordre. – Franque, tu accourras à ce signal ; Pierre, Barthélémy, vous attaquerez la porte.
TOUS.
Amen.
MORAND.
L’étoile du matin se lève ; nous aurons à peine le temps de rentrer chez nous.
FRÈRE JEAN.
Un moment encore, mes amis ; j’ai vu avec douleur des signes de discorde dans nos rangs. D’eux d’entre vous, tous deux braves et dévoués au bien public, semblent conserver un souvenir fâcheux de quelques paroles trop vives échangées dans un moment de colère. L’union avant tout, mes enfants. Avant de nous séparer, que Pierre et Franque se touchent dans la main comme deux frères.
PIERRE.
Moi !...
TOUS.
Oui, qu’ils soient amis.
LE LOUP-GAROU.
À la bonne heure ! mais qu’il se défasse de ses airs de gentilhomme.
PIERRE.
Et toi, de tes airs de...
FRÈRE JEAN.
Çà, qu’on se donne la main, et que tout soit oublié.
Pierre et le Loup-Garou se donnent la main.
LE LOUP-GAROU, à Pierre.
Tu as une petite menotte blanche comme la main d’une femme.
PIERRE.
Ta main est bien rouge, Loup-Garou.
LE LOUP-GAROU.
Je m’en vante.
FRÈRE JEAN.
Avant de quitter ce lieu, jurons de nous trouver fidèlement sur la place du marché, jeudi, après prime.
TOUS, étendant la main.
Nous le jurons !
FRÈRE JEAN.
Que la bénédiction de Dieu et de monseigneur saint Leufroy soit avec vous ! Jeudi nous serons réunis pour ne plus nous séparer.
Ils sortent.
Scène XVI
FRÈRE JEAN, PIERRE
La cellule de Frère Jean, dans l’abbaye de Saint-Leufroy.
PIERRE.
Je n’aime pas ce mélange parmi nos conjurés. Encore si vous n’aviez que des hommes doux et humains comme Simon et Morand, mais cet ivrogne de Gaillon, et surtout ce Franque !... je ne puis penser sans frémir à toutes les atrocités qu’il a commises ; d’ailleurs n’a-t-il pas renié son Dieu, aussi bien que toute sa troupe ?
FRÈRE JEAN.
Franque avait été gravement offensé : sa vengeance a été terrible, je le sais, mais enfin c’était une vengeance. Et puis, dans un temps comme celui-ci, il ne faut pas être trop scrupuleux. Franque a du cœur et un bon bras. Son secours n’est pas à dédaigner.
PIERRE.
Quand tous ces bandits vont se trouver les maîtres, ils seront pires que des bêtes féroces.
FRÈRE JEAN.
Ne suis-je pas leur chef, et crois-tu que je ne saurai pas me faire obéir ? C’est pour les retenir que j’ai consenti à me mettre à leur tête.
PIERRE.
Fasse le ciel que vous en veniez à bout !
FRÈRE JEAN.
Pensons d’abord à faire réussir notre entreprise. On va sonner pour prime. Aide-moi à passer cette cotte de maille et ma robe par-dessus. Cette messe sera la dernière que j’entendrai... ici du moins. Toi, va m’attendre sur la place ; avec cette barbe et ce manteau, personne ne pourra te reconnaître.
PIERRE.
La cloche sonne. Jamais mon cœur n’a battu si fort à l’approche d’un danger.
FRÈRE JEAN.
Il n’y a plus à reculer. Ce soir nous serons libres ou pendus. Quant à moi, je ferai mes efforts pour ne pas être pendu. Imite-moi, et songe à la récompense qui t’attend.
PIERRE.
Jésus !
La cloche sonne.
FRÈRE JEAN.
Adieu. Au sortir de l’église je te rejoins.
Ils sortent.
Scène XVII
SIMON, MORAND, MANCEL, BARTHÉLÉMY, FOULE DE PAYSANS
La place du marché du village d’Apremont. Une potence est dressée. On aperçoit le château à quelque distance.
BARTHÉLÉMY, à Morand.
Tu es bien pâle, l’ami ; as-tu peur ?
MORAND.
Le père Jean ne vient pas.
SIMON.
Gaillon est allé le chercher.
MORAND.
Sais-tu si l’on a des nouvelles de Thomas ?
BARTHÉLÉMY.
Voici des charrettes qui enfilent la grande rue. Ce sont nos gens.
MANCEL.
Barthélémy, tu devrais déjà être à ton poste avec Morand.
MORAND.
Attendons encore un peu. Personne ne sort du château, je crains qu’ils ne se doutent de quelque chose.
BARTHÉLÉMY.
Garde tes idées pour toi, et n’effraye pas les autres. Il ne s’agit pas ici de faire le poltron...
MANCEL.
Le beffroi n’a pas encore sonné. Il n’y a rien à craindre.
GAILLON, entrant.
Le révérend père me suit de près. On dit que monseigneur a la goutte, et qu’il n’assistera pas à l’exécution.
MORAND.
Diable ! cela change l’affaire.
BARTHÉLÉMY.
Pas du tout. Nous irons le chercher dans son lit, et le guérir de la goutte.
MORAND.
Parle plus bas, de grâce.
MANCEL.
Regarde, Simon, n’est-ce pas Thomas de Genêts qui est monté sur cette charrette, là-bas ?
SIMON.
C’est lui, ma foi, et il a la mine d’avoir fait un beau coup dans son pays. Je m’en vais lui parler.
Il sort le beffroi sonne.
MORAND, se signant.
Sainte Vierge ! voici le beffroi qui sonne pour l’exécution.
BARTHÉLÉMY.
Je voudrais savoir à quoi pense Renaud dans ce moment-ci. Je parie qu’il ne se doute guère...
MORAND.
Chut ! – Le pont-levis se baisse.
FRÈRE JEAN, entrant, bas.
Hé bien, mes enfants, chacun est-il prêt ?
BARTHÉLÉMY, entr’ouvrant sa casaque et montrant une poignée d’épée.
Voyez-vous ce bel outil ?
FRÈRE JEAN.
Bon, cache-le encore quelques instants.
MORAND.
Voici la procession qui descend.
FRÈRE JEAN.
Allons ; à ton poste, Barthélémy ! Au premier son du cor...
BARTHÉLÉMY.
Oui, oui.
FRÈRE JEAN.
Morand, suis-le.
MORAND.
Donnez-moi votre bénédiction, mon père.
FRÈRE JEAN.
Va, ne crains rien, monsieur saint Leufroy nous aidera.
MORAND.
Amen !
BARTHÉLÉMY.
Et Pierre, où est-il ?
FRÈRE JEAN.
Là-bas, caché dans son manteau ; il te fait signe.
Morand et Barthélémy sortent.
MANCEL, à Frère Jean.
Voyez-vous, mon père, cette fumée là-bas ! ce sont nos amis de Lasource.
FRÈRE JEAN.
Bien ! bien !
SIMON, entrant.
J’ai vu Thomas, révérend père. Messire de Batefol...
Il passe sa main sur son cou.
FRÈRE JEAN.
Bien !
SIMON.
Thomas a vu en chemin le Loup-Garou ; il est prêt, l’arc bandé, la flèche encochée.
FRÈRE JEAN, à Simon.
Tu as la voix forte, tu pousseras le premier cri. – Gaillon, as-tu ton cornet ?
GAILLON.
Le voici. J’ai bu bouteille ce matin pour me préparer le gosier.
MANCEL, à Frère Jean.
Mon père, encore une autre fumée !
UN PAYSAN, entrant, à Frère Jean.
Tout est bâclé chez nous, nous venons vous aider.
FRÈRE JEAN.
Paix ! le moment approche.
Entre Thomas conduisant une charrette de paille.
THOMAS.
Qui veut acheter ma paille ? cette charrette-là vaut de l’argent.
SIMON.
Un bout de lance passe ; je vais le renfoncer.
Entrent Montreuil, Siward, Conrad, son précepteur, tous quatre à cheval, Renaud, le bourreau, un crieur, hommes d’armes.
MONTREUIL.
Place !
CONRAD.
Place, canaille !
LE PRÉCEPTEUR.
Place à monseigneur Conrad d’Apremont !
SIWARD, montrant Thomas.
Ce vilain a une bonne idée. Du haut de sa charrette il est placé à merveille pour voir l’exécution.
CONRAD, riant.
Ah ! ah ! ah ! si on mettait le feu à cette paille pendant que ce vilain est étendu dessus, comme cela le ferait gigoter.
LE PRÉCEPTEUR.
Ah ! la drôle d’idée ! Monseigneur, vous êtes un espiègle ; mais, monseigneur, ne voyez-vous pas que cette paille appartient sans doute à monsieur votre père, et si vous la brûliez vous détruiriez ainsi votre propre bien.
CONRAD.
Bah ! cela m’est égal. Je donnerais bien toute cette paille pour voir la mine de ce vilain quand il se sentirait flamber...
LE CRIEUR.
« De par haut et puissant seigneur, noble homme, messire Gilbert baron d’Apremont, on fait savoir à tous qu’il appartiendra, la grande justice qui va être faite sur la personne de Renaud, serf et vassal du fief d’Apremont, atteint et convaincu d’homicide sur la personne de messire Thomas Gatigny, sénéchal dudit messire Gilbert, baron d’Apremont. Or, voyez et profitez de l’exemple. »
RENAUD, sur l’échafaud.
Je vous prie tous, gens de ce village, de prier pour le salut de mon âme.
FRÈRE JEAN.
Allons, Gaillon, sonne fort ! Leufroy !
SIMON et MANCEL.
Leufroy ! Franchise aux communes ! Leufroy !
Gaillon sonne du cor, tous les paysans répètent le cri. Les uns attaquent les hommes d’armes qui sont sur l’échafaud, les autres prennent les armes cachées sous la paille des charrettes. Entrent le Loup-Garou et ses gens. Tumulte général.
MONTREUIL.
Les vilains se révoltent, courons au château.
Il sort au galop.
THOMAS, saisissant Conrad.
Arrête, petit vipereau ; tu payeras pour ton père.
CONRAD.
Oh ! mes amis, ne me faites pas de mal.
À son précepteur.
Mon ami, défendez-moi.
LE PRÉCEPTEUR.
Épargnez le noble sang d’Apremont.
THOMAS.
Tiens, voilà pour le sang d’Apremont.
Il tue Conrad.
LE LOUP-GAROU.
Tiens aussi, toi ; accompagne-le chez le diable !
Il tue le précepteur, on renverse l’échafaud, et Renaud est délivré.
SIMON, à Renaud.
Enfin, mon garçon, je te revois ! embrasse-moi encore.
MANCEL.
Tiens, prends cette arbalète, et viens avec nous.
Il faut en découdre. Ils sortent tous les trois du côté du château.
SIWARD, entouré de paysans armés.
Holà, messieurs ! Je ne suis point parent de messire Gilbert. Je suis son ennemi capital, et de plus son prisonnier, à moins que vous ne vouliez me délivrer.
UN PAYSAN.
À mort ! c’est un gentilhomme.
SECOND PAYSAN.
Tuez-le ! c’est un malandrin.
TROISIÈME PAYSAN.
Demandons au père Jean, ce qu’il faut en faire ?
À Frère Jean.
Révérend père, voici un homme qui se dit prisonnier de Gilbert d’Apremont ; faut-il le tuer ?
FRÈRE JEAN, à Siward.
Qui êtes-vous ?
SIWARD.
Mon nom est François Siward. Je suis Anglais, et j’étais prisonnier du baron d’Apremont.
FRÈRE JEAN.
Vous commandez une compagnie de gendarmes... une compagnie d’aventure ?
SIWARD.
Je...
FRÈRE JEAN.
Je le sais. –
Aux paysans.
Ne lui faites point de mal. Que deux hommes le gardent pendant que nous irons à l’assaut. Allons, mes enfants, suivez-moi !
Rentrent Barthélémy, Pierre, Morand, Simon.
BARTHÉLÉMY, à Morand.
Lâche ! imbécile ! c’est ta faute.
MORAND.
Tu as joué des jambes tout comme moi.
PIERRE.
Si vous aviez poussé en avant comme je vous le disais, cela ne serait pas arrivé.
FRÈRE JEAN.
Qu’y a-t-il ? Pourquoi revenez-vous ainsi ?
BARTHÉLÉMY, montrant Morand.
Nous avons manqué le château par sa faute.
LE LOUP-GAROU.
Tenez ! vous êtes tous des lâches, excepté Barthélémy et Pierre. – Nous étions déjà sur le pont-levis, quand ces misérables ont vu ce gros bœuf de Montreuil revenir au château avec une demi-douzaine de gendarmes, courant tous à bride abattue. Les voilà qui perdent la tête, ils se culbutent les uns sur les autres, c’est à qui fuira le plus vite. Bref, le pont-levis a été levé, et peu s’en est fallu que nous ne fussions pris.
PIERRE.
Et Montreuil est rentré avec ses hommes.
FRÈRE JEAN.
Consolons-nous, mes enfants ; dans quelques jours le château tombera entre nos mains. Il faut l’entourer de toutes parts, et bien prendre garde qu’il n’y entre des vivres. – Messire Siward, avancez ; je veux vous parler.
SIWARD.
Rendez-moi la liberté, vous voyez bien que je fais ainsi que vous la guerre au sire d’Apremont.
FRÈRE JEAN.
Eh bien, capitaine ! en supposant que nous vous mettions en liberté, serez-vous assez galant chevalier pour ne pas oublier ce bienfait ?
SIWARD.
Vous n’avez qu’à me dire comment vous voulez que je le reconnaisse.
FRÈRE JEAN.
Les gens de ce pays ont pris les armes pour recouvrer leurs franchises, et se venger des cruautés des barons, et surtout de Gilbert, votre ennemi. Nous vous verrions avec plaisir faire cause commune avec nous, et joindre vos gendarmes à nos archers. Vous savez que les seigneurs de ce pays sont riches ; le butin se partagera loyalement.
SIWARD.
Par saint Georges ! c’est parler, cela. J’allais vous offrir mes services. Je pars à l’instant ; et demain mon pennon sera planté sur cette place, à côté de vos enseignes.
FRÈRE JEAN.
Donnez-moi donc votre main.
Aux paysans.
Enfants, voici un ami de plus. Le brave capitaine Siward se joint à nous !
PIERRE, à part.
Encore une recrue de l’espèce du Loup-Garou.
FRÈRE JEAN.
Capitaine, attendez encore pour partir ; je veux vous consulter sur le siège. – Barthélémy, allez vous poster en face des barrières ; lancez vos flèches sur tout ce qui se présentera. – Qu’on allume un grand feu pour répondre aux signaux de nos amis. Pierre, va-t’en montrer à ces braves gens comment on fait des fascines. Il faut en couper dans le bois pour combler le fossé. – Ne perdons pas de temps ; que les femmes et les enfants apportent de la terre, des pierres, que chacun mette la main à l’œuvre.
Bas au Loup-Garou.
Toi, va au couvent avec tes loups ; tu connais mes intentions.
LE LOUP-GAROU.
Oui, oui. Tonsuré ou non, peu m’importe.
Il sort.
SIWARD.
Voici une douzaine de gendarmes morts, cela est très bon pour combler un fossé.
THOMAS.
Allons, faisons-les sauter.
SIWARD.
Prenez-moi des portes et des tables, et faites-vous-en des pavois contre les flèches ; et voulez-vous que je vous enseigne un bon tour à jouer à Gilbert ? Prenez du chanvre, trempez-le dans la poix, entortillez-en la pointe de vos flèches, et lancez-moi cela tout allumé sur l’écurie du château ; il y a force fourrage, cela fera un beau feu...
FRÈRE JEAN.
Il a raison. Vite ! vite en besogne !
UN PAYSAN, présentant une tête à Frère Jean.
Voici la tête de messire Philippe de Batefol.
FRÈRE JEAN.
Bien, plante-la sur un pieu en face du château.
SIWARD.
Philippe de Batefol ! Par l’épée de Roland, j’en suis bien aise. Ce scélérat a fait pendre un de mes archers.
UN PAYSAN, à Frère Jean, en lui présentant une tête de femme.
Voyez cette tête, mon révérend, c’est celle de la dame de Bernilly. Les beaux cheveux ! en voulez-vous pour faire un chasse-mouche ?
FRÈRE JEAN.
Fi ! cela est dégoûtant. Cette chevelure est tout ensanglantée.
SIWARD.
C’est dommage, elle n’était pas encore trop laide. Bah ! il en restera toujours assez pour les honnêtes gens.
FRÈRE JEAN.
Allons au bord du fossé ; capitaine, faisons notre ronde, et donnez-moi votre avis.
Ils sortent.
Scène XVIII
L’ABBÉ HONORÉ, à genoux devant la chasse de saint Leufroy, FRÈRE IGNACE, FRÈRE GODERAN, MOINES, TROUPE DE VILAINS, vassaux de l’abbaye
Une cour Intérieure du couvent de Saint-Leufroy. La Porte est fermée avec soin. On voit un tas d’armes de toute espèce[52].
FRÈRE IGNACE, aux vilains.
Allons, mes enfants, du courage ! défendez ceux qui vous donnent du pain, aidez-nous à repousser les scélérats qui se sont révoltés contre leurs seigneurs.
FRÈRE GODERAN, aux vilains.
Çà, prenez des armes : en voici de toute espèce, et servez-vous-en en braves.
FRÈRE IGNACE.
Oui, ils se conduiront en gens de cœur, j’en réponds. N’est-ce pas, mes enfants, que vous défendrez nos saintes reliques et cette sainte maison jusqu’à la dernière goutte de votre sang ?
FRÈRE GODERAN, bas à Frère Ignace.
Ils ne répondent pas.
FRÈRE IGNACE, aux vilains.
Je vous demande, mes enfants, si vous voulez nous défendre ? D’ailleurs, notre ami, le sire d’Apremont, aura bientôt fait justice de tous les rebelles, et cette abbaye n’aura rien à craindre.
QUELQUES VILAINS.
Oui, nous vous défendrons.
D’AUTRES VILAINS, entre eux, bas.
Gilbert d’Apremont est mort. – Ils l’ont tué.
FRÈRE IGNACE, bas à l’abbé.
Sire abbé, parlez-leur aussi. Exhortez-les à bien faire leur devoir.
L’abbé ne répond pas et paraît absorbé dans la contemplation des reliques.
Je vous dis, sire abbé, qu’il faut leur parler ; qui sait jusqu’où peut aller cette révolte ?
Pensez donc que ces vilains vont se battre pour nous : il faut les encourager.
À part.
Il est sourd. – L’imbécile ! Va, tu auras beau prier devant ce coffret que j’ai fait avec Jean, il ne te sauvera pas.
FRÈRE GODERAN.
Sulpice.ne vient pas. Il était allé à la découverte ; je crains quelque malheur.
FRÈRE IGNACE.
Il faudrait écrire au gouverneur de Beauvais, messire Enguerrand de Boussies, pour qu’il nous envoyât quelques gendarmes.
UN VILAIN, à un de ses camarades.
Jean, prête-moi ton couteau.
DEUXIÈME VILAIN.
Tiens. Qu’en veux-tu faire ?
PREMIER VILAIN.
Couper la corde de cette arbalète. Cela fera que je ne pourrai pas m’en servir.
FRÈRE IGNACE.
Hé bien, mes enfants ! êtes-vous tous armés à votre goût ? Voici des piques encore. Prenez-les.
TROISIÈME VILAIN.
Cette pique est toute vermoulue.
FRÈRE IGNACE.
Prends-en une autre. Tiens, celle-ci !
TROISIÈME VILAIN.
Celle-là a le fer tout tortu.
FRÈRE IGNACE.
Elle peut servir.
PREMIER VILAIN.
Mon arbalète n’a pas de corde.
FRÈRE IGNACE.
Va chercher une corde, et dépêche.
DEUXIÈME VILAIN.
La mienne n’a pas de corde non plus.
QUATRIÈME VILAIN.
Je m’en vais en chercher une neuve.
PLUSIEURS VILAINS.
Et moi aussi.
Ils s’avancent vers la porte.
FRÈRE IGNACE, se mettant devant eux.
Doucement, mes maîtres, où voulez-vous aller ?
LES VILAINS.
À nos maisons prendre de meilleures armes.
FRÈRE IGNACE.
Non, restez, mes enfants ; celles que vous avez sont bonnes, et d’ailleurs vous n’en aurez pas besoin avec l’aide de Dieu et de monsieur saint Leufroy.
On frappe violemment à la porte.
L’ABBÉ, se levant avec effroi.
Ah ! mon Dieu ! Saint Leufroy, adjuva nos !
FRÈRE IGNACE.
Qui est là ?
VOIX dehors.
Ouvrez, je suis Sulpice.
FRÈRE IGNACE.
Ouvrez vite.
À Frère Sulpice qui entre tout effaré.
Hé bien, qu’y a-t-il ?
FRÈRE SULPICE.
Ah ! mes amis !...
FRÈRE IGNACE.
Parlez bas.
FRÈRE SULPICE, aux vilains.
Tout va bien ! tout va bien, mes amis ! le sire d’Apremont les a défaits.
LES VILAINS.
Vivent saint Leufroy et nos nobles seigneurs !
Frère Sulpice s’approche de l’abbé, tous les moines l’entourent. Les vilains restent dans le fond.
FRÈRE SULPICE.
Tout est perdu. Les paysans sont révoltés. Messire d’Apremont est tué, m’a-t-on dit. Tout le Beauvoisis est en armes contre la noblesse.
FRÈRE GODERAN.
Alors ils ne nous en veulent pas, à nous autres ?
FRÈRE IGNACE.
Dieu le veuille !
FRÈRE SULPICE.
Mais ce qui est plus horrible, ce qui est à peine croyable, c’est que le frère Jean, le trésorier de cette abbaye, est, dit-on, à la tête des rebelles.
FRÈRE IGNACE et FRÈRE GODERAN.
Le frère Jean !
L’ABBÉ.
L’impie, l’antéchrist ! Ô mon Dieu ! lui livreras-tu tes brebis ?
FRÈRE SULPICE, à Frère Ignace.
Le voilà, votre protégé, Ignace ! Qu’en dites-vous ?
FRÈRE IGNACE.
Je suis confondu.
FRÈRE GODERAN.
Et moi de même. Je ne le croyais pas capable d’un si grand crime.
L’ABBÉ.
Eh bien, mes frères ! ce que nous avons à faire, c’est de prendre au plus vite la châsse de monsieur saint Leufroy, avec ce que nous pourrons emporter d’argent comptant, et de nous sauver à Beauvais, sans regarder derrière nous ; autrement ce Philistin va venir et nous égorgera tous.
FRÈRE GODERAN.
Oh ! le danger n’est pas si pressant, Dieu merci.
FRÈRE SULPICE.
J’ai envoyé tout aussitôt un valet à messire Enguerrand. Ainsi nous serons promptement secourus.
FRÈRE IGNACE.
Nos murailles sont hautes.
L’ABBÉ.
Ah, mes frères ! vous ne connaissez pas ce fils de Satan ! Cet impie, par la puissance de sa magie, renverserait nos murailles plus facilement qu’un chandelier de bois. Sauvons-nous ! sauvons-nous !
FRÈRE IGNACE.
Parlez plus bas, sire abbé, les vilains peuvent nous entendre.
L’ABBÉ, prenant un des bâtons qui servent à porter la châsse.
Allons, vite ! qui m’aide à porter ces précieuses reliques ?
FRÈRE IGNACE.
Écoutez
On entend des cris confus.
L’ABBÉ.
Consummatum est. L’impie est venu.
Il se jette à genoux.
FRÈRE SULPICE.
On frappe ! Jésus ! Maria !
On frappe à grands coups.
L’ABBÉ, d’une voix affaiblie.
Vade retro, Satanas !
FRÈRE IGNACE.
Qui frappe si rudement à la porte de cette sainte abbaye ?
LE LOUP-GAROU, en dehors.
Ouvrez, au nom du diable ! ouvrez, ou j’enfonce la porte !
L’ABBÉ.
Mon Dieu ! donnez-moi le courage de mourir martyr !
FRÈRE IGNACE.
Si vous ne vous retirez sur-le-champ, nous allons vous accabler de pierres et de flèches.
LE LOUP-GAROU, en dehors.
Nous ne craignons pas plus vos flèches que vos excommunications ! ouvrez la porte, ou je vais l’enfoncer !
FRÈRE IGNACE, aux vilains.
Allons, mes amis, tirez par les meurtrières sur ces brigands.
LE LOUP-GAROU.
Vassaux de ce couvent, nous venons vous délivrer du servage ; aidez-nous, nous sommes vos frères ! Je suis Chrétien Franque, je viens vous délivrer.
L’ABBÉ.
Le Loup-Garou ! Jésus ! Maria !
TOUS.
Le Loup-Garou !
PREMIER VILAIN.
Jamais je n’oserai tirer sur le Loup-Garou.
La plupart des vilains s’éloignent de la porte.
LE LOUP-GAROU.
Ah ! vous allez voir ce que peut la masse du Loup-Garou.
Il frappe la porte à coups redoublés.
Apportez-moi cette grande poutre. – Ici, François, ici, Petit-Jean. – Attention ! frappez en mesure. Une, deux, trois.
La porte est frappée violemment et semble près de se briser.
Voilà qui va bien ! encore un bon horion ! Une, deux, trois.
Une planche de la porte est enfoncée.
FRÈRE IGNACE, prenant une pique.
Il faut être brave aujourd’hui, autrement c’est fait de nous.
À l’abbé et aux autres moines.
Allons, faites comme moi, au lieu de prier et de vous signer comme des femmes.
Aux vilains.
À moi, mes amis !
La porte est enfoncée, le Loup-Garou entre suivi de sa troupe ; tous les moines et les vilains reculent à sa vue. Il arrache la pique des mains de frère Ignace, et le jette par terre en le frappant du bois.
LE LOUP-GAROU.
Laisse cette arme à des hommes, vieille tête pelée ! Franchise aux vilains ! Plus de servage ! Allons, vilains, répétez ce cri : Franchise !
VILAINS.
Franchise ! plus de servage !
LE LOUP-GAROU.
Plus de servage ! plus de corvées ! plus de seigneurs ! tout ce qu’ils ont est à nous !
VILAINS.
Franchise ! tout ce qu’ils ont est à nous !
LE LOUP-GAROU.
Or çà, avant de piller, procédons avec ordre. – Où est un certain Honoré, qui se prétend abbé de ce couvent.
L’ABBÉ, à part.
Mon Dieu ! ce n’est pas que j’aie peur de mourir, mais c’est que j’ai peur de ne pas mourir saintement.
LE LOUP-GAROU.
Eh bien ! personne ne répond ! À ce costume, je reconnais ce frère Honoré.
Il le saisit par le collet.
Belle figure d’abbé, par ma foi !
Les vilains rient.
L’ABBÉ.
Oh ! mon Dieu ! fais du moins que mon martyre soit court !
FRÈRE SULPICE, au Loup-Garou.
Ayez pitié des ministres du Seigneur !
LE LOUP-GAROU.
Tais-toi.
À l’abbé.
Dis-moi, qui t’a donné l’audace de te faire abbé de cette abbaye au préjudice du digne et révérend père Jean ?
L’ABBÉ, balbutiant.
Je... je... je... Le Loup-Garou. Parle clairement ou, par saint George ! je t’étrangle.
L’ABBÉ, montrant les moines.
J’ai été élu par ceux-ci.
LE LOUP-GAROU.
Les autres auront à répondre tout à l’heure pour cette élection. Mais dis-moi, misérable moine, ne savais-tu pas que le père Jean valait dix fois mieux que toi ? Réponds.
L’ABBÉ.
Tuez-moi tout de suite.
LE LOUP-GAROU, levant sa masse.
Tu vas être satisfait.
LES MOINES.
Grâce ! grâce ! seigneur capitaine !
LE LOUP-GAROU.
Avant que je te tue, dis-moi, tonsuré, où est le trésor de ton couvent ?
L’ABBÉ.
C’est... le bien des pauvres... Mais... prenez-le... frère Goderan vous y conduira...
LE LOUP-GAROU.
Combien êtes-vous de moines dans cette abbaye ?
L’ABBÉ.
Je... crois... que... de quatre-vingt-deux... à... quatre-vingt-trois.
LE LOUP-GAROU.
Oui, quatre-vingt-deux et demi ? Imbécile, qui ne sait pas le compte de son troupeau !
L’ABBÉ.
Quatre-vingt-deux...
LE LOUP-GAROU.
Mes révérends pères, vous pouvez écrire à vos amis qu’ils m’envoient cent francs de rançon pour chacun de vous, et cela avant un mois. En attendant, vous serez dans votre colombier en prison. Si l’on tarde davantage, je vous coupe une oreille à chacun : quinze jours de plus, l’autre oreille : quinze jours de plus, la tête. Arrangez-vous. À bon entendeur, salut.
PLUSIEURS MOINES.
Notre famille est pauvre, et jamais...
LE LOUP-GAROU.
Silence ! qu’on m’emmène ces braillards !
À un brigand.
Wilfrid, va t’assurer du magot. – Petit-Jean, enferme-moi ce tas de robes noires. Attends. – Qui de vous se nomme Ignace ? Répondez. Qui de vous se nomme Ignace ?
FRÈRE IGNACE.
Me voici, que me voulez-vous ?
LE LOUP-GAROU.
Vous pouvez vous en aller partout où vous voudrez, sans rançon. Remerciez-en le père Jean et le capitaine Franque, surnommé le Loup-Garou. Emportez ce qui vous appartient, et grand bien vous fasse !
FRÈRE IGNACE.
Je vous remercie ; mais donnez-moi une escorte pour me conduire à Beauvais, autrement...
On emmène les moines.
LE LOUP-GAROU.
Bien ! bien ! nous verrons !
À l’abbé.
Quant à toi, qui es de cette détestable race d’Apremont, tu n’as pas de quartier à espérer ; je veux te brûler vif devant le château de ton cousin.
L’ABBÉ, à genoux.
Ah ! sainte Vierge ! saint Leufroy ! quel supplice me destinez-vous !
LE LOUP-GAROU.
Ce gros coffre doré, c’est, je suppose, la châsse de saint Leufroy. Qu’on l’emporte au camp, elle nous portera bonheur.
Il la pousse du pied.
L’ABBÉ, se relevant avec fureur.
Impie ! tu outrages les saintes reliques, je te punirai de mes faibles mains.
Il s’élance sur le Loup-Garou, comme pour le prendre à la gorge : celui-ci le renverse facilement. L’abbé tombe sur la châsse, qu’il embrasse.
LE LOUP-GAROU.
Voyez-vous ce mouton qui se met en colère !
L’ABBÉ.
Je ne crains plus la mort maintenant ; je veux mourir martyr ! Tant que je vivrai, tu ne profaneras pas ces reliques !
LE LOUP-GAROU.
Lâche ce coffre, ou je te fends la tête.
L’ABBÉ.
Scélérat ! je t’excommunie, toi et le frère Jean !
LE LOUP-GAROU.
Voilà le paiement de ton excommunication !
Il lui casse la tête.
L’ABBÉ.
Jésus !
Il meurt. Les vilains murmurent.
QUELQUES VILAINS.
Tuer l’abbé sur la châsse de saint Leufroy ! Sacrilège !
LE LOUP-GAROU.
Que disent ces vils esclaves ? qui parle de sacrilège ? Qui de vous a quelque chose à me dire ? qu’il se présente, qu’il paraisse, je lui répondrai...
Silence. À ses brigands.
Enlevez ce cadavre, et jetez-le dans quelque trou. – Vous, emportez cette châsse.
Les brigands hésitent à obéir.
UN BRIGAND.
Mais, capitaine... c’est que...
LE LOUP-GAROU.
Comment, poltron, tu crains que saint Leufroy, tout mort qu’il est, ne te fasse du mal ? Imbécile, regarde-moi.
Il soulève le coffre.
Prends, maintenant ; tu vois qu’on n’en meurt pas.
Les brigands emportent la châsse.
Allons, mes amis, la journée est à nous, faisons ripaille. La cave des moines est bonne, allons la visiter.
QUELQUES VILAINS.
Oui, allons faire bombance ; allons boire le vin des moines.
UN VILAIN.
Tout cela porte malheur. J’aime bien mieux aller piller chez messire d’Apremont.
MORAND, entrant.
Chrétien Franque ! Chrétien Franque !
LE LOUP-GAROU.
Que me veux-tu ?
MORAND.
Le père Jean m’envoie pour te recommander de ne pas faire tomber un seul cheveu de la tête de l’abbé.
LE LOUP-GAROU.
Par les cornes de Mahom ! tu viens un peu tard ; cependant je ne l’ai pas tondu, regarde plutôt.
Il montre le cadavre.
MORAND.
Ah ! sainte Vierge, qu’as-tu fait ?
LE LOUP-GAROU.
N’était-il pas de cette race de vipères ? Crois-tu que, pour un moine de moins, le monde en ira plus mal ? Allons boire un coup dans le réfectoire.
Il entre dans le couvent avec Morand ; les brigands et une partie des vilains le suivent, les autres se dispersent : deux restent devant le cadavre de l’abbé.
PREMIER VILAIN.
Dire pourtant que je l’ai entendu chanter la messe, et cela pas plus tard qu’hier !
DEUXIÈME VILAIN.
Il l’a tué tout raide ; il a eu tort.
PREMIER VILAIN.
Je croyais d’abord que la chasse aurait fait un miracle ; mais, quand j’ai vu qu’il ne s’en faisait pas, cela m’a donné une mauvaise idée de l’abbé.
DEUXIÈME VILAIN.
Nous devrions l’enterrer.
PREMIER VILAIN.
Il a au cou une belle chaîne, ma foi, qu’il ne faut pas enterrer.
Il prend la chaîne.
DEUXIÈME VILAIN.
Est-ce que tu prends cette chaîne ?
PREMIER VILAIN.
Pourquoi pas ?
DEUXIÈME VILAIN.
Ah ! et pourquoi donc ne lui prendrais-je pas cette bourse que voilà, dont les cordons passent hors de sa ceinture ?
PREMIER VILAIN.
Ses habits sont encore bons. Il ne faut pas les perdre.
DEUXIÈME VILAIN.
Non, il faut les lui ôter, et puis nous les partagerons.
PREMIER VILAIN.
Il a une robe qui est de fine bure, cela fera un bel habit des dimanches à ma femme.
DEUXIÈME VILAIN.
Nous tirerons au sort à qui l’aura.
Ils dépouillent le cadavre.
PREMIER VILAIN.
Bah ! qu’avons-nous besoin de l’enterrer ? d’autres en prendront soin.
DEUXIÈME VILAIN.
Au fait, il faut mettre en sûreté ce que nous avons ; car on pourrait bien nous le voler. Les gens qui sont ici n’ont pas l’air de très honnêtes gens.
PREMIER VILAIN.
Bien dit. Allons cacher notre butin.
Ils sortent.
Scène XIX
ENGUERRAND DE BOUSSIES, FLORIMONT DE COURSY, CHEVALIERS, ÉCUYERS, HOMMES D’ARMES
Une colline à quelques lieues de Beauvais.
ENGUERRAND, à sa suite.
Qu’on plante ma bannière sur cette touffe de genêts et qu’on sonne la trompette.
FLORIMONT, à son écuyer.
Richemond, plantez ici ma bannière.
À Enguerrand.
Messire Enguerrand fait sonner à l’étendard comme s’il était notre capitaine.
ENGUERRAND.
Par la mort Dieu ! messire Florimont, ne suis-je pas gouverneur de la province ?
FLORIMONT.
D’accord ; mais les seigneurs qui se sont réunis pour secourir notre ami Gilbert d’Apremont, n’ont point encore décidé que vous seriez notre chef dans cette chevauchée.
ENGUERRAND.
C’est-à-dire que vous prétendez à cet honneur ?
FLORIMONT.
Peut-être.
ENGUERRAND.
Par le chef de saint Jean ! je serais curieux de voir comment s’y prendrait pour commander à tant de bons chevaliers un enfant que j’aurais pu prendre pour page il y a quelques mois.
FLORIMONT.
Les barons qui s’avancent vers nous, penseront peut-être qu’un chevalier banneret, qui vient avec treize pennons, est plus digne de commander qu’un vieux chevalier grisonnant, qu’hier au soir j’ai vu tourner bride et faire retraite au galop devant quelques vilains armés de bâtons. – Dites-moi, messire Enguerrand, n’avez-vous point faussé vos éperons hier soir, car vous piquiez sans ménagement.
ENGUERRAND.
Vous m’insultez ! et je vous prouverai la lance au poing que je suis un plus raide chevalier que vous.
FLORIMONT.
Quand vous voudrez. Prenez un champ, et je vous délivrerai[53].
ENGUERRAND.
Ici même et demain : trois coups de lance, trois coups d’épée et trois coups de hache ; voici mon gant.
FLORIMONT.
Voici le mien.
Des écuyers ramassent les gantelets. Entrent le sénéchal du Vexin, Olivier Laudon, Perceval de la Loge, Gautier de Sainte-Croix, chevaliers, etc.
LE SÉNÉCHAL.
Qu’y a-t-il, messeigneurs, vous semblez émus ?
ENGUERRAND.
Émus !... Nullement, sénéchal.
FLORIMONT.
Ne perdons point de temps ; nommons un capitaine, et choisissons un cri pour la bataille.
OLIVIER.
Quelle est la bannière la mieux accompagnée ?
ENGUERRAND.
Messeigneurs, le roi m’a donné le gouvernement du Beauvoisis...
FLORIMONT.
Eh ! de par le diable ! gouvernez votre ville. Ce n’est pas un gouverneur, c’est un capitaine qu’il nous faut.
ENGUERRAND.
Insolent ! vous devez obéir aux ordres du roi.
FLORIMONT.
J’ai treize pennons sous ma bannière, et je vous obéirai quand le roi vous aura donné commission pour combattre les révoltés.
LE SÉNÉCHAL.
Au nom de Dieu, chevaliers, ne vous querellez pas au moment d’une bataille. Vous êtes tous deux dignes de commander ; mais l’union surtout nous est nécessaire, croyez-en un vieux soldat.
OLIVIER.
Sénéchal, vous aussi vous avez commission de mon redouté seigneur le due de Normandie, soyez notre chef.
PERCEVAL.
Oui, qu’il soit notre chef.
LE SÉNÉCHAL.
Messeigneurs, vous faites trop d’honneur à mes cheveux blancs. Je n’ai que quelques soldats sous ma bannière. Choisissez plutôt entre ces deux braves chevaliers.
GAUTIER.
Sénéchal, vous avez commandé une armée royale, il faut que vous soyez notre chef aujourd’hui.
PERCEVAL.
Oui, que le sénéchal nous commande.
OLIVIER.
Que ceux qui veulent le sénéchal pour capitaine lèvent la main droite.
Tous lèvent la main, excepté le sénéchal, Enguerrand et Florimont.
ENGUERRAND.
Au moins, ce n’est pas cet insolent damoiseau.
FLORIMONT.
Au moins, celui-là n’est pas un lâche.
OLIVIER.
Le seigneur sénéchal est notre capitaine ! Que les bannières et les pennons saluent sa bannière.
GAUTIER.
Maintenant allons vite en besogne ; quel sera notre cri ?
OLIVIER.
Il convient que l’on adopte le cri du général.
PERCEVAL.
Ainsi l’on criera : Beaudouin au sénéchal !
FLORIMONT, bas à un jeune chevalier.
Baudet le sénéchal !
ENGUERRAND.
Messeigneurs, la plus grande partie de nos hommes d’armes ne connaissent pas ce cri. Il faudrait en prendre un autre avec lequel ils aient déjà combattu.
LE SÉNÉCHAL.
Vous avez raison. Chevaliers, je vous propose de crier : Notre-Dame de Boussies !
FLORIMONT.
J’ai treize pennons sous ma bannière, et il me semble que j’ai plus de droit qu’un autre à donner mon cri : De Coursy au lion rouge !
GAUTIER.
Oui, cela est raisonnable. Il a treize pennons.
PERCEVAL.
Eh ! qu’importent ses treize pennons ? Ce jeune homme peut bien attendre pour donner son cri que la barbe lui soit poussée au menton.
ENGUERRAND.
Notre-Dame de Boussies a souvent effrayé les Anglais.
FLORIMONT.
Oui, mais ce cri n’a pas, à ce qu’il paraît, le pouvoir d’effrayer Jacques Bonhomme.
LE SÉNÉCHAL.
Finissons ce débat, messeigneurs. Que chacun garde le cri de sa bannière, mais, pour l’honneur de la France, je propose de crier avant : Montjoie Saint-Denis !
TOUS.
Montjoie Saint-Denis !
LE SÉNÉCHAL.
Disposons promptement notre attaque. Messire Olivier de Laudon et messire Perceval de la Loge ont guidé les coureurs, et vont d’abord nous rendre compte de ce qu’ils ont vu.
OLIVIER.
Ce sera bientôt fait. Vous voyez d’ici l’ordonnance de ces misérables. À leur droite est un ruisseau encaissé ; leur gauche est couverte par leurs chariots. Ils sont rangés sur deux lignes, leurs archers en tête.
FLORIMONT.
Ces rustres singent vraiment les hommes d’armes.
LE SÉNÉCHAL.
La position que ces vilains ont prise est forte et de difficile abord. Ils ont avec eux quelque renard anglais qui les aura rangés de la sorte.
FLORIMONT.
Eh bien ! il y aura quelque gloire à gagner. Je craignais seulement qu’ils ne voulussent pas nous attendre.
LE SÉNÉCHAL.
Messire de Coursy, avez-vous vu beaucoup de batailles ?
FLORIMONT.
Messire sénéchal, dites-vous cela pour vous railler de ma jeunesse !...
LE SÉNÉCHAL.
Je ne raille point, jeune homme. Aujourd’hui vous verrez une bataille et non un tournoi à lances mornées. Je connais les gens de ce pays et leurs longues flèches et leurs lourds épieux. Croyez-moi, la journée sera rude.
FLORIMONT.
Quoi ! Jacques Bonhomme se battre ! Allons donc ! passe encore pour les compagnons d’aventure qui n’ont point rougi de se joindre à des paysans.
LE SÉNÉCHAL.
Messire Florimont, puissiez-vous ne point faire aujourd’hui une triste expérience du courage de vos compatriotes !
Entre le Loup-Garou gardé par des soldats.
UN SOLDAT.
Messeigneurs, voici un prisonnier que nous vous amenons. Ce coquin si robuste est venu nous braver en s’avançant tout près de nous ; mais il s’est rendu ensuite sans combat, comme un lâche qu’il est.
LE SÉNÉCHAL.
Avance, vilain, et dis la vérité, si tu tiens à la vie. Combien y a-t-il d’hommes là-bas ?
LE LOUP-GAROU.
Hélas ! monseigneur... que voulez-vous que je vous dise ?
LE SOLDAT, le menaçant.
Veux-tu répondre mieux que cela, voleur !
LE SÉNÉCHAL.
Ne le maltraitez pas. Et toi, vilain, écoute ; si tu réponds juste à mes questions, je te donnerai la vie, et un manteau de laine par-dessus le marché.
LE LOUP-GAROU.
Monseigneur, nous sommes bien trois mille... nous sommes bien quatre mille. Voilà tout, aussi vrai que nous sommes tous ici des honnêtes gens.
LE SÉNÉCHAL.
Tu veux me tromper, coquin. Hier soir tes camarades étaient au moins huit mille.
FLORIMONT.
Sénéchal, vous êtes vieux, et vos yeux ne peuvent plus compter des hommes d’armes. Il n’y a pas là-bas plus de quatre mille hommes.
LE SÉNÉCHAL.
Mes yeux me montrent ici quatre mille hommes ; mais mon expérience me dit que ces marécages et ces creux en cachent encore autant.
LE LOUP-GAROU.
Monseigneur, vous nous avez fait tant de peur, que la moitié de nos hommes a déserté.
FLORIMONT.
Je le disais bien, ils vont nous échapper. Sus, chargeons !
LE SÉNÉCHAL, au Loup-Garou.
Tu répètes bien la leçon que tu as apprise de ton capitaine ; il me prend envie de te faire couper les oreilles.
LE LOUP-GAROU.
Ah ! monseigneur, ce serait dommage.
LE SÉNÉCHAL.
Où sont les aventuriers ?
LE LOUP-GAROU.
Hélas ! la moitié aussi s’en est allée, et nous ne comptons pas trop sur le reste. Mais voici les Anglais du capitaine Siward qui n’a pu nous quitter, car il a la cuisse cassée ; et là-bas, ces trente ou quarante chevaux, ce sont des Navarrais. Ah ! si nous en avions seulement deux cents !
LE SÉNÉCHAL.
Tu mens à chaque mot. Ces armures si luisantes, que je vois au centre, m’annoncent une troupe nombreuse d’aventuriers.
LE LOUP-GAROU.
Faites excuse, monseigneur, c’est la troupe du Loup-Garou avec la moitié des hommes d’Apremont. L’autre moitié, comme vous le savez, et les gens de Genêts, sont restés au siège d’Apremont avec les capitaines Pierre et Thomas.
LE SÉNÉCHAL.
Où donc ces vilains ont-ils pris des armets si luisants, et d’où vient qu’ils plantent des pieux devant eux, ainsi que font les Anglais ?
LE LOUP-GAROU.
Monseigneur, quant aux armets, c’est qu’ils les écurent avec du sable ; voilà pourquoi ils sont si luisants. Quant aux pieux, on dit que c’est pour vous empêcher de passer ; mais je crains bien que cela ne serve de rien contre vos bons chevaux.
FLORIMONT.
Eh ! que voulez-vous apprendre de cet imbécile ? Sénéchal, nous perdons ici notre temps. Donnez le signal.
LE SÉNÉCHAL.
Je suis votre chef, et n’ai point d’ordre à recevoir de vous.
Au Loup-Garou.
Si tu as menti, tu sais que la corde t’attend ? N’as-tu rien à dire encore, penses-y bien.
LE LOUP-GAROU.
Monseigneur, j’ai dit la vérité.
LE SÉNÉCHAL.
Qu’on l’emmène.
LE LOUP-GAROU.
Et le manteau de laine ?
LE SÉNÉCHAL.
Le manteau ou la corde, après la bataille.
LE LOUP-GAROU.
De quelle couleur le manteau ?
On l’emmène.
LE SÉNÉCHAL.
Qu’en dites-vous, chevaliers ?
FLORIMONT.
Attaquons sur-le-champ, c’est mon avis.
PERCEVAL.
Et le mien.
FLORIMONT.
Déployons nos bannières, couchons le bois[54], et en avant ! au galop !
TOUS, excepté le sénéchal.
En avant !
LE SÉNÉCHAL.
Braves chevaliers, souffrez que ma vieille expérience guide votre valeur. Le front de notre ennemi est garni de bons archers qui vont abattre la moitié de vos chevaux avant que vous les ayez approchés d’une longueur de lance. D’ailleurs, il a plu beaucoup hier, la terre est toute détrempée, et nos chevaux entreront jusqu’aux sangles dans la boue. Il me semble donc qu’il vaut mieux envoyer devant nos arbalétriers. Leurs arbalètes portent plus loin que les arcs, et ils ouvriront facilement les rangs de ces vilains mal armés. Nous autres, mettant pied à terre et serrés en gros bataillon, nos lances retaillées à cinq pieds, nous soutiendrons notre avant-garde, et, Dieu aidant, nous donnerons le coup de grâce aux rebelles.
FLORIMONT.
Nous, mettre pied à terre, et combattre avec les arbalétriers !
OLIVIER.
Mettre pied à terre devant des vilains, comme si nous avions affaire à des gendarmes anglais ou flamands !
PERCEVAL.
Des chevaliers français doivent combattre à cheval comme faisaient leurs aïeux.
GAUTIER.
Des chevaliers français ne peuvent combattre, confondus avec des arbalétriers[55] !
LE SÉNÉCHAL.
Messeigneurs, souvenez-vous de Poitiers !... Chez les Anglais, le poste d’honneur est avec les archers !
FLORIMONT.
Eh ! laissons les Anglais et leurs façons. Des gendarmes français n’ont besoin d’apprendre à se battre de personne.
LE SÉNÉCHAL.
De quel usage seront nos chevaux dans cette espèce de marécage où l’ennemi s’est retranché ? Jamais nous ne pourrons les charger en ligne.
FLORIMONT.
Sénéchal, laissez-moi avec mes seuls gendarmes enfoncer ce tas de brigands. Vous viendrez après nous, et vous n’aurez que la peine d’assommer ceux que nous allons jeter par terre.
LE SÉNÉCHAL.
Jeune homme, croyez-en une barbe grise qui a vu plus de batailles rangées que vous n’avez rompu de lances...
FLORIMONT.
J’en crois mon cheval et mes éperons. Je fais vœu aux dames, aux preux et au héron, dont je porte les plumes[56], de planter ma bannière au milieu du camp des rebelles.
PERCEVAL.
Nous vous suivrons.
GAUTIER.
Mon cheval me porterait tout armé au delà d’une rivière.
ENGUERRAND.
Quant à moi, j’en crois messire Beaudouin. Le terrain n’est pas bon pour jouter à cheval.
OLIVIER.
Mon cheval m’a coûté quatre cents francs. Toute réflexion faite, je ne veux pas le faire estropier d’un coup de flèche.
LE SÉNÉCHAL.
Vous venez de me nommer votre chef, et j’ai le droit d’exiger de vous de l’obéissance. Que les arbalétriers commencent l’attaque, et que les gendarmes les suivent à pied.
FLORIMONT.
J’ai treize pennons sous ma bannière, et je combattrai à cheval.
GAUTIER.
Voyez-vous ces vilains, ils sont tellement orgueilleux de notre hésitation que leurs archers se détachent en avant pour nous attaquer.
FLORIMONT.
Compagnons, souffrirons-nous que les vilains tirent la première flèche ? Déployez ma bannière, je vais écraser ces misérables.
LE SÉNÉCHAL.
Je suis seul chef ici, et personne ne doit attaquer sans mon ordre. À pied, messieurs !
À un officier.
Vous, dites aux arbalétriers de marcher en avant.
L’OFFICIER.
Monseigneur, les arbalétriers ont fait quatre lieues dans la boue, ils demandent une heure pour se reposer.
FLORIMONT.
Eh quoi ! cette lâche canaille fera-t-elle la loi à des chevaliers français ? Par saint George ! chargeons l’ennemi sur le ventre de ces ribauds[57]. À cheval ! Debout mes pennons ! de Coursy au lion rouge !
LE SÉNÉCHAL.
Arrêtez, ou vous allez tout perdre ! arrêtez, je vous l’ordonne.
FLORIMONT, montant à cheval.
Je ne reçois d’ordre que de ma maîtresse et du roi.
À ses hommes d’armes.
Couchez le bois. De Coursy au lion rouge ! et la belle Matheline !
Ses trompettes sonnent, il sort avec sa suite.
GAUTIER.
Par saint Denis et saint George ! je suivrai ce brave chevalier ! Sainte-Croix, à la rescousse !
Il sort avec sa suite.
PERCEVAL.
À moi, ma bannière ! Délogez à la loge[58] !
Il sort suivi d’un grand nombre de chevaliers que le sénéchal essaye en vain de retenir. Tumulte. Entre le Loup-Garou à cheval.
LE LOUP-GAROU.
Ils sont à nous ! Je vais reprendre mon arc !
Il sort au galop.
UN HOMME D’ARMES, à pied, courant après lui.
Arrêtez ! arrêtez ce brigand ! Il a tué mon camarade, et il nous vole un cheval.
Il sort.
LE SÉNÉCHAL, aux chevaliers qui sont restés avec lui.
Les insensés ! ils me quittent et vont se précipiter tête baissée dans ce marais d’où jamais ils ne sortiront. Vous, messeigneurs, vous voulez faire triompher la bannière royale ; suivez-moi, au nom de saint George, et tâchons, s’il se peut, de réparer leur faute.
OLIVIER.
Entendez-vous ces cris ? Par le sourcil de Notre Dame ! dans leur course ils culbutent nos propres arbalétriers.
LE SÉNÉCHAL, se frappant la tête.
Oh ! les insensés ! les insensés !
ENGUERRAND.
Les voilà dans la boue maintenant, et les archers les tirent comme des oiseaux englués. Sainte Vierge ! regardez donc ces troupes d’archers qui paraissent de toutes parts. Ils les avaient cachés. Voyez comme les chevaux du sire de Coursy tombent pêle-mêle sous leurs flèches. Ah ! mon jeune chevalier, vous payerez cher votre orgueil. Sénéchal, à votre place je le laisserais où sa présomption vient de l’entraîner.
LE SÉNÉCHAL.
Fi donc, monseigneur ! – Courons à son secours, chevaliers ; il est téméraire, mais il a du courage. Ce serait une honte éternelle à nous, si nous l’abandonnions dans ce mauvais pas. Messire Enguerrand, ralliez, s’il se peut, nos arbalétriers. – Vous, messire Olivier, suivez-moi. Essayons de passer le marais avec nos gendarmes à pied. Montjoie Saint-Denis, à la rescousse !
Il sort avec sa suite.
Scène XX
FRÈRE JEAN, SIWARD, MORAND, SIMON
Une petite colline près du champ de bataille, On entend dans le lointain le bruit du combat.
FRÈRE JEAN.
Cours aux chariots, Morand ; envoie-leur de nouvelles flèches. Les trousses de nos archers commencent à s’épuiser.
MORAND.
Je vole.
Il sort.
SIWARD.
La commission est de son goût. Il n’aime pas à voir battre les taureaux de trop près.
SIMON, regardant du côté de la bataille.
Grâce à Dieu et à saint Leufroy, ils sont pris dans ce marais comme des oiseaux dans la glu.
SIWARD, à Frère Jean.
Quand donc me permettrez-vous de me mêler de la besogne ?
FRÈRE JEAN.
Maintenant, capitaine, une charge vigoureuse sur leur flanc. Évitez le marais avec soin. Voyez-vous ces saules ? au delà le terrain est bon pour vos chevaux bardés.
SIWARD.
Vous allez voir ce que je sais faire.
FRÈRE JEAN.
Tournez à gauche de ce bouquet de peupliers ; quand vous serez sur un terrain ferme, lancez-vous sur eux sans crainte, je vous soutiendrai avec mes piquiers.
SIWARD.
À moi, gendarmes ! à Siward ! à Siward !
SIMON.
Et nous, que faisons-nous ?
Il sort.
FRÈRE JEAN.
Va dire à Renaud qu’il ne se laisse pas entraîner trop avant à la poursuite de l’aile gauche. – Ensuite tu viendras me joindre, je vais faire avancer les piquiers. Nous allons donner le coup de grâce à la bataille du sénéchal.
Scène XXI
LE SÉNÉCHAL, OLIVIER, HOMMES D’ARMES, tous à pied
Une autre partie du champ de bataille. La bannière du sénéchal est plantée en terre.
LE SÉNÉCHAL.
Compagnons, vous avez juré de défendre cette bannière : souvenez-vous de vos serments.
OLIVIER.
Nos chevaux sont pris. Qu’allons-nous devenir ?
LE SÉNÉCHAL.
Il faut vaincre ou mourir. Beaudouin au sénéchal ! Ah ! si nous avions ici seulement une centaine de bons arbalétriers génois, ils tiendraient l’ennemi à distance !
Entre Florimont à cheval, l’épée à la main, avec sa bannière déchirée, et quelques soldats.
LE SÉNÉCHAL, à Florimont.
À moi, Florimont ! nous tenons encore. – Eh bien ! jeune homme, en croirez-vous un vieux soldat ?
FLORIMONT.
Ah ! messire sénéchal, c’est moi qui ai tout perdu ! Plût au ciel que je fusse mort à la première décharge !
LE SÉNÉCHAL.
Ne nous décourageons pas. Unissons nos efforts, et peut-être parviendrons-nous à nous tirer d’affaire. – Qu’est devenu messire Gautier ?
FLORIMONT.
Une flèche... Ah ! sénéchal, j’ai vu plus de cent gendarmes abattus par de vils archers avant d’avoir pu les toucher de la lance. Tous ces braves sont morts par ma faute !
LE SÉNÉCHAL.
J’espérais encore... si messire Gautier... n’importe...
À Florimont.
Vous qui êtes à cheval, voyez-vous messire Enguerrand ?
FLORIMONT.
Depuis longtemps le lâche a pris la fuite.
LE SÉNÉCHAL.
La volonté de Dieu soit faite ! Ne pensons plus qu’à vendre chèrement notre vie.
FLORIMONT.
Oui, mourir avec gloire est maintenant ma seule espérance. Mais vous, sénéchal, conservez au roi et à la France une vie précieuse. Prenez mon cheval : il m’a tiré du marécage et des ennemis ; il vous portera en sûreté jusqu’à Beauvais.
Il descend de cheval.
LE SÉNÉCHAL, lui prenant la main.
Vaillant jeune homme, un vieillard comme moi ne peut plus être utile au roi ; conservez-lui un brave chevalier qui manquait d’expérience, mais qui vient aujourd’hui d’acquérir une expérience de cinquante années.
FLORIMONT.
Je ne veux pas survivre à ma honte. Montez vite, sénéchal ; plus tard il ne sera plus temps.
LE SÉNÉCHAL.
Non, mon cher Florimont, vous avez assez d’années à vivre pour venger cette défaite... mais moi, je ne trouverai peut-être pas une autre occasion de mourir sur un champ de bataille.
FLORIMONT.
Je resterai, de par Dieu ! montez, mon père, et portez cette écharpe à Matheline de Harpedanne...
LE SÉNÉCHAL.
J’ai juré de défendre la bannière du roi ; je resterai auprès d’elle tant que j’aurai un souffle de vie.
FLORIMONT.
Eh bien ! nous mourrons ensemble.
Il tue son cheval.
LE SÉNÉCHAL.
Que faites-vous ?
FLORIMONT.
Au moins il ne sera pas monté par un vil paysan. – Mon père, embrassez-moi, et pardonnez-moi ma folle présomption.
LE SÉNÉCHAL, l’embrassant.
Malheureux jeune homme, tu prives la France d’un preux chevalier !
FLORIMONT, à ses hommes d’armes.
Roulez ma bannière ; elle n’est pas digne de flotter auprès de celle du sénéchal. – Mes amis, voilà celle qu’il faut défendre. Montjoie Saint-Denis ! Beaudouin au sénéchal !
LE SÉNÉCHAL, faisant le signe de la croix.
Serrez-vous, ils approchent.
Entrent Brown, Siward, le Loup-Garou, aventuriers et paysans.
BROWN.
Laissez-nous faire, beaux sires ; n’allez pas vous faire embrocher par leurs lances. À moi, Loup-Garou ! Voici un beau but pour nos flèches. Voyons qui de nous deux saura le mieux percer une cuirasse de Milan.
LE LOUP-GAROU.
Voyons, brave Anglais. À ce heaume doré !
Combat ; la troupe du sénéchal est défaite après une longue résistance.
LE SÉNÉCHAL, blessé à mort.
Mon Dieu ! pardonnez-moi mes péchés !
FLORIMONT.
Eh quoi ! personne n’ose s’approcher de moi ! ne puis donc mourir !
Il est frappé de deux coups de flèche.
Ah ! du moins c’était la lance d’un chevalier !... Jésus !
Il meurt.
BROWN.
C’est ma flèche.
LE LOUP-GAROU.
Par le diable ! c’est la mienne.
BROWN.
Quand j’ai tiré, il est tombé.
LE LOUP-GAROU.
Je le visais à l’oreille, là où le heaume est moins épais.
BROWN.
Moi au cœur.
LE LOUP-GAROU.
Ma foi, il en a une dans l’oreille et une dans le cœur. Mes compliments, camarade.
BROWN.
Je te fais les miens.
OLIVIER, à Siward.
À merci ! chevalier, à merci !
SIWARD.
Êtes-vous noble ? êtes-vous riche ?
OLIVIER.
Oui, capitaine, je puis vous donner une bonne rançon.
SIWARD.
Défaites votre gantelet[59], vous êtes mon prisonnier.
LE LOUP-GAROU.
Un prisonnier ! un gentilhomme prisonnier ! Par Notre-Dame ! je ne le souffrirai pas. À mort ! de par saint Alipantin !
Il tue Olivier.
SIWARD.
Comment ! tu oses tuer mon prisonnier !
LE LOUP-GAROU.
Nous ne nous battons pas seulement pour gagner de l’argent, mais pour détruire la race des nobles ; entendez-vous, capitaine ?
SIWARD.
Je ne sais qui me retient...
SIMON, entrant à Siward.
Capitaine, le père Jean m’envoie vous chercher. L’ennemi se défend encore au milieu de ses chariots de bagages. On dit qu’il y a un beau butin à faire.
BROWN.
En avant ! de par la moustache de Judas !
SIWARD.
En avant, camarades !
LE LOUP-GAROU.
À moi les loups !
Tous sortent.
Scène XXII
BROWN, LE LOUP-GAROU, assis à boire
Bivouac des insurgés sur le champ de bataille.
BROWN.
Je te l’ai dit, mon garçon : nous ne pouvons plus nous quereller maintenant. Nous avons bu dans le même hanap. Tu m’as donné ton arc, je t’ai donné le mien. Je ne l’aurais jamais donné à un autre, m’eût-on offert autant de nobles à la rose qu’il a lancé de flèches. Avec tout cela, mon brave Loup, je suis fâché contre toi. Non, tu as beau dire, tu ne devais pas tuer ce seigneur, quand le capitaine l’avait fiancé prisonnier.
LE LOUP-GAROU.
Le diable m’emporte, camarade, si je me laisserais dire la moitié de cela par un autre que toi ! Vous autres Anglais, vous faites de la guerre un commerce.
BROWN.
Eh bien ! ventre de bœuf ! n’avons-nous pas raison ?
LE LOUP-GAROU.
Oui ; moi aussi j’aime à gagner de l’argent avec mon arc et mon sabre. – Mais je déteste tellement les nobles, que pour le plaisir d’en assommer un je renoncerais, je crois, au profit de cette guerre.
BROWN.
Chacun son goût. Permis à toi de suivre le tien. Mais, tête bleu ! laisse les autres faire comme ils l’entendent. Le capitaine est d’une fureur de diable. Il dit que tu lui as fait perdre plus de trois mille francs.
LE LOUP-GAROU.
Que veux-tu que j’y fasse ? Je me suis donné du plaisir pour plus de dix mille francs. Bah ! ceux qui sont morts, sont morts. Vois-tu cette masse ? j’ai fait au manche trente-trois coches. Sais-tu ce que cela veut dire ?
BROWN.
Non.
LE LOUP-GAROU.
Cela veut dire que j’ai tué pour ma part trente-trois nobles ou varlets de nobles ; et j’ai juré de ne pas coucher dans un lit que je n’en sois arrivé au demi cent. J’espère bien que mon vieil ennemi d’Apremont me fera faire une belle coche de plus.
BROWN.
Courage, mon luron ! mais ne tue pas les prisonniers des autres. Promets-moi, cher enfant, que cela ne t’arrivera plus.
LE LOUP-GAROU.
À la bonne heure ! je suis ton ami. C’est à toi que je le promets, et non à ton capitaine, dont je me soucie comme d’une flèche cassée.
BROWN.
Ah ! voilà un brave homme ! Tu es la perle des Français. Moi aussi je suis ton ami, le diable m’étrangle ! Tiens, Loup-Garou, nous pourrons bien un jour nous trouver sous deux bannières ennemies ; mais, par saint George ! si je bandais mon arc contre toi !... Eh bien ! je manquerais mon coup... La peste m’étouffe !
LE LOUP-GAROU.
Embrasse-moi, compère. Tiens, buvons un coup à notre amitié.
BROWN.
Je le veux, et je boirai à toi une pinte entière.
LE LOUP-GAROU.
Donne-moi le hanap, que je te fasse raison. Nous sommes comme saint Castor et saint Pollux, les deux meilleurs archers et la meilleure paire d’amis.
BROWN.
Saint Castor et saint Pollux, de quel pays étaient-ils ?
LE LOUP-GAROU.
L’un était Français, et l’autre Anglais.
BROWN.
À leur santé !
LE LOUP-GAROU.
Ensuite, s’il reste du vin, nous boirons à la ligue des communes et au père Jean.
BROWN.
Ton père Jean ne me plaît pas trop.
LE LOUP-GAROU.
À cause ?
BROWN.
Je n’aime pas à voir un frater en robe noire commander à des gens cuirassés.
LE LOUP-GAROU.
Aimerais-tu mieux un chevalier tout bardé de fer, et qui fait le brave parce qu’on ne pourrait le piquer même avec une aiguille ?
BROWN.
Tu sais ce que je pense de ces statues de fer. Mais, ma foi ! chacun son métier. Un frocard général ne me plaît pas. Le nôtre ne veut pas qu’on s’écarte pour piller. Il veut empêcher de violer, enfin de faire tout ce qui se fait dans une guerre réglée. Et puis il nous prêche de temps en temps des sermons ; je ne les aime pas.
LE LOUP-GAROU.
Je le laisse dire, et j’en fais à ma tête.
BROWN.
Où compte-t-il nous mener ? Veut-il retourner à sa bicoque d’Apremont ?
LE LOUP-GAROU.
Je l’imagine ; le vieux baron tient encore.
BROWN.
Nous ferions bien mieux d’aller fourrager tout droit devant nous. Au moins nous aurions un pays tout neuf à courir.
LE LOUP-GAROU.
Voici le père Jean, il va nous dire ce que tu veux savoir.
FRÈRE JEAN, entrant.
Franque, il faut que tu te rendes au siège d’Apremont. Thomas me fait dire que Pierre ménage l’ennemi. Il faut en finir, et ne pas laisser un seigneur debout derrière notre armée.
LE LOUP-GAROU.
Ce coquin de Pierre ! je m’en suis toujours méfié.
FRÈRE JEAN.
Nous autres, nous allons marcher sur Beauvais. On me dit que nous y trouverons des amis qui n’attendent que notre présence, pour chasser la garnison et nous ouvrir leurs portes.
BROWN.
À Beauvais ! Morbleu ! beau père, vous avez là une bonne idée. Voilà une belle ville à mettre à sac !
LE LOUP-GAROU.
Et par les cornes du diable ! je n’y serai pas !
FRÈRE JEAN.
Sois tranquille, l’armée te donnera ta part dans le butin. Mais cours au siège d’Apremont, et donne-moi promptement de tes nouvelles. Quand nous aurons pris Beauvais, je t’enverrai, s’il le faut, un millier de bras pour t’aider.
LE LOUP-GAROU.
Bientôt vous entendrez parler de moi. – Adieu, camarade.
Il serre la main de Brown, et sort.
BROWN.
Adieu ; bonne chance !
Ils sortent.
Scène XXIII
COUPELAUD, MAILLY, LAGUYART, BOURRÉ, ÉCHEVINS et BOURGEOIS
Beauvais. La maison de ville.
COUPELAUD.
La nouvelle est-elle vraie ?
MAILLY.
Rien de plus sûr, voisin.
LAGUYART.
Messire Enguerrand de Boussies a traversé la ville avec le reste de ses gendarmes, tous harassés de fatigue, quelques-uns blessés. Il ne nous laisse qu’une centaine d’arbalétriers.
BOURRÉ.
Il est certain que les affaires vont mal pour la noblesse ; car messire Enguerrand, lui qui est toujours si hautain et si fier, il avait ce matin la gueule morte, comme dit l’autre. Je l’ai rencontré dans la rue. Du plus loin qu’il me voit, il touche son bonnet et vient à moi. – « Ah ! mon cher Bourré, comment vous en va ? – Bien, monseigneur, pour vous servir. – Et votre femme ? vos enfants ? – Assez bien, Dieu merci ! – Et le commerce ? – Bien doucement. Vous savez que les laines renchérissent. – Ah ! mon cher ami, me dit-il, vous avez sans doute appris que les Jacques Bonshommes se sont révoltés du côté d’Apremont. Des capitaines d’aventures les ont joints. Hier nous avons escarmouché avec eux, et ils ont envoyé une troupe nombreuse contre notre ville, que la sainte Vierge l’ait en garde ! – Comment ? lui fis-je. – Oui, fit-il, je m’en vais aller vous chercher du secours, mais je vous laisse mes archers. D’ailleurs, a-t-il ajouté, monseigneur le duc compte sur vous. Il connaît ses bons bourgeois de Beauvais, et n’attend que l’occasion de leur accorder de nouvelles franchises. » Là-dessus il est monté à cheval, et il est parti avec ses gendarmes, et tout ce qu’il y avait de noble dans la ville.
COUPELAUD.
Et ces misérables vilains osent marcher contre nous ?
MAILLY.
Il a dit qu’ils étaient nombreux ?
LAGUYART.
Je sais de bonne part que tous les villages sont soulevés. Ils ont avec eux des capitaines anglais et navarrais. On nomme déjà Siward, qui s’est échappé de prison, Perducas, Eustache de Lancignac, le baron Galas, et je ne sais combien d’autres routiers.
BOURRÉ.
Quand un ours sort du bois, les loups et les renards l’accompagnent, pour avoir leur part de la curée.
MAILLY.
Mais nous perdons ici notre temps. Les rebelles approchent ; ils ont laissé quelques hommes devant le château de messire Gilbert. Mais tout le reste, avec les aventuriers et un moine qui les conduit, se dirige sur Beauvais.
LAGUYART.
Par la messe ! le cas est pressant, et nous n’avons que cent archers.
BOURRÉ.
Mais nous pouvons sonner la grosse cloche et armer les métiers.
COUPELAUD.
Armer les métiers ! doucement ! nous n’en sommes pas encore là, Dieu merci ! Peste ! donner des armes à la populace !
LAGUYART.
La canaille ne nous aime pas, et, si jamais elle se sentait les armes à la main, elle voudrait nous faire la loi.
MAILLY.
Enfin, il faut bien prendre un parti.
BOURRÉ.
Voulez-vous laisser prendre Beauvais par les vilains ?
COUPELAUD.
Non, certes.
BOURRÉ.
Alors armons les métiers pour nous défendre ; ou bien donnons de l’argent aux paysans pour qu’ils nous laissent en paix. Ils disent qu’ils n’en veulent qu’aux nobles.
COUPELAUD.
La bourgeoisie, quand elle est aussi ancienne que la mienne, par exemple, est comme la noblesse.
MAILLY.
Et puis donner de l’argent, toujours de l’argent...
LAGUYART.
On a bien de la peine à gagner un florin ; faut-il, quand on le tient dans sa pochette, le donner aussitôt à des voleurs ?
BOURRÉ.
Faites ce que bon vous semblera, mais décidez-vous.
COUPELAUD.
Envoyons aux murailles toute la petite bourgeoisie. Elle a tout autant à craindre des vilains que nous-mêmes. Nous, restons ici pour donner des ordres ; ou, si vous voulez, montons au clocher, nous verrons si chacun est à son poste.
BOURRÉ.
J’ai grand’peur que les bourgeois ne se conduisent pas trop bravement. Les gens de métiers sont meilleurs pour se battre.
COUPELAUD.
Il faut dire aux bourgeois que monseigneur le duc leur donnera des franchises, s’ils se comportent en prud’hommes.
BOURRÉ.
Oui-dà ; mais nous croiront-ils ? Le roi, Dieu le bénisse ! nous avait promis des privilèges pour avoir défendu la ville contre l’Anglais, et nous sommes encore à les attendre, ces privilèges.
COUPELAUD.
Bah, bah ! le danger n’est peut-être pas aussi pressant qu’on se l’imagine. Nos murailles sont hautes, il y a de l’eau dans les fossés.
Entre un bourgeois.
MAILLY.
Qu’est-ce qu’y a-t-il, maître Mauclerc ?
LE BOURGEOIS.
Messire, voilà qu’une grande poussière s’élève du côté de la porte Saint-Jean. Une trentaine de coureurs se sont déjà montrés à un trait d’arc des barrières.
BOURRÉ.
Et nos arbalétriers, que font-ils ?
LE BOURGEOIS.
Ils sont aux murailles avec quelques bourgeois, mais ils menacent de les quitter, si l’on ne vient à leur aide. D’un autre côté, les ouvriers et les gens de métiers commencent à jeter des cris, et parlent de se joindre aux vilains.
COUPELAUD.
Sainte Vierge ! voilà le pire de tout !
MAILLY.
Comment ! les scélérats oseraient se révolter contre ceux qui leur donnent du pain !
LAGUYART.
Mes ouvriers n’ont pas été payés depuis dix jours ; je crains qu’ils ne fassent quelque sottise.
LE CONCIERGE DE LA MAISON DE VILLE, entrant.
Voici des gens de métiers qui heurtent à la porte et demandent à parler au conseil.
COUPELAUD.
À la bonne heure. Ils viennent sans doute nous offrir leurs bras. Il faut donner des armes à ces braves gens. Qu’on les fasse entrer.
Entrent plusieurs ouvriers.
BOURRÉ.
Eh bien ! mes amis, mes enfants, vous venez pour combattre nos ennemis. Vous venez nous offrir vos services ?
UN OUVRIER.
Oui, maître ; mais je voudrais bien vous dire un petit mot, sauf l’honneur de toute la compagnie.
MAILLY.
Parle, mon compère ; n’aie pas peur, mon ami.
COUPELAUD.
Qu’on donne un verre de vin à ce brave homme.
LAGUYART.
Comment se porte ta femme ?
L’OUVRIER.
Elle est en couche de son septième.
COUPELAUD.
Voilà un brave homme qui donne sept enfants au roi. Combien de garçons, mon camarade ?
L’OUVRIER.
Cinq, à votre service, notre maître.
COUPELAUD.
Tu venais nous demander des armes, n’est ce pas ?
L’OUVRIER, prenant un verre qu’on lui apporte.
Je bois à toute l’honorable compagnie.
BOURRÉ.
Merci, mon ami. – Au fait.
L’OUVRIER.
Notre maître, les cardeurs de laine, sauf votre respect et celui de la compagnie, m’ont envoyé vous demander... Je n’ose vous dire quoi.
COUPELAUD.
Parle, mon enfant.
L’OUVRIER.
Dame ! maître, c’est que les cardeurs de laine, révérence parler, ne gagnent que trente deniers par jour, ce qui est bien peu quand on a, comme moi, femme et enfants, Dieu soit avec nous ! Et... nous vous demandons... nous vous prions de vouloir bien nous en donner soixante au lieu de trente.
COUPELAUD.
Soixante deniers, coquin ! soixante deniers au lieu de trente !
MAILLY.
Et tu as l’impudence de nous proposer cela en face !
LAGUYART.
Un bâton ! un bâton !
BOURRÉ, bas.
Doucement, beaux sires, l’ennemi est aux portes.
À l’ouvrier.
Tu demandes soixante deniers, dis-tu ?
L’OUVRIER.
Ce n’est pas moi tout seul, maître, ce sont tous les cardeurs de laine, sauf votre bon plaisir.
COUPELAUD.
Ah ! scélérat ! je vais te faire mettre en prison.
MAILLY.
Il faut le faire pendre pour l’exemple.
BOURRÉ.
Eh ! messieurs, ne nous amusons pas à ferrer des cigales.
À l’ouvrier.
Mon brave homme, retire-toi pour un instant, nous allons te rendre réponse tout à l’heure.
L’ouvrier sort.
COUPELAUD.
Soixante deniers ! soixante panerées de diables les prennent au corps !
BOURRÉ.
Mais, voisin... Ah ! que nous veut le garde du beffroi ?
LE GARDE DU BEFFROI, entrant.
Messires, les paysans appellent à grands cris les ouvriers à la révolte. Les aventuriers ont mis pied à terre, retaillé leurs lances, et ils vont donner l’assaut. Tous crient : À sac ! à sac !
BOURRÉ.
Vite, donnons-leur ce qu’ils demandent.
COUPELAUD.
Hélas ! soixante deniers ; mais nous serons tous ruinés !
BOURRÉ.
Aimez-vous mieux être pillés ?
LAGUYART.
Soixante deniers ! il faut bien en passer par là.
MAILLY.
Ils nous revaudront cela dans un autre temps. L’ouvrier rentre. Faites rentrer ce coquin.
BOURRÉ.
Mon camarade, vous aurez soixante deniers à l’avenir, mais courez vite aux murailles.
L’OUVRIER.
Maître, soixante deniers, c’est bien peu. Les cardeurs de laine en voudraient quatre-vingts, s’il vous plaisait les leur donner.
COUPELAUD.
Ah ! traître, tu n’en demandais tout à l’heure que soixante.
L’OUVRIER.
C’est que je me serai trompé, notre maître.
BOURRÉ.
Aux murailles ! aux murailles ! nous parlerons de nos comptes une autre fois.
LAGUYART.
Entendez-vous ces cris ?
CRIS derrière la scène.
Vivent les métiers ! à bas les bourgeois ! Aux bâtons !
COUPELAUD.
Hélas ! ils se révoltent !
BOURRÉ.
Oui, vous aurez quatre-vingts deniers.
OUVRIERS, entrant en tumulte.
Douze sous par jour ! du vin au lieu de bière ! du travail toute la semaine !
COUPELAUD.
Que dites-vous, coquins ?
BOURRÉ.
Nous sommes perdus ! je cours chez moi pour tâcher de sauver quelque chose.
Il sort.
OUVRIERS.
Douze sous ; ou pillage, pillage !
COUPELAUD.
Vous serez tous pendus, misérables !
LE CHEF DES ARBALÉTRIERS, entrant.
Messires, nous ne pouvons plus longtemps défendre seuls la muraille. Les métiers nous assomment à coups de pierres, et déjà ils jettent des cordes et des échelles aux vilains.
COUPELAUD.
Hélas ! que faire ? Ah ! Notre-Dame de Beauvais, je vous promets un chandelier d’argent haut comme moi... si...
OUVRIERS.
Vingt sous par jour, ou nous mettons tout au pillage.
COUPELAUD, MAILLY, LAGUYART.
Mes enfants, mes enfants ! mes bons amis !
OUVRIERS.
À sac, à sac !
COUPELAUD.
Mes chers enfants, écoutez-moi !
OUVRIERS.
À sac, à sac ! à bas les riches ! à bas les bourgeois !
CRIS, derrière la scène.
Ils sont entrés ! À sac ! à sac les bourgeois !
COUPELAUD, MAILLY, LAGUYART.
Miséricorde ! on nous pille ! sauvons-nous !
Ils sortent.
PAYSANS et AVENTURIERS, derrière la scène.
Leufroy ! ville gagnée ! À mort, à sac les bourgeois !
OUVRIERS.
À sac les bourgeois ! vivent les métiers !
Ils sortent.
Scène XXIV
D’APREMONT, blessé et s’appuyant sur son bâton, ISABELLE
Une salle du château d’Apremont.
ISABELLE.
Mon père, rentrez, croyez-moi, vous êtes encore trop faible pour sortir.
D’APREMONT.
Ma blessure n’est rien. Il y a trop longtemps que je suis dans mon lit. Je veux revoir un peu ces ribauds.
ISABELLE.
Mais vous marchez à peine, vous ne pouvez pas encore mettre une cuirasse, et leurs archers sont toujours aux aguets.
D’APREMONT.
N’importe ! je ne veux pas mourir dans mon lit comme un moine. Mon père est mort à Crécy ; mes aïeux sont tous morts sur un champ de bataille... et je mourrais au lit, le dernier de ma maison !... Mon fils !... mon pauvre fils !... je ne croyais pas qu’il dût me précéder !
ISABELLE.
Du courage, mon père. Tout n’est pas encore perdu. On dit que le château peut tenir longtemps.
D’APREMONT.
Le château de Geoffroy d’Apremont, faute de pain, pris par des paysans ! Le château d’Apremont, qui a vu quatre-vingts pennons déployés contre lui, qui a résisté à deux mille lances.
ISABELLE.
Il reste encore un peu de farine... d’ailleurs, nous serons bientôt secourus par nos amis.
D’APREMONT.
Secourus !... Les rebelles disent vrai. J’ai reconnu la tête de mon vieil ami le sénéchal et sa bannière. Les aventuriers ont défait la noblesse du Beauvoisis, car des vilains n’auraient jamais pu soutenir leur premier choc. Sainte Vierge ! des chevaliers, car ce Siward est un chevalier, se joindre à des vilains pour égorger des gentilshommes !
ISABELLE.
Quand même leur victoire serait certaine, ils n’ont pas encore pris Beauvais ; et s’ils osent se présenter pour en faire le siège, ils donneront le temps à monseigneur le dauphin d’envoyer ses gendarmes pour les exterminer.
D’APREMONT.
Monseigneur le dauphin a bien à faire pour rendre la paix à son royaume ; et si la ruine de mon château pouvait sauver la France, j’y consentirais volontiers... Mais, hélas !... Mort de ma vie ! je parle comme une femme au lieu d’aller à mon poste.
Il va pour sortir.
ISABELLE.
Restez, mon père ! restez, au nom de Dieu ! que voulez-vous voir ? Tenez, voici monseigneur de Montreuil qui vient de faire sa ronde.
Entre de Montreuil.
D’APREMONT, après s’être assis.
Eh bien ?
DE MONTREUIL.
Cette nuit, cinq autres de nos hommes d’armes sont descendus dans le fossé le long d’une corde et se sont rendus aux rebelles.
D’APREMONT.
Ils m’abandonnent tous.
ISABELLE.
Réjouissons-nous, nous aurons cinq bouches de moins à nourrir.
DE MONTREUIL.
Il n’y a pas de quoi se réjouir. Les vilains connaîtront par eux notre position.
D’APREMONT.
Rien sur la route de Beauvais ?
DE MONTREUIL.
Rien.
D’APREMONT.
Les vilains ont-ils fait quelque nouveau mouvement, nous minent-ils ?
DE MONTREUIL.
J’espère que non.
D’APREMONT.
Ils attendent que la famine nous livre sans défense entre leurs mains.
DE MONTREUIL, après un silence.
Peut-être pourrions-nous obtenir une capitulation.
D’APREMONT, avec feu.
Une capitulation ! qu’oses-tu dire ? Des chevaliers ayant encore un souffle de vie, ayant encore l’épée au côté, se rendre à des vilains !
DE MONTREUIL.
Vous êtes le châtelain, je dois vous obéir. Si votre intention est de mourir ici, je mourrai avec vous ; mais pensez à votre fille.
ISABELLE.
Oh ! mon père, je saurai mourir s’il le faut, mais pourquoi rejetteriez-vous ce que les plus braves acceptent ?
D’APREMONT, lui serrant la main.
Je connais ton courage, ma bonne Isabelle. – C’est un ange, Montreuil, que je voulais te donner.
DE MONTREUIL, après un silence.
Que ferons-nous ?
D’APREMONT.
Y a-t-il quelque chevalier d’aventure à qui nous pourrions rendre nos épées ?
DE MONTREUIL.
Ils sont tous du côté de Beauvais.
D’APREMONT.
Et tu veux que Gilbert d’Apremont rende son épée à des vilains ?
DE MONTREUIL.
Votre fille...
D’APREMONT.
Malheureuse enfant ! maudit soit le jour où ta mère te mit au monde !
ISABELLE.
Il n’y a pas de honte à se rendre après une belle défense.
DE MONTREUIL.
La chevalerie le permet.
D’APREMONT.
Quels sont les chefs de cette canaille ?
DE MONTREUIL.
Celui qu’ils appellent le Loup-Garou...
D’APREMONT.
Un assassin ! un voleur de profession !
DE MONTREUIL.
Un Thomas, charpentier de Genêts, et Pierre.
D’APREMONT.
Le scélérat ! l’infâme renégat ! moi, lui rendre mon épée ! Moi, lui crier merci !... à mon valet ! Voilà ce que tu as le front de me proposer ?...
ISABELLE.
Peut-être que ce valet, s’il n’est pas un réprouvé, n’aura pas perdu tout respect pour ses maîtres.
D’APREMONT.
Le misérable ! Jamais il ne touchera mon épée par la poignée. Je mourrai sur la brèche avant cette infamie !
DE MONTREUIL.
Votre...
D’APREMONT.
Non, tu as beau me montrer ma fille ; je la tuerai de ma main s’il le faut, plutôt que de déshonorer ma maison...
ISABELLE.
Ah ! si vous voulez mourir, tuez-moi la première.
D’APREMONT.
Mon Isabelle, toi seule ici tu as le cœur d’un homme.
ISABELLE.
Mais serait-ce déshonorer notre maison ?...
DE MONTREUIL.
Mon redouté seigneur le duc de Berry s’est rendu à un simple archer anglais, à la malheureuse bataille de Poitiers.
D’APREMONT.
Cela est vrai... Oh ! mon Dieu, que tu sais bien humilier notre orgueil !
DE MONTREUIL.
Un chrétien sait recevoir la mort avec courage, mais il ne la cherche pas.
D’APREMONT.
Un chrétien... Tes discours sont d’un moine, non d’un chevalier. Ni ton père ni le mien n’auraient ainsi parlé, tout pieux qu’ils étaient.
ISABELLE.
Écoutez-le, mon père, il vous dit la vérité.
D’APREMONT, après un silence.
Faudra-t-il que j’aille moi-même élever le drapeau blanc ?
DE MONTREUIL.
Je vous épargnerai cette peine.
ISABELLE.
Voici une écharpe blanche, elle peut vous servir.
De Montreuil prend l’écharpe et sort.
D’APREMONT.
Il me semble voir Geoffroy d’Apremont sortir de son tombeau pour me maudire et m’appeler lâche !
ISABELLE.
Geoffroy d’Apremont serait un lâche lui-même, s’il vous donnait ce nom !
D’APREMONT.
Ne blasphème pas ! respecte la mémoire de mon père. Je l’ai vu tout sanglant, son casque fendu par la hache d’un gendarme, refuser son épée à un chevalier banneret... et moi !... On entend de grands cris.
ISABELLE.
Entendez-vous ces cris de joie ? ils acceptent la capitulation.
D’APREMONT.
Tu te trompes. J’entends leur cri de guerre : ils ne donnent point de quartier !
Il se lève.
ISABELLE.
Messire de Montreuil !...
DE MONTREUIL, rentrant.
Les scélérats ! les assassins ! tirer sur un drapeau de paix !
D’APREMONT.
Je l’avais prévu.
DE MONTREUIL.
Toute la troupe du Loup-Garou a répondu à mon cor par une grêle de flèches. C’est un miracle qu’ils ne m’aient pas tué.
D’APREMONT.
Il faut mourir.
DE MONTREUIL.
Les misérables !
D’APREMONT.
Et mourir après une lâcheté ! Nous la rachèterons par notre mort, Montreuil.
DE MONTREUIL.
Je ferai de mon mieux pour mourir en chevalier ; mais vous... blessé comme vous l’êtes...
D’APREMONT.
Les gendarmes me porteront sur un brancard de piques. Ce sera mon lit de mort... celui-là convient au fils de Geoffroy.
DE MONTREUIL.
Mais...
D’APREMONT.
Attendrons-nous que la faim nous ait livrés sans force à ces vautours ? Non, Montreuil ; nos provisions suffisent encore pour un repas. Demain, à l’aube, nous sortirons. Mes soldats me porteront sur leurs épaules, ma bannière marchera devant moi, et j’espère qu’avant que les traîtres aient égorgé leur seigneur, ma bonne épée de Bordeaux aura rendu encore quelque service à son maître.
ISABELLE.
Et moi, que deviendrai-je ?
D’APREMONT.
Isabelle, ton père ne te laissera pas déshonorer.
Il sort.
ISABELLE.
Il le faut ! Je ne pleure pas mon sort... mais mon pauvre père... blessé... S’il tombait vivant entre leurs mains ! Ah ! je vois encore la tête de mon frère qu’ils portaient au bout d’une lance.
DE MONTREUIL.
Monseigneur Gilbert m’a toujours aimé : j’allais être son gendre... Je saurai faire pour lui ce qu’il ferait pour moi, si j’étais blessé.
ISABELLE.
Et que feriez-vous ?
DE MONTREUIL, touchant sa dague.
Je...
ISABELLE.
Quoi !... vous ! vous l’oseriez ! vous, Montreuil !
DE MONTREUIL.
C’est le dernier service qu’un soldat puisse rendre à son ami[60].
ISABELLE, après un silence.
Écoutez-moi. La sainte Vierge m’a inspirée. Il est peut-être un moyen de sauver mon père, de sauver les braves gens qui défendent le château. Quelqu’un doit se dévouer ; il se dévouera. Une fille doit se dévouer pour son père.
DE MONTREUIL.
Que dites-vous ?
ISABELLE.
Nous étions fiancés ; j’avais reçu de vous cet anneau...
DE MONTREUIL.
Hélas !
ISABELLE.
Reprenez-le, si vous aimez mon père, si vous m’aimez.
DE MONTREUIL.
Pourquoi le reprendre ? quel est votre dessein ?
ISABELLE.
Renoncez à moi, je vous en conjure à genoux !
DE MONTREUIL.
Levez-vous, belle cousine, que faites-vous ?
ISABELLE.
Je suis perdue pour vous. – Nous allons tous périr. – Ne pouvez-vous donc reprendre cet anneau ?
DE MONTREUIL.
Je devine que vous voulez faire un vœu, et je le reprends. D’ailleurs, je l’avoue, de mon côté j’ai fait vœu d’entrer en religion si j’échappais aux périls qui nous menacent.
ISABELLE.
Je suis contente. Voici votre anneau ; allez réciter les prières des agonisants pendant que je me préparerai dans mon oratoire.
DE MONTREUIL.
Mais...
ISABELLE.
De grâce, allez, Montreuil, donnez-moi votre main. Nous sommes amis, n’est-ce pas ?
DE MONTREUIL.
Pour toujours.
ISABELLE.
Oui, pour toujours. – Adieu.
Elle sort.
DE MONTREUIL.
Que veut-elle faire ? La sainte Vierge lui soit en aide !
Il sort.
Scène XXV
PIERRE, LE LOUP-GAROU
Le logement de Pierre devant le château assiégé.
PIERRE.
C’est une honte ! Jamais Sarrasins firent-ils rien de pareil ? Un drapeau blanc et celui qui le porte doivent être aussi respectés que le saint sacrement et le prêtre qui le présente au peuple.
LE LOUP-GAROU.
Je me moque de vos usages et de vos lois, messieurs les soldats. Mais ne pensez pas commander ici à vos mercenaires disciplinés ; nous nous sommes armés pour recouvrer nos franchises, et nous faisons une guerre à mort.
PIERRE.
Crois-tu pouvoir commander seul ici, et refuser une capitulation, parce que cela te plaît ?
LE LOUP-GAROU.
Et crois-tu avoir le droit de nous la faire accepter, parce que tu es assez lâche pour craindre encore ceux qui furent tes maîtres ? Que fais-tu ici ? pourquoi n’es-tu pas devant Beauvais ? Le père Jean t’a rappelé.
PIERRE.
Ce n’est pas à toi que je dois rendre compte de ma conduite, brigand ; le conseil fera justice de toi et de tes soldats. C’est à lui que je porterai mes plaintes.
LE LOUP-GAROU.
C’est là que je t’attends. On jugera entre nous deux.
PIERRE.
Jusque-là je suis seul maître dans ce quartier, Laisse-moi.
LE LOUP-GAROU.
Je te laisse, mais songe que je surveille tes mouvements.
UN CAVALIER, entrant.
Capitaines, le révérend père Jean et les nobles chefs de la ligue vous font savoir qu’ils ont pris la ville de Beauvais ; et qu’après l’avoir mise à sac pendant trois jours, ils s’en reviennent avec des engins et des canons pour réduire ce château.
PIERRE.
La ville a donc été prise d’assaut ?
LE CAVALIER.
Non, les bonnes gens nous ont ouvert les portes. Il faisait beau voir fuir les bourgeois, crier les femmes, brûler les maisons ! Ah ! nous avons fait un joli butin en argent et en meubles, sans compter plus de cent gros bourgeois que l’on garde pour en tirer rançon.
PIERRE, à part.
Dans quel abîme me suis-je précipité !
LE LOUP-GAROU.
Nos gens seront-ils bientôt ici ?
LE CAVALIER.
La cavalerie me suit de près ; le capitaine Siward mène l’avant-garde : vous connaissez sa diligence.
LE LOUP-GAROU.
Voilà qui avancera nos affaires. Adieu, valet d’Apremont ; j’aurai un compte à régler avec toi, un de ces jours.
Il sort avec le cavalier.
UN PAYSAN, entrant.
Capitaine, la grosse Marion vient de sauter par une fenêtre pour se rendre à nous. Voulez-vous l’interroger ?
PIERRE.
Qu’elle vienne.
MARION, entrant.
Comme te voilà ! comme vous voilà bien vêtu, messire Pierre ! Qui vous aurait jamais reconnu avec cette belle robe de satin ?
PIERRE.
Tu t’es sauvée du château...
MARION.
Oui, il n’y a plus de vivres.
Elle lui fait un signe.
PIERRE, au paysan.
Retire-toi. Plus de vivres, dis-tu ? Pourquoi donc ne faisiez-vous pas une sortie pour vous emparer de ces bœufs qu’on faisait paître au bord du fossé ?
MARION.
La garnison était trop faible, et nous pensions que vous nous tendiez un piège. Mais lisez cette lettre.
PIERRE.
Cette lettre... à moi... et de madame Isabelle !
MARION.
Pauvre dame ! elle a bien pleuré en l’écrivant.
PIERRE.
Je n’en puis croire mes yeux !
MARION.
Lisez, vous serez bien plus étonné.
PIERRE, après avoir lu.
Tu mens, Marion ; ta maîtresse n’a pu écrire cela !
Il relit la lettre.
« Maître Pierre, si vous voulez faire sortir mon père, messire de Montreuil et la garnison du château, et les faire parvenir en lieu de sûreté, je me mettrai à votre merci, je consentirai à devenir votre femme. Si vous acceptez cette proposition, engagez votre foi sur les saints Évangiles, que porte la personne qui vous rendra cette lettre. »
MARION.
Hélas ! malheureuse damoiselle !... son père est blessé, et elle veut lui sauver la vie...
PIERRE.
Infortunée !
MARION.
Voici un Évangile ; prêtez le serment qu’elle exige.
PIERRE.
Non, je ne suis pas encore assez cruel pour accepter son offre.
MARION.
Quoi ! vous ne voulez pas !
PIERRE.
Je la sauverai, ou je perdrai la vie... Je ne lui demande qu’une grâce ! que je puisse être encore son écuyer !... Hélas ! je ne puis, je ne dois pas le demander !
MARION.
Demandez de l’argent, tout ce qu’il vous plaira ; mais vous avez promis de la sauver.
PIERRE.
Je veux mourir pour elle. Écoute. Notre armée est en marche : elle revient de Beauvais. Demain je ne pourrai rien entreprendre. Il faut que, cette nuit même, vous quittiez le château.
MARION.
Cette nuit ? où irons-nous ?
PIERRE.
À Senlis. Sur cette route vous êtes moins exposés à rencontrer nos partis. J’écarterai les sentinelles... Et quant au Loup-Garou... j’irai l’attaquer, s’il le faut... J’y périrai... n’importe !... Retourne à ta maîtresse, et dis-lui...
MARION.
Comment pourrai-je rentrer sans être vue ? Écrivez ce que vous avez à dire, et lancez la lettre avec une flèche, à la quatrième meurtrière de la tour carrée.
PIERRE.
Puissent tous les saints les guider dans leur marche ! – Je vais écrire la lettre. Viens avec moi.
MARION.
Heureusement que la lune se lève tard aujourd’hui.
Ils sortent.
Scène XXVI
GILBERT D’APREMONT, porté en litière, ISABELLE, DE MONTREUIL, HOMMES D’ARMES, blessés, UN PAYSAN, servant de guide
Un chemin au milieu des bois, à quelque distance du château. Il est nuit.
LE PAYSAN.
Maître Pierre ne peut encore nous joindre. Il est auprès du Loup-Garou, et va le mener à l’escalade du château vide. – La nuit est sombre et nous favorise.
DE MONTREUIL.
Marchons, marchons, au nom de Dieu ! ne l’attendons pas. Nous avons bien fait de quitter nos armures, nous avons une longue traite à faire avant le jour.
D’APREMONT.
Mon pauvre château !
ISABELLE.
Marchons, marchons !
UN HOMME D’ARMES.
J’entends des pas de chevaux et un bruit d’armes devant nous.
LE PAYSAN.
Je vais voir qui ce peut être, attendez-moi.
DE MONTREUIL.
Tu ne nous quitteras pas, coquin ; et si nous sommes découverts, je t’enfonce cette dague dans le corps.
D’APREMONT.
Silence, au nom du ciel ! Quittons le chemin et enfonçons-nous dans le bois.
DE MONTREUIL, bas.
Le bruit se rapproche. J’entends des voix confuses.
UNE VOIX.
Qui vive ?
Ils commencent à entrer dans le bois.
D’APREMONT, bas.
Silence !
LA VOIX.
Holà ! de ce côté. En avant, les éclaireurs ! Qui vive ?
D’APREMONT, bas au paysan.
Réponds le mot des vilains.
LE PAYSAN.
Communes ! Leufroy !
LA VOIX.
Quel village ?
LE PAYSAN.
Genêts !
UNE AUTRE VOIX.
Holà ! Thomas ! Thomas de Genêts, parle-moi !
LE PAYSAN.
Il n’est pas ici. Qui êtes-vous ?
LA PREMIÈRE VOIX.
Qui que vous soyez, halte ! En avant, vous autres.
D’APREMONT.
Nous sommes perdus. – Laissez-moi, et sauvez-vous. Montreuil, je te recommande ma fille.
ISABELLE.
Je ne vous quitte pas.
DE MONTREUIL.
Sauvez-vous, cousine, nous allons le porter sur nos épaules.
D’APREMONT, à Isabelle.
Fuis, ou bien il faudra que je te tue.
LA PREMIÈRE, VOIX.
Archers, les voici ; lancez !
D’APREMONT, tirant son épée.
Isabelle, approche !...
Au moment de la frapper, il est atteint d’une flèche.
Ah !... Montreuil... tue la pauvre fille !
Il meurt.
DE MONTREUIL.
Ah ! si nous avions nos armures !...
ISABELLE, à genoux.
Tuez-moi, mon cousin.
SIWARD, entrant avec Brown et des paysans armés.
Leufroy ! à mort ! à mort ! – Eh ! que vas-tu faire, gros porcher !
Il attaque Montreuil, le tue, et saisit Isabelle.
ISABELLE.
Au nom de Dieu et de sa sainte mère, ayez pitié de moi !
SIWARD.
Ne crains rien, mon enfant. Es-tu jolie ?
ISABELLE.
À votre armure, je crois que vous êtes un chevalier. Ayez pitié de la fille d’un chevalier.
SIWARD.
Parbleu ! c’est ma belle hôtesse. N’ayez aucune peur. Les belles n’ont jamais eu à se plaindre de moi.
Il ôte son casque.
ISABELLE.
Vous, monseigneur de Siward ! je me fie à votre chevalerie.
SIWARD.
Ne craignez rien, madame ; j’aurai pour vous plus de courtoisie que vous n’en avez eu pour moi. Vous m’avez donné place dans votre château, je prétends vous donner place dans mon lit.
Il l’embrasse.
ISABELLE.
Au nom de Dieu, Monseigneur !
SIWARD.
Ne criez pas, cela est inutile. – Brown, mène nos gens au château. Il y a un noble butin à faire. La chambre verte... c’est là qu’est le trésor. Edmond t’y conduira. Je vois là-bas une cabane... Je reviendrai dans un quart d’heure... – Louis, Derrick, suivez-moi !
BROWN.
Toujours le même ! Allons, enfants, au château ! au pillage ! Le capitaine va dire ses patenôtres.
Siward monte à cheval, et ses écuyers placent Isabelle évanouie devant lui. Brown sort avec les Anglais et les paysans, après avoir dépouillé les morts.
Scène XXVII
DERRICK, LOUIS, gardant trois chevaux sellés
Devant une cabane abandonnée au milieu des bols. Il est nuit.
LOUIS.
J’ai vu, Dieu merci, plus d’une ville mise à sac ; jamais cris ne m’ont fait tant de mal à entendre.
DERRICK.
C’est que tu es encore bien doux de sel. Satan violerait les onze mille vierges devant moi, que je ne sourcillerais pas.
LOUIS.
Vieux blasphémateur ! il t’arrivera malencontre pour ton impiété.
DERRICK.
Nous verrons.
LOUIS.
C’est une jeune dame de noble race.
DERRICK.
Eh bien ! le capitaine est noble aussi.
LOUIS.
C’est bien consolant pour elle.
DERRICK.
Sans doute ; elle ne déroge pas.
LOUIS.
Je n’aurais pas cru le capitaine capable de cette mauvaise action.
DERRICK.
Bah ! il en a fait bien d’autres. Seulement ses cheveux commencent à grisonner ; il n’est plus aussi diable qu’au temps du siége de Rennes.
LOUIS.
Que faisait-il donc alors ?
SIWARD, sortant de la cabane.
Mon cheval !
DERRICK.
Le voici, capitaine.
SIWARD.
Il y a là dedans une femme... que vous emporterez au village. Faites-lui une litière avec des lances et vos manteaux. Ayez soin d’elle, vous m’en répondez sur votre tête.
DERRICK.
C’est bon, capitaine.
Ils sortent.
Scène XXVIII
SIWARD, ISABELLE
Une chambre du château d’Apremont.
ISABELLE.
Laissez-moi embrasser vos genoux !
SIWARD.
Relevez-vous, de grâce.
ISABELLE.
Non, laissez-moi demeurer dans cette posture. Vous m’avez rendue la plus malheureuse des femmes ; il faut que vous m’accordiez une grâce, ou que vous me donniez la mort.
SIWARD.
Parlez, madame ; mais, je vous en supplie, asseyez-vous.
ISABELLE.
S’il y a quelque chevalerie en vous, sire capitaine, ayez pitié d’une malheureuse damoiselle que vous pouvez arracher au déshonneur. Si vous êtes chrétien, messire Siward, donnez-moi votre main devant un prêtre ; daignez m’épouser !
SIWARD, étonné.
Vous épouser !
ISABELLE.
Pour prix de cette faveur, tous mes biens en Artois, tout ce qui appartenait à mon père, tout ce qu’on pourra recueillir de sa fortune dans des temps moins désastreux, tout cela, je le mets à vos pieds, monseigneur, et je me tiendrai pour heureuse si vous l’acceptez.
SIWARD.
Madame !
ISABELLE.
Au nom de notre Sauveur, ne me refusez pas.
SIWARD.
Vous refuser !
À part.
Malepeste ! quelque sot !
Haut.
Fort honoré de votre préférence.
ISABELLE.
Vous consentez à me donner votre nom ?
SIWARD.
De tout mon cœur, foi de chevalier. Vous savez que j’en ai toujours eu le désir.
ISABELLE.
Encore une grâce. Permettez-moi de me retirer 3dans un couvent, chez l’abbesse de Saint-Denis, ma parente. Je sens que je ne pourrais vivre auprès du meurtrier... Je ne serais qu’un fardeau pour vous... La vie d’aventure que vous menez...
SIWARD.
Madame, il m’en coûtera sans doute de me séparer de vous...
ISABELLE.
Ah ! monseigneur...
SIWARD.
Si vous l’exigez... j’y consens... pour quelque temps encore.
ISABELLE.
La dernière prière que je vous ferai... messire de Siward... si... j’avais... un fils, permettez-moi de l’élever, permettez qu’il porte le nom d’Apremont ; le fief que je vous apporte en dot, et dont il sera l’héritier après vous, lui en donne le droit.
SIWARD.
Le nom de Siward en vaut bien un autre. Mais pourtant, qu’il s’appelle Apremont, je ne m’y oppose pas. Quant à l’élever, apprenez-lui votre clergie, rien de mieux ; mais, à seize ans, envoyez-le-moi, je lui apprendrai à porter la lance, et j’en ferai un homme de guerre.
ISABELLE.
Je vais à l’instant écrire la donation de mes biens.
SIWARD.
Nous parlons d’élever notre fils, et nous ne sommes pas même sûrs... Ah çà !... vous vous retirez au couvent, à la bonne heure... mais l’hiver prochain, quand on ne se battra plus... Suis-je condamné à rester sans femme ?... Me comprenez-vous ? On ne renonce pas à un si friand morceau...
Il lui prend la main.
ISABELLE.
Siward ! vous avez du sang sur votre épée...
Elle fond en larmes.
SIWARD.
Allons... calmez-vous... Je vous demande pardon de vous parler de ces choses-là.
À part.
Laissons-la pleurer, et nous verrons ensuite.
ISABELLE.
Faites venir un prêtre... Il faut qu’il se presse... je suis bien mal.
SIWARD.
J’en suis désolé ; mais cela ne sera rien. Remettez-vous. – Voulez-vous que je prie le père Jean de bénir notre mariage ?
ISABELLE.
Non... pas ce prêtre, il me fait horreur.
SIWARD.
Eh bien ! voulez-vous un brave Irlandais, moine noir et confesseur de ma compagnie ?
ISABELLE.
S’il a les pouvoirs... faites-le appeler.
SIWARD, à un écuyer.
Holà, Louis, va chercher le moine, qu’on le décrasse, qu’on lui mette sa belle soutane, et qu’il vienne à la chapelle avec son livre. – Moi, je vais cher. cher de ce pas mes bons amis Eustache de Lancignac et Perducas d’Acuna : ils nous conduiront à l’autel. – Vous êtes bien pâle, ma chère Isabelle... Ne voulez-vous point prendre quelque chose ?
ISABELLE.
J’aurai encore assez de force pour descendre à la chapelle.
SIWARD.
Derrick, va chercher un verre de vin épicé pour madame. Apporte aussi une feuille de parchemin et une plume. – Je vais chercher mes amis, et je reviens auprès de vous.
Il sort.
Scène XXIX
FRÈRE JEAN, PIERRE
Une salle au château d’Apremont.
PIERRE.
Que la foudre m’écrase si je ne me venge !
FRÈRE JEAN.
Insensé, où vas-tu ?
PIERRE.
Il est dans le château. Je vais le chercher et le tuer.
FRÈRE JEAN.
Pierre, il faut maintenir la concorde entre nous et nos alliés, pour le succès de notre sainte entreprise.
PIERRE.
Maudite soit votre sainte entreprise, maudit celui qui m’y entraîna !
FRÈRE JEAN.
C’est pour une femme que tu t’exposes à voir se fermer la brillante carrière qui s’ouvrait devant toi, c’est pour une femme que tu vas manquer à tes serments !
PIERRE.
C’est pour elle que j’ai tiré mon épée. Croyez-vous que je me souciais de vos franchises ? Mort de ma vie ! je me suis parjuré, j’ai trahi mon maître ! Je suis un autre Judas ! je serai damné ! Et je ne me vengerais pas !
Il sort.
FRÈRE JEAN.
Il m’échappe, et les vilains et les aventuriers, qui se détestent déjà, vont s’entrebattre. Il faut l’arrêter de gré ou de force. – Ah ! je vois fort à propos le Loup-Garou.
Il sort.
Scène XXX
SIWARD, PERDUCAS D’ACUNA, EUSTACHE DE LANCIGNAC, AVENTURIERS, PAYSANS, sortant de la chapelle
La cour du château d’Apremont. La porte de la chapelle est ouverte.
SIWARD, à ses écuyers.
Courez vite, priez le père Jean de venir sur-le-champ. Il saura lui donner quelque baume.
PERDUCAS.
Je crains qu’elle n’en ait plus besoin.
SIWARD.
En tout cas vous êtes témoins que nous sommes mariés.
PERDUCAS.
Cap saint Antonin ! je le certifierais devant le pape.
EUSTACHE.
C’est après avoir dit oui qu’elle est tombée comme si elle pâmait.
PIERRE, derrière la scène.
Mariée ! mariée à Siward !
VOIX derrière la scène.
Arrêtez, arrêtez !
PIERRE, entrant l’épée à la main.
Le voici ! – Traître, tu mourras de ma main !
PERDUCAS.
Holà ! que nous veut cet ivrogne ?
PIERRE, jetant son gantelet à la tête de Siward.
Défi à toi, lâche ! je te le jette au front ! Défends-toi ou je te tue.
SIWARD.
Que veut dire cet insolent ?
PAYSANS.
Il est fou ! il faut le désarmer !
PIERRE.
Retirez-vous ; quiconque m’approche est mort !
SIWARD.
Est-ce un duel que tu oses me proposer ? Toi...
PIERRE.
En garde, scélérat !
SIWARD.
Tu ne mériterais pas que je te fisse cet honneur.
Il tire son épée.
Place ! place ! et franc jeu !
Ils se mettent en garde ; entrent Frère Jean et le Loup-Garou sa masse d’armes à la main.
FRÈRE JEAN.
Bas les armes, enfants, devant une chapelle !...
LE LOUP-GAROU.
Ventre de bœuf ! deux chefs de la ligue tirer l’épée l’un contre l’autre !
PIERRE, à Siward.
Quand tous tes pillards seraient avec toi, tu mourras.
TOUS.
Séparez-les ! bas les armes !
LE LOUP-GAROU.
Bas les armes ! j’assomme le premier qui lève l’épée.
SIWARD.
Laissez-nous, laissez-nous !
LE LOUP-GAROU, frappant Pierre.
Tiens, je te devais cela.
PIERRE.
Ah !
Il tombe.
SIWARD, au Loup-Garou.
Par la mort et le sang ! pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te regarde pas ?
LE LOUP-GAROU, levant sa masse.
Ah ! ah ! en veux-tu tâter aussi ?
BROWN, lui retenant le bras.
Doucement, compère, en voilà assez de fait.
FRÈRE JEAN.
Arrêtez, mes enfants ! point de querelles entre frères. Baisse ta masse, Franque, et vous, capitaine, remettez l’épée au fourreau.
SIWARD.
A-t-on jamais vu s’entremettre ainsi dans un combat, quand on a crié, Franc jeu !
FRÈRE JEAN.
Que ce débat finisse. – Aussi bien, je vois que l’auteur de la querelle en a porté la peine. – Dieu lui fasse paix !
EUSTACHE, regardant le cadavre de Pierre.
Par la barbe de Mahom ! il lui a enfoncé la cervelle dans le gosier.
LE LOUP-GAROU.
Je ne donne jamais qu’un coup.
PERDUCAS, maniant la masse du Loup-Garou.
Corps du Christ ! compagnon, vous avez là un bel outil !
SIWARD.
Révérend père, il y a là dedans une dame malade qui a besoin de vos secours.
FRÈRE JEAN.
Isabelle d’Apremont !
SIWARD.
Elle-même ! à présent Isabelle Siward !
FRÈRE JEAN.
Ô ciel !
Il entre dans la chapelle.
Scène XXXI
LE LOUP-GAROU, BROWN
Le camp des révoltés auprès du château d’Apremont. On entend sonner les trompettes, on volt des charlots chargés de bagages et tous les préparatifs d’un départ.
BROWN.
Enfin je l’entends, ce boute-selle si désiré ! Je croyais que nous resterions ici jusqu’au jour du jugement.
LE LOUP-GAROU.
Oui, j’entends bien les trompettes de vos aventuriers et le cor de mon lieutenant, mais le diable sait si cela fera bouger les vilains.
BROWN.
La robe noire a fait lever la grande bannière. Nous allons à Meaux.
LE LOUP-GAROU.
Nous devrions y être déjà ; mais ces lourdauds de paysans veulent rester dans leur pays. Morand, Simon, Renaud, ne parlent que de retourner à leur charrue.
BROWN.
Pauvre espèce ! toute l’ambition d’un vilain est d’avoir un bel attelage de bœufs et un beau fumier. Par le sourcil de Notre-Dame ! ils mériteraient qu’on les étouffât dans leur fumier.
LE LOUP-GAROU.
Quant à moi, j’ai bientôt oublié charrue, forge, et tout, une fois que j’ai goûté de la vie d’homme d’armes.
BROWN.
Renaud, dis-tu, veut aussi retourner à son fumier ?
LE LOUP-GAROU.
Il me l’a dit lui-même. Je l’avais cru d’abord un luron, à cause de son affaire avec le sénéchal ; mais il n’a du courage que par accès, et comme un autre a la fièvre.
BROWN.
Le voici qui vient de ce côté avec Barthélémy.
LE LOUP-GAROU.
Il faut les faire boire pour leur remettre le cœur au ventre. Holà ! hé ! Renaud ! Renaud !
BROWN, montrant une bouteille.
Venez ici tous deux ; venez boire avec nous le coup de l’étrier.
RENAUD, s’approchant.
Volontiers, capitaine. Le révérend père Jean veut donc aller à Meaux pour en chasser la noblesse qui s’y est réfugiée ?
BARTHÉLÉMY.
À votre santé, camarades. – Je ne sais si nous serons assez nombreux pour aller jusque-là.
BROWN.
Comment ?
BARTHÉLÉMY.
Morand et la moitié des hommes d’Apremont veulent rester chez eux.
BROWN.
Les lâches !
LE LOUP-GAROU.
Il faut empêcher ces coquins de quitter ainsi l’armée.
RENAUD.
Écoute, Franque ; ces braves gens se sont battus comme toi, tant qu’ils ont eu des ennemis devant eux. À présent que nul danger ne nous menace, ils veulent revoir leur famille ; et puis il faut bien achever la récolte.
LE LOUP-GAROU.
Eh ! qu’ils laissent là leur récolte, par cent panerées de diables ! Ils auront assez à récolter dans les hôtels de Paris ou de Meaux.
RENAUD.
Il faut bien qu’il y ait quelqu’un pour cultiver la terre.
BROWN.
Bon ! il faut laisser cela à la canaille.
BARTHÉLÉMY.
Qu’appelez-vous canaille ?
RENAUD.
Et comment ferait-on sans laboureurs ? Vous ne pourriez vivre sans eux, sire archer.
BROWN.
Tout homme qui se sent un cœur dans le ventre et un arc au poing, ne doit semer ni blé ni avoine, puisqu’il peut prendre du pain pour lui, de l’avoine pour son cheval dans les coffres de ses ennemis.
RENAUD.
Vous m’avez l’air d’avoir pour ennemis tous les gens paisibles.
LE LOUP-GAROU.
Renaud, ne dis pas d’injures à mon ami l’Anglais, entends-tu ? – Il faut faire travailler les nobles, leur faire porter le fumier, et leurs femmes scieront le blé et porteront la hotte. Ce sera pour crever de rire, que de les regarder, courbées en deux et se donnant des ampoules à manier la faucille de leurs petites mains blanches.
BARTHÉLÉMY.
L’idée n’est pas mauvaise, et nous autres, pendant ce temps-là, nous nous gobergerons dans les châteaux.
RENAUD.
Si vous continuez comme vous avez commencé, vous risquez bien d’être obligés de travailler vous-mêmes. Il ne restera bientôt plus de nobles dans le Beauvoisis.
LE LOUP-GAROU.
Nous verrons, nous verrons. – Est-ce que tu veux nous quitter aussi, Renaud ?
RENAUD.
Non, je ne puis, j’ai juré au père Jean de le suivre partout.
BROWN, à Barthélémy.
Et toi, compère, est-ce à remuer du fumier que tu destines ces bras-là ? On jurerait qu’ils n’ont été faits que pour manier le sabre.
BARTHÉLÉMY.
Moi, voyez-vous, je resterai encore jusqu’au sac de Paris ; après quoi, ma petite fortune sera faite, ou bien j’aurai les reins cassés.
LE LOUP-GAROU.
Voilà ce qui s’appelle parler d’or. Trinquons ensemble, mon brave.
RENAUD.
Oh ! oh ! d’où vient ce tumulte ? On entend des cris confus.
BARTHÉLÉMY.
Tout le camp est en émeute.
Entrent Frère Jean suivi d’une troupe d’aventuriers, et Morand avec une troupe de paysans.
FRÈRE JEAN.
Vous nous suivrez à Meaux, vilains ; je vous l’ordonne sous peine d’excommunication.
MORAND.
Oh ! nous ne craignons pas les excommunications. Vous nous avez dit vous-même de n’en point être effrayés, et que personne n’en mourait.
FRÈRE JEAN.
Si vous osez me désobéir, si vous ne suivez pas la grande bannière, je saurai vous y contraindre.
MORAND.
Mais, mon révérend père, vous nous avez dit dans le temps que nous étions tous libres de faire ce que bon nous semblerait. Pourquoi maintenant, si bon nous semble de rester, ne resterions-nous pas ? Et puis nos champs ont besoin de nous.
FRÈRE JEAN.
Vos femmes les cultiveront.
MORAND.
Et si quelque malandrin vient courir le pays, qui défendra nos femmes ?
FRÈRE JEAN.
Nous avons purgé le pays de malandrins. Il n’y a rien à craindre.
MORAND.
N’importe. Je ne suis pas un soldat, moi : je suis soûl de la guerre, et je reste chez moi.
FRÈRE JEAN.
Espèce indocile ! misérables vilains ! il n’y a donc que les châtiments qui puissent vous toucher ? – Le premier qui quittera la bannière sera pendu comme déserteur.
LE LOUP-GAROU.
Bien dit.
MORAND.
Pendu ! Qui êtes-vous donc pour nous faire pendre ? quel droit...
RENAUD.
Allons, Morand, tais-toi.
FRÈRE JEAN.
Je suis votre capitaine ! Vous m’avez choisi, vous devez m’obéir.
MORAND.
Nous vous avons fait notre capitaine ; eh bien ! maintenant nous vous défaisons.
FRÈRE JEAN.
Insolent !
Aux aventuriers.
Holà messieurs ; aidez-moi à châtier cet audacieux rebelle.
SIWARD.
Allons ! flamberge au vent !
Il s’avance avec quelques aventuriers pour arrêter Morand.
MORAND, à ceux de son parti.
À l’aide ! mes amis, soutenez-moi !
SIMON, à Frère Jean.
Père Jean, nous vous aimons tous ; mais ne faites pas de mal à Morand, ou nous serions pour lui contre vous.
RENAUD, à Frère Jean.
Mon père, laissez-le dans son village ; soldat de mauvaise volonté ne peut nous être utile.
FRÈRE JEAN.
Non, non ; il faut un exemple aux autres.
SIWARD.
Apprenons à ces marauds la discipline militaire ! À Siward ! à Siward !
BROWN, à Frère Jean.
Voulez-vous que je lui envoie une flèche ? Cela sera bientôt fait.
LE LOUP-GAROU.
Tire, mon brave ; je n’ai jamais aimé ce poltron de Morand.
RENAUD, à Brown qui bande son arc.
Arrête, ou tu vas faire tuer la moitié de nos gens par l’épée de leurs frères.
SIMON.
Ne souffrons pas que ces Anglais maltraitent un d’entre nous.
MANCEL, à Morand.
Saint Leufroy te le pardonne, Morand ! je crains bien que tu ne causes quelque grand malheur.
THOMAS, aux paysans.
Gens d’Apremont, si les Anglais vous attaquent, comptez sur nous.
FOULE DE PAYSANS.
N’abandonnons point ceux d’Apremont ! soutenons l’honneur de la France ! À bas les Anglais ! Montjoie Saint-Denis !
Tumulte.
RENAUD, à Frère Jean.
Mon père, voyez quelle guerre va s’émouvoir. Cédez-leur quelque chose.
MANCEL, à Morand.
Les épées sont tirées, et voilà qu’on bande les arcs. Allons, Morand, un peu moins de raideur.
MORAND, effrayé.
Je consentirai volontiers à tout ce qui sera raisonnable, mais qu’on empêche ce gros Anglais de me lancer sa flèche.
MANCEL.
Bonnes gens, silence ! accommodement !
RENAUD.
Bas les armes ! De par saint Leufroy ! point de querelles dans la ligue des communes !
MORAND.
Je ne veux causer la mort de personne. Ainsi, je suis prêt à rester jusqu’à la Saint-Jean, si le révérend père s’en contente.
FRÈRE JEAN.
Un capitaine traiter avec ses soldats !
SIWARD, à Frère Jean.
C’est ici la tour de Babel ; mais nous ne sommes pas les plus forts.
PERDUCAS.
Ils sont vingt contre un ; ils vont nous assommer, si vous ne consentez à ce qu’ils demandent. Encore si nous étions à cheval !
FRÈRE JEAN, après un silence.
Puisque ces nobles capitaines m’en requièrent, je veux bien lui pardonner. Qu’il serve encore jusqu’à la Saint-Jean ; quand même il y aurait alors des ennemis en campagne, il pourra se retirer, ainsi que ses pareils. Il restera toujours assez de braves avec moi.
À part.
Si je puis les tirer une fois de leur pays, je saurai bien les empêcher d’y revenir de sitôt.
RENAUD.
La paix ! la paix ! vive saint Leufroy ! À Meaux ! Vite, en marche !
TOUS.
À Meaux ! marchons à Meaux ! finissons la guerre !
PERDUCAS, à Siward.
Vous voyez ce que l’on gagne à servir ces misérables. Ils veulent déjà se débander, sans songer que les seigneurs français ont encore une armée à Paris.
SIWARD.
Que voulez-vous ? autant vaudrait laver la tête d’un âne qu’obliger un vilain.
Ils sortent.
Scène XXXII
FRÈRE JEAN, CHEFS DES PAYSANS et DES AVENTURIERS
Le camp des insurgés sur la route de Meaux. Tente du conseil.
FRÈRE JEAN.
Vous le voyez, ils viennent pour traiter avec nous. Si chacun s’en était allé à sa maison, ils auraient repris du cœur et nous auraient détruits en détail.
SIMON.
Je ne dis pas non ; mais voyons un peu ce qu’ils demandent.
FRÈRE JEAN.
Qu’on les fasse entrer.
Entrent Jean de Bellisle et maître Yvain Langoyrant.
FRÈRE JEAN.
Qui êtes-vous, messires, et que venez-vous demander au conseil suprême des communes ?
BELLISLE.
Très illustre capitaine, je me nomme Jean de Bellisle, chevalier de l’hôtel du roi. Voici le docte maître messire Yvain Langoyrant, docteur en droit, et nous sommes envoyés par mon redouté seigneur, le duc de Normandie, régent de ce royaume, pour traiter de la paix.
LANGOYRANT.
C’est-à-dire, écouter vos plaintes et y faire droit si le cas y échet. BELLISLE.
C’est ce que vous expliqueront ces lettres dont nous sommes porteurs.
Il remet des lettres à Frère Jean.
LANGOYRANT, à Bellisle.
Messire Jean, c’est moi qui dois parler, comme vous le savez. Mon discours est prêt ; laissez-moi faire.
BELLISLE, bas.
Que Dieu y ait part ! mais abrégez, croyez-moi.
LANGOYRANT.
Неm ! hem ! hem !
Il ôte son bonnet et salue trois fois, puis se couvre, tousse et retrousse ses longues manches.
FRÈRE JEAN.
Commencez donc, nous écoutons.
LANGOYRANT.
Monsieur et messieurs, Anaxagoras, en son temps, philosophe et physicien de Denys Ier, roi de Sicile, interrogé par ledit Denys sur ce qui, à son sentiment, était le plus utile au bonheur d’un royaume, répondit qu’il y avait deux choses nécessaires à la félicité publique, et une troisième qui était indispensable.
MORAND, à Renaud.
Comprends-tu ?
SIMON.
Que nous vient-il conter ?
LE LOUP-GAROU.
Est-ce français qu’il parle ?
FRÈRE JEAN.
Au fait, docteur.
LANGOYRANT.
Or çà, monsieur et messieurs,
Il se découvre.
voulez-vous savoir quelles sont ces trois choses ? Au sentiment du philosophe Anaxagoras, c’était primò, un bon roi ; secundò, un terroir fertile ; tertiò, la paix, id est, la bonne intelligence entre le roi et son peuple. Mais peut-être, monsieur et messieurs,
Il se découvre.
que vous m’arrêterez ici, m’objectant que ce savant philosophe susdit, Anaxagoras, n’était qu’un païen mécréant, en ce qu’il adorait les faux dieux, et qu’il était entièrement, et comme disent les Latins nos maîtres, toto cœlo, totâ via aberrans en matière de religion, ignare des commandements de notre sainte mère l’Église, et de la doctrine sacrée de notre maître et Sauveur Jésus-Christ.
Il se découvre et se signe ; le Frère Jean et tous les assistants l’imitent.
Or çà, monsieur et messieurs,
Même geste jusqu’à la fin.
quelle réponse ferai-je, croyez-vous, à votre objection ? – Concluante. Et j’argumente ainsi. Hem ! hem ! hem ! – Oui, sans doute, monsieur et messieurs, Anaxagoras était un païen mécréant, et comme tel est damné comme un sarment[61]. Mais ce néanmoins, monsieur et messieurs, sa réponse au roi Denys, par une permission toute divine, était sage, imò conforme aux saintes Écritures, et je le prouve. – Quomodò ? – Sic. Quelles choses sont utiles au bien public ? Primò, un bon roi. Or, que dit l’Écriture ? « Dominator hominum, justus dominator in timore Dei, sicut lux aurora, oriente sole, manè absque nubibus, rutilat, et sicut pluviis germinat herba de terra... »
LE LOUP-GAROU.
C’est trop fort !
SIMON.
Je crois qu’il nous charme avec des paroles magiques.
SIWARD.
S’il continue, je m’endors tout à fait.
FRÈRE JEAN.
L’ennuyeux orateur ! Au fait ! au fait !
LANGOYRANT, continue au milieu d’un tumulte toujours croissant.
Secundò, disait Anaxagoras, un terroir fertile. Pour prouver cela, je ne suis guère embarrassé. Dieu ne dit-il pas à Abraham : « Je bénirai ta lignée et je lui donnerai la terre de Chanaan. » Or, quid la terre de Chanaan ? sinon un terroir fertile : « Quœ revera fluit lacte et melle, ut ex his fructibus... »
SIMON.
À bas le docteur !
LE LOUP-GAROU.
Il nous ensorcelle ; je vais l’assommer.
THOMAS.
Mettons-le en chair à pâté, s’il ne se tait.
FRÈRE JEAN.
Parleur impitoyable, ne sauriez-vous nous dire en peu de mots ce que vous avez à nous proposer ?
LANGOYRANT.
Tout beau, monsieur et messieurs, je n’en suis encore qu’à mon exorde.
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! ton exorde et toi, vous pouvez aller à tous les diables !
À Bellisle.
– Et vous, ne sauriez-vous parler clairement et nous expliquer en deux mots ce que celui-ci ne pourrait dire en vingt mille ?
LANGOYRANT, à Bellisle.
Partons.
BELLISLE, à Frère Jean.
Très volontiers ; mais d’abord permettez-moi de vous demander, de la part de monseigneur le duc de Normandie, pourquoi vous avez pris les armes.
FRÈRE JEAN.
Ne le sait-il pas ? Pourquoi le lion attaque-t-il l’homme ? n’est-ce pas parce que l’homme lui fait la guerre ? Les vilains de France se sont armés contre les nobles parce que les nobles les traitaient en ennemis.
LANGOYRANT.
Laissez-moi lui répondre ; j’ai de quoi le mettre à quia.
BELLISLE.
Non, maître Yvain, ne dites mot. – Mon père, votre réponse est juste ; mais pourquoi n’avez-vous pas eu assez de confiance dans la royale bonté de monseigneur le duc pour lui adresser vos doléances ? Il s’est affligé de ne les point connaître, car il ne désire autre chose que de contenter petits et grands. En France, vous le savez, le roi est le roi du peuple.
FRÈRE JEAN.
Sire chevalier, voyez-vous cette épée ? elle nous a fait rendre justice ; elle a mieux plaidé notre cause qu’une plume d’oie. C’est par elle que nous voulons délivrer tous les serfs de France.
PAYSANS.
Oui ! oui ! nous les délivrerons tous !
BARTHÉLÉMY.
Et nous voulons que tous les Français soient nobles.
LE LOUP-GAROU.
Excepté les nobles. Chacun à son tour.
BELLISLE.
Par la messe, mon révérend père ! vous avez là une belle épée de Bordeaux, et vous semblez savoir vous en servir aussi bien que d’une crosse d’abbé. Mais, ne vous en déplaise, ne pourrait-on entrer en accommodement, ne pourrait-on affranchir tous les serfs du royaume sans qu’il fût besoin qu’une moitié de la France égorgeât l’autre moitié ?
SIMON.
En voici un raisonnable à la fin.
THOMAS.
On l’entend du moins.
RENAUD.
Laissez-le parler.
FRÈRE JEAN.
Je vois où vous voulez en venir, monseigneur. Mais vous ne nous ferez pas déposer les armes avec vos paroles dorées.
BELLISLE.
Écoutez-moi, bonnes gens ; mes chers compatriotes, écoutez-moi, et vous jugerez si je veux vous tromper. Monseigneur le duc vous engage à exposer vos griefs librement et avec franchise ; il y fera droit. Tout ce que vous demanderez, il vous l’accordera ; car vous ne demandez rien que de juste, j’en suis certain.
LE LOUP-GAROU.
Je veux que le roi me fasse baron, ou sinon...
FRÈRE JEAN.
Silence, Loup-Garou.
RENAUD.
Plus de corvées ! franchise entière !
PAYSANS.
Oui, plus de corvées ! Communes ! franchises !
BELLISLE.
Si ce sont là vos demandes, elles seront satisfaites sans difficulté, j’en suis certain. Quand de part et d’autre on se parle franchement, on n’a pas de peine à s’entendre. Il vaut mieux s’expliquer en famille que d’en venir d’abord aux coups. Dieu soit loué ! voilà la paix faite. Êtes-vous de bons Français ? – Oui. – Donc, vous ne voulez pas laisser la France aux Anglais ? – Non. – Et si vous tuez vos gentilshommes, ce sont autant de vos soldats que vous tuez. C’est l’infanterie qui tue ses gendarmes. – Les vilains de France une fois en paix avec la noblesse, qui osera nous attaquer ? – Personne. – Qui a le poignet assez fort pour casser une trousse de vingt-quatre flèches ? – Personne. – Samson ou bien ce grand homme-là
Il montre le Loup-Garou.
s’y donneraient des ampoules. – Défaites la trousse, un enfant cassera les flèches une à une. – Séparez les vilains de la noblesse, l’Anglais tombera sur les uns, et en aura bon marché, puis sur les autres, et il n’aura pas grand’peine. Unis, les Français n’ont rien à craindre ; désunis, ils sont exposés aux insultes du premier venu. LE
LOUP-GAROU.
Celui-là sait parler.
SIMON.
Faisons une bonne paix et soyons unis !
THOMAS.
Faisons la paix !
PAYSANS.
La paix ! la paix !
SIWARD.
Déjà ! les lâches ! Oubliez-vous que nous avons encore à chevaucher tout le pays de Meaux qui regorge d’argent ?
FRÈRE JEAN.
Quelles garanties nous donnerez-vous en preuve que tout ce que vous nous promettez s’exécutera loyalement ?
SIMON.
Oui, c’est là le point important.
BELLISLE.
Demandez les garanties que vous voudrez... La parole royale... Et puis, vous me faites rire avec vos garanties. N’êtes-vous pas les plus forts ? Il y a trois cents vilains contre un gentilhomme. Faisons une trêve, envoyez des députés au Louvre, et nous arrangerons tout pour le mieux.
FRÈRE JEAN.
Vous demandez une trêve, c’est-à-dire que vous voulez gagner du temps pour rassembler une armée et nous attaquer à votre avantage.
BELLISLE.
On dit vrai, les moines sont méfiants ! – Nous n’avons guère envie de lever la lance une seconde fois. Mais restez en armes, si vous le voulez, pendant la trêve. Seulement ne passez pas l’Oise. Voilà tout ce qu’on vous demande ; est-ce trop ?
SIWARD.
Non, non ! point de trêve ! il veut gagner du temps, et nous priver du butin que nous avons à faire.
PERDUCAS.
Passons l’Oise ! allons à Meaux, nous deviendrons tous riches.
BELLISLE.
Ces messieurs veulent la guerre. Je conçois leurs raisons. Ce ne sont pas leurs châteaux qu’ils pillent ; ce ne sont pas leurs blés que leurs chevaux foulent aux pieds. Ils savent que, la paix venue, l’aventurier n’est plus qu’un voleur et que la corde l’attend. Tout gentilshommes qu’ils sont, ils pourront bien y venir.
SIWARD.
Coupons les oreilles à ce coquin.
PERDUCAS.
Nous appeler voleurs !
FRÈRE JEAN, aux aventuriers.
Arrêtez, messieurs, il a un saufconduit de moi.
SIMON.
Ce qu’il dit est vrai. Le pays est dévasté, et l’orge est renchérie de deux sous par boisseau.
BARTHÉLÉMY.
Les aventuriers mettent tout à feu et à sang.
MORAND, bas.
Ils sont plus nos ennemis que les nobles.
LE LOUP-GAROU.
C’est vrai qu’après eux il n’y a rien à prendre.
RENAUD.
Pourquoi les avoir appelés dans nos affaires ?
FRÈRE JEAN.
Silence, encore une fois ! Français ou Anglais, nous sommes tous frères dans la sainte ligue des communes !
MORAND, bas.
Oui, comme Abel et Caïn.
SIWARD, à part.
Ils sont les plus forts, mais ils me revaudront cela.
BELLISLE.
Allons, mes amis, décidez-vous ; la paix ou la guerre ?
PAYSANS.
La paix ! la paix !
BELLISLE.
Eh bien ! en attendant la paix, faisons une trêve de trois mois, pendant laquelle nous réglerons tous nos différends.
PAYSANS.
La trêve ! la trêve ! retournons chez nous ! Il faut faire la récolte.
FRÈRE JEAN.
Je ne consentirai jamais à trois mois de trêve. Sire ambassadeur, vous ne cachez pas assez vos ruses.
BELLISLE.
Je suis accommodant. Que la trêve soit d’un mois et rien de plus. Êtes-vous satisfait ?
PAYSANS.
Oui, oui ! c’est un galant chevalier, celui-là.
FRÈRE JEAN.
Je consens... Nous consentons à la trêve, pourvu que l’on remette la ville de Meaux entre nos mains. Ce sera pour nous une garantie de votre bonne foi.
BELLISLE.
Eh ! mes bons amis, il n’y a plus à Meaux que de malheureuses femmes à moitié mortes de peur. Qu’avez-vous besoin d’une ville pour sûreté ? Vous aurez des otages tant que vous en demanderez.
SIWARD.
Il nous faut avoir Meaux ; c’est plus sûr.
PAYSANS.
Eh ! que nous importe Meaux ?
SIMON.
Nous sommes déjà bien assez loin de chez nous.
MORAND.
De bons otages suffiront.
PAYSANS.
La paix ! la trêve !
FRÈRE JEAN, aux paysans.
Vous le voyez, il veut nous tromper. Il nous refuse les garanties que nous lui demandons.
BELLISLE.
Je vous l’ai déjà dit, bonnes gens, la comtesse de Meaux est avec ses dames dans la ville. Elle n’a pas un gendarme à sa suite. C’est une bonne et charitable dame, vous le savez tous. Au nom de saint Leufroy, votre patron, laissez-la en paix dans sa ville.
PAYSANS.
Qu’on nous donne des otages, et nous serons contents.
FRÈRE JEAN.
Mais...
PAYSANS.
Des otages et la paix ! la paix !
FRÈRE JEAN.
Or çà, sire chevalier, quels otages nous donnerez-vous pour la sûreté des députés que nous enverrons ?
BELLISLE.
Moi d’abord, ce qui vous prouve que je ne cherche point à vous tromper, je tiens à mon cou aussi bien qu’un autre. Maître Langoyrant restera aussi, et, si ce n’est point assez d’un chevalier et d’un docteur, on vous donnera encore deux chevaliers prud’hommes et de renom.
PAYSANS.
C’est un loyal chevalier ! la trêve ! la paix !
BELLISLE.
Çà, mon père, vous semblez être leur chef ; n’irez-vous point traiter de la paix à Paris ?
FRÈRE JEAN.
Non, monseigneur : je n’aime pas les voyages, et d’ailleurs votre tête, quand bien même on vous la couperait, n’irait jamais aussi bien sur mes épaules que la mienne.
BELLISLE.
Comme il vous plaira. Envoyez qui vous voudrez ; moi, je reste. Ah çà ! vous avez du bon vin ici, je l’espère ?
SIMON.
Oui, fort à votre service.
BELLISLE.
À la bonne heure. Je vais faire porter mon bagage à votre camp ; et puis qu’on me donne du vin, car j’ai assez parlé pour boire.
PAYSANS.
Soyez tranquille, gentil chevalier, vous serez bien traité.
FRÈRE JEAN.
Et surveillé de près.
BELLISLE.
Comme je n’ai nulle envie de vous trahir, je suis sans inquiétude.
Il sort avec Langoyrant.
SIMON.
Va à Paris, Morand, tu as le bec affilé.
MORAND.
Vas-y toi-même. Le père Jean n’y va pas ; je reste avec lui.
THOMAS.
J’irai, moi, si l’on veut. Qu’ai-je à craindre ?
FRÈRE JEAN.
Vous l’avez voulu, c’est une chose faite. Il n’y faut plus songer. Maintenant réfléchissez aux demandes que vous voulez faire. Demain nous ferons partir nos députés pour Paris. Au reste, je vous le répète, restons unis : ne nous séparons pas. C’est pendant une trêve et au moment de faire la paix, qu’il faut prendre soin de ses armes.
SIMON.
Vous savez que la moitié de nos gens doit s’en retourner dans huit jours pour faire la récolte.
FRÈRE JEAN.
Et doit revenir sous les drapeaux au bout d’une semaine.
MORAND.
On ne l’a pas oublié ; n’ayez pas peur.
FRÈRE JEAN.
Ce soir, venez tous à mon logement, je vous ferai part des conditions que je veux proposer au duc de Normandie.
Ils sortent tous, excepté Siward, Perducas d’Acuna et Eustache de Lancignac.
PERDUCAS.
Eh bien, Siward ! nous allons rester seuls. Ils font la paix.
SIWARD.
Que veux-tu ?
EUSTACHE.
Cette paix nous ruine.
SIWARD.
Moi, je n’ai pas fait la paix. S’ils s’arrangent, je retourne dans mon fort et je recommence mes courses comme par le passé.
PERDUCAS.
Bien dit. D’ailleurs les trêves vont bientôt finir entre l’Angleterre et la France ; et nous aurons de l’occupation, Dieu aidant.
EUSTACHE.
Il y aura alors de la gloire à gagner, et de beaux coups de lance à faire.
PERDUCAS.
Et des barons français à rançonner.
SIWARD.
Et des villages et des villes à mettre à sac.
PERDUCAS.
Bah ! le métier n’est pas encore à laisser.
Ils sortent.
Scène XXXIII
BELLISLE, assis, SIWARD, entrant, une épée sous le bras
La maison dans laquelle est gardé Jean de Bellisle.
SIWARD, avec hauteur.
Vous désirez me parler, messire de Bellisle ?
BELLISLE, se levant.
Oui, messire de Siward, depuis longtemps je désirais cette entrevue ; mais prenez un siége, s’il vous plaît, car j’ai bien des choses à vous dire. Avant tout, je vous dois des excuses pour certaines paroles offensantes, prononcées indiscrètement par moi, contre la noble profession d’aventure que vous honorez.
SIWARD.
Si vous n’étiez pas notre otage, monseigneur, j’aurais relevé vos paroles comme elles le méritent.
BELLISLE.
Quand je parlais ainsi, mon cœur démentait ma bouche ; mais j’étais chargé de haranguer des vilains, je devais les flatter et me conformer à leur grossier langage. Vous voyez ma franchise. Ces paroles outrageantes sont bien loin de ma pensée. Sainte Vierge ! moi mal penser des chevaliers d’aventure, ces glorieux soutiens de la chevalerie errante ! Encore une fois pardon, et permettez-moi d’enchaîner ainsi votre colère et votre bras.
Il lui attache au bras un riche bracelet.
SIWARD.
Saint George ! que cela est beau ! quel riche travail ! quels beaux rubis !... Ah ! messire de Bellisle !
Il lui serre affectueusement la main.
BELLISLE.
Je l’ai gagné dans un tournoi ; j’avais juré de ne le donner qu’à une bonne lance, et je vous ai connu pour tel à Niort.
SIWARD.
Quoi ! vous n’avez pas oublié le tournoi de Niort ?
BELLISLE.
Si je l’ai oublié ! Une fête si galante, tant de belles dames réunies, de si beaux coups de lance ! Nous étions tous deux parmi les tenants, et il m’en souvient, vous étiez si ferme sur la selle, que vous fûtes contraint de mettre pied à terre, pour prouver aux spectateurs que vos armes n’étaient pas vissées au harnais de votre cheval[62].
SIWARD.
Ce fut là que je perçai le bras du sire de Joigny. On prétendit que je m’étais forfait[63] ; mais votre oncle, qui était l’un des maréchaux du tournoi, parla si bien en ma faveur, que je fus absous. Sans lui, je perdais mes armes et mon cheval[64].
BELLISLE.
Or çà, vous dinerez avec moi, et nous boirons à nos anciens amis, en devisant de beaux faits d’armes.
SIWARD.
De tout mon cœur.
BELLISLE.
Et je veux aussi engager votre ami messire Perducas. Quand des chevaliers ne se donnent plus de coups de lancé, ce qu’ils ont de mieux à faire c’est de se divertir ensemble.
SIWARD.
À propos, la trêve va finir. D’où vient que nous ne recevons pas de nouvelles de nos envoyés ?
BELLISLE.
Je ne puis vous le dire. Leurs prétentions sont tellement ridicules, que je répondrais d’avance qu’ils n’obtiendront rien. Mais laissons cela, et, puisque vous voulez bien me visiter, parlons de sujets plus intéressants pour nous autres. Depuis que je suis ici, je n’ai pas eu l’occasion d’entretenir un gentilhomme, et je n’ai pour toute société que trois ou quatre manants, les plus ennuyeuses gens du monde.
SIWARD.
À vrai dire, la société des vilains n’est pas très amusante pour des hommes comme nous ; et sans les gentilshommes anglais et gascons, je serais déjà mort d’ennui.
BELLISLE.
Passe encore si vous étiez bien payés par ces gens-là.
SIWARD.
Payés ! Croyez-vous donc que notre armée est une armée royale ? On partage le butin, et nous avons notre part ; voilà tout.
BELLISLE.
Ce n’est pas beaucoup ; si vous aviez en tête un corps de gendarmes, le butin serait bien peu de chose.
SIWARD.
Je le crains.
BELLISLE.
Entre nous, la guerre va recommencer. Jamais mon redouté seigneur le duc de Normandie n’accordera à ces vilains les conditions extravagantes qu’ils demandent.
SIWARD.
Hum !
BELLISLE.
Et alors je vous plains, si votre parti a le dessous, comme je le crois. Le captal de Busch, sous qui vous avez servi, je pense, est revenu d’Allemagne ; il rassemble une armée formidable. Les rebelles n’ont que peu de gendarmes à nous opposer. La lutte pourrait-elle être longtemps douteuse ? Vous vous trouverez mêlé à une foule de paysans rebelles, avec lesquels, permettez-moi de parler avec la franchise d’un soldat, avec lesquels vous n’auriez pas dû vous associer.
SIWARD.
Ils m’ont délivré de ma prison, et je me suis trouvé engagé avec eux avant d’avoir pu réfléchir à ce que je faisais.
BELLISLE.
Est-il donc trop tard pour vous désengager ?
SIWARD.
Je ne sais si je commence à vous entendre... mais parlez-moi avec la franchise d’un soldat, et je vous comprendrai mieux.
BELLISLE.
Eh bien ! si vous voulez quitter ces vilains révoltés, si vous voulez revenir sous la bannière de votre ancien capitaine, vous pourrez compter sur la reconnaissance de monseigneur le duc.
SIWARD.
Voilà de belles paroles ; mais ce n’est pas avec des paroles que l’on fait vivre une compagnie d’aventure.
BELLISLE.
Or çà, que diriez-vous, si monseigneur le duc de Normandie prenait votre compagnie à son service, pour tout le temps de cette campagne, avec la paye des gendarmes français, et, de plus, une pension perpétuelle de cent écus pour le capitaine ?
SIWARD.
Je me déciderais facilement, si j’étais fait banneret. J’ai bien assez d’écuyers à mon service pour être fait banneret.
BELLISLE.
Je puis vous promettre ma foi de chevalier que vous obtiendrez tout cela. Désirez-vous encore quelque autre chose ?
SIWARD.
Non, en vérité. Vos procédés sont si nobles qu’on ne saurait y résister. Comptez sur moi.
Ils se donnent la main.
BELLISLE.
Votre compagnie est, ce me semble, de cinquante lances et de cent archers.
SIWARD.
Cent quarante archers. Les archers ne sont pas précisément à moi, bien qu’ils suivent mon pennon ; mais, si le captal de Busch commande votre armée, ils me suivront avec joie.
BELLISLE.
Voici d’avance, en beaux florins, la solde d’un mois, et voici cent écus pour vous.
SIWARD, après avoir compté.
Vous êtes en vérité d’une exactitude surprenante.
BELLISLE.
Et ne me donnerez-vous pas en retour un mot d’écrit ? ne signerez-vous pas votre engagement ?
SIWARD.
Pour le signer, jamais, car je ne sais pas écrire, mais je ferai la croix et je scellerai de mon sceau, quand il vous plaira.
BELLISLE.
À la bonne heure. Dans quelques jours le captal sera à Meaux, et alors vous passerez de son côté.
SIWARD.
Oui, foi de loyal chevalier.
BELLISLE.
J’aurais quelques idées à vous communiquer à ce sujet, si je pouvais m’entendre avec vos compagnons les capitaines d’aventure. Je ferai tous mes efforts pour les obliger : j’ai à leur service bon nombre de florins et de nobles à la rose.
SIWARD.
Je réponds d’eux comme de moi-même.
BELLISLE.
Faites que je puisse leur parler. – Quand le temps sera venu de mettre nos projets à exécution, vous me procurerez une échelle de corde pour sortir d’ici, car la prudence me défend de rester avec ces vilains au moment où nos gendarmes marchent à leur rencontre.
SIWARD.
Vous aurez une échelle de cordes ; des chevaux et des guides, si vous voulez.
BELLISLE.
Grand merci, tout ira bien.
SIWARD.
Je vais vous amener Perducas et messire de Lancignac ; je ne doute pas que vous ne soyez content d’eux.
BELLISLE.
Allez donc, et revenez vite.
Scène XXXIV
SIMON, MORAND, MANCEL
Le camp des Insurgés.
SIMON.
Parlez-moi de celui-là ! il est bien d’une autre pâte que nos défunts seigneurs. Il cause de la moisson et des laboureurs comme s’il avait mené vingt ans la charrue.
MANCEL.
Et il a toujours le mot pour rire.
MORAND.
Avec tout cela, je ne sais ce que sont devenus nos gens que nous avions envoyés pour la paix. Je crains bien pour le pauvre Thomas surtout.
SIMON.
Bah ! qu’y a-t-il à craindre ? N’avons-nous pas entre nos mains des otages ? C’est otages, n’est-ce pas, que dit le père Jean ?
MANCEL.
Morand ne pense jamais qu’aux malheurs.
MORAND.
C’est le plus sûr ici-bas.
On entend sonner des trompettes.
SIMON.
On sonne la trompette, il est arrivé quelque chose.
RENAUD, entrant.
Savez-vous la nouvelle ?
SIMON.
Quelle ?
RENAUD.
Les nobles ont remis une armée sur pied. Ils ont plus de dix mille gendarmes ; et le captal de Busch, Dieu confonde le païen et son diable de nom !... c’est leur capitaine : il marche sur nous, et demain peut-être nous aurons la bataille.
MORAND.
Jésus ! Marie ! c’est fait de nous.
MANCEL.
Impossible, Renaud !
RENAUD.
Franque a vu leurs coureurs, et vient d’escarmoucher avec eux : à telles enseignes qu’ils nous ont blessé une douzaine d’hommes, entre autres Topineau le jeune qui a la cuisse percée jusqu’à l’os.
MORAND.
Par la passion de Notre-Seigneur ! nous sommes trahis ! nous n’avons plus de ressources...
SIMON.
Le diable me brûle si je ne m’en venge pas sur ce déloyal chevalier ! Topineau est le frère de ma marraine.
Il se fait un grand mouvement dans le camp. Entrent Frère Jean, Siward, le Loup-Garou.
FRÈRE JEAN.
Nous sommes trahis ! le scélérat s’est échappé !
SIWARD.
Holà ! Derrick ; Louis ! Qu’on m’amène mon cheval alezan ! qu’on me donne mes armes ! Je veux le rattraper, fût-il au fond de l’enfer !
LE LOUP-GAROU.
À cheval ! à cheval !
MORAND.
Qui donc s’est échappé ?
LE LOUP-GAROU.
Eh ! parbleu, Bellisle, ce faiseur de beaux discours. Et les gendarmes du roi sont en marche.
SIWARD.
À cheval, Loup-Garou ! C’est du côté des bois qu’il a dû s’échapper.
LE LOUP-GAROU.
Non, j’ai vu des pas de chevaux auprès de la fontaine. Il a fait un détour pour nous donner le change.
SIWARD.
Je te dis qu’il a pris par les bois, un de mes gens a vu un cavalier entrer dans la forêt...
FRÈRE JEAN.
Allez chacun de votre côté sans vous disputer davantage. – Vous, courez à vos bandes. – Dans une heure il faut être en marche.
Siward et le Loup-Garou sortent.
MORAND.
Voilà un grand malheur, père Jean !
MANCEL.
On dit que l’ennemi est nombreux.
SIMON.
Comment ont-ils fait pour passer la Marne ?
FRÈRE JEAN.
Allez vous armer au lieu de faire ces sottes questions.
SIMON.
Jamais je ne lui ai vu l’air si troublé.
MORAND.
Mauvais signe !
MANCEL.
Allons toujours nous armer.
Il sort.
MORAND.
Le père Jean baisse, on s’en aperçoit.
SIMON.
Bah ! il n’y a que toi qui le dise.
MANCEL.
Si l’armée du roi nous attaque, nous en viendrons à bout, comme nous avons fait de celle du sénéchal.
MORAND.
Voilà bien des corbeaux du côté de l’orient. Dieu veuille, et Notre-Dame, que nous ne leur donnions pas à manger !
SIMON.
Toujours prophète de malheur !
Ils sortent.
Scène XXXV
Une plaine auprès de Meaux. La bataille est engagée ; on volt çà et là des morts et des blessés. Le Loup-Garou, avec ses archers, escarmouche contre l’avant-garde opposée.
LE LOUP-GAROU, faisant une marque sur sa masse.
Un de plus ! j’espère finir aujourd’hui mon demi-cent. Allons, vous autres, entrez dans ces bruyères à droite, et poussez les archers du roi. Ils ne tiendront pas plus ferme devant vous que les daims du Beauvoisis.
Entre Frère Jean à cheval avec quelques chefs.
FRÈRE JEAN.
Bien commencé, brave Loup. Du courage aujourd’hui, et la guerre est terminée.
LE LOUP-GAROU.
Je ne m’y épargnerai pas pour ma part, soyez-en sûr. Mais comment cela va-t-il de votre côté ?
FRÈRE JEAN.
Bien, je ne crains pas les gendarmes du captal. Mais les aventuriers sont à notre droite et s’apprêtent à les bien recevoir. Je vais voir comment on se comporte à la gauche.
Il sort.
LE LOUP-GAROU.
Jean, mets une corde neuve à mon arc. – Holà ! ménagez vos flèches là-bas. Vous tirez de trop loin. Avancez, avancez, jusqu’à ce que vous puissiez leur voir le blanc des yeux. – Bien, mes lurons, lancez ! Ah ! ce gros arbalétrier, quelle culbute ! – Où diable est fourré maître Brown ? L’ennemi se replie sur sa réserve, et les archers anglais nous seraient bien utiles maintenant. – Je m’en vais lui sonner un rappel.
Il sonne du cor.
Je gage qu’il est à boire quelque part. Tant qu’il reste une bouteille pleine, il ne peut se mettre à l’ouvrage.
Un cor répond à celui du Loup-Garou, entre Brown.
BROWN.
Loup mon ami, veux-tu te faire Anglais ?
LE LOUP-GAROU.
Moi ! à quoi bon ?
BROWN.
Vous êtes tous perdus. Ce soir vous serez tous en chair à pâté. Il n’y a de salut pour toi qu’à te faire Anglais.
LE LOUP-GAROU.
Tu me fais rire, l’ami, je suis de ceux qui mangent les pâtés, et il faudrait un fier cuisinier pour me mettre en pâte.
BROWN.
Vous êtes perdus tous tant que vous êtes ; on vous trahit.
LE LOUP-GAROU.
Que veux-tu dire ?
BROWN.
Nous vous quittons. Cela s’est fait malgré moi ; mais le captal de Busch a été autrefois notre capitaine. – Je ne regrette que toi ;-mais viens avec nous, fais-toi Anglais.
LE LOUP-GAROU.
Au diable tes Anglais ! mais explique-toi, mort de ma vie !
BROWN.
Adieu, adieu ! montre mon arc aux Anglais et dis-leur que tu le tiens du capitaine Brown.
Il sort.
LE LOUP-GAROU.
Arrête, attends donc. Il court comme si le diable l’emportait ! Allons prévenir le père Jean. Il n’y a rien de bien clair dans ce qu’il m’a dit, mais l’autre le devinera. Wilfrid, conduis nos gens, et escarmouche avec prudence.
Il sort.
Scène XXXVI
FRÈRE JEAN, LE LOUP-GAROU, MORAND, SIMON, BARTHÉLÉMY, GAILLON, PAYSANS INSURGÉS
Une forêt. Il est nuit, Frère Jean est debout à l’écart, appuyé contre un arbre ; les autres sont assis ou couchés par terre autour d’un feu, et mangent avec avidité quelques provisions. Quelques-uns sont blessés, et tous semblent accablés de fatigue.
LE LOUP-GAROU.
Quarante-trois hommes ! Perdre en un seul jour quarante-trois des plus braves archers qui jamais aient encoché flèche ! Que la peste étouffe les aventuriers qui nous ont trahis !...
SIMON.
Que le diable étrangle le captal !
MORAND, à basse voix.
Et le moine de Mahom qui nous a menés à la boucherie !
LE LOUP-GAROU.
Toujours le même, vieux Morand. Tu te tais, et tu te caches quand les horions pleuvent. Mais on est sûr de te revoir et d’entendre tes croassements auprès du feu de la cuisine. Ventre de bœuf ! Renaud est mort, c’était le seul brave d’entre vous.
MORAND.
Toi qui parles, n’as-tu pas couru aussi vite que nous autres ?
LE LOUP-GAROU.
Morand, ne m’échauffe pas les oreilles, je ne suis pas en belle humeur, et il m’en coûterait moins de te casser la tête que d’avaler le reste de cette bouteille.
MORAND.
Tu te fâches toujours pour rien.
LE LOUP-GAROU, se levant.
Eh bien ! mes loups, finirez-vous de manger ! Jour de Dieu ! on dirait, à les voir mâcher si lentement, qu’ils sont assis à une table de noce. Debout, coquins ! Nous avons encore une longue traite à faire avant de gagner nos bois.
SIMON, bas à Morand.
Voilà notre vaillant champion qui se trouve encore trop près du captal.
FRÈRE JEAN, s’avançant.
Nous allons lever le camp...
SIMON, bas.
Il appelle cela un camp.
FRÈRE JEAN.
Franque, tu feras l’arrière-garde avec tes braves archers. Demain nous serons en sûreté derrière l’Oise, et nous pourrons recommencer la guerre.
MORAND, bas.
Tu n’en as donc pas assez.
LE LOUP-GAROU.
Mes archers et moi, nous ferons notre retraite tout seuls.
FRÈRE JEAN.
Que veux-tu dire ? Obéis.
LE LOUP-GAROU.
Père Jean, écoutez. Vous êtes devenu notre chef, le diable sait comment et pourquoi. Avant vous je m’étais fait libre. – Je vous ai aidé de tous mes efforts ; moi et mes gens, nous avons fait rage pour vous : maintenant vous voilà retombés dans le bourbier... Par la barbe de Mahom ! tirez-vous-en tout seul. Et adieu !
FRÈRE JEAN.
Je m’étais trompé sur ton compte. Je t’ai cru un soldat, tu n’es qu’un voleur. Tu es âpre à la curée après la victoire ; maintenant...
LE LOUP-GAROU.
Maintenant... Si vous m’aviez laissé dans ma forêt, je serais maintenant à la tête d’une centaine de bons lurons libres comme l’air ; au lieu qu’avec votre belle manière de faire la guerre, vous nous avez presque mis la corde au cou à tous tant que nous sommes. Or sus, adieu !
FRÈRE JEAN.
Eh bien ! fuis, lâche que tu es. Je reste avec ces braves gens. Avec eux je saurai triompher de nos ennemis...
LE LOUP-GAROU.
Je vous le souhaite, mon révérend.
FRÈRE JEAN.
Mais sache que, si tu reviens jamais à mon armée dans un temps plus heureux, je te ferai pendre comme un brigand, et...
Le Loup-Garou sonne du cor avec force, rassemble sa petite trope et s’enfonce dans la forêt.
MORAND.
Il a raison, le Loup-Garou ; nous sommes bien dupes de rester avec ce maudit sorcier.
FRÈRE JEAN.
Simon, et toi, Gaillon, rassemblez ce qui nous reste d’archers. Vous commanderez l’arrière-garde avec moi.
GAILLON.
Bien obligé de votre arrière-garde ! Pour nous faire mettre en hachis ? Quelque sot !...
SIMON.
Père Jean... père Jean...
MORAND, bas à Simon.
Est-ce que tu veux lui obéir ?
FRÈRE JEAN, à Simon.
Tu hésites ?
SIMON.
Ma foi, l’armée est en déroute. Chacun pour soi. Les boiteux feront l’arrière-garde.
BARTHÉLÉMY.
Vous voulez donc toujours nous commander ?
FRÈRE JEAN.
Prétendriez-vous me désobéir ? Parle, toi, Gaillon.
Il le prend à la gorge.
GAILLON.
Moi... Non, non, père Jean... mais...
SIMON.
C’est vous qui êtes cause de tout ce qui est arrivé.
GAILLON.
Vous nous avez menés ici.
BARTHÉLÉMY.
Vous nous avez poussés à la révolte...
MORAND.
Contre nos bons seigneurs.
FRÈRE JEAN, s’avançant vers lui.
Que dis-tu, misérable ! Morand recule effrayé.
SIMON.
Nous nous sommes fiés à vous.
CAILLON.
Vous nous avez fait tuer comme des moutons.
MORAND, aux paysans.
Si vous aviez du cœur, il ne serait plus notre capitaine.
SIMON.
Vous n’êtes plus notre chef.
BARTHÉLÉMY.
Vous nous avez trahis. Tous. Trahison ! trahison !
MORAND.
C’est lui qui a fait assassiner le vénérable abbé d’Apremont.
PLUSIEURS PAYSANS.
C’est cela qui nous a porté malheur.
FRÈRE JEAN.
Lâche canaille ! vous osez élever la voix contre moi ! Avez-vous si vite oublié que sans moi vous seriez encore esclaves ? Avez-vous oublié que par moi, par moi seul, vous avez vaincu vos seigneurs, que vous vous êtes emparés de leurs richesses ? Est-ce ma faute, si votre lâcheté vous attire un revers ? Si je vous abandonnais à vos propres forces, malheureux, vous seriez déjà tous suspendus aux fourches patibulaires. Si maintenant...
BARTHÉLÉMY.
N’écoutons point ce traître...
GAILLON.
Empêchons-le de parler !
MORAND.
Qu’il meure, l’apostat !
SIMON.
Tuons-le comme il a tué le baron d’Apremont.
TOUS.
Qu’il meure ! qu’il meure !
MORAND.
Il faut le livrer au captal, au baron de Bellisle !
FRÈRE JEAN, l’épée à la main.
Avancez, lâches, avancez ; je ne vous crains pas. Qui de vous osera mettre la main sur son capitaine ?
PAYSANS.
Finissons-en ! – Qu’il meure ! – À bas le moine !
Frère Jean est frappé d’une flèche par derrière. Il tombe et se relève aussitôt sur les genoux en s’appuyant contre un arbre.
FRÈRE JEAN.
Cela est digne de vous... misérables... vous me frappez par derrière.
VOIX derrière la scène.
Les gendarmes du roi !
FRÈRE JEAN.
Je vais être vengé !... Allez, traîtres... vous n’échapperez pas... à leurs longues lances... Les roues... les potences vous attendent... Je vous excommunie... et vous dévoue aux supplices éternels.
Il meurt.
MORAND.
Sauve qui peut !
VOIX CONFUSES.
Nous sommes entourés ; sauve qui peut !
QUELQUES PAYSANS.
Qui sera notre capitaine ?... Simon, Simon !
SIMON.
Fuyons, nous sommes perdus !
HOMMES D’ARMES derrière la scène.
Au captal, au captal ! tue, tue !
TOUS.
Sauve qui peut !
Fuite et déroute générales.
[1] Les prêtres étant alors les seuls médecins, et les prières et les vœux presque les seuls remèdes, il n’est pas étonnant que les maladies fussent désignées par le nom des saints qui en guérissaient les dévots, ou qui punissaient par elles les impies et les incrédules.
[2] On dévoue un homme au diable en faisant sur lui la croix de la main gauche. Il faut encore dire certaines paroles.
[3] Rien n’était plus commun, dans ce siècle d’ignorance, que de confondre ainsi dans des serments les noms des saints et des démons. Golfarin, neveu de Mahomet, est représenté dans les vieilles légendes comme un enchanteur redoutable. Quelques érudits veulent voir dans son nom celui du calife Omar.
[4] Cri de joie. On appelait aussi noëls certaines chansons joyeuses.
[5] Routiers, aventuriers, chevaliers d’aventure, noms que l’on donnait à des hommes vivant de pillage en temps de paix, et qui louaient leurs services en temps de guerre au prince qui leur donnait la plus forte solde.
[6] Cavaliers couverts d’armures de fer. Gendarmes, hommes d’armes, lances ; tous ces mots sont souvent employés les uns pour les autres.
[7] C’est-à-dire piller.
[8] Comme il faut que chaque métier ait un patron, les voleurs ont choisi saint Nicolas.
[9] Lieu de refuge où l’on était à l’abri des poursuites de la justice.
[10] Il faut continuellement se reporter à l’ignorance du temps. L’art de l’écriture n’était connu presque exclusivement que des moines.
[11] Cette restriction mentale, qui peut être d’une grande utilité, est encore usitée par les enfants dans leurs jeux.
[12] Soldats du parti du roi de Navarre. Ce prince possédait alors beaucoup de places dans le nord de la France.
[13] Gens de guerre sans emploi, la plupart Anglais ou Gascons et vivant. de brigandage. Ce nom avait été donné à plusieurs bandes que l’espoir du pillage avait attirées en France longtemps après le commencement des guerres.
[14] Terme de mépris et surnom donné à ces soldats.
[15] Il n’était pas rare alors de voir des ecclésiastiques porter les armes. Les aventuriers se donnaient un chef pendant la paix et s’établissaient d’ordinaire dans quelque château qui leur servait de dépôt pour leur butin et de citadelle contre les attaques qu’ils pouvaient avoir à craindre de la part des paysans qu’ils pillaient...
[16] Sobriquet du paysan français.
[17] Plusieurs abbayes de France avaient je droit d’envoyer leurs chefs aux conciles.
[18] Voir les romans de chevalerie.
[19] Voir l’anecdote du comte de Saint-Pol faisant assommer des prisonniers, une heure après le combat, par son fils âgé de douze ans, « lequel y semblait prendre grand plaisir. »
(Histoire des ducs de Bourgogne.)
[20] La science.
[21] La bataille de Poitiers, où le roi Jean fut fait prisonnier. Il mourut en Angleterre sans avoir été racheté.
[22] Les archers anglais poussaient l’arc de la main gauche, en tenant la droite immobile. Les Français, raidissant le bras gauche, tiraient la corde de la main droite. Au reste l’adresse des Anglais comme archers était partout reconnue, et leur assura longtemps la supériorité sur toutes les autres nations.
[23] Prix de l’arc.
[24] Ancienne superstition qui s’est conservée encore dans quelques pays. « ...Lupi Mœrim vidère priores. » VIRGILE, Buc.
[25] C’était un habillement fort serré, ordinairement en buffle ou en toile bien ouatée, que le gendarme portait sous son armure. Son usage était d’empêcher le frottement du fer sur la peau, et il pouvait servir en outre pour amortir les contrecoups.
[26] Le temps de la durée des trêves.
[27] Cotte de mailles d’armure légère.
[28] Bien que les Anglais fussent catholiques alors, cependant leur dévotion n’est pas représentée comme d’une nature très fervente ; et les historiens leur reprochent souvent de piller les églises, de profaner les reliques, etc.
[29] Montjoie Saint-Denis ! était le cri de guerre des Français ; chaque seigneur y ajoutait son cri particulier que répétaient ses vassaux dans les combats.
[30] Rescousse, c’est-à-dire l’action de secourir, de repousser. Ce mot entrait fréquemment dans les cris de guerre.
[31] Miséricorde ou poignard de merci. La lame de cette arme était extrêmement forte et aiguë. Quand un chevalier était renversé, ce n’était pas encore chose aisée de le blesser au travers de sa panoplie. Le vainqueur tâchait de soulever quelque pièce de son armure pour y introduire la pointe de son poignard, à peu près comme on fait pénétrer un couteau entre les deux écailles d’une huître.
Froissard appelle cette opération bouter la dague au corps. Dans ce temps il était d’usage de tuer toutes les personnes qui ne pouvaient donner rançon, ou dont la solvabilité n’était pas bien reconnue.
[32] La plupart des ecclésiastiques exerçaient la médecine.
[33] Ce droit étrange est encore observé à la mer.
[34] Les cagots de la Provence, que l’on a longtemps regardés comme des Sarrasins échappés à la défaite d’Abdérame.
[35] Espèce de fourrure estimée.
[36] L’autorité d’un abbé sur les moines de son couvent s’étendait même encore plus loin.
[37] Tous les talents nécessaires à un troubadour.
[38] On voit dans les fabliaux français avec quelle irrévérence les troubadours traitaient les prêtres et les moines.
[39] Les chevaliers bannerets se distinguaient par une bannière carrée des chevaliers pennonceaux, qui n’avaient qu’un petit drapeau triangulaire nommé pennon. Pour lever bannière, il fallait posséder un certain nombre de fiefs et être suivi d’une troupe considérable de chevaliers et d’écuyers.
[40] On leur donne souvent cette épithète. Voir Joinville passim, etc.
[41] Voir le fabliau du voleur qui entra en paradis par l’intercession de la sainte Vierge, pour laquelle seulement il avait conservé de la dévotion.
[42] Dans ce temps, une dame noble se faisait rendre par un homme des services pour lesquels on emploierait aujourd’hui une femme de chambre.
« Damoiselle, vous avez perdu votre armure de jambe ; votre page vous l’a mal attachée. » (Tiran le Blanc.)
[43] C’était au casque que l’on visait en général dans les tournois. Voir, dans Froissard, la description du tournoi de Calais.
[44] Il fallait faire preuve de noblesse pour être admis à faire armes dans un tournoi.
[45] Ancienne tradition qui fait descendre les rois francs de Francus, fils de Priam, roi des Troyens.
[46] Les anciennes armures étaient de tissu de mailles. Le père Jean fait ici un notable anachronisme.
[47] Il y a trente ans que quatre paysans russes massacrèrent l’intendant de leur seigneur avec les circonstances décrites dans cette scène. Ils se livrèrent ensuite au gouverneur de la province pour empêcher que leur village ne fût décimé. On les envoya aux mines de Nertchinsk, après leur avoir coupé le nez et les oreilles.
[48] De semblables arrangements n’étaient pas rares.
[49] Le dauphin ; depuis, Charles V.
[50] Le prix des chevaux paraît avoir été hors de toute proportion avec celui des objets nécessaires à la vie. Un homme d’armes à qui le roi donnait un cheval valant 200 francs, recevait seulement 30 francs de solde par an.
[51] Carquois.
[52] Les couvents hors des villes étaient tous plus ou moins fortifiés et munis d’armes.
[53] C’est-à-dire, je combattrai contre vous. Dans les beaux temps de la chevalerie errante, un chevalier qui courait les aventures portait en évidence soit une chaîne, soit un bracelet, présent de sa dame. C’était un défi aux autres chevaliers de le délivrer, c’est-à-dire de lui enlever les signes de son entreprise d’armes (emprinse). On a dit ensuite délivrer un chevalier de trois coups de lance, etc. pour courir trois passes contre lui, etc.
[54] Baisser la lance.
[55] Voir la réponse de Bayard à l’empereur Maximilien au siège de Padoue.
[56] Formule de serment. Voir le poème du Héron.
[57] C’est une semblable imprudence qui fit perdre la bataille d’Azincourt.
[58] Ces détestables jeux de mots étaient alors fort à la mode.
[59] On reconnaissait ainsi les hommes d’armes prisonniers.
[60] Ambroise Paré raconte qu’après une petite escarmouche en Piémont, trois ou quatre soldats avaient été horriblement brûlés par l’explosion de leurs flasques de poudre. Un de leurs camarades demanda au savant chirurgien s’il y avait quelque espoir de sauver ces hommes ; sur sa réponse négative il leur coupa « gentiment » la gorge.
[61] Parce que l’on jette au feu les sarments secs. Comparaison fort usitée dans ce temps.
[62] Un chevalier écossais, qui joutait sur le pont de Londres, paraissait si ferme sur la selle, que le peuple le força de mettre pied à terre pour voir s’il n’était pas attaché au cheval.
[63] Se forfaire, c’était manquer aux règles d’un tournoi. On devait toujours frapper entre les quatre membres.
[64] Punition usitée. Voir le tournoi de Calais dans Froissard.