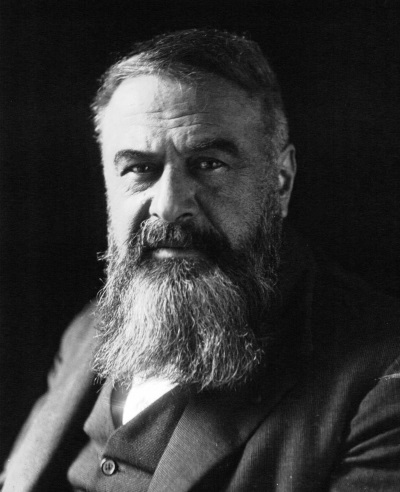L’Accord parfait (Tristan BERNARD - Michel CORDAY)
Comédie en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Fémina, le 25 novembre 1911.
Personnages
ACHILLE
MAURICE MARIN
CLÉMENT
ALBERTE
IRMA
CÉLINA
THOUVELIN
ACTE I
La scène représente un salon très élégant, au Champ de Mars. Au fond, le salon communique par une baie avec une autre pièce. Cette pièce est éclairée par une large porte-fenêtre à gauche, conduisant à un jardin. Les arrivants sont censés venir du dehors en traversant cette pièce du fond et en entrant par une porte à droite que l’on n’aperçoit pas de la salle.
Scène première
CLÉMENT, CÉLINA
CLÉMENT, cinquante-cinq ans, chapeau haut de forme, tenue un peu râpée.
Le patron, sûrement, est sorti.
CÉLINA.
Oui, monsieur Clément, monsieur est sorti en auto avec madame.
CLÉMENT.
Avec madame... et M. Marin ?
CÉLINA.
Avec madame et M. Marin.
CLÉMENT.
Naturellement ! Est-ce que vous savez si le patron a signé les papiers que j’ai laissés là, sur la petite table ?
CÉLINA.
Oh ! je ne crois pas, monsieur Clément.
CLÉMENT.
Non, naturellement !
CÉLINA.
Il est rentré en retard pour déjeuner, et puis, après, il a été question de sortir en auto, et M. Marin a dit : « Dépêchons ! Dépêchons ! » Alors, monsieur s’est dépêché. Je crois qu’ils allaient visiter une maison de campagne.
CLÉMENT.
Une maison de campagne ! Quand on a déjà une maison au Champ-de-Mars... et d’ailleurs, quand on ne comprend rien à la campagne.
CÉLINA.
Vous aimez la campagne, vous, monsieur Clément ?
CLÉMENT.
Je serais capable de la comprendre, comme toutes les personnes qui n’ont pas les moyens d’y aller... Il y a encore du monde dans la maison ?
CÉLINA.
Du monde ?
CLÉMENT.
Oui, j’entends marcher, là-haut.
CÉLINA.
Eh bien, c’est les cousins de madame qui s’habillent pour sortir.
CLÉMENT.
Ah ! oui ! Les Thouvelin ? Ah ! Ah !
Il ricane.
Ils ne sont pas encore partis, ceux-là. Voilà une bonne semaine qu’ils sont ici, je suis sûr qu’ils étaient venus pour quarante-huit heures.
CÉLINA.
Ils s’amusent peut-être à Paris.
CLÉMENT.
Pensez-vous que des gens comme ça puissent s’amuser à Paris ? Ils sont trop serrés, trop sur leurs pièces... Ils ne marchent que dans les distractions à l’œil. Aussitôt que ça coûte plus de cinquante centimes d’entrée, ils renâclent. Ce sont de bons râleux des départements... Ici, ils sont logés et nourris, je ne dis pas remarquablement, mais abondamment. En partant, ils donneront cent sous à chaque domestique et s’en retourneront tout glorieux, sans se presser, dans leur patelin. Ils viennent à Paris pour faire des économies, que je vous dis. Apprêtez-vous donc à recevoir cent sous.
CÉLINA.
Vous êtes gai.
CLÉMENT.
Et les airs qu’ils se donnent de gens avancés, au-dessus des préjugés ! leurs manières d’avant-garde, comme on dit ! Ah ! ils sont comme tous les provinciaux ; ils ne veulent pas être de leur province.
Regardant le bouquet posé sur la table.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
CÉLINA.
Des fleurs !...
CLÉMENT.
Je vois bien, que ce sont des fleurs, mais, comment ça a-t-il poussé ?
CÉLINA.
On les a apportées tout à l’heure. C’est monsieur qui les offre à madame pour leur anniversaire de mariage.
CLÉMENT.
Il lui donne des fleurs pour leur anniversaire de mariage ? Ah ! Ah !
Il ricane.
CÉLINA.
Qu’est-ce qu’il a à ricaner ?
CLÉMENT.
Eh bien, je trouve le patron très gentil... vraiment très gentil... Quant à M. Marin, il n’a pas apporté de fleurs. Ce n’est pas son anniversaire, à lui... Je sais à peu près quand c’est son anniversaire : c’est l’été. Ça s’est passé il y a deux ans, quand le patron les a laissés seuls à Cabourg.
CÉLINA.
Oh ! Il est toujours à raconter des choses...
CLÉMENT.
Ce n’est pas vrai, peut-être ?
CÉLINA.
Je ne sais pas si c’est vrai, mais ce n’est pas à dire, et, en tout cas, vous n’en êtes pas sûr. Personne ne peut affirmer ça.
CLÉMENT.
Il est évident qu’on ne les a pas pincés en flagrant délit. Ils ne vont pas s’amuser à quatre heures sur la promenade publique, comme la musique militaire. Vous comprenez qu’ils se surveillent, et ils ont bien raison ; seulement, dame... Enfin ! c’est leur affaire.
Un bruit d’auto. Clément va à la fenêtre.
Ah ! les voilà ! les voilà tous les trois ! Le patron est devant, il est cramponné au volant, et les deux autres sont derrière, vautrés... Tableau édifiant !... Moi, je m’en vais dans le bureau... Chaque fois qu’ils descendent d’auto, ils ont toujours des petites discussions... passionnantes... sur les routes qu’il fallait prendre, sur la distance en kilomètres... C’est intéressant ! Je ne veux pas assister à cette petite scène de famille.
CÉLINA.
Faudra-t-il vous envoyer monsieur ?
CLÉMENT.
Non, non, je ne peux rien faire sans qu’il ait signé les pièces... alors, je ne suis pas pressé qu’il vienne les signer. Je les remets là, comme d’habitude. J’ai mon temps, vous savez, je suis payé au mois.
Il sort par la porte de droite, pendant qu’Alberte, Achille et Maurice entrent par la porte de gauche.
Scène II
ACHILLE, ALBERTE, MAURICE
Maurice et Alberte ont l’allure dégagée. Maurice est en élégant pardessus d’auto. Il porte un feutre coquet. Achille a des lunettes énormes, relevées sur sa casquette, une longue blouse claire, comme en portent actuellement les chauffeurs. Elle est maculée de cambouis, d’huile et de poussière.
MAURICE, entrant.
Ainsi, tiens, à la Patte-d’Oie, là-bas... Tu ne connais pourtant que ça, ce croisement... Eh bien, non, il a fallu que tu stoppes devant le poteau pour déchiffrer toutes les indications...
ACHILLE.
C’est si ennuyeux de faire de la marche arrière quand on s’est trompé.
MAURICE.
Mais on ne se trompe pas, voyons ! Et ce n’est pas ça qui te paralyse, au fond... Seulement, chaque fois qu’il y a un croisement de route, il faut que tu prennes une résolution, et tu n’aimes pas ça. Quand on se trouve devant un obstacle, c’est la même histoire. Tu es à te demander : est-ce que je prendrai à droite ? Est-ce que je prendrai à gauche ? Et tu t’arrêtes devant.
ACHILLE.
Oui, mais, au moins, je n’entre pas dedans.
MAURICE.
D’accord, mais, dans ce cas-là, on n’avance pas, ce n’est pas la peine de faire de l’auto.
ALBERTE.
Le fait est, Achille, que si Maurice n’était pas dans ton dos pour décider, à ta place...
MAURICE.
Eh bien, qu’est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Moi, je suis né comme ça ; j’ai le sens de l’orientation, c’est un instinct, comme chez les pigeons voyageurs.
ACHILLE.
Dis aussi que tu as la carte sous les yeux.
MAURICE.
Mais non, mon ami, même quand je n’ai pas de carte, je vois aussi clair et aussi juste. Quand tu aperçois une poule à quatre cents mètres, ce sont des fanfares de trompe à n’en plus finir.
ALBERTE.
Et, l’autre jour, quand il s’est arrêté en voyant un troupeau de moutons.
ACHILLE.
Les moutons sur la droite, on dit que c’est mauvais signe.
ALBERTE.
Alors, tu attendais qu’ils veuillent bien passer à gauche.
MAURICE.
Il ralentit également quand il passe n’importe quelle voiture... À ta place, je renoncerais à l’auto et je prendrais un bon phaéton attelé d’un demi-sang normand.
ACHILLE.
Non, parce que j’aurais peur des autos.
MAURICE.
Et, ce qu’il y a de rigolo, c’est que les voitures doivent avoir rudement peur de toi... Tu vas doucement sur la route, mais tu as l’air de guetter les cochers pour les renverser... Avec ce système-là, on ne fait pas beaucoup de chemin... Sans moi, nous serions encore là-bas à visiter cette villa.
ALBERTE.
Est-ce qu’elle vous plaît, Maurice ?
ACHILLE.
Eh bien, oui, au fait : loue-t-on ? ou ne loue-t-on pas ?
MAURICE.
Elle n’est pas mal ; elle est confortable, en somme, et bien distribuée, joliment située.
ACHILLE.
Et toi, Alberte, qu’est-ce que tu en dis ?
ALBERTE.
Je la trouve bien ; c’est près d’une gare.
ACHILLE.
C’est commode pour les communications avec Paris, mais on entend le bruit des trains.
MAURICE.
Il n’en passe pas souvent sur cette ligne.
ACHILLE.
Alors, ce n’est pas commode pour les communications !
MAURICE.
Résumons-nous. Tu préfères ne pas louer ?
ACHILLE.
La villa a ses avantages... on est bien chez soi.
ALBERTE.
Pas de voisins !
ACHILLE.
Mais, alors, on est un peu isolé... Ça doit être triste à la longue... Si on pouvait faire du jardinage.
ALBERTE.
Mais il y a de très jolies fleurs dans le jardin.
ACHILLE.
Oui, mais ça doit être un aria pour les entretenir.
MAURICE.
Décidément, on ne loue pas ?
ACHILLE.
La vue est si belle !
ALBERTE.
Le fait est que la vue est magnifique.
ACHILLE.
Mais l’intérieur est bien moche.
ALBERTE.
Qu’est-ce que tu veux, les maisons toutes meublées...
ACHILLE.
Ces gravures, ces photographies de gens qu’on ne connaît pas, ces meubles qui ne sont plus neufs et qui ne sont pas encore assez anciens.
MAURICE.
Il y a une salle de bains !
ACHILLE.
La bonne femme qui faisait visiter m’a dit qu’il fallait quatre heures pour chauffer un bain... J’aime mieux ne pas y compter, j’emporterai mon tub.
MAURICE.
Alors, on loue ?
ACHILLE.
Je veux bien. Mais, quand la cuisinière verra la cuisine au sous-sol ? Et, vous savez, on n’a qu’un puits pour l’eau... Qu’est-ce que c’est que ce puits ? Il faudra faire bouillir notre eau à boire, et le fourneau de la cuisine est bien petit.
MAURICE.
Alors, je vois que tu es d’avis d’y renoncer.
ACHILLE.
C’est si embêtant de chercher. Si je loue, est-ce que c’est toi qui iras à l’agence pour débattre le prix ?
MAURICE.
Je suis à ta disposition.
ACHILLE.
Oui, parce que, tu sais, s’il faut batailler pour les prix, discuter les réparations, j’aime mieux passer l’été à Paris !
MAURICE.
Alors, j’irai à l’agence demain.
ACHILLE.
Tu ne peux pas y aller maintenant ?
MAURICE.
Bon ! bon ! je vais y passer.
ACHILLE.
Comme ça, on n’en parlera plus !
MAURICE.
C’est à deux pas d’ici, j’y vais et je reviens.
Maurice sort. Les Thouvelin entrent par la gauche. Irma tient son chapeau à la main.
Scène III
ALBERTE, ACHILLE, LES THOUVELIN
IRMA.
Vous, déjà ? Oh ! mais, c’est merveilleux ! Avec ces autos, il n’y a vraiment plus de distance.
ACHILLE.
Oh ! plus de distance !
THOUVELIN.
Oh ! mais, voilà des fleurs magnifiques... En quel honneur ?
ALBERTE.
C’est notre anniversaire de mariage.
THOUVELIN.
Oh ! comment n’ai-je pas su cela ?
IRMA, bas à Thouvelin.
Mais, je te l’avais dit.
Thouvelin lui fait signe de se taire.
ALBERTE.
Et c’est bel et bien notre septième anniversaire.
THOUVELIN.
Vous avez bien compté, voyons, il n’y a pas sept ans que vous êtes mariés...
ACHILLE.
Nous nous sommes mariés en 1904, vous n’avez qu’à compter.
THOUVELIN.
1904 et sept... 1911... 1911 moins sept... 1904.
ACHILLE.
Oh ! vous aurez beau les retourner dans tous les sens...
THOUVELIN.
Eh bien, dites donc, si vous voulez avoir des enfants, il faudrait peut-être vous en occuper.
ALBERTE.
Je ne dirai pas qu’on n’a jamais pensé qu’à ça, mais je crois qu’on a fait ce qu’on a pu... Maintenant, nous pouvons y renoncer.
IRMA.
À qui la faute ?
ALBERTE.
Oh ! les prévisions sont plutôt contre moi ; aucune de mes sœurs n’a eu d’enfant, tandis que les frères d’Achille ont reproduit comme des esturgeons.
ACHILLE.
Vous avez à parler, vous qui faites les malins ! Vous vous êtes contentés d’un rejeton... Et en combien d’années de mariage ? Dites ? Dix ou douze ans ?
IRMA.
Eh ! là ! Eh ! là !
ACHILLE.
J’ai été trop loin ?
THOUVELIN.
Quatorze ans !
IRMA.
Mais, est-ce qu’on te demande de préciser, à toi ?
ALBERTE.
Mais quel âge a votre petit garçon ?
IRMA.
Huit ans bientôt.
ACHILLE.
Eh bien, alors, vous ne l’avez pas eu tout de suite... les professeurs de procréation...
THOUVELIN.
Oh ! je vous demande pardon, il y en avait eu un avant... seulement, celui-là est resté en route.
ACHILLE.
Il ne compte pas, celui-là.
THOUVELIN.
Il compte pour moi. Mais il vaut mieux ne pas parler de ça, ça fait de la peine à Irma, bien qu’elle ne l’ait pas connu... Pauvre petit garçon... ou pauvre petite fille !
ALBERTE.
C’est égal, en dehors de ce passe-temps, qui consiste à vous offrir un enfant tous les huit ans, vous ne devez guère vous amuser à Villeneuve-sur-Saône.
IRMA.
Eh bien, Guillaume a son musée.
ACHILLE.
Je me suis toujours demandé ce qu’un conservateur de musée pouvait faire dans un musée... Les visiteurs, eux... ils ont quelquefois des choses à regarder, mais un conservateur ?
THOUVELIN.
Mon vieux, je travaille quinze heures par jour.
ACHILLE.
Vous êtes fonctionnaire, et vous travaillez quinze heures par jour...
THOUVELIN.
Je travaille à mes collections d’insectes.
ACHILLE.
Ah ! bien, ça n’a pas le moindre rapport avec vos fonctions.
THOUVELIN.
Je vous demande pardon. Quand j’ai été nommé au musée de Villeneuve, les vieux meubles de ce château historique étaient en proie à des quantités d’insectes invisibles... J’ai dû m’occuper de cela et étudier de près ces insectes pour trouver le moyen de les détruire.
ACHILLE.
Et vous vous y êtes tellement intéressé, à ces petites bêtes, que, maintenant, vous les entretenez.
THOUVELIN.
Je ne vais pas jusque-là...
ACHILLE.
Je vous demande pardon si je regarde l’heure... Oh ! j’ai tout de même le temps... Il faut que j’aille voir un client cet après-midi. Vous me permettez de signer quelques pièces ?
THOUVELIN.
Et nous, n’oublions pas notre visite à la tante Émilie.
ACHILLE.
Oh ! il y a bien deux ans que je n’ai été la voir, la tante Émilie.
THOUVELIN.
Vraiment ?
ACHILLE.
Mais oui. On ne voit que les parents qui habitent à quelques centaines de lieues. Ceux qu’on a sous la main, on est tranquille, on n’a pas à penser à eux.
IRMA.
Vous voyez surtout vos amis ?
ALBERTE.
Pas énormément... En dehors de Maurice Marin, qui vient à peu près tous les jours, nous n’avons pas d’amis intimes.
IRMA.
M. Marin est garçon ?
ALBERTE.
Oui.
THOUVELIN.
Et je suis sûr qu’il ne se mariera jamais.
IRMA.
Qu’en sais-tu, Guillaume ? Il est encore jeune.
ALBERTE.
Il a trente-sept ans.
THOUVELIN.
Trente-sept ans ? Tiens ! Je ne le croyais pas plus âgé qu’Achille. Et vous n’avez encore que trente-trois, trente-quatre-ans, vous ?
ACHILLE.
Trente-deux.
THOUVELIN.
Je pensais que vous étiez camarades de lycée, M. Marin et vous !
ALBERTE.
Ils se sont connus à l’école de Droit. Quelques années plus tard, ils se sont retrouvés dans la même compagnie d’assurances... Achille était à la vie, et Maurice Marin aux accidents.
THOUVELIN.
Chacun son goût !
ALBERTE.
Depuis, ils ont pris chacun une agence.
IRMA.
C’est un très bon ami pour vous, M. Marin ?
ALBERTE.
Oh ! un ami excellent.
THOUVELIN.
À Villeneuve, nous avons beaucoup de relations, mais des vrais amis, nous n’en avons pas... Que voulez-vous, les ménages que l’on pourrait fréquenter sont si ennuyeux. Quant aux célibataires...
Il se tait.
ALBERTE.
Les célibataires ?
THOUVELIN.
Eh bien, oui, à Villeneuve, on a moins de liberté qu’à Paris. On pourrait difficilement recevoir, d’une façon continue, un célibataire dans un ménage.
ALBERTE.
Comme nous, Maurice Marin ?
THOUVELIN, après un moment d’embarras qu’il surmonte.
Oui, par exemple, comme vous, M. Marin. Oh ! les gens de province ont une étroitesse d’esprit ! C’est absurde ! C’est idiot ! Mais, nous, avec notre indépendance, nous ne serons jamais les plus forts.
ALBERTE.
C’est un des avantages de Paris. C’est peut-être pour cela que la province se dépeuple....Vous permettez ? Nous allons nous débarrasser de la poussière de la route.
THOUVELIN.
Je vous en prie.
Scène IV
LES THOUVELIN
IRMA.
Eh bien, tu as vu ?
THOUVELIN.
Qu’est-ce que j’ai vu ?
IRMA.
Eh bien, les fleurs... C’est une gaffe... Nous sommes chez Alberte depuis une semaine... La déveine veut que son anniversaire de mariage tombe juste pendant cette semaine-là, et nous ne lui avons rien donné.
THOUVELIN.
On ne souhaite pas l’anniversaire de mariage, ce n’est pas une fête !
IRMA.
Merci. Enfin, il faut absolument que nous leur fassions une politesse.
THOUVELIN.
Quoi ?
IRMA.
On pourrait les inviter à dîner au restaurant.
THOUVELIN.
Fichtre ! Mais, est-ce que c’est indispensable, à ton avis ?
IRMA.
Oh ! indispensable !
THOUVELIN.
Eh bien, c’est gai ! Où les inviter ? Quand nous dînons dehors, tous les deux, au restaurant, nous trouvons de bons petits établissements à trois francs cinquante, compris le vin. C’est, d’ailleurs, aussi bien que dans n’importe quel restaurant. Seulement, du moment qu’on les invite, on ne peut pas les traiter à prix fixe... Ce n’est pas pour l’argent...
IRMA.
C’est pour l’argent !
THOUVELIN.
Ce n’est pas complètement pour l’argent, je t’assure. Je déteste commander sans savoir où je vais... C’est l’inconnu... C’est un peu effrayant.
IRMA.
Voyons, mon ami, il faut tout de même savoir faire un sacrifice, et même avec une politesse, notre voyage nous aura coûté beaucoup moins cher qu’un séjour à l’hôtel : voilà ce qu’il faut se dire. D’ailleurs, quand on est quatre, on ne demande pas pour quatre, bien entendu, on demande pour trois.
THOUVELIN.
Oui, mais si on apporte trois filets de sole ou trois ris de veau quand on est quatre, ça ne fait pas bon effet, la quatrième personne a l’air d’avoir été punie. Enfin, quand est-ce qu’il faut que je les invite ?
IRMA.
Ce soir.
THOUVELIN, sombre.
Ce soir ?
IRMA.
Oui, ce soir, s’ils sont libres. Comme ça, nous aurons l’air de fêter leur anniversaire.
THOUVELIN.
Eh bien, fêtons-le... Mais, écoute, j’y pense... Et Maurice Marin, est-ce qu’il faut l’inviter, lui ?
IRMA.
Depuis une semaine, je l’ai vu ici tous les jours. Il est de toutes les expéditions au dehors ; on peut le considérer comme de la maison... Dis-moi, est-ce que tu crois qu’il y a quelque chose entre Alberte et lui ?
THOUVELIN.
Je me le suis déjà demandé.
IRMA.
Et qu’est-ce que tu t’es répondu ?
THOUVELIN.
Je ne me suis pas répondu. Et toi ?
IRMA.
Moi aussi, je flotte.
THOUVELIN.
Tu vois comme c’est compliqué, tout de même, quand on se met à inviter les gens à dîner.
IRMA.
Mais non, ce n’est pas compliqué. C’est même très simple : ou il y a quelque chose entre eux, ou il n’y a rien...
THOUVELIN.
Ça, c’est inattaquable !
IRMA.
Eh bien, dans le doute, il faut inviter Maurice Marin. Supposons qu’on ne l’invite pas...
THOUVELIN.
Je suppose...
IRMA.
Et qu’il y ait vraiment quelque chose entre eux... Alors, c’est une soirée ratée, ce sont des frais inutiles... Alberte ne cessera d’être morne, maussade, et elle ne nous saura aucun gré de notre invitation, au contraire. Et, même, es-tu sûr qu’au dernier moment elle ne nous fasse pas le coup de la migraine, pour ne pas venir du tout ? Tandis que, si nous invitons Maurice Marin, elle sera épanouie, pleine d’entrain, de bonne humeur, et elle nous aura beaucoup de reconnaissance. Elle est même capable de ne plus nous laisser partir, après ça... Et puis, il n’y a pas à discuter, mon ami, à Paris, c’est l’usage, on ne met jamais une femme à côté de son mari. On s’arrange toujours pour la mettre à côté de son ami... c’est ce que les maîtresses de maison appellent « faire leur table ». C’est tout un art !
THOUVELIN.
Tu as raison... tu as raison... Invitons Maurice Marin... De toutes façons, ce sera plus convenable... Et puis, une fois qu’on s’est lancé dans les folies...
Après réflexion.
Seulement, je ne sais pas si, quand on est cinq, on peut encore demander pour trois.
Scène V
LES THOUVELIN, ALBERTE, ACHILLE, puis MAURICE
ALBERTE.
Et voilà ! On fait semblant d’enlever la poussière, on se met tout bonnement un petit peu de poudre sur le nez, et, tout de suite, ça va mieux... Qu’est-ce que vous complotez, tous les deux ?
THOUVELIN.
Ah ! Ah ! Voilà !... Vous voulez le savoir ?... Eh bien, nous complotons une petite partie pour fêter votre anniversaire... Si nous allions dîner tous ce soir au cabaret ?
À Irma.
J’ai dit au cabaret exprès, c’est tout de suite moins fastueux !...
ALBERTE.
Mais... c’est-à-dire...
IRMA.
Et si M. Marin voulait bien être des nôtres... J’espère qu’il sera libre ?...
ALBERTE.
Je crois qu’il n’a pas d’engagement pour ce soir, qu’il acceptera avec plaisir... vous lui êtes très sympathiques...
On sonne.
D’ailleurs, c’est lui très probablement, il a dit qu’il allait revenir...
Entrée de Maurice, baisemain, poignées de main.
Mon cher ami, mes cousins nous font l’amitié de nous inviter tous les trois pour dîner, ce soir. Êtes-vous libre ?
MAURICE.
Mais, bien sûr... Madame, monsieur, je suis charmé, enchanté, et surtout très touché que vous ayez pensé à moi, que vous connaissez depuis si peu de temps...
ALBERTE.
Oh ! mes cousins vous connaissent bien mieux que vous ne pensez... Tout à l’heure encore nous parlions de vous...
MAURICE.
Vous parliez de moi ?
ALBERTE.
Oui, oui, de vous ! Mes cousins nous enviaient de recevoir si souvent un ami intime. Il paraît que ce n’est pas possible en province, et que tout célibataire admis dans un ménage est nécessairement l’amant de la dame.
THOUVELIN.
Non, voyons, on ne va tout de même pas jusque-là !...
MAURICE.
Alors, les malheureuses dames de Villeneuve, qu’est-ce qu’elles ont dans la vie ? Elles ne peuvent pécher qu’avec des hommes mariés.
ACHILLE.
Oh ! Écoutez ! Écoutez ! Nous sommes tous à Paris, maintenant, nous ne sommes pas en province, et vous êtes là à ragoter, à potiner, comme si vous étiez des gens de Villeneuve... Oh ! Quel sujet intéressant ! Et quel dommage de s’arracher à cette conversation passionnante pour aller vaquer à des affaires !... Il faut que je sorte... à tout à l’heure...
THOUVELIN.
Eh bien, il faut que je parte aussi... Est-ce que tu viens, Irma ?
ACHILLE.
Après la visite à tante Émilie, qu’est-ce que vous faites ?
THOUVELIN.
Nous avons un petit projet : nous allons faire le tour de Paris en métro...
MAURICE.
Mais vous n’allez pas voir grand’chose, excepté dans les parcours aériens...
THOUVELIN.
Non, c’est simplement pour aller en métro.
IRMA.
À tout à l’heure, Alberte, nous reviendrons nous habiller pour dîner...
ALBERTE.
Eh bien, oui, c’est cela. On se donnera rendez-vous ici.
ACHILLE.
Alberte, je vais chez Caudivier. Mais, auparavant, j’ai un coup de téléphone à donner...
Il s’en va par la droite.
IRMA, bas à Thouvelin.
Tu as vu comme Achille était nerveux... Je suis sûr qu’il doit être jaloux... Mais je n’ai pas l’impression qu’il y ait quelque chose entre les deux autres...
THOUVELIN.
Non... mais, dis donc, alors, nous avons peut-être eu tort d’inviter Maurice Marin ?
IRMA.
Une politesse est toujours utile. Ils sortent par le fond.
Scène VI
MAURICE, ALBERTE
Maurice, l’instant d’après, s’approche d’Alberte et la prend dans ses bras.
MAURICE.
Petit bec chéri !...
ALBERTE.
Petite bec aimée !...
MAURICE.
Tu n’es pas gentille, aujourd’hui, avec moi.
ALBERTE.
Pourquoi ça, ma petite reine ?
MAURICE.
Tu n’as pas eu ton bon regard quand je suis rentré, tout à l’heure.
ALBERTE.
C’est ça... c’est ça !... Il fallait sortir mon bon regard devant les Thouvelin... Ça ne fait pourtant pas partie des curiosités de Paris, ça...
MAURICE.
Qu’est-ce que tu penses qu’ils croient, les Thouvelin ?
ALBERTE.
Oh ! Je suis bien tranquille, tu sais... Ils ont peut-être un tout petit, tout petit soupçon... mais je n’ai pas été maladroite avec eux... J’ai abordé la question devant eux, tout à l’heure, du ton le plus franc. Maintenant, ils doivent être persuadés qu’il n’y a rien entre nous, heureusement, tu sais !
MAURICE.
Pourquoi, ce sont de méchantes gens ?
ALBERTE.
Non, ce ne sont pas de méchantes gens, ils sont simplement très mauvaises langues... Tu comprends, ils n’ont pas grand’chose à faire dans la vie... Il n’a jamais eu de maîtresse... Elle n’a jamais eu d’amant... Alors, ils parlent des autres personnes, et, naturellement, cela les soulage, de dire sur leur prochain les choses les plus effroyables... Je suis sûre que si, tout à l’heure, je n’avais pas parlé de toi carrément, eh bien, à la prochaine occasion, ils auraient marché à fond de train contre nous... Seulement, n’est-ce pas, j’ai pris les devants... Ils ont senti que je les traitais en amis... Maintenant, si on nous attaque devant eux, je suis sûre qu’ils nous défendront.
MAURICE.
Tu m’aimes, bec ?
ALBERTE.
Ce n’est pas la question.
MAURICE.
C’est toujours la question... Tu m’aimes, petite bec ?
ALBERTE.
Je t’adore !...
Ils se baisent longuement les lèvres. Alberte se dégage tout à coup, en levant la tête.
J’ai oublié de dire à la cuisinière qu’on ne dînait pas.
MAURICE.
Ah ! c’est à ça que tu penses en m’embrassant ?
ALBERTE.
Non, mais, c’est que je vais te dire...
MAURICE.
Écoute, mon petit, moi, quand je t’embrasse, je pense à ce que je fais.
ALBERTE.
Mais, moi aussi, voyons. Oh ! qu’elle est méchante !... Tiens !...
Elle lui baise encore les lèvres.
Tiens ! regarde, si je pense à ce que je fais.
MAURICE.
Elle est gentille, cette petite bec...
Il la prend dans ses bras.
Je crois que je vais avoir beaucoup de sympathie pour cette personne. En tout cas, je crois que je ne vais avoir pour elle aucune espèce d’éloignement... Si on allait chez nous ?...
ALBERTE, toujours dans ses bras.
Demain.
MAURICE.
Pourquoi ça, demain ?
ALBERTE, sérieuse.
Demain, chéri, les Thouvelin ne déjeunent pas ici... Je pourrai sortir de bonne heure.
MAURICE.
Est-ce que tu m’aimes un petit peu ?
Ils s’embrassent. Tout à coup, on entend du bruit dans le fond. Tous deux se désenlacent vivement. Maurice, la voix changée, et sans, trop savoir ce qu’il dit.
Quelles nouvelles ?
ALBERTE, de même.
Aucune, aucune nouvelle...
MAURICE, d’un ton faussement dégagé.
Savez-vous quand ouvre l’exposition des fleurs ?
ALBERTE.
L’année prochaine.
MAURICE.
Celle de cette année...
ALBERTE.
Bientôt, je crois...
MAURICE.
Nous ne manquerons pas d’y aller, n’est-ce pas ?
ALBERTE.
C’est une idée.
MAURICE.
C’est une très bonne idée.
ALBERTE, gagne le fond et, tout en pensant à autre chose.
C’est une idée excellente.
À mi-voix.
Il n’y a plus personne...
MAURICE, de même.
Qui est-ce qui a pu passer par là ?
ALBERTE, de même.
C’est effrayant. Quelqu’un est venu, certainement. Tu avais raison quand tu me disais...
MAURICE, bas.
Il faut me dire : vous.
ALBERTE.
Mais je te dis des choses assez compromettantes par elles-mêmes...
MAURICE.
Cela ne fait rien... le « tu » s’entend trop !
ALBERTE.
Alors vous aviez raison, quand vous me disiez qu’il valait mieux ne pas s’embrasser dans cette pièce.
MAURICE.
C’est stupide... c’est de la folie...
ALBERTE.
Quel malheur de s’être laissé pincer !... Nous qui depuis deux ans... Mais, sais-tu... ?
MAURICE.
Vous, vous...
ALBERTE, effarée, sans comprendre.
Vous, vous ?
MAURICE.
Dites-moi vous... Dites-moi vous !...
ALBERTE, de même, toujours bas.
Je veux bien te dire vous, mais je ne sais plus du tout ce que je disais.
MAURICE.
Tu disais...
Tapant du pied avec impatience.
Vous me disiez... vous me demandiez si je savais...
ALBERTE.
Sais-tu qui a pu nous voir ?
MAURICE.
Je n’en ai aucune idée...
ALBERTE.
On était si tranquilles !... On était trop tranquilles. On ne pensait pas qu’une pareille chose arriverait jamais !
MAURICE.
C’est absurde de n’avoir pas pris plus de précautions... pour une fois...
ALBERTE.
Qu’est-ce qui va arriver ?
MAURICE.
Rassure-toi.
ALBERTE.
Rassure-toi... Rassure-toi !... Il me dit : « Rassure-toi !... » Est-ce que tu es rassuré, toi ? Voilà quelqu’un...
MAURICE.
Qui est-ce encore ?
Achille apparaît à la baie. Il regarde Alberte et Maurice, qui paraissent atterrés.
Scène VII
MAURICE, ALBERTE, ACHILLE
ACHILLE.
Qu’est-ce qui vous arrive ?
MAURICE.
Une chose très grave... Figure-toi qu’on nous a vus nous embrasser...
ACHILLE, après un silence.
Vous êtes bien embêtants...
MAURICE.
Qu’est-ce que tu veux !... On ne pouvait pas se douter... c’est quelqu’un qui est passé dans la pièce du fond... Je ne sais pas qui... un moment, j’avais espéré que c’était toi.
ACHILLE.
J’étais au téléphone.
MAURICE.
Ce n’était pas les Thouvelin. Ils étaient sortis.
ALBERTE.
C’était peut-être la femme de chambre ?
ACHILLE.
Non... Je l’ai entendue au premier étage... Oh ! ça ne peut être que Clément... Il a dû venir trainer par ici... soi-disant pour venir prendre des papiers avant de s’en aller... C’est Clément, les papiers ne sont plus là. C’est Clément.
ALBERTE.
Oh ! Clément !... mais c’est l’homme le plus bavard de Paris, l’être le plus malfaisant, le plus venimeux, c’est la rosserie en personne...
ACHILLE.
Oui... Il représente le jugement du monde.
MAURICE.
En tout cas, il y a quelqu’un qui nous a vus... Et, surtout si c’est Clément, notre affaire est sûre... Ça se saura... Qu’est-ce que vous voulez... ce que nous avons voulu éviter se réalisera : ça se saura.
Silence.
Ça ne sert à rien de se faire de la bile ; il faut prendre des résolutions, puisque cet événement crée pour nous un état de choses nouveau...
ALBERTE.
Mais quelles résolutions ?
MAURICE.
Écoute, Achille, le jour où je me suis aperçu que j’aimais ta femme, je t’en ai prévenu loyalement...
ACHILLE.
Très loyalement...
ALBERTE.
À ce moment, je me suis aperçue que j’aimais aussi Maurice, et immédiatement, je te l’ai avoué.
ACHILLE.
Ah ! oui... immédiatement... Tu n’as pas attendu.
MAURICE.
Alors, à ce moment-là, nous avons fait une espèce de divorce amiable... nous avions l’idée d’éviter le scandale, nous voulions aussi, peut-être, ménager ton vieil oncle, qui vivait encore...
ACHILLE.
C’est peut-être aussi par paresse...
MAURICE.
Écoute... il ne faut pas être plus sévère pour nous que de raison... C’est peut-être aussi parce que nous avions des motifs un peu plus chic... nous avions horreur des choses et des gens de la chicane, nous ne voulions pas les introduire dans notre vie intime... il nous semblait...
ACHILLE.
Oui, il nous semblait que nous avions le droit d’agir à notre guise, entre nous, que nous n’avions à rendre de comptes à qui que ce soit, du moment que nous ne faisions de tort à personne... Peut-être avons-nous fait ce qui se fera carrément dans un demi-siècle...
MAURICE.
Nous nous sommes passés de la procédure... nous avons décidé que ta compagne devenait ma compagne, que, elle et toi, vous ne seriez plus que des camarades...
ACHILLE.
De très bons camarades...
MAURICE.
Comme nous vivons dans un temps et pas dans un autre, il a bien fallu faire des concessions, il a fallu cacher notre pacte ; au fond, sauver les apparences pour ne pas nous faire tort, pour ne pas aller contre la morale. Mais, aujourd’hui, nous nous trouvons en présence d’une situation modifiée : le monde ne savait pas ; il sait maintenant... ou il va savoir... nous devenons des êtres immoraux... il ne faut pas.
ACHILLE.
Il ne faut pas.
ALBERTE.
Il ne faut pas.
MAURICE.
Autrement nous nous diminuons... toi, tu deviens le mari trompé... Qu’est-ce que tu veux que je te dise ?
ACHILLE.
Je ne tiens pas à ce que tu me dises autre chose...
MAURICE.
Alberte devient, elle, la femme adultère...
ALBERTE, blessée.
Oh ! Maurice !
MAURICE.
Il ne faut pas que cela soit. Maintenant, le moment est venu de nous mettre en règle avec la société... du moment qu’elle est au courant... J’étais, en fait, le véritable mari de ta femme, il faut, désormais, que je le sois en droit... Les événements nous poussent d’une façon irrésistible au divorce... Vous allez divorcer... J’épouserai Alberte... Qu’est-ce qu’il t’en semble, Achille ?
ACHILLE.
Il me semble...
Il regarde Alberte.
ALBERTE.
Eh bien, oui... que veux-tu faire d’autre ?
MAURICE.
Nous allons prendre nos dispositions...
À Alberte.
Il faut que vous voyiez un avoué, sans retard... Il vous dira probablement de quitter le domicile conjugal et d’aller vous installer chez un de vos parents...
ALBERTE, à Achille.
Tu crois ?... Vous croyez ?... Tu crois ?...
ACHILLE.
Je le crois.
MAURICE.
Évidemment, c’est un dérangement...
ALBERTE.
C’est un dérangement.
ACHILLE.
C’est un dérangement.
MAURICE.
Mais il me semble que c’est une solution inévitable... Du reste, au fond, tout cela n’est que de simple formalité... Vous irez habiter chez votre tante... J’irai vous y rendre visite... Achille, également, vous rendra visite à sa guise. J’ai des amis au Palais, qui activeront la procédure, et cela ne traînera pas... Une fois mariés, nous recevrons Achille comme vous aviez l’amabilité de me recevoir... Rien n’interdit au mari divorcé de revenir voir sa femme.
ACHILLE, faiblement.
Le divorce est une institution de trop fraîche date pour qu’il y ait, à cet égard, des usages établis...
MAURICE.
En somme, il n’y aura rien de changé entre nous... nous serons simplement en règle avec l’opinion... Eh bien, Achille, ce n’est pas ton avis ? Tu ne dis rien...
ACHILLE.
Mais si... mais si... Je suis absolument de ton avis... Il n’y aura rien de changé entre nous... Tout ce que tu dis là est évidemment logique, et inévitable...
MAURICE.
Mais il y a pourtant quelque chose qui t’embête, dis ?
ACHILLE.
Rien, rien...
MAURICE.
Mais encore...
ACHILLE.
Alberte ? Est-ce que tu crois que je vais être obligé de le dire ce soir aux Thouvelin ?
ALBERTE.
Oh ! on peut attendre à demain.
ACHILLE.
Mais ce qu’il y a d’ennuyeux c’est de dîner au restaurant avec eux... Ils ont organisé ça pour notre anniversaire de mariage. Eh bien, ce n’est peut-être pas le jour de fêter notre anniversaire de mariage... nous venons de passer par des événements graves et imprévus... et il me serait difficile de cacher mon état d’esprit et ma préoccupation...
MAURICE.
Eh bien, c’est très simple, il n’y a qu’à supprimer la petite fête... nous prétexterons un dîner d’affaires au dernier moment.
ALBERTE.
Un dîner d’affaires au dernier moment...
MAURICE.
Puisqu’ils repassent ici, il sera facile de les prévenir. Ils iront dîner de leur côté, puis nous irons dans un restaurant quelconque.
À Achille.
Ça te va ?
ACHILLE.
Oui, ça me, va.
MAURICE.
Demain matin, je viendrai ici de, bonne heure avec un de mes amis, qui est principal clerc d’avoué... Je vais d’ailleurs tâcher d’aller le voir tout de suite...
Il serre la main d’Achille.
Eh bien, à tout à l’heure, au revoir, mon vieux...
À Alberte.
Au revoir, Alberte !
Il sort. Un silence.
Scène VIII
ACHILLE, ALBERTE
ACHILLE.
J’ai quelques petites courses très pressées ; je m’en vais être obligé de sortir aussi.
Après un moment d’embarras.
Au revoir, Alberte !
Il sort. Elle sonne et s’abîme dans ses réflexions. Entre la femme de chambre.
Scène IX
ALBERTE, CÉLINA
CÉLINA.
Madame a sonné ?
ALBERTE.
J’ai sonné ?
CÉLINA.
Oui, madame.
ALBERTE.
Pourquoi est-ce que j’ai sonné ?... Ah ! je sais !... Vous direz à la cuisinière que nous ne dînons pas ce soir.
ACTE II
Même décor.
Scène première
CÉLINA, LES THOUVELIN
CÉLINA, entre.
Je vais prévenir Mme Marin.
Elle sort.
THOUVELIN.
Alors quoi, le nouveau ménage a gardé la même maison.
IRMA.
Il paraît ! ils n’ont même pas changé les meubles de place.
THOUVELIN.
Depuis quinze mois.
CÉLINA, entrant.
Mme Marin sera à vous dans quelques instants.
IRMA.
Vous êtes donc restée ici, Célina.
CÉLINA.
Oui, madame, je suis restée avec madame, j’ai suivi madame chez sa tante et, quand madame s’est remariée, j’ai pas demandé mieux que de rester avec elle, puisqu’on s’entendait bien toutes les deux.
Alberte entre.
Scène II
LES THOUVELIN, ALBERTE
ALBERTE.
Comment ! Comment ! Vous arrivez à Paris sans nous prévenir et vous nous faites l’affront de descendre à l’hôtel ? C’est tout à fait méchant, ça, vous savez !... Vraiment, ce n’est pas une raison parce que je m’appelle Mme Marin pour que mes cousins ne soient plus mes cousins...
IRMA, pudique.
Oh ! nous avons eu peur d’être indiscrets, de vous déranger. Vous comprenez, un jeune ménage...
ALBERTE, cherchant.
Un jeune ménage... Ah ! oui, nous ?... Oh ! bien, ce n’est pas absolument ce qu’on peut appeler un jeune ménage, bien que nous ne soyons mariés que depuis quatre mois...
THOUVELIN.
Je vois que vous avez conservé la même maison.
ALBERTE.
Oui. Ce petit hôtel m’appartient, il fait partie de ma dot, alors nous avons trouvé plus simple d’y demeurer... Achille s’est installé tout près...
IRMA.
Mais alors, vous devez le rencontrer quelquefois ?
ALBERTE.
Comment ! mais nous n’avons pas cessé de le voir.
IRMA.
Ah ! bien.
ALBERTE.
J’ai toujours pour lui la même affection, et je crois qu’il me la rend bien... de même qu’il a gardé son amitié pour Maurice.
IRMA.
Je trouve ça très bien, moi.
THOUVELIN.
Oui, c’est très bien que les liens d’affection survivent à ces événements conjugaux qui, en somme...
IRMA.
C’est très bien, c’est très bien...
THOUVELIN.
Est-ce que nous aurons le plaisir de voir M. Marin ?
ALBERTE.
Eh bien, il va rentrer tout à l’heure...
THOUVELIN.
Ah ! tout à l’heure... vous ne savez pas au juste ?
ALBERTE.
Non, il a dit qu’il rentrerait bientôt.
THOUVELIN.
C’est que j’ai peur de ne pouvoir l’attendre.
IRMA.
Oui, nous devons aller à une conférence à la salle Charras.
ALBERTE.
Sur un sujet intéressant ?
THOUVELIN.
Un sujet intéressant ? Nous ne savons pas au juste...
IRMA.
On nous a donné des billets.
ALBERTE.
Et M. Thouvelin est toujours passionné de... comment dit-on ?... la science des insectes... un mot comme étymologie...
THOUVELIN.
L’entomologie.
IRMA.
Oui, seulement ce n’est plus les insectes des meubles qui passionnent mon mari, ce sont les insectes des vêtements. Figurez-vous qu’il me défend de mettre de la naphtaline dans mes paquets d’été.
THOUVELIN.
Ne l’écoutez pas, cousine.
IRMA.
Mon petit, on va laisser Mme Marin.
ALBERTE.
Mais je n’ai rien à faire.
THOUVELIN.
Si ! Si !... Et puis nous avons notre conférence.
ALBERTE.
Ah ! oui ! votre conférence...
THOUVELIN.
Oh ! ce n’est pas que nous y tenions énormément. Moi, ça m’ennuie toujours... Et puis il y a des artistes annoncés, mais il y en a beaucoup qui font faux bond.
IRMA.
Il faut bien profiter de nos billets.
THOUVELIN.
Vous avez une station de métro par ici ?
ALBERTE.
Au bout de l’avenue.
THOUVELIN.
Oh ! nous avons pris pour venir un de ces autos à taximètre... Je ne sais pas ce qu’il y avait dans le compteur, il avançait tout le temps. Et nous en avons eu pour une somme...
ALBERTE.
Vous avez peut-être pris un drapeau blanc au lieu d’un drapeau rouge ?
THOUVELIN.
Ah ! je ne savais pas ça... On s’y perd, qu’est-ce que vous voulez. Il faudra que je note ça... ou plutôt, je vais renoncer à prendre des automobiles à taximètres... Nous allons prendre le métro, c’est plus sûr. Moi je suis toujours disposé à payer ce qu’on veut, mais je préfère que ce soit une somme fixe.
ALBERTE.
Je vous demanderais bien de rester à dîner, mais je ne connais pas les projets de mon mari... En tout cas, il faut que nous arrangions cela pour un jour très prochain.
THOUVELIN.
Non, non ! C’est nous qui sommes venus avec des intentions précises à ce sujet. C’est nous qui vous invitons à dîner... vous viendrez dîner à notre hôtel, ou ailleurs, mais vous nous devez une soirée. Rappelez-vous notre partie manquée à notre dernier voyage, il y a... quinze mois... ma foi oui, il y a bien quinze mois... Cette affaire qui vous a retenus au dernier moment... L’invitation est toujours valable et nous tenons à ce que vous l’acceptiez...
ALBERTE.
Entendu...
THOUVELIN.
Voyons, nous allons partir pour quelques jours du côté de Lille pour voir un oncle de ma femme. À notre retour, nous passerons par Paris... Ce sera aujourd’hui en huit. Croyez-vous que M. Marin sera libre aujourd’hui en huit pour dîner le soir ?
ALBERTE.
Je vais lui demander ça... En tout cas, je vous remercie pour nous deux.
IRMA.
Alors, si vous le permettez, aujourd’hui en huit, à trois heures, nous viendrons prendre la réponse...
ALBERTE.
Je pourrais vous écrire.
THOUVELIN.
Non, non, nous viendrons en nous promenant, par le métro...
ALBERTE.
Bien, bien !
IRMA.
Et nous vous remercions de votre aimable accueil.
ALBERTE.
Oh ! mais, voyons...
THOUVELIN.
Vous ferez bien nos amitiés à votre mari.
ALBERTE.
C’est lui qui va être navré, mais vous savez, navré de vous avoir manqués...
Les Thouvelin sortent. Dès qu’ils sont sortis, elle va à la porte de droite qu’elle entr’ouvre.
Maurice... tu peux venir : ils sont partis !
Scène III
ALBERTE, MAURICE
MAURICE.
Eh bien, vrai ! j’ai cru qu’ils ne s’en iraient jamais... On n’a pas entendu que je téléphonais, n’est-ce pas...
ALBERTE.
Non, non. Dis donc, ils viennent de nous inviter à dîner tous les deux pour dans huit jours... C’est leur vieille invitation de l’année dernière qui ressert. Ils espèrent sans doute, en retour, qu’on va les combler de billets de théâtre... J’ai dit que j’allais te consulter.
MAURICE.
Oh ! qu’est-ce que tu veux ? Acceptons. On leur a déjà fait faux bond l’an dernier... Dis donc, c’étaient les Raymond qui parlaient au téléphone. Ils vont à l’Opéra ce soir ; ils nous offrent deux places dans leur loge.
ALBERTE.
Eh bien, oui, on peut accepter... Mais j’y pense... si Achille vient passer la soirée ici...
MAURICE.
Et il viendra très probablement... Mais on ne va pas se gêner avec lui. Nous lui dirons que nous allons à l’Opéra.
ALBERTE.
Tu ne veux pas essayer encore une fois de le faire inviter ?
MAURICE.
Oh ! non, rappelle-toi ce qui s’est passé à l’Opéra-Comique... Les Gérard nous offrent deux places dans leur loge. Comme nous sommes très intimes avec eux, nous avons emmené Achille. C’est effrayant ce qu’on était tassé... Les Gérard nous ont souri beaucoup plus aimablement qu’à l’ordinaire, mais je connais ce sourire-là : ça veut dire qu’ils ne nous inviteront plus... Et puis, n’est-ce pas, je ne sais pas... il y a des gens qui sont un peu gênés de cette situation ; ainsi les Thouvelin, tu vois, ils nous invitaient tous les trois, l’année dernière, et maintenant ils n’invitent plus Achille.
ALBERTE.
Évidemment.
MAURICE.
Qu’est-ce que tu veux, nous allons lui dire que nous n’avons que deux places...
ALBERTE.
Oui, mais va-t-il comprendre ?
MAURICE.
Je n’en sais rien.
ALBERTE.
C’est qu’il tient tant à nous !...
MAURICE.
Oui, il est comme un enfant : il ne veut pas nous quitter...
ALBERTE.
C’est très rare, un attachement pareil.
MAURICE.
Mais il en souffre... Il est évident que nous sommes aussi aimables que possible avec lui, mais un jour, que veux-tu, nous pourrons nous montrer un peu fatigués... ce serait un déchirement pour ce pauvre garçon.
ALBERTE.
C’est comme pour la question du dimanche ; il prétend qu’il ne peut pas passer le dimanche tout seul. D’autant plus qu’il lui semble bien naturel que nous l’emmenions dans notre auto, comme il t’emmenait dans la sienne...
MAURICE.
J’aurais dû prendre une carrosserie à deux places : la question ne se serait pas posée.
ALBERTE.
Qu’est-ce que tu veux, c’est parfois un peu gênant, mais c’est tout de même quelque chose de rare, d’avoir un bon ami comme ça dans la vie.
MAURICE.
Oui, ça n’est pas commun. On sent chez lui une telle chaleur d’affection.
ALBERTE.
Que nous avons également pour lui d’ailleurs.
MAURICE.
Oui, que nous avons pour lui.
ALBERTE.
Qu’est-ce que c’est ? On a gratté à la porte...
MAURICE.
On a gratté à la porte ?
ALBERTE.
Oui, par là... quel est ce bruit ?
Scène IV
ALBERTE, MAURICE, ACHILLE
ACHILLE.
C’est moi.
MAURICE.
Je vois.
ALBERTE.
Comment se fait-il que je ne vous aie pas entendu sonner ?
ACHILLE.
J’ai retrouvé une clef d’entrée d’ici dans une poche de mon vieux veston... Alors, je pourrai la garder, n’est-ce pas ? Comme ça, les domestiques n’auraient pas besoin de se déranger pour venir m’ouvrir. Vous n’y voyez pas d’inconvénient ?
MAURICE.
Aucun, aucun.
ACHILLE.
Dites donc, j’ai gardé ma soirée. J’ai rencontré un vieux camarade qui voulait m’enlever. Mais j’ai refusé pour rester libre... Qu’est-ce qu’on fait ?
ALBERTE.
C’est ennuyeux que vous ayez refusé à votre camarade. Vous auriez pu accepter, nous sommes justement invités à l’Opéra.
ACHILLE.
À l’Opéra, dans une loge !
MAURICE.
Oui, dans une loge, mais les Raymond ont spécifié qu’ils ne pouvaient disposer que de deux places... deux toutes petites places, ont-ils même ajouté...
ACHILLE.
Et vous tenez beaucoup à y aller ? On est si bien ici.
MAURICE.
Nous ne pouvons pas refuser aux Raymond qui ont pensé à nous. On les froisserait.
ACHILLE.
Tu as raison, ne froissez pas les Raymond... Eh bien, je vais aller téléphoner par là pour tâcher d’occuper ma soirée.
Il sort.
Scène V
ALBERTE, MAURICE
ALBERTE.
Si on pouvait lui trouver une occupation plus absorbante.
MAURICE.
...Qui le tienne l’après-midi et même aussi le soir... mais es-tu sûr qu’il consente à prendre un emploi... Il ne se plaint pas de n’avoir rien à faire... Il ne s’ennuie donc jamais !...
ALBERTE.
Il passe des heures sur ce fauteuil... Si on sort, si on arrive à sortir, on le retrouve à la même place en rentrant.
MAURICE.
Il a une si belle confiance dans notre amitié qu’il ne s’imagine pas qu’il nous gêne... Ainsi, il ne se dit pas une minute que nous voudrions, de temps en temps, dîner seuls.
ALBERTE.
J’ai essayé quelquefois jusqu’à huit heures et quart de ne pas lui demander de dîner avec nous ; il ne s’en allait pas, la cuisinière m’a demandé trois fois si elle pouvait servir ; j’ai fini par lui dire : oui, de guerre lasse et par inviter Achille.
MAURICE.
C’était un peu comme je faisais jadis quand je venais chez vous...
ALBERTE.
Mais il est persuadé que nous avons le plus grand plaisir à partager notre repas avec lui...
MAURICE.
Une petite récrimination personnelle. L’autre jour, comme on ne l’attendait pas du tout, on m’avait fait un petit tournedos parce qu’il y avait un gigot et que je n’en mange pas... Comme il ne mange pas de gigot non plus, je lui ai offert mon petit filet : il l’a pris...
ALBERTE.
Pourquoi le lui as-tu offert ?
MAURICE.
Comment veux-tu que je fasse autrement : je suis chez moi, ici... c’est-à-dire que je suis chez moi...
ALBERTE.
Nous ne sommes pas chez nous, voilà la vérité.
MAURICE.
Enfin, quoi ? Il n’y aurait pas moyen de lui faire comprendre... de lui faire comprendre qu’on l’aime bien, mais qu’on l’aimerait davantage s’il s’imposait moins... Mais comment veux-tu dire à quelqu’un qu’il est indiscret ?
ALBERTE.
Oh ! je vais lui dire ça, moi.
MAURICE.
Tu ne feras pas ça.
ALBERTE.
Tu verras.
MAURICE.
Je sais bien que c’est dans son intérêt autant que dans le nôtre... Il n’y a pas d’être meilleur et plus sympathique... de là à devenir odieux, il n’y a qu’un pas.
ALBERTE.
Odieux est un mot un peu trop fort. Il est un peu embêtant.
MAURICE.
On n’est pas un peu embêtant...
Songeur.
C’est curieux...
ALBERTE.
Oui, je vois ce que tu veux dire : il n’était, pas comme cela jadis.
MAURICE.
Oui, quand il était ton mari, il était d’une discrétion... oui, c’est un homme délicat... Comme il avait tous les droits de nous troubler, il n’en usait pas, et maintenant qu’il n’en a plus, il en abuse.
ALBERTE.
Je vais lui parler...
MAURICE.
Tu oseras ?
ALBERTE.
Tu vas voir...
MAURICE.
Non, je ne verrai pas ça... Tu me raconteras.
ALBERTE.
Ah ! Voilà l’homme brave !
MAURICE.
Si on allait faire un voyage ?
ALBERTE.
Il nous suivrait... Mais c’est si simple d’avoir une explication.
MAURICE.
Simple ! Simple !... Le voilà qui revient.
Scène VI
ALBERTE, MAURICE, ACHILLE
ACHILLE, rentrant.
C’est curieux comme cet appareil téléphonique est plus agréable que le mien... Il est pourtant de la même marque...
ALBERTE.
Avez-vous organisé votre soirée ?
ACHILLE.
Non, mais ne vous occupez pas de moi. J’ai demandé deux amis à l’appareil, avec l’espoir qu’aucun d’eux ne serait chez lui, ils étaient libres l’un et l’autre ce soir, et pourtant je ne leur ai pas proposé de passer la soirée avec eux... Je leur ai parlé d’autre chose. Je passerai à l’Opéra, je tâcherai d’avoir un fauteuil et j’irai vous voir pendant les entr’actes... Je suis énervé aujourd’hui..., agacé, je ne me sens pas le courage de passer la soirée seul... Il n’est venu personne aujourd’hui ?...
ALBERTE.
Non... Si... les Thouvelin.
ACHILLE.
Ah ! les Thouvelin sont à Paris. Tiens, j’aurais voulu les voir... Est-ce qu’ils doivent revenir ?
ALBERTE.
Oui, dans huit jours. Ils nous ont invités à dîner.
ACHILLE.
Nous trois ?
ALBERTE.
Je pense.
ACHILLE.
Enfin quoi, ils vous ont dit de me le dire ?
ALBERTE.
Hé bien... je ne sais pas... Ils vont peut-être vous écrire.
ACHILLE.
Ils ne m’inviteront pas... vous verrez... Ils ne m’inviteront pas.
Énervé et machinal.
Je voudrais une cigarette...
S’approchant d’une table.
Tiens, le tiroir aux cigarettes ne s’ouvre plus ?
ALBERTE.
Il est de l’autre côté, on a retourné la table.
ACHILLE.
Pourquoi a-t-on retourné cette table ?
Silence.
MAURICE.
Moi, mes enfants, il faut que je sorte. Vous allez m’excuser.
ACHILLE.
Va, va, ne te gêne pas avec moi. Je reste avec Alberte.
À Alberte.
Je pense que vous n’avez pas à sortir ?
ALBERTE.
Non, non.
ACHILLE.
C’est curieux comme j’ai pris facilement le pli de vous dire vous. Au fond, je pouvais très bien vous dire tu, mais nous avons jugé que c’était plus convenable... Voilà des petites concessions à l’opinion auxquelles je ne tiens guère. Enfin, c’était plutôt votre idée.
MAURICE.
Eh bien, au revoir. Je te quitte.
ACHILLE.
Tu me quittes... L’opinion nous permet de nous tutoyer.
MAURICE, après avoir fait un mouvement vers Alberte, lui fait de la main un signe d’adieu.
Au revoir !
ALBERTE.
Au revoir.
Maurice sort.
Scène VII
ALBERTE, ACHILLE
ACHILLE.
Alberte, je ne suis pas fâché de rester seul avec vous, j’avais quelque chose à vous dire...
ALBERTE.
Quelque chose à me dire ?
ACHILLE.
Oui, j’ai besoin d’avoir avec vous une explication et de vous demander de calmer mes inquiétudes... ou de les confirmer... alors je serai fixé... Voilà : depuis quelques jours, j’ai remarqué... non, je n’ai pas remarqué... j’ai senti un petit changement dans votre attitude et dans celle de Maurice. Oh ! vous êtes toujours aussi charmante avec moi... vous n’êtes pas capable d’être autrement, mais vous êtes charmante avec un peu d’effort. Je me suis demandé, non sans angoisse, si je vous gênais... Cela me serait tellement douloureux de penser que je vous gêne...
ALBERTE.
Mais qu’est-ce que vous allez chercher là, Achille ?
ACHILLE.
Vraiment ? Je ne vous gêne pas ? Vous ne me dites pas ça par gentillesse ?
ALBERTE.
Je vous assure... Vous ne nous gênez pas.
ACHILLE.
Vous voyez, j’ai l’impression que lorsque vous me dites : « Vous ne me gênez pas », vous faites encore un effort... Alberte, voyons, Alberte, sois franche avec moi. Si je suis de trop ici, il faut me le dire tout de suite, ça sera un coup terrible pour moi, mais il ne faut pas hésiter à me le porter. Tu vois, je suis un peu lâche... je te somme d’être franche, et je te montre en même temps que ta franchise pourrait m’être si pénible... Vraiment je ne suis pas seulement un peu lâche, je suis très lâche. Je ne supporterai pas de ne pas venir ici autant que j’y suis venu. Et veux-tu que je te dise : je trouve que je n’y viens pas encore assez. Toi, tu trouves que j’y viens assez...
ALBERTE.
Tu ne viens pas trop.
ACHILLE.
Mais ça te suffit ? Moi, ça ne me suffit pas... Alberte, je n’ai jamais eu autant besoin de te voir... la tendresse que je n’ai jamais cessé d’avoir pour toi quand tu t’es détachée de moi...
ALBERTE.
Je ne me suis pas détachée de toi.
ACHILLE.
Tu t’es attachée à un autre... À ce moment-là, par indulgence, par crainte de complication, par pose peut-être, pour faire l’homme indépendant, je me suis efforcé de croire que je n’en souffrirais pas. Et maintenant que tu es mariée à un autre, que la question de vanité n’est plus en jeu, je souffre, non pas d’être un mari trompé – je ne suis plus un mari trompé – je souffre d’être un mari abandonné.
ALBERTE.
Quelle histoire, Achille ! Je ne peux vraiment pas croire ça.
ACHILLE.
C’est comme ça cependant. Et il faut que ça soit bien vrai pour que je surmonte ma honte et que je vienne te l’avouer.
ALBERTE.
Tu te montes la tête.
ACHILLE.
Non, non, Alberte. On se fiche dedans parfois quand on croit être amoureux, mais quand on tient à une femme, on le sait, on en est sûr. Il n’y a pas à s’y tromper. Je ne viens pas te dire que je suis amoureux de toi, ce serait ridicule, mais, enfin, je ne fais que penser à toi, j’ai un besoin constant de te voir, et... je ne te dis pas la moitié de ce que j’aurais à te dire.
ALBERTE.
Mais enfin, mon pauvre ami, en admettant que tu ne t’exaltes pas à faux, pourquoi ne te distrais-tu pas : il y a tout de même d’autres femmes sur la terre.
ACHILLE.
Non.
ALBERTE.
Comment non ?
ACHILLE.
Il n’y a pas d’autre femme que toi.
ALBERTE.
Tu ne me diras pas que depuis que nous sommes séparés, depuis plus longtemps que ça, tu n’as pas cherché à te distraire... tu n’as pas connu d’autres femmes...
ACHILLE.
Mais si, j’en ai connu plusieurs, pas des quantités, mais j’en ai connu...
ALBERTE.
Tu vois ?
ACHILLE.
Qu’est-ce que tu veux ?
Silence.
ALBERTE.
Qu’est-ce que c’était que ces femmes ? Des femmes que je connais ?
ACHILLE.
Mais non.
ALBERTE.
Je m’étais figuré que j’en connaissais une.
ACHILLE.
Qui ça ?
ALBERTE.
Céline Dergas.
ACHILLE.
Pourquoi ?
ALBERTE.
Une idée.
ACHILLE.
Mais non, je n’avais pas le courage de commencer une intrigue avec une femme... Quand je pensais à une femme, j’allais en chercher une très facile.
ALBERTE, riant.
Oh !
ACHILLE.
C’était ce qu’il y avait de plus simple.
ALBERTE.
Et ça t’est arrivé souvent ?
ACHILLE.
C’est suivant ce qu’on entend par « souvent » !
ALBERTE.
C’est drôle... J’étais bien certaine que tu voyais des femmes, mais je ne me l’imaginais pas... Il y avait bien de ces femmes que tu voyais plus souvent que d’autres ?
ACHILLE.
Peut-être.
ALBERTE.
Parce qu’elles te plaisaient davantage ?
ACHILLE.
Non, parce que ça se trouvait comme ça.
ALBERTE.
Les hommes sont dégoûtants.
Silence.
C’est une vie amusante, mais c’est bien répugnant.
ACHILLE.
Tu crois que c’est amusant ? Ah ! la, la ! Ce que j’en ai assez ! Il n’y a qu’une femme au monde qui soit une femme pour moi. Les autres, aussitôt que je suis calmé, m’embêtent, m’embêtent... Toi, je ne cessais de t’aimer et de me plaire avec toi. Je sais bien, j’aurais dû te le dire davantage, mais j’avais comme une espèce d’orgueil imbécile qui m’empêchait de montrer à quel point je tenais à toi, parce que je me disais que toi, tu ne tenais pas à moi... Mais la vérité, la vérité qui est encore plus vraie maintenant que jamais, c’est que je suis absolument possédé par toi...
ALBERTE.
Mais, mon pauvre ami, c’est terrible pour toi ce que tu me dis là.
ACHILLE.
Non, parce que d’être avec toi, simplement, comme nous sommes, ce n’est évidemment pas l’idéal pour moi, mais ça vaut mieux que d’être séparé de toi.
ALBERTE.
Ce qu’il y a d’ennuyeux, c’est que maintenant que nous avons abordé ce genre de conversation, toutes les fois que nous allons nous retrouver ensemble, ça va recommencer...
ACHILLE.
Alors quoi ? Il ne faut plus que je te revoie ?
ALBERTE.
Mais non, je ne dis pas ça, seulement il faut que tu sois raisonnable et que nous parlions d’autre chose... D’abord je ne dois plus parler de choses pareilles avec toi... Je suis la femme de Maurice.
ACHILLE.
Et tu l’aimes toujours autant ?
ALBERTE, d’un ton ferme.
Je l’aime toujours davantage.
ACHILLE.
Bon !
Il tombe accablé sur une chaise. Au bout d’un instant de réflexion, son visage s’éclaire et il se met à chantonner.
Bon ! Bon ! Bon ! Bon !
ALBERTE.
Qu’est-ce qui te prend ?
ACHILLE.
J’ai réfléchi. D’abord ça m’a accablé d’entendre que tu l’aimais toujours davantage, et puis j’ai pensé que ce n’était peut-être pas vrai.
ALBERTE.
Pourquoi ?
ACHILLE.
Parce que, si c’était vrai, tu ne me l’aurais pas dit aussi brutalement pour ne pas me faire de la peine...
ALBERTE.
Avec ça !
ACHILLE.
« Avec ça ! » Avec ça ! est bon. Si c’était vrai que tu l’aimes encore autant, tu me ménagerais.
ALBERTE.
Oh ! tu es trop subtil pour moi... Écoute, on a fermé la porte d’entrée... C’est Maurice qui entre... D’abord il faut cesser de me tutoyer.
ACHILLE.
Je t’aime...
ALBERTE.
Tais-toi !
Scène VIII
ALBERTE, ACHILLE, MAURICE
MAURICE, entrant.
Mes enfants, j’ai ramené un taxi. Si vous voulez, on ira goûter à Bellevue. J’ai à voir un client par là.
ALBERTE.
C’est une idée.
ACHILLE.
Alors je vais téléphoner chez moi... J’ai quelque chose à dire.
ALBERTE.
Achille, voulez-vous dire à la femme de chambre – elle coud dans la lingerie – voulez-vous lui dire qu’elle m’apporte mes vêtements d’auto et mon chapeau ? Je me recoifferai là-bas en arrivant.
Sort Achille.
MAURICE.
Eh bien, tu lui as parlé ?
ALBERTE.
Oui...
MAURICE.
Alors, tu as osé ?
ALBERTE.
Oui... oui...
MAURICE.
Je pense bien que tu ne lui as pas dit ça brutalement ?
ALBERTE.
Oh ! non !
MAURICE.
Est-ce qu’il comprendra qu’il vaut mieux ne pas venir si souvent ?
ALBERTE.
Oui, il comprendra.
MAURICE.
Et il ne t’a pas fait de reproches ?
ALBERTE.
Non, il a très bien pris la chose.
MAURICE.
Alors, tu crois qu’il viendra moins ?
ALBERTE.
J’y arriverai... J’y arriverai.
ACHILLE, rentrant.
Il y a quelqu’un pour toi dans le téléphone... quelqu’un qui ne fait que dire : « Allo ! Allo ! » je n’ai pas pu téléphoner chez moi.
MAURICE.
J’y vais.
Il sort.
ACHILLE, à Alberte.
Je t’aime !
ALBERTE.
Écoute, finis ! Tu vois comme il est confiant, nous avons toujours agi si loyalement tous les trois... Ce serait une trahison beaucoup plus odieuse que les trahisons ordinaires... je t’assure que ce serait très mal...
ACHILLE.
Je t’aime !
MAURICE, rentrant et traversant rapidement le salon.
Eh bien, venez-vous ?
Il passe dans le fond.
ALBERTE, à Achille.
Ce serait très mal.
ACHILLE, vite et bas.
Je t’aime ! Je t’aime ! Je t’aime !
ACTE III
Même décor.
Scène première
CÉLINA, LES THOUVELIN
La bonne introduit M. et Mme Thouvelin.
CÉLINA.
Monsieur et madame vont pouvoir attendre ici monsieur et madame.
THOUVELIN.
Ils ne vont pas tarder à rentrer ?
CÉLINA.
Non, il est tantôt trois heures et demie.
THOUVELIN.
Et ils nous ont dit de venir un peu après trois heures.
CÉLINA.
Je ne sais pas comment il se fait qu’ils ne sont pas encore ici... Ils ont été déjeuner au bois de Boulogne en automobile. Ils sont avec M. Achille.
THOUVELIN.
Et c’est M. Achille qui conduit ?
CÉLINA.
Non, non, monsieur, c’est monsieur. Monsieur a maintenant une auto magnifique, il n’a pas un clou comme on en voit... ça marche le tonnerre... Si vous voyiez le coffre où c’est qu’est le moteur, le capot, qu’ils disent, eh bien, il est long comme une malle, et ça fait si peu de bruit qu’on dirait que ça vole.
IRMA.
Je crois qu’on a sonné.
CÉLINA.
Oui, on a sonné... C’est à la porte d’entrée.
IRMA.
Il y a quelqu’un pour ouvrir ?
CÉLINA.
Il y a moi... Vous savez qu’avec cette auto on va à la mer en pas quatre heures... Tiens, on a resonné encore.
THOUVELIN.
Il faudrait peut-être ouvrir.
CÉLINA.
Quand le temps est à la boue, je les laisse un peu plus longtemps à la porte, parce qu’en poireautant ils ne savent pas quoi faire et s’ennuient les pieds sur le paillasson.
Elle sort.
THOUVELIN.
Dis donc, quand nous sommes venus il y a huit jours, ils n’avaient pas l’air si bien que ça avec Achille.
CÉLINA, rentrant.
Voulez-vous entrer par ici, monsieur Clément...
Scène II
CLÉMENT, LES THOUVELIN
CLÉMENT.
Monsieur et madame Thouvelin, je crois ?
THOUVELIN, hésitant.
J’ai vu monsieur.
CLÉMENT.
Je suis le secrétaire de M. Achille.
THOUVELIN.
Ah ! très bien ! très bien !
CLÉMENT.
Je viens le relancer jusqu’ici ; je ne le vois jamais à la maison.
IRMA.
Il s’occupe toujours d’assurances ?
CLÉMENT.
Si ça s’appelle s’occuper ! C’est moi qui fais tout. Il signe les pièces ; quand il y a une pièce à signer, je suis bien forcé de la lui apporter.
THOUVELIN.
Mais ses affaires vont tout de même ?
CLÉMENT.
Elles vont comme ci, comme ça... Parce qu’il ne s’en occupe pas, sans cela !... Moi, n’est-ce pas, j’ai un principe que devraient avoir tous les employés. On se tait... on a un emploi, il faut le garder... Ce n’est pas à nous à apprécier, nous n’avons qu’à nous incliner... Quand votre cousin a succédé à M. Thevel, dans son cabinet d’assurances, c’était une affaire admirable, une clientèle à tripler... ça n’a pas bougé, et si ça a bougé, ça a plutôt diminué...
IRMA.
Achille est pourtant un garçon intelligent.
CLÉMENT.
Eh bien ?... Il faudra m’expliquer ce que vous entendez par intelligent... Votre cousin a la grande chance d’avoir son pain tout cuit : son intelligence, c’est d’être venu au monde après son papa.
THOUVELIN.
Il passe pourtant pour être...
CLÉMENT.
Tant mieux ! Tant mieux ! Je veux bien qu’il ait de l’intelligence, mais quand est-ce qu’il en fait preuve ? Il est intelligent dans les affaires ? Il n’a pas su développer une affaire d’or qui ne demandait qu’à s’accroître... Il a été intelligent dans ses affaires de ménage, sans doute ? C’est ce qui l’a conduit à être trompé dans les grandes largeurs...
IRMA.
Permettez...
CLÉMENT.
Je ne vous apprendrai rien ; quand il s’est résolu à divorcer, il était trompé depuis belle lurette...
THOUVELIN.
Nous ne savions pas ça.
CLÉMENT.
Alors, vous étiez les seuls, car tout le monde le savait, même lui.
IRMA.
Qu’est-ce que vous dites ?
CLÉMENT.
C’est quand il a vu que c’était un peu scabreux qu’il a pris le parti que vous savez... Enfin, moi je ne lui fais pas un crime d’avoir été trompé ; avec une petite poupée comme sa femme, ça aurait pu arriver à n’importe quel honnête homme.
THOUVELIN.
Elle est très gentille !
CLÉMENT.
Oui... avec le minimum de cœur et de cervelle.
IRMA.
Évidemment, je ne l’approuve pas. Mais il faut dire à son excuse que M. Marin était un homme séduisant.
CLÉMENT.
Séduisant ? Permettez-moi de vous dire que vous n’êtes pas dure ! Qu’est-ce qu’il a de séduisant ? Sa figure ? Son esprit ? Son intelligence ? J’espère que, sur son intelligence à lui, vous n’avez aucun doute ?
THOUVELIN.
Pourtant, il m’a semblé...
CLÉMENT.
C’est un homme prétentieux et creux. Le patron, lui, peut encore faire illusion... Il a un air distrait qui vous fait dire, quand il n’a pas l’air de comprendre quelque chose : il a peut-être mal écouté... Mais Marin ! Marin intelligent !... Savez-vous de qui il est signé, son brevet d’intelligence ? De lui-même. Il se croit un aigle. Il faut lui laisser ça... Je ne crois pas que la patronne le fasse jamais cocu. Mais lui, il ne s’en doutera jamais... Il est heureux, ce sont des gens heureux...
IRMA.
Sont-ils si heureux que ça ?
CLÉMENT.
Eh bien, il y a une quinzaine, le patron avait l’air énervé et soucieux. Depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui s’est passé, il est de très bonne humeur. Hier, il a voulu s’occuper d’affaires. Je l’ai arrêté à temps. La maison a encore quelque ressort. Seulement, qu’il ne s’avise pas d’y toucher... Sur ce, madame et monsieur, je vais aller travailler... Vous seriez peut-être mieux là, dans le petit bureau.
Il montre la porte de gauche.
IRMA.
Mais vous allez y travailler.
CLÉMENT.
Non, moi je vais tout au fond, dans le débarras, trier des papiers de famille à M. Marin... Je suis le secrétaire de tout le monde, ici. J’examine des vieilles lettres relatives à un domaine qu’il a dans le Midi... Des histoires imbéciles... Son grand-père était stupide et son arrière-grand-père idiot... Vous ne vous installez pas dans le bureau ?
THOUVELIN.
Non, nous allons plutôt faire un tour dans le jardin.
CLÉMENT.
Vous savez par où on passe ?
THOUVELIN.
Oui, je connais...
CLÉMENT.
Je vous aurais montré... Parce que les domestiques, ici, sont incapables de rien indiquer... Ce sont de pauvres êtres d’une ineptie incommensurable... Tenez, c’est par là... Passez, madame... Non, pas par là, à gauche.
Clément, seul, revient à l’avant-scène.
Quel couple ! Quelle paire d’empotés !... J’ai déjà vu des gens arriérés...
Il entre à gauche.
Scène III
ALBERTE, MAURICE, ACHILLE
Maurice est cette fois en tenue de chauffeur, Alberte et Achille en élégant costume de promenade.
ALBERTE.
Le concierge m’a dit que les Thouvelin sont là.
MAURICE.
Oui, je les ai vus par la fenêtre... Ils sont dans le jardin.
ALBERTE.
Eh bien, laisse-les... On les aura assez sur le dos.
ACHILLE.
Mes enfants, je vais téléphoner par là.
ALBERTE.
Il y avait longtemps !
MAURICE.
Va. Moi, je vais prendre la voiture pour la mener jusqu’à l’usine, parce qu’il y a un petit bruit que je ne m’explique pas... Je veux en avoir le cœur net.
ACHILLE.
C’est ça.
Il sort.
MAURICE.
C’est curieux, ce que ce garçon a pu changer depuis quelques jours... Je l’aime mieux comme ça... Tu sais qu’il devenait embêtant !... On peut le dire maintenant... Quand nous avons parlé de lui la semaine dernière, toi et moi, l’idée qu’il nous embêtait, nous osions à peine nous l’avouer... et maintenant, grâce à ce changement qui s’est produit dans son humeur, il est très agréable. Et pourtant il ne vient pas aussi souvent... Il a dû avoir à son insu une crise de foie... et ça lui a passé... Tu sais qu’il y a des maladies dont on s’aperçoit à peine, qui vous incommodent d’une façon indéfinissable et qui guérissent tout à coup... Ou se figure qu’on est de mauvaise humeur, c’est que l’on est malade... Tout à coup, on est de meilleure humeur, c’est qu’on est guéri... Je suis sûr que s’il avait été de cette humeur-là toute sa vie, il n’aurait jamais cessé de te plaire ?
ALBERTE.
C’est possible !
MAURICE.
Au fond, il n’y a rien de tel que la santé. Moi, je crois que je suis un homme appréciable... C’est parce que je suis sain... tu ne me tromperas jamais, parce que je me porte bien.
ALBERTE.
Oh ! comme il est sûr de lui !
MAURICE.
Et je suis un petit peu sûr de toi.
ALBERTE.
Tu peux !
MAURICE.
Le voilà.
ACHILLE, entrant.
Alors tu vas à l’usine ?
MAURICE.
Mais oui. Je reviendrai tout de suite. À moins que je sois obligé de laisser la voiture là-bas. Alors, dans ce cas, je reviendrai en taxi...
ACHILLE.
...Comme le temps est remis au beau, tu peux faire ouvrir la voiture.
MAURICE.
Non, il fait encore un peu de vent... Ce n’est pas que je craigne l’air, rien ne me fait peur... À tout à l’heure, mes enfants.
Il sort.
Scène IV
ACHILLE, ALBERTE
ACHILLE.
Alberte ! chère petite Alberte !
ALBERTE.
Attention ! il vient à peine de sortir... Tu ne fais pas assez attention. Ainsi, j’ai toujours peur que tu me tutoies devant lui... Il faudra dire un de ces jours : « C’est trop bête ! recommençons à nous tutoyer. » Alors, ce sera admis. Quand on se dit tantôt « tu », tantôt « vous », c’est effrayant ce qu’on risque de se couper.
ACHILLE.
Petite Alberte ! Sais-tu qu’avec tes allures frivoles, tu es pleine de sens pratique et de sagesse. Je ne m’en serais jamais douté. Il me semble que c’est maintenant seulement qu’on commence à se connaître.
ALBERTE.
Oui, c’est vrai... on se connaît mieux.
ACHILLE.
Si on s’était connu ainsi jadis ?
ALBERTE.
Eh bien ?
ACHILLE.
Eh bien, peut-être rien de ce qui est arrivé ne serait arrivé.
ALBERTE.
Peut-être !
ACHILLE.
Tu n’as pas l’air de le regretter.
ALBERTE.
Veux-tu que je sois franche ? Je ne regrette rien. Au fond, le destin fait bien ce qu’il fait. Il me semble que j’aime mieux t’avoir comme amant que comme mari.
ACHILLE.
C’est assez flatteur.
ALBERTE.
Je ne sais pas si c’est flatteur, mais c’est vrai, Maurice est résolu, sûr de lui ; c’est le type du mari. Toi, tu es tracassé, tourmenté. C’est très fatigant de faire vie commune avec un individu aussi agité que toi... et d’autre part, ce ne serait pas agréable de passer les heures... les heures intéressantes de l’existence avec un homme aussi calme, aussi pondéré que mon mari... Je dis : ce serait, car, naturellement, depuis que Maurice m’a épousée, il n’y a plus pour lui ni pour moi d’heures intéressantes...
ACHILLE.
Oh ! une femme dit toujours ça à son amant.
ALBERTE.
Est-ce que ce n’était pas vrai quand tu étais mon mari ?
ACHILLE.
Si, après tout.
ALBERTE, rêveuse.
En somme, je suis maintenant comme une petite reine : j’ai un intendant sérieux qui me dirige et un page inquiet que je domine.
ACHILLE.
Je t’admire.
Il s’approche d’elle, la prend dans ses bras.
Je t’admire de voir si clair en toi et autour de toi... Et penser qu’à d’autres moments, tu es une petite sauvage inabordable... Alberte chérie !
Il va pour l’embrasser dans le cou, quand la porte du fond s’ouvre. Le public voit apparaître Clément. Achille et Alberte se retournent au moment où Clément referme la porte.
Qu’est-ce que c’est ?
ALBERTE.
Eh bien, il y a qu’on nous a encore surpris.
ACHILLE.
Comment, encore ?
ALBERTE.
C’est-à-dire... je veux dire que c’est encore plus embêtant.
ACHILLE.
Qui cela peut-il être ?
ALBERTE.
Oh ! Clément, parbleu !... Oh ! je suis impardonnable... le ciel me punit...
ACHILLE.
Voyons ! voyons ! ne t’énerve pas...
ALBERTE.
Je m’étais juré que personne ne m’embrasserait plus jamais dans ce salon. Qu’est-ce qui va se passer, maintenant ?
ACHILLE.
Oui, qu’est-ce qui va se passer ? Il me semble qu’il n’y a qu’une solution ; il faut prévenir loyalement Maurice...
ALBERTE.
Ah ! non, par exemple ! je ne recommence pas.
ACHILLE.
Pourtant, à moi, vous m’avez avoué tous les deux...
ALBERTE.
Ce n’était pas la même chose.
ACHILLE.
Pourquoi n’était-ce pas la même chose ?
ALBERTE.
Parce que toi, tu étais un autre homme, tu étais soupçonneux, tu te tourmentais, tu me tourmentais aussi. Je te sentais là inquiet, anxieux... C’était insupportable... Tu souffrais certainement plus d’un soupçon que tu n’as souffert de la certitude.
ACHILLE.
C’est ce que tu as compris admirablement ! Tu m’as collé une bonne certitude pour me guérir de mes soupçons...
ALBERTE.
C’est ton caractère, que veux-tu ? Tu passais ton temps à te rendre malheureux avec les choses qui pouvaient arriver. Une fois qu’elles arrivaient, eh bien, tu avais épuisé ta douleur. Quand tu as été au courant, je ne dis pas que tu n’as plus été malheureux du tout, mais tu as été moins embêtant.
ACHILLE.
Oui, une fois que j’ai su mon malheur, il a été plus supportable... pour vous deux tout au moins...
ALBERTE.
Nous avons peut-être eu tort de t’avouer. On ne doit pas avouer ces choses-là... un mari... un mari ne doit rien savoir.
ACHILLE.
Alors tu crois qu’il vaut mieux ne rien dire à Maurice ?
ALBERTE.
Certainement non ! voyons ! Maurice est un homme tranquille, parfaitement tranquille, pourquoi troubler sa tranquillité ? Il a en lui-même une confiance énorme. Tout à l’heure, il me disait encore que je ne le tromperais jamais parce qu’il a une bonne santé... c’est même ce qui s’appelle en avoir une de santé ! Une révélation serait terrible pour lui. Je frémis rien que d’y penser... Ce serait un vrai coup d’assommoir...
ACHILLE.
Mais enfin, qu’est-ce qui va se passer ?... Est-ce que Clément ne va rien lui raconter ?
ALBERTE.
Non, non. Je ne vois pas du tout Clément allant le dire à Maurice. Il ne te disait rien à toi, n’est-ce pas ? Et même s’il allait lui raconter quelque chose, Maurice ne le croirait pas. C’est un homme qui ne croit que ce qu’il voit... Eh bien, maintenant, c’est à nous à ne pas nous faire voir. Que cet avertissement nous serve de leçon !
ACHILLE.
En tout cas, si Clément ne dit rien à Maurice, il va bavarder tout autour de nous.
ALBERTE.
Eh bien, et après ? La première fois qu’il nous a surpris...
ACHILLE.
Pas nous.
ALBERTE.
C’est-à-dire qu’il m’a surprise, nous avons eu peur de lui parce qu’il allait apprendre aux gens que tu étais un mari complaisant... Voilà ce que les gens ne doivent pas savoir, voilà, ce qui était grave... contraire à la morale... Tandis que cette fois-ci, qu’est-ce que tu veux qu’il leur apprenne, aux gens ? Que j’ai trompé mon mari, voilà tout !... Je ne suis pas la seule !
ACHILLE.
Alors on laisse aller les choses ?
ALBERTE.
C’est ce qu’il y a de mieux à faire...
ACHILLE.
Voilà les Thouvelin qui viennent...
ALBERTE.
Je ne veux pas les voir... Allons par là.
Ils sortent.
Scène V
LES THOUVELIN
THOUVELIN.
C’est curieux ce qu’on voit peu les maîtres de la maison.
IRMA.
Ils sont pourtant rentrés ; il y avait du monde dans le salon.
THOUVELIN.
Ils n’ont pas l’air d’être pressés de nous voir. Je me demande pourquoi nous passons notre temps à les chercher...
IRMA.
Le fait est... Des gens dont on entend dire tant de mal.
THOUVELIN.
C’est peut-être pour cela que nous tenons à les fréquenter...
Clément entre par le fond. Il a un air indifférent qui change soudain dès qu’il aperçoit les Thouvelin.
Scène VI
CLÉMENT, LES THOUVELIN, puis MAURICE, puis ACHILLE et ALBERTE
CLÉMENT.
Si vous saviez ce que je viens de voir... ou d’entrevoir !...
Les Thouvelin se rapprochent.
Je ne veux rien affirmer, mais comme j’arrivais du petit débarras et comme j’ouvrais la porte, j’ai vu le patron et son ex-femme très près l’un de l’autre. Ça rebiche entre eux. Pas d’erreur !
THOUVELIN.
Qu’est-ce que vous dites là ?
CLÉMENT.
Il y a du bon. Le ménage à trois se reforme. Je m’explique le changement d’humeur du patron. Tant que ça n’était pas reformé, ça marchait mal, maintenant que c’est reformé, ça va remarcher bien...
IRMA.
Oh ! C’est tout de même scandaleux !
THOUVELIN.
Mais non !...
IRMA.
Comment, ce n’est pas scandaleux ?
THOUVELIN.
Mais non, tout cela me paraît logique. Et c’est étonnant ce que cela me rappelle certaines observations d’histoire naturelle. On peut envisager le groupement de ces trois individus comme un organisme. Or, dans un organisme, il faut que chaque organe ait sa fonction.
CLÉMENT.
C’est ce qui arrivait jadis, quand Achille était le mari et Maurice l’amant.
THOUVELIN.
Oui. Et quand Maurice est devenu le mari, ce pauvre Achille n’a plus eu de fonction du tout. Il était l’intrus, le parasite. Il était condamné à disparaître, quand, heureusement, il a repris un rôle actif, qui assure à tout le groupe et à lui-même une vitalité nouvelle...
CLÉMENT.
Les voilà repartis !...
MAURICE, entrant.
Tiens, monsieur et madame Thouvelin ! Quelle bonne surprise !... Où dînez-vous, ce soir ?
IRMA.
Mais avec vous... Vous saviez bien que vous nous aviez promis une soirée. Vous allez nous faire le plaisir de venir dîner avec votre femme.
MAURICE.
C’est que nous avons un ami à dîner avec nous.
THOUVELIN.
Oh ! mais Achille dîne aussi avec nous.
MAURICE.
Parfait ! Parfait !... Où est donc Achille ?...
ACHILLE, sortant de gauche.
Voilà... Voilà !
ALBERTE.
Voilà...
Elle aperçoit Clément. Très aimable.
Bonjour, cher monsieur Clément ! Excusez-moi, je vous avais à peine dit bonjour tout à l’heure.
CLÉMENT, réservé.
Bonjour, madame.
ALBERTE.
Ah ! ces amis Thouvelin, quelle bonne surprise !
IRMA.
Mais vous dînez avec nous ?
ALBERTE, hésitante.
Eh bien, je ne sais pas.
IRMA.
Si, si, vous dînez avec nous tous les trois.
THOUVELIN.
Tous les trois.
TOUS.
Parfait.
CLÉMENT.
Tous les trois !