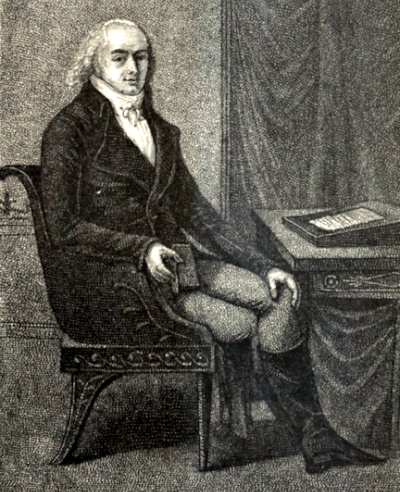Duhautcours (François CHÉRON - Louis-Benoît PICARD)
Sous-titre : le contrat d’union
Comédie en cinq actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Louvois, le 6 août 1801.
Personnages
DURVILLE, négociant
DUHAUTCOURS
FRANVAL, commerçant de Marseille
DELORME, marchand
AUGUSTE, neveu de Durville
VALMONT, petit-maître
CRÉPON, marchand de modes
FIAMMESCHI, artificier illuminateur
MARASCHINI, confiseur
GRAFF, agent de Duhautcours
LEDOUX, agent de Duhautcours
PRUDENT, agent de Duhautcours
UN VALET
MADAME DURVILLE
MADEMOISELLE DELORME
MADAME FIERVAL
MADAME VALBELLE
MADEMOISELLE MINETTE, fille de boutique de Crépon, personnage muet
CRÉANCIERS de Durville, personnages muets
La scène est à Paris, chez Durville.
PRÉFACE
Plusieurs fois je me suis associé avec un ami pour composer un ouvrage. Voilà le premier que je croie devoir placer dans mon recueil, de l’aveu de mon cher et estimable collaborateur.
Il y a quelques années, un journaliste de mauvaise humeur contre moi, faisant un grand éloge de Duhautcours, et trouvant la pièce meilleure que mes autres ouvrages, cherchait à élever des doutes sur mon droit à la propriété de cette comédie. M. Chéron se hâta de répondre. Je l’en remerciai, je l’en remercie encore. Il me rend justice, il sait que, si son droit à la propriété de Duhautcours avait été attaqué, je l’aurais défendu avec le même empressement.
Au moment où nous donnâmes la pièce, quelques négociants de Paris affichaient le plus grand luxe. On ne nous accusera pas cette fois d’avoir placé la scène dans les derniers rangs. Ces négociants faisaient les grands seigneurs ; leurs maisons étaient le rendez-vous de nos généraux, de nos premiers magistrats. Seulement la société, toujours très nombreuse, était un peu mêlée, comme cela devait être à la suite d’une révolution qui avait déplacé et confondu toutes les classes. Ces négociants, encouragés par le succès de quelques spéculations hardies, croyaient pouvoir acquérir en peu d’années une fortune égale et même supérieure à celle que les négociants prudents et sensés obtenaient jadis par vingt ou trente années de travail. Ces dépenses et cette cupidité en conduisirent plusieurs à des faillites arrangées. C’est ce vice, c’est ce crime (car c’en est un), que nous entreprîmes d’attaquer dans cette comédie.
Suivant quelques critiques, c’est un sujet qui a plus besoin d’être réprimé par la sévérité des lois que par la censure théâtrale. La comédie ne devrait en effet poursuivre que les vices et les ridicules : mais les délits qui, malgré la prévoyance des lois, trouvent moyen de leur échapper, ne deviennent-ils pas du ressort de la comédie ? L’adultère et la banqueroute frauduleuse sont de ce nombre. Malheureusement, l’homme qui trompe ses créanciers n’offre pas des aspects aussi comiques que celui qui séduit la femme de son voisin ou de son ami. Aussi nous reprocha-t-on d’avoir choisi un sujet très moral, mais dont le fond et les détails sont naturellement sérieux. Nous avons cherché, le plus qu’il nous a été possible, à jeter de la gaieté dans l’ouvrage, et quelquefois, je crois, nous y avons assez bien réussi.
Cet art de préparer une banqueroute n’est pas neuf. En 1687, les comédiens italiens donnèrent un Banqueroutier. Cette pièce, imprimée dans le Théâtre italien de Gherardi, ne nous a pas été inutile.
Parmi les principaux personnages, on distingua celui de Duhautcours, celui de Franval, celui de madame Durville. Quoique la position de Delorme tourne un peu au drame, on nous sut gré d’avoir opposé au banqueroutier frauduleux un négociant honnête, mais forcé par les circonstances de retarder ses paiements.
On critiqua le personnage de Durville. C’est, dit-on, un homme faible et sans caractère. Les hommes forts, les hommes à caractère sont-ils donc si communs dans le monde ? Ce monde n’est-il pas rempli au contraire d’hommes sans caractère et sans volonté ? Il vaudrait mieux sans doute ne présenter ces personnages que sous un aspect ridicule et comique, comme les grands maîtres n’ont jamais manqué de le faire. Cependant le tableau d’un homme incertain entre sa conscience et sa cupidité est-il indigne de la scène comique ? Je ne le crois pas.
On critiqua les amours d’Auguste et de mademoiselle Delorme. Ces amours en effet ne servent pas beaucoup à l’action ; mais Auguste faisant rougir son oncle par sa probité, et mademoiselle Delorme venant implorer madame Durville au moment où elle est occupée des préparatifs d’une fête, me semblent bien en situation pour faire ressortir le but de l’ouvrage.
On m’a reproché souvent d’introduire trop de personnages. Je n’ai pas fait une pièce où il y ait autant de rôles que dans celle-ci, et personne ne crut y voir un personnage de trop. C’est qu’ici tous sont nécessaires, et que les physionomies sont heureusement trouvées, et heureusement dessinées. Nous avions à représenter une fête et une assemblée de créanciers. Il nous fallait des personnes invitées à la fête, et des créanciers vrais ou supposés ; le public s’accorda à trouver de la vérité et de la variété dans tous ces personnages épisodiques, mais bien liés à l’action principale.
La pièce me paraît bien conduite. Les deux premiers actes me semblent comiques. Ce contraste d’une fête avec la préparation d’une banqueroute n’est pas sorti de notre imagination : cela n’est arrivé que trop fréquemment. Le troisième acte et le cinquième sont plus graves. Mais l’arrivée de Franval au troisième acte me semble bien nouer l’action, et l’idée de faire payer les créanciers par madame Durville, qui profite ainsi de sa séparation de biens, me paraît assez ingénieuse.
Notre acte chéri c’est le quatrième. Je crois pouvoir dire franchement, après plusieurs suffrages honorables, que notre assemblée de créanciers est comique, intéressante, et quelquefois effrayante de vérité.
ACTE I
Le théâtre représente un salon.
Scène première
CRÉPON, MADEMOISELLE MINETTE, portant un carton de modes et une robe très élégante
CRÉPON.
Prenez donc garde à ce que vous faites, mademoiselle Minette ; des objets d’art aussi délicats, qui ont besoin de toute leur fraîcheur ! Vous allez les chiffonner. Faites-vous indiquer le cabinet de toilette de madame Durville, et priez mademoiselle Julie d’avertir sa maîtresse que son marchand de modes vient faire Son travail avec elle.
Mademoiselle Minette sort.
Scène II
CRÉPON, FIAMMESCHI
FIAMMESCHI, entrant et se retournant du côté de la coulisse.
Des lampions dans la cour, des verres de couleur dans les bosquets, des lanternes chinoises et des chiffres dans le kiosque ; surtout rentrez le feu d’artifice sous la remise s’il vient à pleuvoir.
Scène III
CRÉPON, FIAMMESCHI, MARASCHINI
MARASCHINI, entrant du côté opposé, se retournant vers la coulisse.
Crème, pistache, ananas et vanille ; le grand plateau avec ses quatre groupes, les Aventures de Don Quichotte, les Quatre Parties du Monde, un Parnasse garni de ses neuf Muses, et le Désespoir de Jocrisse, en sucre candi.
CRÉPON.
Diantre ! il paraît que monsieur Durville donne une fête magnifique.
MARASCHINI.
Salut à monsieur Crépon, le modiste.
CRÉPON.
Salut à monsieur Maraschini, l’officier glacier, confiseur. Salut à monsieur Fiammeschi l’artificier, lampiste, illuminateur. Vous attendez monsieur Durville ?
MARASCHINI.
C’est la vérité.
CRÉPON.
Pour moi, j’attends madame. Dans notre état nous n’avons affaire qu’aux dames.
MARASCHINI.
Foi d’artiste, le dessert de ce soir me coûtera vingt-cinq louis de ma poche ; mais il sera bien, et je suis content. Perché, l’honneur !...
FIAMMESCHI.
Une excellente maison pour nous, messieurs ; une fête tous les mois.
MARASCHINI.
Mà monsieur Durville nous doit encore la dernière.
CRÉPON.
Eh quoi ! craindriez-vous...
FIAMMESCHI.
La bancarotta !
MARASCHINI.
Mais...
CRÉPON.
Allons donc un négociant qui fait les plus grandes affaires, qui jouit du plus grand crédit ! C’est de l’argent comptant.
MARASCHINI.
On en voit beaucoup par le temps qui court ; il s’est lié depuis peu avec monsieur Duhautcours.
CRÉPON.
Eh bien ! monsieur Duhautcours, un homme fort aimable un bon cuisinier, un cabriolet, un entresol meublé dans le dernier goût.
FIAMMESCHI.
Un faiseur d’affaires.
MARASCHINI.
Point d’autre état que celui d’entrepreneur général de toutes les banqueroutes de Paris, et il ne manque pas d’ouvrage.
FIAMMESCHI.
Ah ! Santo Gennaro, que me dites-vous là ?
MARASCHINI.
C’est lui qui a arrangé le malheur de mon fripon d’associé dans les fêtes champêtres où vous me fournissiez l’illumination et l’artifice.
FIAMMESCHI.
Pas possible.
MARASCHINI.
Un homme perdu de dettes, et qui ne paiera jamais ses créanciers qu’en politesses. Un front d’airain, et puis il a à sa disposition trois ou quatre faux négociants qui se succèdent dans toutes les faillites pour entraîner la masse aussi quand je vois cet homme-là lancé quelque part, je ne suis pas tranquille.
CRÉPON.
Fi donc, fi donc ! monsieur Maraschini ! craintes chimériques, injurieuses pour monsieur Durville ; un très galant homme ; sa femme est pleine de goût, de grâces.
FIAMMESCHI.
Un très galant homme, si vous voulez ; mais s’il ne me donne pas de l’argent comptant tout à l’heure, je remporte mon décor et mes lampions.
CRÉPON.
Ah ! monsieur Fiammeschi, quand on a reçu quelque éducation, peut-on songer à un pareil procédé ?
MARASCHINI.
Monsieur Crépon a raison. En ami, j’ai cru devoir vous avertir tenez-vous sur vos gardes ; mà point de scandale.
FIAMMESCHI.
Mais permettez donc ; il me doit déjà...
CRÉPON.
Mais quand il vous devrait cent feux d’artifice, on n’en vient pas à ces violences avec les gens qui tiennent un certain état dans le monde. Vous vous nuiriez beaucoup. Dans les beaux-arts, il faut savoir attendre et perdre pour se faire une réputation. J’entends monsieur Durville ; allons, monsieur Fiammeschi, de la douceur, et laissez vos lampions.
FIAMMESCHI.
Il est bien cruel d’exposer ses fonds...
MARASCHINI.
Eh ! mon Dieu ! on s’en fait des fonds, quand on n’en a plus.
Scène IV
CRÉPON, FIAMMESCHI, MARASCHINI, DURVILLE, DELORME
DURVILLE.
Prières inutiles, monsieur Delorme ; j’en suis désespéré.
DELORME.
Mais, monsieur, les pertes nombreuses que je viens d’essuyer...
DURVILLE.
Eh ! mais, monsieur, dans le commerce on doit prévoir les pertes. Vous êtes venu vous établir dans ma maison, je vous ai loué un très joli appartement au second, je vous ai aidé de ma bourse, de mon crédit. Aujourd’hui, votre effet est dans les mains de mon huissier, et j’ai pour principe de ne jamais entraver ses opérations.
À Maraschini et à Fiammeschi.
Ah ! messieurs, je vous salue ; je suis à vous dans l’instant.
À Delorme.
Il y a sentence et même prise de corps contre vous ; c’est à vous d’empêcher...
À Maraschini et à Fiammeschi.
Eh bien ! messieurs, notre fête de ce soir sera-t-elle brillante ?
FIAMMESCHI.
Très brillante, monsieur Durville.
DELORME.
Je ne rougis pas d’insister. Il s’agit de sauver ma pauvre fille. La faillite du banquier Dorval, qui m’emporte vingt mille francs, un cautionnement indiscrètement signé pour un homme dont la fortune me paraissait assurée, voilà les causes de mon malheur. Pour une modique somme resterez-vous seul impitoyable ? Je vous paierai, monsieur ; je paierai tous mes créanciers. J’ai un ami, un ami respectable, négociant à Marseille, le parrain de ma fille ; il ne m’a jamais rien promis, mais il a toujours fait pour moi plus que je ne lui ai demandé. Je lui ai écrit, et j’espère...
DURVILLE.
Ah ! oui, des amis ! je compterais sur les vôtres, quand j’ose à peine compter sur les miens ! Cela ne me regarde plus, encore une fois, monsieur Delorme ; voyez mon huissier. Pardon, mais vous voyez que je suis en affaire.
DELORME.
Eh bien ! monsieur, je subirai mon sort ; je ne m’abaisserai plus à vous supplier. Grâce à vous, après trente ans d’une vie honnête et laborieuse, je serai ruiné ; mais le témoignage de ma conscience me restera. Si jamais vous éprouvez les mêmes malheurs, puissiez-vous trouver au fond de votre âme les mêmes consolations !
Il sort.
Scène V
CRÉPON, FIAMMESCHI, MARASCHINI, DURVILLE
DURVILLE.
Que signifient ces grands airs ? Un petit marchand dont la fille tourne la tête à monsieur mon neveu... et j’aurais quelques égards pour lui ! Non, parbleu ! Eh bien ! mes amis, vous allez vous distinguer, j’espère ; cela peut doubler votre réputation. J’ai tout Paris ce soir.
CRÉPON.
Madame Durville sera mise comme une déesse.
DURVILLE.
Je m’en rapporte à vous, monsieur Crépon ; il est vrai que vos mémoires sont exorbitants. Madame Durville fait une dépense effroyable.
CRÉPON.
Mais elle donne le ton à toutes nos dames.
FIAMMESCHI, tirant un mémoire de sa poche.
On ne m’accusera pas d’enfler mes mémoires.
MARASCHINI, tirant aussi un mémoire.
Ni moi. Voici celui de la fête de ce soir et celui de la fête du mois dernier.
DURVILLE.
Comment ! on ne vous a pas payés ? Vous ne vous êtes donc pas présentés à la caisse ?
FIAMMESCHI.
Ah ! monsieur, c’est une misère.
DURVILLE.
Pardonnez-moi, ces choses-là doivent se payer comptant. La caisse est fermée dans ce moment-ci ; mais demain matin...
FIAMMESCHI et MARASCHINI.
Ah ! monsieur...
CRÉPON, bas à Fiammeschi.
Vous voyez bien que vos inquiétudes n’avaient pas le sens commun.
FIAMMESCHI.
Ainsi demain matin...
DURVILLE.
Oui, mes chers amis. J’attends mon neveu ; allez, et que tout se passe ce soir d’une manière convenable.
MARASCHINI.
Vous serez content, monsieur Durville.
FIAMMESCHI.
Et demain matin nous viendrons recevoir vos éloges...
DURVILLE.
Et votre argent.
MARASCHINI.
Voilà ce que c’est. La caisse sera ouverte demain ?
DURVILLE.
Oui, oui, elle sera ouverte.
MARASCHINI.
Votre très humble serviteur, monsieur Durville.
Il sort avec Fiammeschi.
CRÉPON.
Pour moi, vous savez que je ne suis pas inquiet ; un petit à-compte demain matin, car vous n’imaginez pas les avances que je suis obligé de faire. Le crédit me tue. J’ai tant perdu avec les actrices... Je vole à mon poste auprès de votre charmante épouse.
Il sort.
Scène VI
DURVILLE, seul
Tous ces préparatifs m’importunent... Cette fête à la veille d’un événement... Et ce Delorme qui vient m’implorer... Je dois le poursuivre, oui, je le dois... Plus le moment approche, plus je tremble. Est-il donc si nécessaire d’en venir à cette extrémité ? Je n’y pensais pas ; Duhautcours est venu me trouver dans un moment de gêne, d’inquiétude ; il a redoublé mes craintes, il a flatté mes passions, il m’a proposé... de manquer... sur-le-champ il s’est emparé de moi ; tout est prêt. Quel métier ! que de dangers ! quel jeu terrible que ces spéculations sur la hausse et sur la baisse ! J’aurais bien mieux fait d’être un véritable commerçant , un honnête banquier... Réduire ma dépense ! ma foi, non habitué à l’aisance, à tous les agréments de la vie... Et puis ma femme ! la faire renoncer à ses fêtes, à sa parure, à ses sociétés ! Il faudrait des scènes ! des querelles ! un divorce peut-être !... Mais c’est à mon neveu surtout qu’il faut cacher soigneusement ce qui se prépare... Le voici ; il faut l’effrayer, me brouiller avec lui, c’est le plus sûr.
Scène VII
DURVILLE, AUGUSTE
AUGUSTE.
Vous m’avez demandé, mon oncle ?
DURVILLE.
Oui, monsieur, j’ai une conversation très sérieuse à avoir avec vous.
AUGUSTE, lui remettant des lettres.
Mon oncle, voici des lettres.
DURVILLE.
C’est bon, je les lirai. Monsieur, lorsque par égard pour mon frère, par amitié pour vous, je consentis à vous admettre dans ma maison, j’ai dû penser que je trouverais le prix de ma conduite dans votre reconnaissance.
AUGUSTE.
Je ne crois pas, mon oncle, avoir trompé votre espoir.
DURVILLE.
Pardonnez-moi, monsieur. D’abord admis par moi dans mon amitié, dans ma confiance, vous vous permettez de critiquer mes opérations.
AUGUSTE.
Il ne m’appartient pas sans doute de vous donner des conseils, mon oncle ; mais ne serais-je pas coupable , si je vous cachais mes sentiments ? Voyez ces vrais négociants, ces banquiers, dont tout Paris, dont toute la France chérit et bénit la fortune, aussi sévères pour le débiteur de mauvaise foi, qu’indulgents pour l’honnête homme victime des circonstances, s’unissant ensemble pour relever le crédit, ranimer la confiance, honorer leur patrie chez l’étranger, et la délivrer de cette troupe d’usuriers qui spéculaient sur le malheur des temps ; un luxe bien entendu, des spéculations grandes, utiles ; l’encouragement de l’agriculture, des arts, des manufactures ; voilà leurs titres à l’estime, à la reconnaissance publique. Pouvez-vous me blâmer, mon oncle, quand je n’ai d’autre désir que de vous voir marcher sur les traces de ces hommes vraiment respectables ?
DURVILLE.
Qu’est-ce à dire... ? Sachez, monsieur, que le devoir d’un commis, car vous êtes le mien, est de suivre aveuglément les volontés de celui qui l’emploie.
AUGUSTE.
Si vous m’en voulez pour avoir intercédé en faveur de monsieur Delorme auprès de vous ?
DURVILLE.
Ah ! voilà ce que j’attendais. Prenez encore le parti de monsieur Delorme.
AUGUSTE.
Riche comme vous l’êtes, pouvez-vous pour une somme...
DURVILLE.
Et qui vous a dit, s’il vous plaît, que j’étais si riche ? Avez-vous compté avec moi ?
AUGUSTE.
Pardon, mon oncle ; mais vos entreprises, vos dépenses, vos fêtes...
DURVILLE.
Croyez-vous que ce soit pour mon plaisir que je donne ces fêtes ? Ne voyez-vous pas que tous ces bals, ces réunions, ces dépenses sont nécessaires pour augmenter, pour conserver mon crédit ? Vous ne vous formez pas du tout en vérité ; j’en suis fâché pour vous, mais vous n’entendrez jamais rien au commerce. Revenons à monsieur Delorme, aux reproches nombreux que j’ai à vous faire ; ils ont surtout pour objet votre conduite, vos mœurs.
AUGUSTE.
Mes mœurs, mon oncle !
DURVILLE.
Oui, monsieur, vos mœurs. Pourquoi, lorsque j’ai du monde à dîner, vous esquiver toujours au dessert ? Lorsqu’à force d’instances, vous voulez bien nous honorer de votre présence, on vous voit debout près de la cheminée, répondant par monosyllabes, et feuilletant je ne sais quelle brochure, comme pour distraire votre ennui.
AUGUSTE.
Ces torts sont réels, sans doute ; mais vous parliez de mes mœurs.
DURVILLE.
Précisément. Vous dédaignez ma société pour celle de monsieur Delorme. Quand vous avez refusé une place au spectacle dans la loge de votre tante, on vous aperçoit aux troisièmes avec monsieur et mademoiselle Delorme.
AUGUSTE.
Pourriez-vous blâmer ma liaison avec une famille respectable.
DURVILLE.
Mais est-il aussi respectable le motif qui vous attire chez cet ennuyeux honnête homme ? Voilà de nos philosophes du jour, qui condamnent avec amertume les actions des autres, et qui cherchent à séduire les femmes, les filles de ceux qu’ils appellent leurs amis.
AUGUSTE.
Qui ? moi, grand Dieu ! la séduire !
DURVILLE.
Et quel serait votre but ? Vous ne pouvez pas songer à l’épouser ?
AUGUSTE.
Et pourquoi ne songerais-je pas à l’épouser ?
DURVILLE.
Plaît-il ! mais vous avez donc perdu tout-à-fait la tête ? Vous marier, à vingt ans, sans état, sans fortune ! Et à qui ? À la fille d’un petit marchand, d’une intelligence très bornée, dont les affaires sont considérablement dérangées ! Par toute l’autorité que je puis avoir sur vous, monsieur, je vous défends de remettre les pieds chez monsieur Delorme.
AUGUSTE.
Ah ! mon oncle, combien vous êtes changé pour moi ! depuis que ce monsieur Duhautcours s’est établi votre conseil.
DURVILLE.
Vous en voulez beaucoup à monsieur Duhautcours.
AUGUSTE.
N’est-ce pas lui qui m’a enlevé votre amitié, votre confiance ? Ai-je rien fait pour m’en rendre indigne ? Et cependant... mais je vois que je vous irrite ; je sors. Si mes assiduités chez monsieur Delorme ne servent qu’à vous aigrir contre lui, il faudra bien que je cesse de le voir ; mais n’est-ce pas me faire cruellement acheter l’asile que vous m’avez offert ?
Il sort.
Scène VIII
DURVILLE, seul
L’impertinent ! je renverrai ce petit sot à son père ; il prend avec moi un ton de remontrance. On dirait que c’est moi qui suis le neveu ; voyons ces lettres.
Il ouvre et lit les lettres.
Oh ! oh ! des faillites à Hambourg, à Livourne, à Londres, et les maisons les mieux famées ! Eh bien ! voilà des exemples... des exemples qui doivent décider, car enfin aucune d’elles ne m’atteint ; mais elles pourraient m’atteindre. Allons, il est de la prudence, il devient nécessaire... de prévenir un malheur. Mais Duhautcours ne vient pas il devait être ici de bonne heure ; ah ! le voilà.
Scène IX
DURVILLE, DUHAUTCOURS
DURVILLE.
Eh ! venez donc, venez donc, mon ami ; je vous attendais avec impatience.
DUHAUTCOURS.
Je n’ai pas perdu une minute ; mon cheval est rendu. J’ai tout négocié, tout est bien disposé, tout est en règle. Votre santé ?
DURVILLE.
Ah ! bien faible, mon ami. Vous avez placé mes effets ?
DUHAUTCOURS.
À quatre-vingt-quinze. Il faut vous ménager, avoir soin de vous.
DURVILLE.
Vous avez raison ; mais ces choses-là donnent toujours un peu de souci.
DUHAUTCOURS.
C’est une enfance. Quoi ! parce que vous vous arrangez avec vos créanciers, vous allez vous rendre malade ? Est-ce que l’on prend garde à ces misères-là aujourd’hui ? Voudriez-vous paraître coupable, lorsque vous n’êtes que prévoyant ?
DURVILLE.
Mes billets sur Dorval ?
DUHAUTCOURS, remettant des papiers et un portefeuille à Durville.
Escomptés à trois quarts. Voici les fonds.
DURVILLE.
Et les cinquante mille francs, dont j’ai donné mon acceptation à monsieur Franval, ce négociant de Marseille qu’on attend à Paris.
DUHAUTCOURS.
Cinquante billets de caisse dans ce portefeuille.
DURVILLE.
Tous nos cafés, nos sucres ?
DUHAUTCOURS.
Dans les magasins de Pleinchêne ; il me devait cela : je lui ai rendu le même service.
DURVILLE.
Ainsi tout est à couvert.
DUHAUTCOURS.
Ce n’est pas tout ; il vous fallait présenter un actif qui fermât la bouche à tous les médisants. J’ai acheté à deux pour cent six cent mille francs de créances sur des négociants ruinés ; j’ai eu pour dix mille francs deux millions d’actions sur des corsaires... qui sont à Londres à l’heure où je vous parle.
DURVILLE.
En vérité ! Vous êtes un homme unique.
DUHAUTCOURS.
Quelque activité, beaucoup d’habitude des affaires. J’en ai tant fait, à Berlin, à Gênes, partout ; j’ai beaucoup voyagé. Il est bien entendu que je figure parmi vos créanciers.
DURVILLE.
Vous ?
DUHAUTCOURS.
Je n’en serai pas moins votre agent, votre défenseur ; mais cela dépayse les méchants, les curieux ; et puis c’est la manière la plus loyale de prendre mes honoraires. Ah ! que ne suis-je à votre place. Mais ne fait pas banqueroute qui veut ; il faut du crédit ; et que je suis fâché de ne vous avoir pas connu plus tôt ! nous aurions bien mieux réglé les choses ; vous auriez fait les affaires, je vous aurais prêté mon nom ; j’aurais tout signé, vous n’auriez jamais été compromis.
DURVILLE.
Mais vous, Duhautcours ?
DUHAUTCOURS.
Oh ! moi, cela ne tire pas à conséquence ; on a comme cela, un commis prête-nom qui signe et qui disparaît ; on a beaucoup perfectionné les différentes manières, parce que c’est si couru dans ce moment-ci...
DURVILLE.
Oui, ce sont les exemples qui m’entraînent.
DUHAUTCOURS.
Dites, qui vous justifient. Pour moi, je me suis fait une conscience là-dessus ; ce que ces gens-là perdent avec nous, ils le gagnent avec d’autres ; personne n’est dupe.
DURVILLE.
J’ai besoin de me le persuader.
DUHAUTCOURS.
Il n’y a que les sots qui perdent. Quand vous chargez un navire, ne comptez-vous pas sur les avaries ? Eh bien les faillites, les avaries, cela arrive à tout le monde. Mais il faut se hâter : voilà tout votre avoir en sûreté. La séparation de biens entre votre femme et vous est terminée ; nous ne prendrons pas de notaire. J’ai un ami, un soi-disant homme de loi, je lui fais dresser l’acte, je préviens tous nos gens, et je fixe l’assemblée à demain matin midi.
DURVILLE.
À demain, cela ne se peut pas.
DUHAUTCOURS.
Et pourquoi donc ?
DURVILLE.
Je reçois du monde ce soir, beaucoup de monde ; ma femme donne une fête.
DUHAUTCOURS.
J’ai cru que vous donniez votre fête tout exprès ; c’est une occasion excellente. Elle va doubler votre crédit ; vous pouvez faire des affaires d’or d’ici à demain.
DURVILLE.
Oh ! non, c’est déjà trop... J’aime mieux différer.
DUHAUTCOURS.
Impossible. Les affaires de cette nature demandent à être menées chaudement. Il faut emporter d’assaut les signatures pour arriver aux trois quarts en somme.
DURVILLE.
J’aurais voulu me débarrasser de mon neveu. Je le renvoie à son père.
DUHAUTCOURS.
Vous craignez votre neveu ? Oh ! pour le coup, c’est trop plaisant. Un petit jeune homme qui fait le pédagogue avec vous, et qui se permet de me regarder de travers ! Craignez plutôt que ce Franval, ce négociant de Marseille, ce créancier de cinquante mille francs n’arrive à Paris avant l’opération. Vous me l’avez peint comme un homme intraitable...
DURVILLE.
Je ne l’ai jamais vu ; mais d’après sa correspondance...
DUHAUTCOURS.
Bon ! il ne vaut pas mieux qu’un autre, je le parierais ; mais il faut le prévenir. Si vous retardez d’un moment, tout est perdu.
DURVILLE.
Eh bien ! j’aime mieux remettre la fête ; oui. Ce sera difficile.
DUHAUTCOURS.
Vous avez tort ; mais vous le voulez.
DURVILLE.
Le lendemain d’un bal, cela serait d’un scandale !
DUHAUTCOURS.
Allons, les plaisirs après les affaires.
DURVILLE.
Je vais envoyer contre-ordre chez toutes les personnes invitées ; je ferai entendre raison à ma femme. Mais vous oubliez le point important : à quel taux se font aujourd’hui les...
DUHAUTCOURS.
Les ?
DURVILLE.
Oui, les... Vous m’entendez bien.
DUHAUTCOURS.
Ah ! les arrangements ? À douze, oui, à douze. C’est dommage que vous ne puissiez pas attendre la fin du mois. Monsieur Desbilans assure qu’ils se feront à dix et même à huit.
DURVILLE.
Ah ! c’est trop peu.
DUHAUTCOURS.
Oui, c’est trop peu. Vous donnerez vingt ; il faut être honnête.
DURVILLE, avec un soupir.
Sans doute.
DUHAUTCOURS.
Oh ! je ne m’en chargerais pas autrement. Moi, je suis l’homme de vos créanciers autant que le vôtre.
DURVILLE.
Voilà qui est convenu.
DUHAUTCOURS.
Avec des échéances.
DURVILLE.
Avec des échéances.
DUHAUTCOURS.
Partie en marchandises.
DURVILLE.
Comme cela se pratique.
DUHAUTCOURS.
Mon ami, votre affaire ne souffrira pas la plus petite difficulté.
Scène X
DURVILLE, DUHAUTCOURS, MADAME DURVILLE
MADAME DURVILLE.
Entendez-vous, monsieur Crépon, la plume un peu plus penchée en avant, et cela sera divin, divin... Monsieur, je vous salue. Ah ! mon ami, que j’aurai un joli bonnet ! sans prétention, mais si élégant, si élégant...
DURVILLE.
Je suis bien aise de vous voir, madame ; j’allais passer chez vous ; c’est avec regret que je vous l’annonce, mais la fête ne peut pas avoir lieu ce soir.
MADAME DURVILLE.
Comment ! vous plaisantez sans doute !
DURVILLE.
Non, je parle très sérieusement.
MADAME DURVILLE.
Mais vous perdez donc la tête ! Eh ! quoi, tous nos amis priés depuis huit jours ! les billets d’invitation distribués ! les jardins déjà illuminés ! et ma jolie parure que personne ne verrait ! C’est une horreur que vous ne vous permettrez pas.
DURVILLE.
J’en suis fâché ; mais il faut envoyer à l’instant chez tous nos amis, et leur mander qu’une affaire, un événement imprévu ne nous permet pas de les recevoir.
MADAME DURVILLE.
À cette heure-ci, on ne trouvera personne. Vous voulez donc me faire mourir, me rendre malade ; je n’oserais plus me montrer nulle part.
DURVILLE.
C’est une affaire qui m’oblige...
MADAME DURVILLE.
Eh ! monsieur, faites vos affaires et laissez-moi m’amuser ! Vos affaires m’importent fort peu ; je dois donner une fête, et je la donnerai. Vous ne voudrez pas, j’espère, me contrarier pour une chose si raisonnable.
DURVILLE.
Encore une fois, madame, j’ai un rendez-vous très important avec monsieur.
MADAME DURVILLE.
Avec monsieur ? Eh bien ! monsieur, ne nous fait-il pas l’honneur d’être de la fête ? Vous ferez vos affaires dans votre cabinet sans que la compagnie s’aperçoive seulement de votre absence.
DUHAUTCOURS.
Madame a raison.
MADAME DURVILLE.
C’est qu’il serait d’une indécence inouïe de ne pas recevoir les personnes invitées, surtout quand ce sont de certaines personnes : Dumont, le journaliste, qui dit du mal de tout le monde, et que tout le monde s’arrache ; la petite Dorlis, qui danse comme Psyché ; le petit Précour, qui joue un jeu d’enfer, et qui perd toujours.
DUHAUTCOURS.
Il est certain que voilà des personnes à ménager.
DURVILLE.
Mais, mon ami, vous savez bien...
DUHAUTCOURS.
Je sais que tout peut s’arranger suivant les désirs de madame ; nous devons suivre en tout les volontés des dames.
DURVILLE, à Duhautcours.
Mais cependant...
DUHAUTCOURS, à Durville.
Mais vous êtes un enfant. Donnez votre fête ce soir ; n’ébruitez rien, et demain c’est un malheur imprévu, un véritable coup de tonnerre.
DURVILLE.
Un malheur imprévu !
DUHAUTCOURS.
Eh oui ! cela se fait toujours comme cela.
Pendant ce dialogue entre Durville et Duhautcours, madame Durville se regarde dans une glace et arrange ses cheveux.
DURVILLE, à sa femme.
Eh bien ! madame, soyez contente, recevez votre monde.
MADAME DURVILLE.
Ah ! il est fort heureux que vous vous rendiez à la raison.
DUHAUTCOURS, à Durville.
Un peu plus de résolution. Il faut prendre sur soi. De l’assurance, de la confiance !
DURVILLE.
Eh bien ! ma bonne amie, tu crois donc que ta fête sera bien ?
MADAME DURVILLE.
Charmante ; c’eût été un meurtre d’y renoncer. Mille remerciements, monsieur, d’avoir parlé pour moi.
DUHAUTCOURS.
Je me suis rendu service à moi-même, madame.
Scène XI
DURVILLE, DUHAUTCOURS, MADAME DURVILLE, MARASCHINI
MARASCHINI.
Un coup d’œil à mon plateau, monsieur Durville ; rien n’est si galant : des fleurs, des feuillages, des oiseaux, des groupes et des devises d’une naïveté ! Je m’admire dans mon propre ouvrage.
Scène XII
DURVILLE, DUHAUTCOURS, MADAME DURVILLE, MARASCHINI, FIAMMESCHI
FIAMMESCHI.
Monsieur, votre impertinent jardinier, pour sauver ses légumes, ne veut pas que j’établisse mon temple en feu grégeois sur son potager ; je vous ferai remarquer que cela dérangerait toute ma symétrie.
DURVILLE.
Gardez-vous d’écouter ce maraud. Allons, mes amis, de l’activité, de l’intelligence ; soutenez votre réputation. Des glaces, des liqueurs, des vins de tout pays, monsieur Maraschini : que ma maison soit brillante ce soir comme un palais enchanté, monsieur Fiammeschi. Mon cher Duhautcours, vous ne tarderez pas à revenir ; je vous attends. Allons voir votre plateau, monsieur Maraschini.
DUHAUTCOURS.
Dans deux minutes je suis de retour.
Scène XIII
MARASCHINI, FIAMMESCHI
FIAMMESCHI.
Mais qu’est-ce que vous disiez donc, mon ami ? Vous voyez bien que monsieur Durville est un homme très solide.
MARASCHINI.
J’avais tort peut-être ; mais je n’aime pas à figurer dans les fêtes où monsieur Duhautcours est invité.
ACTE II
Scène première
MADEMOISELLE DELORME, seule
Toutes les portes ouvertes ! tous les domestiques occupés et vous répondant à peine ! tous les préparatifs d’une fête ; et c’est le maître de cette maison qui persécute mon père pour une modique somme ! Réussirai-je dans mon projet ? Ah ! je crains bien. Il n’y a qu’un seul être dans cette famille qui porte un cœur vraiment sensible ; c’est Auguste.
Scène II
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME
AUGUSTE.
Que vois-je ? mademoiselle Delorme chez mon oncle ?
MADEMOISELLE DELORME.
C’est vous, monsieur Auguste ?
AUGUSTE.
Et que venez-vous faire ici, grand Dieu ?
MADEMOISELLE DELORME.
Mon père se désole ; il affecte devant moi un air tranquille, mais je lis au fond de son âme. J’ai profité du moment où il est allé chercher, presque sans espoir, de nouvelles ressources, pour venir à son insu solliciter encore...
AUGUSTE.
Mon oncle ? Ah ! je crains bien...
MADEMOISELLE DELORME.
Non pas lui ; je n’oserais jamais l’aborder, lui parler ; mais madame Durville m’a témoigné, dans tous les temps, de l’intérêt, de l’affection : peut-être consentirait-elle à parler pour nous à son mari.
AUGUSTE.
Je me garderai bien de vous détourner de ce projet ; je vous seconderai même. Ma tante, je le crois, a un bon cœur ; mais elle est si légère, si frivole, toujours si occupée de sa parure, de ses plaisirs...
MADEMOISELLE DELORME.
Et cependant ce n’est point une grâce si extraordinaire que nous demandons. Que dis-je ? C’est l’intérêt même de monsieur Durville de nous accorder du temps. Il reste à mon père des ressources honorables et sûres dans son travail, dans son intelligence : monsieur Durville sera-t-il plus avancé en les lui enlevant ? Il a des amis, d’ailleurs, monsieur Franval, un fameux négociant de Marseille.
AUGUSTE.
Monsieur Franval, dites-vous ?
MADEMOISELLE DELORME.
C’est mon parrain, c’est notre bienfaiteur.
AUGUSTE.
Mais il est en correspondance avec mon oncle ; il fait beaucoup d’affaires avec monsieur Durville : c’est en effet un commerçant très estimé. Ses lettres annoncent la probité la plus sévère.
MADEMOISELLE DELORME.
Eh bien ! mon père lui a écrit, il lui a mandé son désastre ; il fera tout pour nous sauver, j’en suis sûre.
AUGUSTE.
Mon oncle a dû recevoir des nouvelles de monsieur Franval ; mais il ne me dit plus rien depuis que monsieur Duhautcours s’est introduit dans la maison : il semble qu’on se cache de moi. Ainsi ce n’est donc que quelques jours à gagner. Comme les malheurs viennent en un instant ! Il y a trois jours, nous étions si gais à ce petit bal chez votre cousine.
MADEMOISELLE DELORME.
Où vous m’avez si cruellement contrariée. Oh ! comme je vous gronderais si je n’étais pas si malheureuse !
AUGUSTE.
Du courage ! Voici ma tante, nous allons lui parler.
Scène III
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME, MADAME DURVILLE
MADAME DURVILLE, très parée.
Ah ! vous voilà, Auguste ; je vous cherche partout. Vous avez du goût, je le sais ; dites, ne suis-je pas mise à ravir ?
AUGUSTE.
Ma tante, c’est mademoiselle Delorme.
MADAME DURVILLE.
Mademoiselle Delorme ? Eh, bonjour, ma chère voisine. Vous qui vous y connaissez, n’est-il pas vrai que ce bonnet-là me va à ravir ?
MADEMOISELLE DELORME.
Madame...
MADAME DURVILLE.
Et cette robe, n’est-elle pas du dernier goût ? En vérité, monsieur Crépon s’est surpassé aujourd’hui.
AUGUSTE.
Ma tante...
MADAME DURVILLE.
Je n’ai pas voulu mettre mes diamants, parce que la simplicité sied toujours mieux quand on est chez soi. Qu’en pensez-vous ?
MADEMOISELLE DELORME.
Madame, je suis descendue exprès pour vous prier...
MADAME DURVILLE.
Je me fais une idée délicieuse de notre fête de ce soir ; nous n’aurons jamais eu tant de monde : six tables de bouillote dans le grand salon, et l’on dansera dans la galerie. Mais concevez-vous le caprice de monsieur Durville, qui voulait remettre la fête ? En vérité, cet homme-là ne sait ce qu’il veut. Eh ! mais, mon Dieu ! moi qui n’y ai pas pensé, il faut que vous en soyez, ma petite voisine ; à votre âge on aime la danse. Ne vous inquiétez pas de votre toilette ; une jeune personne, tout lui va une rose dans les cheveux seulement, et vous serez charmante.
MADEMOISELLE DELORME.
Ah ! madame, nous ne sommes pas en humeur de songer à nos plaisirs.
MADAME DURVILLE.
Comment donc ! qu’avez-vous, je vous prie ? Vous m’inquiétez ; confiez-moi vos peines, ma chère enfant.
En se regardant à une glace.
Ah ! le joli bonnet ! mon Dieu ! le joli bonnet ! j’en raffole.
MADEMOISELLE DELORME.
Je venais exprès pour solliciter votre entremise.
MADAME DURVILLE.
Tout ce que vous voudrez, ma chère voisine ; vous savez combien je suis attachée de cœur à vous, à votre cher papa. Comme elle est intéressante cette bonne petite ! n’est-il pas vrai, Auguste ?
AUGUSTE.
Ah ! j’en étais bien sûr, ma tante, que vous ne seriez pas insensible à la situation de mademoiselle. Vous saurez que monsieur Delorme, par une complication de malheurs, se trouve dans le plus grand embarras.
MADAME DURVILLE.
Ah ! mon Dieu ; mais c’est affreux ce que vous m’apprenez là !
MADEMOISELLE DELORME.
Tous ses créanciers, touchés de son infortune, et convaincus de sa probité, lui ont accordé toutes les facilités qu’il a demandées. Il n’en est qu’un seul...
AUGUSTE.
Oui, monsieur Durville, mon oncle, est seul resté inflexible.
MADAME DURVILLE.
Mon mari !
AUGUSTE.
Il y a une sentence, une prise de corps.
MADEMOISELLE DELORME.
Mon père a vainement essayé de l’attendrir.
MADAME DURVILLE.
C’est une barbarie !
AUGUSTE.
Mon oncle l’a repoussé.
MADEMOISELLE DELORME.
Mon père a peut-être un peu trop de fierté. Il est décidé à ne plus tenter de nouveaux efforts. Il m’a défendu même de venir vous voir ; j’ai profité de son absence pour hasarder une dernière démarche auprès de vous.
MADAME DURVILLE.
Et vous avez très bien fait, mon enfant.
MADEMOISELLE DELORME.
Vous avez eu la bonté de me montrer quelque amitié.
AUGUSTE.
Parlez pour monsieur Delorme à mon oncle.
MADEMOISELLE DELORME.
Obtenez-nous du temps pour nous acquitter, quelques jours seulement.
MADAME DURVILLE.
Écoutez, je ne me mêle jamais des affaires de mon mari. Il m’a fait signer ces jours-ci je ne sais quel acte, une séparation de biens, je crois. Il fait de moi tout ce qu’il veut ; je n’y entends rien : mais ici c’est différent ; c’est une affaire de procédés entre voisins, un acte de justice, une bonne action que je lui propose ; je lui parlerai, je vais lui parler.
AUGUSTE.
Ah ! ma tante, quelle reconnaissance ne vous devrai-je pas... ne vous devra pas mademoiselle ?
MADEMOISELLE DELORME.
Que j’ai bien fait, madame, de m’adresser à vous ! Mais nous n’avons pas de temps à perdre.
MADAME DURVILLE.
Non, vraiment ; tout notre monde ne peut tarder, et quand une fois le bal sera commencé, j’aurai tant d’occupations, tant d’embarras... Il n’y aura pas moyen de lui parler. Le voici ; vous allez voir comme je vais prendre vos intérêts.
MADEMOISELLE DELORME.
Le voici. Je vous laisse.
MADAME DURVILLE.
Eh ! non, restez ; je veux que vous soyez témoin de la chaleur avec laquelle je vous défendrai.
AUGUSTE.
Restez, mademoiselle ; votre présence ne peut faire qu’un bon effet auprès de mon oncle.
MADEMOISELLE DELORME.
Ah ! mon Dieu ! me voilà toute tremblante.
AUGUSTE.
Songez que vos amis sont là pour vous rassurer... ma tante, et moi.
MADAME DURVILLE.
Oui, sans doute ; laissez-moi faire, tout ira bien.
Scène IV
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME, MADAME DURVILLE, MONSIEUR DURVILLE
MADAME DURVILLE.
Venez, venez, monsieur ; je suis bien aise de vous voir. J’ai à vous gronder. Est-il permis de se conduire de la sorte avec un voisin, un galant homme dans le malheur ?
DURVILLE.
Quoi donc, madame ? qui peut m’attirer cette réprimande de votre part ?
MADAME DURVILLE.
Comment ! monsieur, vous poursuivez avec acharnement ce brave monsieur Delorme ! Il faut de l’humanité, monsieur Durville.
DURVILLE.
Permettez-moi de vous dire, madame, que je suis tout aussi humain qu’un autre ; mais que vous n’entendez rien aux affaires de commerce, et qu’il ne vous convient pas même de vous en mêler.
MADAME DURVILLE.
D’accord, monsieur. Mais quand une personne aussi intéressante que mademoiselle vient implorer mon appui, certainement je ne le lui refuserai pas ; et si j’ai quelque pouvoir sur vous...
DURVILLE.
Mademoiselle, je suis fâché...
À sa femme.
En vérité, madame, je ne sais à quoi vous songez de m’exposer à une scène aussi désagréable.
AUGUSTE, à mademoiselle Delorme.
Du courage.
MADEMOISELLE DELORME.
Monsieur, ne nous accablez pas...
DURVILLE.
Mademoiselle, j’ai déjà usé de tous les ménagements possibles envers monsieur votre père ; il y a un terme à tout, et la sûreté du commerce...
AUGUSTE.
Eh quoi ! mon oncle, oseriez-vous inculper la probité de monsieur Delorme ? Ah ! croyez que, sans les événements malheureux dont il est la victime, dès longtemps il se serait acquitté.
DURVILLE.
Je n’ai pas de conseils à recevoir de vous, monsieur.
MADEMOISELLE DELORME.
N’irritez pas votre oncle, monsieur Auguste.
MADAME DURVILLE.
Allons, monsieur Durville, il y aurait de la barbarie à tourmenter une honnête famille.
DURVILLE.
Eh bien ! madame, je verrai, je m’arrangerai.
À sa femme.
Je ne vous pardonne pas de m’avoir mis dans un pareil embarras.
Scène V
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME, MADAME DURVILLE, MONSIEUR DURVILLE, DELORME
DELORME.
Je vous avais prié, ma fille, de ne plus paraître chez monsieur Durville.
MADEMOISELLE DELORME.
Mon père, j’avais cru que mes prières pourraient obtenir de monsieur...
DELORME.
Je ne veux aucune grâce de monsieur. J’ai épuisé auprès de lui tout ce que la raison, l’honneur et la justice ont pu me fournir de plus puissant ; il a été insensible. Nous nous avilirions en ajoutant un mot.
DURVILLE.
Comment ! que veut dire ce ton méprisant ? Ce langage est assez déplacé dans la bouche d’un homme pour lequel on a eu tous les égards...
MADAME DURVILLE.
Vous avez tort, monsieur Delorme. Eh quoi ! lorsque j’intercède pour vous, que je suis sur le point d’obtenir... Vous voyez, mon enfant, j’ai fait tout ce que j’ai pu, ce n’est pas ma faute.
Ici on entend des violons.
Eh bien ! qu’est-ce que c’est donc ? Comment, personne n’est arrivé, et les voilà qui commencent leurs contre-danses. Mille pardons si je vous quitte. Ah çà, monsieur Durville, je m’en rapporte à vous ; ne tourmentez pas ces braves gens.
À mademoiselle Delorme.
Dites donc à votre papa de ne pas être si fier. Voilà comme on gâte toutes les affaires.
Elle sort.
Scène VI
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME, MONSIEUR DURVILLE, DELORME
DELORME.
Retirons-nous, ma fille ; laissons monsieur Durville recevoir sa nombreuse société.
DURVILLE.
Souvenez-vous, monsieur, que demain je peux faire exécuter la sentence.
DELORME.
Disposez de moi comme il vous plaira, monsieur. Prends courage, ma fille ; quelque grands que soient nos malheurs, songe que l’honneur nous restera, et que jamais le nom de banqueroutier ne flétrira la mémoire de ton père.
Il sort avec sa fille.
Scène VII
DURVILLE, AUGUSTE
DURVILLE.
Est-on plus insolent !
AUGUSTE.
J’entends du monde ; je vous laisse. Vous vous étiez attendri, mon oncle ; de grâce, n’étouffez pas ce premier mouvement de votre cœur ; et pour une somme qui ne doit être qu’une bagatelle à vos yeux, ne réduisez pas un honnête homme au désespoir...
Il sort.
Scène VIII
DURVILLE, seul
« Jamais le nom de banqueroutier ne flétrira la mémoire de ton père. » Ces mots m’ont tout-à-fait déconcerté.
Scène IX
DURVILLE, VALMONT
VALMONT.
Eh ! bonjour, mon cher Durville ; j’arrive avant tout le monde, et pour cause. Il faut que tu me rendes un grand service.
DURVILLE.
Je suis à toi de tout mon cœur.
VALMONT.
Je le sais ; au surplus, en m’obligeant, cela t’arrangera toi-même. Écoute, tu fais valoir ton argent à la bourse, dans les affaires, le commerce : moi, je n’y entends rien ; je ne joue qu’à la bouillote, au quinze, dans les meilleures maisons. Hier j’ai gagné l’impossible. Tu sais que mon jeu est leste, hardi ; mais la fortune est inconstante... Voilà vingt mille francs que je veux mettre à l’abri. Je les place chez toi.
DURVILLE.
Chez moi !
VALMONT.
Oui, chez toi. Je ne peux pas les placer d’une manière plus avantageuse, plus solide surtout. Tu me les feras valoir.
DURVILLE.
Pardon, mais dans ce moment je n’ai pas besoin de fonds.
VALMONT.
Si fait, si fait ; quand on fait des affaires aussi considérables, l’argent ne peut jamais gêner.
DURVILLE.
Mais je ne sais si je dois...
VALMONT.
D’ailleurs, c’est par amitié. Eh bien ! les premiers mois tu me paieras tel intérêt que tu voudras, et tu choisiras un bon moment... N’en parle à personne, cela me forcerait de payer mes dettes... J’entends du bruit, on vient, c’est ta femme avec madame Valbelle, madame Fierval ; prends ces billets de caisse, et pendant le bal tu me feras un mot de reçu, de quittance, n’est-ce pas ?
Il lui met dans la main vingt billets de mille francs.
DURVILLE.
Mais non, je n’accepte pas.
VALMONT.
Prends, prends, te dis-je.
DURVILLE, prenant les billets presque malgré lui, à part.
Oh ! je trouverai le moyen...
Scène X
DURVILLE, VALMONT, MESDAMES DURVILLE, VALBELLE, FIERVAL
MADAME DURVILLE.
C’est bien joli à vous, mes belles dames, d’arriver ainsi les premières.
MADAME FIERVAL.
Oh ! moi, je ne me fais jamais attendre ; j’ai été prendre madame chez elle.
MADAME VALBELLE.
Précisément comme j’achevais de m’habiller. Eh ! bonsoir, mon cher Durville.
DURVILLE.
Mesdames, je vous présente mes très humbles hommages.
MADAME FIERVAL.
Bonjour, Valmont. Je me fais une fête de passer la soirée avec vous, ma chère amie.
MADAME VALBELLE.
Il n’est déjà question que de votre bal dans tout Paris.
MADAME DURVILLE.
En vérité, on est bien bon de s’occuper de ces misères.
MADAME VALBELLE.
Nous aurons beaucoup de danseurs ?
MADAME FIERVAL.
Et des joueurs ?
MADAME VALBELLE.
Et un concert ?
MADAME FIERVAL.
Et un feu d’artifice ?
MADAME VALBELLE.
Et des illuminations ?
MADAME FIERVAL.
C’est charmant !
MADAME DURVILLE.
Et monsieur Fierval, où est-il donc ?
MADAME FIERVAL.
Ah ! bien oui, comptez sur les maris pour donner la main à leurs femmes. Il viendra à minuit faire son piquet avec monsieur Durville.
MADAME VALBELLE.
Vous êtes bien heureuse, vous, madame Durville, d’avoir un mari galant, empressé ; car ce n’est pas à l’aimable Durville que s’adressent nos reproches.
DURVILLE.
Vous êtes bien bonnes, mesdames.
À part.
Duhautcours ne vient pas.
MADAME FIERVAL.
Eh ! mais qu’a-t-il donc, le cher Durville ? il paraît tout soucieux ce soir.
DURVILLE.
Eh ! non, mesdames, je suis tout entier au bonheur de vous voir.
MADAME FIERVAL.
Vous nous dites cela d’un air bien triste. À propos, vous ne savez pas la nouvelle ; Monval manque de je ne sais combien de cent mille francs.
MADAME VALBELLE.
Ah ! mon Dieu !
MADAME DURVILLE.
Je n’en suis pas fâchée pour sa femme.
MADAME FIERVAL.
Oui, elle fait de l’esprit.
VALMONT.
Et son mari des banqueroutes ; quel couple intéressant !
MADAME VALBELLE.
Bon ! cela n’empêchera pas la femme de se montrer dans tous les athénées.
MADAME FIERVAL.
Et le mari à la bourse. Cela est reçu.
VALMONT.
Heureusement que ces choses-là deviennent un peu plus rares. C’était une véritable épidémie.
MADAME FIERVAL.
Eh ! mais, mon cher Durville, vous faites bien mal les honneurs de chez vous. Seriez-vous pour quelque chose dans la banqueroute de Monval ? Quand vous y perdriez quelque argent, avec votre fortune, votre audace en affaires, votre activité... Comment trouvez-vous ma garniture ?
MADAME DURVILLE.
Charmante. Ces dames ont raison ; faut-il que les affaires vous poursuivent au milieu de la société ?
DURVILLE.
Mille pardons, me voilà tout à vous. Avez-vous vu la petite pièce nouvelle, aux Variétés ?
MADAME VALBELLE.
Ah ! c’est pitoyable.
MADAME FIERVAL.
Mais comme c’est joué !
VALMONT.
Comme c’est nature !
MADAME FIERVAL.
Je ne sais pas où ils vont chercher tous leurs quolibets.
DURVILLE.
Ils sont fort gais.
À part.
Ce Duhautcours, comme il se fait attendre !
VALMONT.
Bon ! dans la société on en dit de bien plus forts.
MADAME FIERVAL.
À propos, vous allez demain à Bagatelle ; il y a une course, un pari.
MADAME DURVILLE.
Oui, sans doute.
MADAME FIERVAL.
Nous viendrons vous prendre.
MADAME DURVILLE.
Volontiers.
VALMONT.
Ces dames me permettront-elles de les accompagner ?
MADAME FIERVAL.
Oui, on vous le permet. Ainsi donc à midi précis nous sommes à votre porte. Vous serez prête ?
MADAME DURVILLE.
Oh ! je vous le promets.
MADAME FIERVAL.
C’est que tout Paris y sera.
Scène XI
DURVILLE, VALMONT, MESDAMES DURVILLE, VALBELLE, FIERVAL, UN VALET
LE VALET, annonçant.
Monsieur Duhautcours.
DURVILLE.
Ah ! le voilà.
MADAME FIERVAL.
Qu’est-ce que c’est que monsieur Duhautcours ?
MADAME DURVILLE.
Un nouvel ami de mon mari.
MADAME VALBELLE.
Vous ne vous rappelez pas ; monsieur Duhautcours que nous avons vu chez ce pauvre Monval au dernier bal qu’il nous donna ?
MADAME FIERVAL.
Ah ! oui, un danseur infatigable.
MADAME VALBELLE.
Un beau joueur !
MADAME FIERVAL.
Qui est-ce qui nous disait donc que c’était un fripon ?
MADAME VALBELLE.
Bon, bon ! des méchants qui s’amusent.
Scène XII
DURVILLE, VALMONT, MESDAMES DURVILLE, VALBELLE, FIERVAL, DUHAUTCOURS
DUHAUTCOURS.
Mesdames, j’ai bien l’honneur... En vérité, mon cher Durville, c’est un cadeau que vous m’avez fait de m’inviter à votre fête ; je viens de traverser le jardin, le salon ; des jolies femmes partout. Il est impossible de voir une réunion plus complète.
MADAME DURVILLE.
Comment il y a du monde dans le salon, et moi qui m’amuse ici ; mille pardons, mesdames ; mais il faut arranger les contre-danses et les parties.
Elle sort.
MADAME VALBELLE.
Eh vite ! eh vite ! que j’aille prendre une place. Le petit Précour, qui m’a priée ce matin, ne me pardonnerait pas de manquer la première contre-danse.
MADAME FIERVAL.
Eh vite ! eh vite ! une place à la bouillote. J’ai perdu tout mon argent hier.
VALMONT, offrant la main à madame Valbelle.
Madame, voulez-vous bien permettre...
DURVILLE.
Vous savez que nous avons à causer ensemble, Duhautcours ?
DUHAUTCOURS.
Je suis à vous dans l’instant, mon cher Durville.
À madame Fierval, en lui donnant la main.
Qu’il est heureux pour moi, belle dame, de vous retrouver encore !...
Ils sortent.
Scène XIII
DURVILLE, seul
Obligé de répondre, de rire, de les provoquer, pour ainsi dire, à la joie, quand je me sens déchiré.
On entend une musique un peu éloignée.
J’entends la musique. Les voilà qui dansent, qui jouent. Fort bien, mes amis ; amusez-vous. Bien, ma femme ; soyez toute glorieuse de l’éclat de votre fête, tandis que moi... seul... à l’écart...
Scène XIV
DURVILLE, DUHAUTCOURS
DUHAUTCOURS.
Quelle sottise vous auriez faite de renoncer à votre fête, mon ami ! c’est un coup d’œil enchanteur, ravissant. Ces lustres, ces femmes, ces plumes, ces paillettes éblouissantes... Votre salon ressemble à un ballet de l’opéra. Voilà une fête qui vous fera beaucoup d’honneur.
DURVILLE.
Oh ! oui, beaucoup, je le crois. Parlons de notre affaire.
DUHAUTCOURS.
Eh bien ! notre affaire, elle est sûre ; nos amis sont prêts, tous les rôles sont distribués. J’ai fait dresser l’acte sous mes yeux, et demain matin...
DURVILLE.
Mais êtes-vous bien sûr, mon ami, que nous soyons en règle ?
DUHAUTCOURS.
Parfaitement en règle, mon cher ; Dieu merci, je sais mon métier, et nous leur faisons un si beau sort ! combien y a-t-il de gens qui voudraient trouver vingt pour cent de leurs créances ?
DURVILLE.
Et ce malheureux Valmont, qui me force pour ainsi dire de prendre vingt mille francs qu’il place chez moi.
DUHAUTCOURS.
En vérité ! quand je vous ai dit que cette fête allait doubler votre crédit.
DURVILLE.
Oh ! je vais lui rendre...
DUHAUTCOURS.
Gardez-vous-en bien ; vous feriez soupçonner... Il les perdrait au jeu. C’est vous seul que je crains, mon cher Durville. Vous n’avez pas de force de caractère, de fermeté. Et ceux qui ont acheté, revendu, centuplé leurs capitaux ; et ceux qui prêtent sur des gages qu’ils vendent, qui ne vivent que de pots-de-vin sur les marchés ; et les caissiers qui font valoir, et les dépositaires qui s’enrichissent, et ceux qui ont remboursé avec des assignats ! eh bien ! tous ces gens-là ont fait leurs opérations avec une sécurité de conscience que vous devriez avoir. Songez que vous recevez ce soir vos amis.
DURVILLE.
Allons, puisque le sort en est jeté... Mais ne restons pas plus longtemps ensemble.
Scène XV
DURVILLE, DUHAUTCOURS, MADAME DURVILLE
MADAME DURVILLE.
Ah ! mon ami, que viens-je d’apprendre ? Est-il vrai que vous éprouviez des malheurs assez grands pour ressentir de la gêne dans vos négociations ?
DURVILLE.
Qu’est-ce donc ? qui vous a dit...
MADAME DURVILLE.
Personne ; mais j’ai cru entendre circuler des mots défavorables : on a l’air de me plaindre. La présence même de monsieur paraît redoubler les inquiétudes.
DUHAUTCOURS.
Ma présence ! En vérité, c’est trop plaisant.
DURVILLE, à Duhautcours.
Eh bien ! ma fête double-t-elle mon crédit ?
DUHAUTCOURS.
Ah ! le moyen commence à s’user.
MADAME DURVILLE.
De grâce, rassurez-moi ; quelles que soient vos infortunes, croyez que je saurai les supporter.
DURVILLE.
Eh ! mais, mon Dieu ! quel éclat vous faites ! quelles alarmes ! Voulez-vous chasser toute la société ? Je voulais éviter cette fête. Vous avez tenu à vos idées ; maintenant sachez vous contenir.
DUHAUTCOURS.
Monsieur Durville a raison ; d’abord il est certain que madame n’a rien à craindre.
DURVILLE.
Notre séparation de biens ne vous met-elle pas à couvert ?
DUHAUTCOURS.
Si après cela monsieur Durville est forcé par des causes majeures de transiger avec ses créanciers...
MADAME DURVILLE.
Transiger avec vos créanciers ! Eh ! mais, mon ami, c’est une faillite !
DUHAUTCOURS.
Que voulez-vous ? Les débiteurs ne paient pas.
DURVILLE.
Vous-même, vous m’amenez cette mademoiselle Delorme.
MADAME DURVILLE.
En êtes-vous donc réduit à cette extrémité ? N’est-il aucun moyen de conserver votre honneur ?
DURVILLE.
Mon honneur !
DUHAUTCOURS.
Croyez-vous donc qu’il soit compromis, parce que Durville est malheureux ?
DURVILLE.
Est-ce ma faute, si de tous côtés j’éprouve des pertes affreuses ?
DUHAUTCOURS.
Que madame me permette une seule petite réflexion. Voyez autour de nous dans la société, Cléon, Damis, Sainville, Monval et tant d’autres : sont-ils déshonorés par leur infortune ? Ne sont-ils pas accueillis, fêtés, recherchés ? Pourquoi ? C’est que le malheur a des droits sacrés, et qu’on respecte en eux l’honorable adversité.
DURVILLE.
Cessez donc, madame, de me gratifier de votre pitié, et de craindre pour mon honneur.
MADAME DURVILLE.
Pardon, mon ami, je n’ai pas eu l’intention de vous offenser ; mais le mot de faillite est bien cruel, et je tremble que le monde...
DURVILLE.
Mais ma justification est toute prête.
DUHAUTCOURS.
Sans doute ; l’actif est infiniment supérieur au passif.
MADAME DURVILLE.
En ce cas, pourquoi prendre un parti si déterminé ? Demandez des délais.
DUHAUTCOURS.
Des délais ! y pensez-vous, madame ? Il faudrait toujours finir par payer ; et paiera-t-on monsieur ?
DURVILLE.
Point d’inquiétude, ma bonne amie. Tenez, les femmes doivent s’en rapporter à leurs maris. Surtout gardez-vous de laisser paraître le moindre trouble pendant la fête que nous donnons.
Scène XVI
DURVILLE, DUHAUTCOURS, MADAME DURVILLE, MADAME FIERVAL
MADAME FIERVAL.
Eh ! mais, mon Dieu ! que devenez-vous donc, mes amis ? Comment ! vous donnez une fête, et vous vous éclipsez ! Auriez-vous des chagrins, mon cher Durville ?
DURVILLE.
Aucuns, madame, aucuns ; je ne fus jamais d’une humeur plus gaie, jamais plus disposé à bien recevoir ma société ; n’est-il pas vrai, ma chère amie ?
MADAME FIERVAL.
À la bonne heure ; pour moi, je suis dans un chagrin épouvantable. Ce petit sot de Précour, que je persécute pour prendre une place... Il s’assied ; du premier coup il a un brelan ; il emporte tout mon argent, et il fait charlemagne. J’ai recours à vous, mon cher Durville ; il faut que je prenne ma revanche, et que vous me prêtiez de l’argent.
DURVILLE.
Comment donc, madame ? ordonnez, je vous en prie ; je vais mettre quelques rouleaux sur la cheminée, une carte, un crayon ; que tous mes amis prennent et s’inscrivent tant qu’il y en aura.
DUHAUTCOURS.
C’est un homme d’or que monsieur Durville. Puisqu’il en est ainsi, je veux risquer une cave à la bouillote.
Il donne la main à madame Fierval.
MADAME DURVILLE, à part.
Que je m’en veux d’avoir provoqué cette fête !
DURVILLE, affectant un air gai.
Allons, mesdames, livrons-nous à la gaieté qu’inspire une aussi aimable réunion !
ACTE III
Cet acte et les suivants se passent le lendemain matin.
Scène première
CRÉPON, MARASCHINI
CRÉPON.
Ce que vous m’apprenez là est-il possible, monsieur Maraschini ?
MARASCHINI.
Vous n’avez pas voulu me croire hier au soir, monsieur Crépon, et nous perdons tout ce matin.
CRÉPON.
Et c’est monsieur Durville qui vous a donné lui-même la nouvelle ?
MARASCHINI.
Oui, monsieur, il a déposé son bilan ce matin : banqueroute réglée. C’est une suite de malheurs qui ne finissent plus des corsaires qui ont été pris par les Anglais ; des banqueroutes qui ont précédé la sienne.
CRÉPON.
Oui, des friponneries, des infamies, des horreurs ; mais, morbleu ! cela ne se passera pas comme cela.
MARASCHINI.
Quand je vous dis que nous autres qui figurons dans les fêtes, nous sommes toujours les précurseurs des accidents.
CRÉPON.
Qu’il fasse perdre à tous ceux qui ont spéculé avec lui, cela m’est fort égal ; mais d’honnêtes marchands, d’honnêtes entrepreneurs comme moi, comme vous, cela ne se peut pas ; nous devons avoir un privilège.
MARASCHINI.
Ah ! bien oui, un privilège pour des glaces et des gazes ! ah ! par Saint-Marc, cela ne finira-t-il pas ? Voilà la douzième en un an, et l’on s’étonne qu’on fasse payer cher ceux qui paient... Monsieur Fiammeschi est allé tenter un dernier effort.
CRÉPON.
Il n’en obtiendra rien ; c’est un huissier qu’il faut employer.
MARASCHINI.
Patienza ! monsieur Crépon, il ne faut rien précipiter.
Scène II
CRÉPON, MARASCHINI, FIAMMESCHI
MARASCHINI.
Eh bien ! monsieur Fiammeschi ?
FIAMMESCHI.
Niente, absolument, niente. Mais, monsieur Durville, sentez donc la position où je me trouve. Ah ! mon cher Fiammeschi, puis-je, encore plus malheureux que vous... Bref, beaucoup de politesses ; mais de l’argent, point : et il a fini par me prier de me trouver à une heure à l’assemblée des créanciers. Il m’a chargé de vous y inviter ; il désire que vous fassiez entendre raison aux autres, et qu’on accepte les arrangements qu’il doit proposer.
CRÉPON.
Ah ! oui, qu’il s’en rapporte à nous ; il est temps de faire un exemple, et, pour la sûreté du commerce, il faut poursuivre rigoureusement...
MARASCHINI.
Ses arrangements ! quels peuvent-ils être ? Des centimes pour des francs. Mais enfin, cet homme a des biens, un mobilier superbe.
CRÉPON.
Il faut tout faire saisir ; point de pitié.
FIAMMESCHI.
Eh ! non, désabusez-vous. Tous ces biens, tous ces meubles, ce n’est pas à lui.
MARASCHINI.
Et à qui donc ?
FIAMMESCHI.
À sa femme ; et, comme cela se pratique, séparation de biens entre le mari et la femme.
MARASCHINI.
Ah ! mon Dieu ! ce Duhautcours n’oublie rien quand il se mêle d’une affaire.
CRÉPON.
Qu’est-ce que vous dites donc ? Séparation de biens entre le mari et la femme. Ah ! mes amis, je suis sauvé !
MARASCHINI.
Eh ! comment donc, s’il vous plaît ?
CRÉPON.
Des rubans, du crêpe, des fleurs, du rouge et des ridicules ; ce n’est pas pour monsieur, je crois. Il est bien clair que je n’ai affaire qu’à madame.
MARASCHINI.
Mon cher Fiammeschi, est-ce que nous ne pourrions pas faire passer vos lampions et mes glaces sur le compte de madame ?
FIAMMESCHI.
Ah ! oui, avec des fripons comme ceux-là !
CRÉPON.
Des fripons ! ah, c’est trop fort, monsieur Fiammeschi. J’ai toujours connu monsieur Durville pour un très galant homme ; j’aime à croire qu’il n’est que malheureux.
FIAMMESCHI.
Fort bien, prenez sa défense, monsieur le marchand de modes, qui n’avez affaire qu’à madame.
CRÉPON.
Croyez, mes bons amis, que je ne suis animé que du désir de vous être utile. Mais tenez, la colère ne mène à rien ; vous avez dû l’éprouver dans plus d’une occasion semblable. J’ai un conseil à vous donner : prenez ce qu’il vous offrira ; c’est toujours autant de gagné. Mille pardons si je vous quitte ; faites vos affaires avec monsieur Durville ; je vais faire arrêter mon mémoire par madame.
Il sort.
Scène III
FIAMMESCHI, MARASCHINI
MARASCHINI.
Qu’en dites-vous, monsieur Fiammeschi ? Tant qu’il se croit perdu avec nous, il nous conseille de poursuivre avec vigueur ; quand il se voit sauvé, il nous engage à la résignation. Lequel des deux conseils suivrons-nous ?
FIAMMESCHI.
Le premier. Unissons-nous, monsieur Maraschini ; mettons-nous en règle, et venons en force à l’assemblée des créanciers.
MARASCHINI.
J’aperçois monsieur Duhautcours. Quand je vous ai dit que c’était lui qui machinait tout cela.
Scène IV
FIAMMESCHI, MARASCHINI, DUHAUTCOURS
DUHAUTCOURS.
Eh ! bonjour, hommes à talents, hommes charmants, aimables gens ; vous nous avez donné hier une fête... une fête divine. Parbleu ! je me propose d’en donner une incessamment, mais plus modeste ; il me faudra seulement de la galanterie, de l’esprit, de la grâce. J’espère bien m’adresser à vous.
MARASCHINI.
Argent comptant, monsieur Duhautcours, et vous pouvez disposer de nous.
FIAMMESCHI.
Sortons, monsieur Maraschini ; ma tête se monte ; je me ferais justice à moi-même avec ce fripon qui l’est encore plus que l’autre. Au revoir, monsieur Duhautcours ; nous nous trouverons à l’assemblée des créanciers à une heure.
MARASCHINI.
Oui, monsieur, nous y serons.
Il sort.
Scène V
DUHAUTCOURS, seul
C’est unique comme tous ces gens-là ont l’air de m’en vouloir ! Qu’ils ne s’avisent pas de faire les méchants, ou, s’il leur prend fantaisie de manquer à leur tour, ils ne me trouveront pas. J’ai fait avertir Durville ; nous n’avons pas de temps à perdre ; j’ai une autre affaire que je dois entamer ce matin. Ah ! le voilà.
Scène VI
DURVILLE, DUHAUTCOURS
DURVILLE.
Ah ! c’est vous, Duhautcours.
DUHAUTCOURS.
Allons, mon ami, voici l’instant du courage. Tenez-vous ferme.
DURVILLE.
Je viens d’essuyer un rude assaut avec ce pauvre Fiammeschi ; qu’il m’en a coûté de ne lui pas donner d’argent !
DUHAUTCOURS.
Bon ! ce sont bien ces gens-là qu’il faut plaindre ; ils gagnent plus que vous et moi.
DURVILLE.
Vous serez présent à l’assemblée ?
DUHAUTCOURS.
Parbleu ! Ah çà ! il est bien convenu que je ne fais paraître que trois de nos amis : pour entraîner il ne faut pas effaroucher. L’homme d’affaires chargé de la rédaction de l’acte, et deux autres, garçons intrépides et dévoués. Mais dites-moi donc, ce petit marchand qui demeure dans votre maison...
DURVILLE.
Delorme ?
DUHAUTCOURS.
Qu’est-ce que c’est que cet homme-là ?
DURVILLE.
Un pauvre diable à qui j’en veux beaucoup. Mais pourquoi cette question ?
DUHAUTCOURS.
Je viens de le rencontrer tout à l’heure, et il était avec un homme d’une figure... une espèce de voyageur qui avait l’air d’arriver à l’instant ; il ne m’est pas revenu du tout cet homme-là.
DURVILLE.
Eh ! qu’importe !
DUHAUTCOURS.
C’est que ce diable d’homme avait un air de gravité, de brusquerie... et comme je passais auprès d’eux, ils m’ont regardé avec un air... de mépris... oui, de mépris. Vous sentez bien que je suis au-dessus de cela.
DURVILLE.
Parbleu ! il sied bien à monsieur Delorme de prendre ces grands airs avec mes amis, quand il est mon débiteur, quand j’ai eu pour lui tous les égards...
DUHAUTCOURS.
Et puis cet individu, cet étranger a élevé la voix, et a dit à Delorme, probablement pour que je l’entendisse : Soyez tranquille, mon ami, je me charge de votre affaire ; il faudra bien qu’on vous accorde du temps. Eh ! les voilà tous les deux.
DURVILLE.
Ah ! oui, je suis bien en humeur de l’écouter.
Scène VII
DURVILLE, DUHAUTCOURS, FRANVAL, DELORME
DURVILLE.
Que veut monsieur Delorme ? vient-il encore...
DELORME.
Il me semble, monsieur, que depuis hier j’ai assez exprimé l’intention de ne plus avoir recours auprès de vous à des prières aussi inutiles qu’humiliantes. C’est un autre motif qui m’amène.
DURVILLE.
Un autre motif ! il n’y a pas d’autre motif, et il ne peut pas y en avoir.
DELORME.
Puisse le trait généreux que je vais vous révéler vous faire rougir de vos procédés envers moi ! Le voilà, monsieur, cet ami si digne de ce beau nom, qui, à la première nouvelle de mon désastre, a abandonné son pays, son état, sa famille, a fait un voyage de deux cents lieues, pour m’arracher au malheur qui me menaçait.
FRANVAL.
Votre fille n’est-elle pas ma filleule ? n’êtes-vous pas mon ami ? je vous devais cela. Ce que je fais pour vous, vous l’auriez fait pour moi, n’est-ce pas ? Vite des chevaux de poste, et me voilà. La conduite de monsieur Durville avec vous est bien plus faite pour étonner. C’est monsieur, je crois ; eh bien ! je ne m’en dédis pas. Vous êtes riche, je le savais avant d’arriver à Paris. Le train de votre maison, l’éclat de votre mobilier, ne démentent pas l’opinion que j’avais de votre fortune. Comment se fait-il que vous soyez le plus impitoyable des créanciers de Delorme ? et pour combien ? pour une somme de deux mille écus.
À Delorme.
N’est-ce pas deux mille écus que vous lui devez ?
À Durville.
Corbleu ! cela n’est pas bien. Permettez-moi de vous le dire. Il y a des débiteurs de mauvaise foi, je le sais ; il y a des étourdis, des ignorants qui font mal leurs affaires, parce qu’ils n’y entendent rien. Pour ceux-là, je vous aiderais à les poursuivre ; mais vous avez trop de discernement pour confondre un honnête homme, un bon négociant, avec des fripons ou des imbéciles.
DURVILLE.
Monsieur, j’admire le dévouement avec lequel vous offrez de payer pour monsieur Delorme ; mais avant de me blâmer, il faudrait que vous fussiez instruit...
DUHAUTCOURS.
C’est qu’il est inconcevable qu’un inconnu vienne insulter les gens...
FRANVAL.
Moi, je n’insulte personne, et je ne suis pas un inconnu pour monsieur Durville. Je suis Franval.
DURVILLE.
Franval !
FRANVAL.
Commerçant de Marseille.
DUHAUTCOURS, à Durville.
Précisément le créancier que je craignais. Allons, mon ami, de la tête et du front ! Je suis là.
DURVILLE.
Ah ! monsieur, pardon, si je...
FRANVAL.
Point d’excuse. Je vous ai dit ma façon de penser. Tant mieux pour vous si ma franchise a fait quelque impression sur votre esprit ; parlons d’affaires. Je me charge de la dette de Delorme. Vous allez me donner votre acquit de la somme qu’il vous doit, à compte de celle de cinquante mille francs que vous me devez, dont j’ai votre acceptation payable aujourd’hui, et que vous allez me compter sur-le-champ, s’il vous plaît. Dépêchons-nous, j’ai hâte ; j’ai besoin de cet argent pour satisfaire les autres créanciers de mon ami.
DURVILLE.
Monsieur, je suis fâché...
FRANVAL.
De quoi ? Cette proposition est simple, et vous ne pouvez, je pense, hésiter.
DURVILLE.
Pardonnez-moi, monsieur, mais...
FRANVAL.
Comment, il n’y a pas de mais... donnez-moi cinquante mille francs. Voilà vos billets.
DURVILLE.
Cela n’est plus possible.
FRANVAL.
Comment ?
DURVILLE.
Vous ignorez apparemment...
FRANVAL.
Quoi donc ?
DURVILLE.
Les malheurs, les pertes, les circonstances m’ont forcé à prendre un parti cruel.
FRANVAL.
Plaît-il ?
DURVILLE.
J’ai déposé mon bilan aujourd’hui.
DELORME.
Ah ! mon Dieu !
FRANVAL.
Vous avez déposé votre bilan !
DUHAUTCOURS.
Oui, monsieur, notre bilan est déposé. C’est le bruit public à-présent. Il est étonnant que vous l’ignoriez.
DURVILLE.
Personne ne souffre plus que moi de cette affreuse calamité.
FRANVAL.
Eh bien ! remerciez-moi donc, mon cher Delorme, d’avoir fait le voyage pour vous. C’est plutôt à moi à vous remercier ; sans votre accident, je restais à Marseille, et monsieur que voilà arrangeait si bien ses affaires, que je perdais mes cinquante mille francs.
DELORME.
Quel malheur pour vous !
FRANVAL, fort en colère.
Corbleu !...
S’apaisant tout-à-coup.
J’allais me fâcher, cela ne me vaut rien. Ah ! vous avez déposé votre bilan. En voilà donc encore une ; ce qui m’en plaît, c’est que cela ne vous a pas empêché de donner un fête superbe hier.
DUHAUTCOURS.
C’est une nouvelle affreuse qui nous est arrivée ce matin, un coup de foudre.
FRANVAL.
Pauvres gens ! un coup de foudre ! cela arrive toujours comme cela. Je ne vous reprocherai pas non plus d’avoir, au moment où vous alliez manquer vous-même, poursuivi avec acharnement un débiteur malheureux qui ne vous demandait que du temps, sans aucun sacrifice dont il eût à rougir. Vous me répondriez que c’est précisément ce qui prouve la nécessité de votre opération.
DUHAUTCOURS.
En effet, comment payer nos créanciers, quand nos débiteurs ne nous paient pas ?
FRANVAL.
C’est tout simple. Un seul mot, honnête et malheureux Durville : on verra ce bilan. Avez-vous bien pris toutes vos précautions ? Avez-vous bien clairement détaillé toutes les pertes, toutes les spéculations malheureuses dont vous êtes la victime ?
DUHAUTCOURS.
Nous sommes en règle, monsieur.
FRANVAL.
Je n’en doute pas. Par conséquent il sera facile de suivre la trace des cinquante mille francs que vous avez touchés en mon nom. Les paiements que vous avez faits sont authentiques et clairs.
DURVILLE.
Monsieur, mon homme d’affaires doit être ici à une heure ; il vous rendra tous les comptes que vous désirez.
DUHAUTCOURS.
Je prie monsieur de considérer que c’est à la masse que le compte doit être présenté, et que s’il fallait rendre raison à chacun en particulier, on n’en finirait pas. Comme disait monsieur Durville, nous avons une assemblée de créanciers à une heure, ici.
FRANVAL.
À mon tour, monsieur, je vous dirai que je n’ai pas besoin des observations d’un inconnu.
DUHAUTCOURS.
Je ne suis pas un inconnu ; je suis l’agent de monsieur, et de plus son créancier comme vous.
FRANVAL.
Son créancier ! Et c’est vous qui le justifiez !
DUHAUTCOURS.
C’est qu’avant tout je suis son ami ; c’est que je crois à ses malheurs, comme à sa probité, et que j’ai pris l’habitude de me regarder comme très heureux quand je peux, dans un moment comme celui-ci, sauver un quart ou un cinquième de mes fonds.
FRANVAL.
Je vous félicite, monsieur, de faire des opérations assez avantageuses pour y perdre impunément les trois quarts de vos avances ; mais moi, qui n’ai pas encore pris cette habitude-là...
Scène VIII
DURVILLE, DUHAUTCOURS, FRANVAL, DELORME, AUGUSTE
AUGUSTE.
Que viens-je d’apprendre, mon oncle ; serait-il vrai ? Vous suspendez vos paiements ? Vous manquez ?
DURVILLE.
Hélas ! il n’est que trop vrai, mon cher neveu.
AUGUSTE.
Cela ne se peut pas, mon oncle ; vous avez de quoi faire face à tous vos engagements.
FRANVAL.
Ah ! ah !
DURVILLE.
Et d’où sauriez-vous...
AUGUSTE.
Je le sais. N’est-ce pas moi qui suis chargé de toute votre correspondance ? Hier encore je me félicitais de la situation de vos affaires.
DUHAUTCOURS, à part.
Oh ! l’imbécile jeune homme !
FRANVAL.
Eh ! que diable aussi, pourquoi ne lui faites-vous pas sa leçon, mon confrère le créancier ?
DURVILLE.
Croyez-vous donc être dans la confidence de toutes mes opérations ?
DUHAUTCOURS.
Oui, sans doute ; c’est à un jeune étourdi comme vous que monsieur Durville ira confier des entreprises délicates !
FRANVAL.
Fi donc vous êtes trop jeune, mon ami, trop ingénu pour qu’on vous emploie dans des opérations délicates, comme dit monsieur.
DURVILLE.
Ah ! mon neveu, si vous connaissiez le malheur affreux dont je viens de recevoir la nouvelle.
AUGUSTE.
Un malheur ! en est-il un seul qui puisse vous réduire à cette extrémité ? C’est une honte dont vous ne vous couvrirez pas.
DUHAUTCOURS.
Il va tout perdre.
DURVILLE.
Monsieur, quel ton singulier prenez-vous donc avec moi ?
AUGUSTE.
Quelles mesures aurais-je encore à garder ? Ne suis-je pas votre neveu, votre ami...
FRANVAL.
Il a du feu, le jeune homme.
DELORME, bas à Franval.
C’est ce neveu de monsieur Durville...
FRANVAL, bas à Delorme.
Dont ta fille m’a déjà parlé ; un sujet qui s’annonce fort bien. Je t’en félicite pour ma filleule.
Haut.
Messieurs, j’en suis fâché pour vous ; mais plus ce jeune homme m’inspire d’estime et de confiance, plus il me donne mauvaise opinion de vous.
DELORME.
Franval, monsieur Durville m’a fait bien du mal ; mais jusqu’ici je n’ai jamais douté de sa probité ; loin de l’accuser, je le plains d’être entouré de conseillers perfides et méchants.
DUHAUTCOURS.
Trop honnête ; c’est à moi que ceci s’adresse.
DURVILLE.
Il ne me manquait plus que la pitié de monsieur Delorme.
DELORME.
Non, monsieur Durville n’est point un malhonnête homme.
FRANVAL.
Mais il est en bon train de le devenir ; c’est un service à lui rendre que d’empêcher sa première sottise. Je m’en charge. À une heure, ici, l’assemblée des créanciers. Sans adieu, messieurs. Touchez là, jeune homme. Ta fille n’avait pas tort de me faire l’éloge d’Auguste : c’est votre nom, je crois. Vous êtes un brave. Je ne m’en dédis pas, Delorme ; je me charge de ton affaire auprès de tes créanciers. Mes cinquante mille francs ne sont pas encore perdus.
Il sort.
AUGUSTE, le suivant.
Ah ! messieurs ; mon cher Delorme, c’est vous que
j’implore. Que monsieur Franval ne précipite point ses
démarches.
DELORME.
Vous m’avez trop bien servi dans mes malheurs pour que les vôtres me soient étrangers.
Il sort.
Scène IX
DURVILLE, DUHAUTCOURS, AUGUSTE
DUHAUTCOURS, à Durville.
Tout ceci ne m’épouvante pas ; mais à quelque prix que ce soit, éloignez votre neveu.
DURVILLE, à Duhautcours.
Vous avez raison, il nous perdrait.
AUGUSTE, revenant, à son oncle.
Mon oncle, au nom de tout ce que vous avez de cher, pour votre intérêt, pour votre gloire, abjurez un projet aussi honteux. Je suis jeune, j’aurai quelque fortune, disposez de moi ; tout ce que je puis espérer, tout ce que je puis acquérir par mon travail, par mon industrie, je le consacre à vous sauver l’honneur.
DURVILLE, avec dureté.
Monsieur...
Se radoucissant.
Eh ! mon cher neveu, crois-tu que je ne souffre pas plus que toi...
DUHAUTCOURS.
Quelqu’injurieux soupçons que vous ayez pu concevoir sur mon compte, je vous rends justice, monsieur ; j’apprécie des sentiments aussi délicats. Croyez-vous qu’en véritable ami de monsieur Durville je n’aie pas cherché avec lui les moyens... ? Mais la nécessité...
AUGUSTE.
N’avez-vous pas des ressources ? Ne pouvez-vous obtenir du temps ?
DURVILLE.
Impossible des lettres de change ; des paiements déjà retardés. Tout m’accable à-la-fois.
AUGUSTE.
N’avez-vous pas des amis ?
DURVILLE.
Des amis ! oui, il en est un surtout, l’honnête et riche Forlis. Vingt fois il a désiré l’occasion de m’obliger.
DUHAUTCOURS.
Un homme sûr. Je le connais, il vous tiendra parole.
AUGUSTE.
Eh bien !
DURVILLE.
Il est absent.
DUHAUTCOURS.
À sa campagne ; je la connais. Un séjour délicieux.
À part.
Bien trouvé.
DURVILLE.
À cinq lieues de Paris.
DUHAUTCOURS.
Quitter Paris ! cela aurait l’air d’une fuite.
AUGUSTE.
Un mot de votre main, et j’y vole.
DUHAUTCOURS.
Écrivez, écrivez.
DURVILLE, s’asseyant et écrivant.
Eh bien ! soit.
AUGUSTE.
Je vous rapporte la réponse avant la fatale assemblée ; vous la retardez jusqu’à mon retour.
DUHAUTCOURS.
Oui, sans doute, nous la retardons.
À part.
Nous l’avançons, au contraire.
DURVILLE, toujours écrivant, à part.
Qu’il m’en coûte de le tromper !
DUHAUTCOURS, à Auguste.
Si vous saviez combien je vous estime, brave jeune homme ; mais ne soyez donc pas si prompt à soupçonner les gens. Eh ! mon Dieu ! dans tout ceci, nous ne voulons que l’avantage de tout le monde !
DURVILLE, remettant la lettre à son neveu.
Tiens, ne perds pas de temps de mon côté je vais...
DUHAUTCOURS.
Oui, nous allons frapper à toutes les portes. Je commence à être un peu plus tranquille : tout ira bien. Votre oncle va donner ses ordres pour qu’on vous selle un cheval. Bon voyage, mon jeune et intéressant ami. Venez, mon cher Durville.
Ils sortent.
Scène X
AUGUSTE, seul
Je pars... Mon oncle ne peut pas me tromper : non, il ne le peut pas ; et ce Duhautcours lui-même... je l’ai jugé peut-être trop sévèrement.
Scène XI
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME
MADEMOISELLE DELORME.
C’est vous, monsieur Auguste, je vous cherchais. Vous me voyez dans une ivresse, dans un ravissement. Monsieur Franval est arrivé, les affaires de mon père prennent une excellente tournure. Il me tardait de vous faire partager ma joie.
AUGUSTE.
Je la partage bien sincèrement, mademoiselle ; mais permettez...
MADEMOISELLE DELORME.
Eh ! mais, mon Dieu ! qu’avez-vous donc ? Vous m’inquiétez...
AUGUSTE.
Ah ! mademoiselle, je le vois, vous ignorez le cruel événement...
MADEMOISELLE DELORME.
Quel événement ?
AUGUSTE.
Pardon, il faut que je vous quitte...
MADEMOISELLE DELORME.
Un seul mot, expliquez-moi...
Scène XII
AUGUSTE, MADEMOISELLE DELORME, MADAME DURVILLE
MADAME DURVILLE.
Vous voilà, Auguste, ma bonne voisine. Vous me voyez dans une inquiétude... Monsieur Durville a eu beau chercher à me rassurer hier, me parler de cette séparation de biens...
AUGUSTE.
Ah ! ma tante, renoncez à cette séparation officieuse, à cette précaution funeste. Tous les biens ne sont-ils pas à mon oncle ? N’appartiennent-ils pas à ses créanciers ? Mais je n’ai pas un instant à perdre, je pars, et j’espère encore... Ma tante, réfléchissez au conseil que je vous donne.
À mademoiselle Delorme, en sortant.
Adieu, mademoiselle.
Scène XIII
MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME
MADAME DURVILLE.
Oui. Mon neveu a raison ; plût au ciel que monsieur Durville eût toujours suivi ses conseils ?
Scène XIV
MESDAMES DURVILLE, FIERVAL, VALBELLE, MADEMOISELLE DELORME
MADAME FIERVAL.
Nous voilà. Vite, vite, partons.
MADAME VALBELLE.
Eh ! quoi, ma chère amie, vous n’êtes pas prête ?
MADAME FIERVAL.
Eh ! mon Dieu ! dépêchez-vous donc, nous n’arriverons jamais assez tôt.
MADAME VALBELLE.
Il y a déjà un monde sur la route du bois de Boulogne.
MADAME FIERVAL.
Et il fait un temps superbe.
MADAME VALBELLE.
Oh ! nous allons passer une matinée délicieuse.
MADAME DURVILLE.
Excusez-moi, mesdames ; mais il m’est impossible... Dans la situation où je suis... je ne me sens pas bien. Mille pardons, encore une fois ; mais il faut que je vous quitte. Ne m’abandonnez pas, ma chère voisine.
Elle sort avec mademoiselle Delorme
Scène XV
MADAME FIERVAL, MADAME VALBELLE
MADAME VALBELLE.
Y concevez-vous quelque chose ?
MADAME FIERVAL.
Mais c’est d’une impolitesse !
MADAME VALBELLE.
Il se passe quelque chose d’extraordinaire dans cette maison.
MADAME FIERVAL.
Est-ce que la nouvelle qu’on m’a dite hier sur monsieur Durville aurait quelque fondement ?
MADAME VALBELLE.
Eh ! quoi donc ?
MADAME FIERVAL.
Ah ! des choses affreuses, horribles !
MADAME VALBELLE.
En vérité. Et qu’est-ce donc, bon Dieu ! ma chère amie ?
Scène XVI
MESDAMES FIERVAL, VALBELLE, VALMONT
VALMONT.
Ah ! mesdames, votre valet de tout mon cœur. Vous voyez que je suis exact au rendez-vous. Où est donc madame Durville ?
MADAME FIERVAL.
Elle nous a laissées tout d’un coup ; elle ne vient pas avec nous.
VALMONT.
Et pourquoi donc ?
MADAME FIERVAL.
Vous ne savez donc rien ? On me l’avait dit tout bas hier à l’oreille ; je ne voulais pas le croire. Durville est ruiné.
MADAME VALBELLE.
Ruiné !
VALMONT.
Ruiné !
MADAME FIERVAL.
Il a fait de mauvaises affaires ; il va manquer.
VALMONT.
Ah ! mon Dieu ! et mes vingt mille francs ! Mille pardons, mesdames ; mais une affaire importante ne me permet pas de vous accompagner. Je cours chez mon avoué. Ce serait une friponnerie... Votre valet de tout mon cœur. J’aurais bien mieux fait de les risquer au jeu. Au désespoir, mesdames.
Il sort.
Scène XVII
MESDAMES FIERVAL, VALBELLE
MADAME VALBELLE.
Eh bien ! il nous laisse là ; eh ! mais, écoutez donc, écoutez donc. La tête tourne-t-elle à tout le monde ?
MADAME FIERVAL.
Qu’en dites-vous, ma chère amie ? Mais cela commence à devenir plaisant : il faudra que nous allions toutes seules à Bagatelle.
MADAME VALBELLE.
Cette pauvre petite madame Durville !
MADAME FIERVAL.
Ah ! cela me fait un mal !
MADAME VALBELLE.
C’était une si bonne petite femme !
MADAME FIERVAL.
Elle se mettait si bien !
MADAME VALBELLE.
Cela va gâter toute ma matinée ; cependant il faut bien prendre notre parti. On nous attend.
MADAME FIERVAL.
Oui, sans doute ; mais c’est affreux, en vérité.
MADAME VALBELLE.
Je reviendrai la voir, la consoler.
MADAME FIERVAL.
abandonner ses Vous ferez bien. Il ne faut pas dans le malheur. Allons à Bagatelle.
ACTE IV
Scène première
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF
DUHAUTCOURS.
Or çà, vous savez vos rôles, le moment approche, recordons-nous.
À Ledoux.
Toi, tu es l’homme chargé de rédiger l’acte, un de ces parasites de palais qui se font appeler hommes de loi, comme jadis les laquais s’appelaient bourgeois de Paris. Tu lis ton papier à toutes les questions, à tous les reproches qu’on te fait, tu ne réponds autre chose sinon que tu as été mandé pour préparer un contrat d’union, et que tu es absolument étranger aux intérêts des parties... Froid, impudent et laconique, voilà ton personnage.
LEDOUX.
C’est entendu.
DUHAUTCOURS, à Prudent et à Graff.
Vous autres, vous êtes deux créanciers ; je vous ai expédié vos titres.
À Graff.
Toi, un gros négociant important, suffisant, tu as beaucoup d’humeur d’abord, tu suis la colère des autres ; tu te consultes, tu t’apaises, tu signes le premier, et dans ta colère comme dans ta résignation tu ne laisses échapper que des monosyllabes.
GRAFF.
Que des monosyllabes.
DUHAUTCOURS, à Prudent.
Toi, tu me ferais quelque bévue. Tu es sourd.
PRUDENT.
Ah ! je suis sourd... J’étais bègue l’autre fois.
DUHAUTCOURS.
Tu es sourd aujourd’hui.
Lui donnant un cornet.
Voilà un cornet à l’aide duquel tu n’entends rien, même quand on crie ; tu prends l’acte, tu le lis attentivement, tu balances, et tu signes après Graff. Point de confusion, point de fausse démarche, point de bavardage. C’est Durville que je crains le plus. Il est aussi incertain dans le mal que dans le bien. L’arrivée de ce Franval l’a tout-à-fait déconcerté. Je tremble qu’il ne lui survienne quelque retour de vertu. L’assemblée sera chaude.
À un valet qui entre.
Écoute, toi, Michel, tu te tiendras à cette porte. Dès que tu entendras disputer dans ce salon, ne manque pas d’accourir tout effrayé, annonce à Durville qu’il vient de prendre à sa femme un évanouissement ; il te suivra, et je reste maître du champ de bataille.
Le valet sort.
J’entends du bruit ; voilà nos gens allons, messieurs, attention à vos rôles, et méritez l’honneur que je vous fais en vous employant dans des affaires difficiles.
Scène II
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, AUTRES CRÉANCIERS
DUHAUTCOURS, allant au-devant des personnages qui entrent.
Donnez-vous la peine d’entrer, messieurs ; monsieur Durville va paraître dans l’instant. Asseyez-vous donc, je vous en prie.
MARASCHINI.
Nous asseoir ! Il est poli.
DUHAUTCOURS.
Voilà un siège, M. Graff.
GRAFF.
Mille remerciements, monsieur Duhautcours.
DUHAUTCOURS.
Vous restez debout, monsieur Fiammeschi.
FIAMMESCHI.
Oui, monsieur, c’est mon habitude.
À Maraschini.
Qu’est-ce que c’est donc que ce monsieur Graff, comme il l’appelle ?
MARASCHINI.
Un de ses bons amis qui fait son état d’être créancier ; je le parierais sans le connaître.
FIAMMESCHI.
Vous croyez... Il a l’air d’un saint.
DUHAUTCOURS.
C’est une circonstance bien fâcheuse qui nous rassemble, messieurs.
GRAFF.
Ah ! certainement, bien fâcheuse !
DUHAUTCOURS.
Qui se serait douté hier, monsieur Fiammeschi, pendant qu’on admirait votre feu d’artifice, que ce matin nous nous trouverions ici comme créanciers de monsieur Durville ?
MARASCHINI.
Créancier, vous !
DUHAUTCOURS.
Hélas ! oui, mon cher Maraschini, j’y suis comme vous, et c’est dur pour moi qui ne suis pas avancé ; eh bien ! je n’ai pas eu le courage d’en vouloir à Durville. Il avait un air si pénétré... Oh ! cet événement-ci le tuera ; et sa femme... En vérité, cela tire des larmes des yeux.
GRAFF.
Cependant il est bien cruel de perdre...
FIAMMESCHI.
Eh bien ! entendez-vous quelque chose à cet homme-là ? Le voilà qui pleure à présent.
DUHAUTCOURS.
Oui, sans doute, ces événements-là sont faits pour inspirer des réflexions... Quand on pense à l’instabilité des fortunes, on est tenté de s’enfuir dans un désert. Car il est incroyable... Ah ! voilà monsieur Durville.
Scène III
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, AUTRES CRÉANCIERS, DURVILLE
DURVILLE.
Messieurs, j’ai bien l’honneur... Vous voyez un homme désespéré.
DUHAUTCOURS.
Mon ami, j’ai dit à ces messieurs tout ce qu’il était possible... Nous voilà, je crois, tous à-peu-près rassemblés.
DURVILLE.
Pardonnez-moi ; monsieur Franval n’est pas ici.
DUHAUTCOURS.
C’est sa faute, il a été averti, il viendra ; pourvu qu’il soit ici pour signer, d’ailleurs.
Scène IV
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, DURVILLE, VALMONT, AUTRES CRÉANCIERS
VALMONT.
Ah ! vous voilà, monsieur Durville.
DURVILLE.
Ciel ! Valmont.
VALMONT.
Est-il une conduite plus affreuse que la vôtre ?
DUHAUTCOURS.
Épargnez-le, mon cher Valmont, il est assez malheureux.
VALMONT.
Que je l’épargne ! et les vingt mille francs que je lui ai confiés hier !
DUHAUTCOURS.
Mais aussi, vous le forcez, pour ainsi dire ; je sais que c’est malgré lui...
VALMONT,
Il devait donc me prévenir...
DUHAUTCOURS.
De quoi ? C’est ce matin que l’orage s’est déclaré.
VALMONT.
Il devait donc me les rendre à l’instant ; il devait m’excepter.
DURVILLE.
Oh ! je le voudrais de bon cœur.
MARASCHINI.
Mais nous ne le souffririons pas, nous autres.
FIAMMESCHI.
Non, parbleu !
VALMONT.
Pourquoi donc cela, messieurs ? C’est une affaire de confiance de ma part.
FIAMMESCHI.
C’est égal.
VALMONT.
Il ne peut pas encore avoir employé mes vingt mille francs.
FIAMMESCHI.
Tant mieux ; ils retourneront à la masse.
GRAFF.
C’est cela ; à la masse.
DUHAUTCOURS.
J’en suis désespéré pour vous, mon cher Valmont ; mais il est certain que nous avons tous autant de droits que vous.
VALMONT.
Autant de droits que moi ? Cela ne se peut pas.
MARASCHINI.
Comment ! cela ne se peut pas !
FIAMMESCHI.
Je vous trouve plaisant, monsieur, de prétendre...
PRUDENT, à Valmont.
Faites-moi l’amitié de me dire, monsieur ; de quoi s’agit-il ?
VALMONT.
Et laissez-moi donc. Est-ce que vous ne l’entendez de quoi il s’agit ? pas,
DUHAUTCOURS.
Précisément ; c’est qu’il ne l’entend pas. Il est sourd, le pauvre cher homme.
VALMONT.
Eh oui, je le vois, je parle à des sourds ; monsieur Durville, surtout... Mais cela ne se passera pas comme cela, morbleu !
MARASCHINI.
Eh bien ! nous verrons ! nos droits sont aussi sacrés que les vôtres.
GRAFF.
Aussi sacrés.
FIAMMESCHI.
Il y a toujours, comme cela, des gens qui veulent des préférences ; mais nous ne le souffrirons pas.
DUHAUTCOURS.
Doucement, doucement, messieurs, entendons-nous,
DURVILLE, à part.
Quel supplice !
Scène V
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, DURVILLE, VALMONT, FRANVAL, AUTRES CRÉANCIERS
FRANVAL.
Eh bien ! qu’est-ce ? on se dispute déjà !
DURVILLE.
C’est monsieur Franval.
FRANVAL.
Du calme, du sang-froid, messieurs ; les gens à qui nous avons affaire n’en manquent jamais. Nous en avons besoin pour déjouer leurs manœuvres.
GRAFF.
Oui, pour les déjouer.
MARASCHINI.
C’est cela ; chacun fera valoir ses droits à son tour.
FIAMMESCHI.
Du silence, et procédons à notre affaire.
VALMONT.
Il faut convenir qu’il est bien cruel...
Tout le monde s’assied.
DUHAUTCOURS.
Comme je vous le disais, messieurs, ce n’est pas sans la plus vive douleur que monsieur Durville...
FRANVAL.
Il y a sans doute quelqu’un ici chargé de nous présenter l’état de situation de notre débiteur.
DUHAUTCOURS.
Oui, vraiment ; monsieur Ledoux, homme de loi que voilà.
FRANVAL.
Faites, je vous prie, qu’il remplisse son ministère ; ce n’est pas pour entendre les phrases de monsieur que nous sommes réunis.
DUHAUTCOURS.
Il me semble qu’il est bien permis à l’amitié...
MARASCHINI.
Ce monsieur-là a raison.
FIAMMESCHI.
Et ses phrases valent bien les vôtres. Un homme de mérite !
GRAFF.
En effet... C’est juste.
DURVILLE.
Je vous sais gré de votre zèle, mon ami... mais puisqu’il déplaît à ces messieurs...
À Ledoux.
Lisez, je vous prie, monsieur, l’acte que vous avez rédigé.
LEDOUX.
C’est un simple projet.
Lisant.
« Par-devant les notaires publics, etc. »
S’interrompant.
L’acte définitif sera par-devant notaire. « Furent présents Antoine Durville, d’une part ; et... tels et tels... vos noms, prénoms et qualités, etc. tous créanciers dudit Durville, d’autre part ; lequel Antoine Durville a exposé à sesdits créanciers que des spéculations malheureuses, des pertes multipliées et imprévues avaient été précédemment supportées par lui avec courage et résignation, et qu’il avait vu s’évanouir sans se plaindre plus de la moitié de sa fortune. »
MARASCHINI.
Et si vous aviez perdu la moitié de votre fortune, pourquoi donniez-vous des fêtes ?
DUHAUTCOURS.
C’est style de notaire, mon cher Maraschini ; n’interrompez donc pas.
LEDOUX, continuant.
« Mais que, primò les divers intérêts qu’il avait sur différents corsaires se trouvant anéantis par la prise desdits corsaires. »
FIAMMESCHI.
Oui style de corsaire.
LEDOUX, continuant.
« Secundò plusieurs faillites qu’il vient d’éprouver coup sur coup sur les places de Vienne, Hambourg, Cadix, et autres villes commerçantes de l’Europe, lui ayant enlevé le reste de ses moyens, il se voit réduit à réclamer l’indulgence de ses créanciers. »
FRANVAL.
Un moment. Je demande...
LEDOUX, continuant.
« En conséquence... »
FRANVAL.
C’est tout simple, des corsaires, des faillites, des malheurs, c’est le protocole ordinaire de tous les actes de cette sorte ; on en déguise les phrases, mais le fonds est toujours le même.
DUHAUTCOURS.
Il est incroyable que l’on interrompe ainsi un officier public ; je réclame, moi, la continuation de la lecture.
FRANVAL.
Ne vous fâchez pas, honnête homme ; je demande seulement où sont les titres, les preuves, les pièces justificatives de toutes ces allégations ?
FIAMMESCHI.
Voilà ce que c’est ; il parle bien : et que me font à moi vos spéculations et vos corsaires ? Voilà le mémoire de mes illuminations, et il me faut de l’argent.
MARASCHINI.
Comme à moi ; et puisque monsieur est un homme de justice, j’espère qu’il me fera payer.
GRAFF.
Il est certain que nous ne devons pas entrer...
VALMONT.
Vous ne me prouverez pas que mes vingt mille francs aient été placés sur vos corsaires.
PRUDENT.
On se dispute, je crois.
DUHAUTCOURS.
On vous les fournira les preuves ; mais remarquez donc que ceci n’est qu’un simple projet d’acte que vous allez signer, en cas que...
DURVILLE.
Ah ! mes amis, je voudrais de grand cœur vous satisfaire ; mais tout ne doit-il pas être égal entre mes créanciers ?
DUHAUTCOURS.
La paix, mes amis, la paix ; entendons-nous, point de bruit. Si l’on met le feu dans l’affaire, si l’on dispute au lieu de se rapprocher, nous perdrons tout.
Scène VI
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, DURVILLE, VALMONT, FRANVAL, AUTRES CRÉANCIERS, UN VALET
LE VALET.
Monsieur, madame se trouve mal. Les cris qu’elle vient d’entendre lui font craindre que vous ne soyez exposé à quelque danger. Elle s’est troublée, elle s’est évanouie, elle vous appelle.
DURVILLE.
Ah ! grand Dieu ! j’y vais. Vous voyez, messieurs, qu’il m’est impossible de rester. Remplacez-moi, mon cher Duhautcours, dans ce cruel moment. Vous connaissez mes intentions ; elles sont de satisfaire tout le monde, autant que je pourrai. Mille pardons encore une fois, messieurs.
Il sort.
Scène VII
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, GRAFF, MARASCHINI, FIAMMESCHI, VALMONT, FRANVAL, AUTRES CRÉANCIERS
VALMONT.
Sa femme qui se trouve mal ! je le crois bien.
MARASCHINI.
Bon ! elle se trouve mal comme moi ; c’est un jeu.
DUHAUTCOURS.
Il est certain que de pareilles clameurs sont bien faites pour effrayer. On devrait bien au moins ménager la délicatesse et la sensibilité des femmes.
FRANVAL.
Eh ! monsieur, nous savons aussi bien que vous ce que l’on doit aux femmes de ménagements et d’égards ; mais on n’en doit pas aux fripons. Achevez votre lecture, monsieur, voyons toute l’étendue des malheurs de monsieur Durville.
LEDOUX, continuant.
« En conséquence, le dit Antoine Durville a fait le tableau de sa situation présente, tant en actif qu’en passif ; duquel il résulte que l’actif montant à un million neuf cent cinquante-sept mille trois cent soixante-douze francs quatre-vingt-dix-sept centimes. »
MARASCHINI.
Mais qu’ai-je besoin de tous vos millions ? C’est trois mille francs que vous me devez.
LEDOUX, continuant.
« Et le passif à celle d’un million... »
FRANVAL.
Allons au fait. Quelles sont les propositions qu’on nous fait ?
LEDOUX.
Vingt pour cent du montant des susdites créances, tant en capital qu’intérêts.
GRAFF.
Ah ! vingt pour cent ; c’est trop peu aussi.
MARASCHINI.
Vingt pour cent ! j’aurais vingt francs pour cent francs. J’aimerais mieux rien.
Il se lève.
VALMONT, se levant.
Je ne signerai pas cela.
FIAMMESCHI, se levant.
Ni moi.
FRANVAL, se levant.
Vingt pour cent ! morbleu ! et vous osez, monsieur, vous rendre l’interprète...
LEDOUX, toujours assis.
Monsieur, je n’y suis pour rien.
DUHAUTCOURS, se levant.
Eh bien ! oui, vingt pour cent, c’est fort dur ; mais nous devons nous trouver très heureux ; car enfin combien y en a-t-il qui ne donnent que quinze, douze, cinq, ou rien ; et d’après la connaissance que j’ai de ses affaires, je ne sais comment il fera pour les réaliser, les vingt pour cent. Est-ce sa faute si les meilleurs banquiers de Hambourg, de Vienne et de Cadix ont cessé leurs paiements ? Est-ce sa faute si des corsaires excellents voiliers, vifs comme des oiseaux, sont maintenant dans les ports de Plymouth ou de Liverpool ? Est-ce sa faute, si des débiteurs, monsieur Delorme, par exemple, lui enlèvent tout son avoir ? Combien ne vous citerais-je pas de créanciers qui ont accepté beaucoup moins sans mot dire ; et pourquoi ? C’est parce qu’on sait fort bien qu’on finit par tout perdre, lorsque la justice s’empare de ces sortes d’affaires. Oui, messieurs, c’est pour votre intérêt, pour le mien que je vous parle. Je le répète, si la chicane se mêle dans tout ceci, vos créances seront réduites à zéro, encore si vous n’en êtes pas pour vos frais. Signez donc, hâtez-vous de signer ces propositions que je soutiens loyales, et défiez-vous des boutefeux qui ne cherchent à vous séduire que pour vous tromper et pour embrouiller les affaires.
GRAFF.
Il y a du bon dans ce qu’il vient de dire.
FRANVAL.
Ne croyez pas à la colère de cet homme-là ; elle est fausse, elle est calculée ; il se fâche à froid, j’en réponds. Eh quoi ! il y a vingt ans que je travaille, il me faut encore travailler dix ans pour assurer un état à mes enfants, et des nouveaux venus comme ceux-ci feraient leur fortune en six mois, et au premier revers ils en seraient quittes pour présenter un bilan imaginaire, et ruiner les vrais et honnêtes commerçants ! Cela ne sera pas, croyez-moi. Quand vous devriez tout perdre avec monsieur Durville, pour votre honneur, pour l’honneur et la sûreté du commerce ; que dis-je ? pour votre intérêt particulier à vous tous, qui avez journellement besoin de confiance et de crédit, gardez-vous de signer cet acte où tout me paraît allégué et rien prouvé : car si vous laissez passer encore celle-ci, qui vous répondra que l’impunité ne va pas les multiplier d’une manière effrayante ? Vous perdrez tout aujourd’hui, mais Vous vous sauverez pour la suite. Mais non, vous ne perdrez rien. La justice, la chicane, comme monsieur l’appelle, n’est pas si âpre qu’il voudrait vous le faire croire elle a des formes, des lenteurs salutaires dont il est vrai que des fripons adroits abusent trop souvent ; mais croyez qu’ils ne triomphent que par la faiblesse et l’insouciance des honnêtes gens. Quand un homme juste et ferme a le courage et la volonté de leur tenir tête, croyez qu’il parvient facilement à les démasquer, et je serai cet homme-là, moi.
MARASCHINI.
Bien ! brave homme. Je vous donnerai ma procuration.
FIAMMESCHI.
Et moi la mienne.
DUHAUTCOURS, d’un ton doucereux.
Souffrez, mes bons amis, que je vous fasse entendre quelques paroles de paix. Je rends justice aux sentiments de monsieur, ils sont purs et honnêtes ; mais croyez-moi, finissez cette affaire-là. Monsieur Durville ne craint pas l’examen sévère dont on le menace. Calculez qu’il est jeune, qu’il peut tout réparer, et que peut-être dans quelques années nous le verrons faire tout-à-fait honneur à ses engagements. Pour le moment vous vous obstineriez en vain ; le plus sûr est de signer.
GRAFF.
Ma foi, oui ; je crois que vous avez raison ; je n’aime pas les procès.
Il s’approche pour signer avec Prudent, et tous deux lisent l’acte tout bas.
DUHAUTCOURS.
Ni moi ; c’est ce qui m’a fait signer le premier.
FRANVAL.
Tu as beau changer de ton, hypocrite, tour à tour colère et doucereux.
DUHAUTCOURS.
Les injures ne m’ont jamais effrayé ; elles ne prouvent rien que les torts de ceux qui les disent. Ces messieurs, en signant, répondent sans réplique à vos déclamations.
FRANVAL.
Quelles sont ces gens-là ?
DUHAUTCOURS.
Ce sont des gens qui vous valent bien. Monsieur Graff, négociant, Irlandais d’origine, qui sait ce qu’on doit au malheur, à qui il est dû, par compte arrêté, quatre-vingt-deux mille francs ; monsieur Prudent, un honnête marchand qui a le malheur d’être sourd, mais à qui il n’en est pas moins dû vingt-cinq mille trois cents francs. Qu’avez-vous à leur opposer ? Voilà leurs titres. Ils sont clairs et authentiques.
FRANVAL.
Je n’ai pas besoin de les regarder ; ils sont faux.
GRAFF.
Faux !
DUHAUTCOURS.
Qu’est-ce à dire ? ils sont faux !
PRUDENT.
Je n’entends pas.
FRANVAL.
Oui, je le répète, ils sont faux. Ah ! si ces créances étaient légitimes, ces gens-là signeraient-ils aussi tranquillement la perte de leur fortune ? Leurs femmes, leurs enfants ne se seraient-ils pas présentés à leur pensée ? Voyez si le moindre trouble paraît sur leur physionomie.
GRAFF.
Monsieur, vous m’insultez, et je ne crois pas mériter... Vous parlez de femme, d’enfants ; je suis garçon, et ma fortune est assez conséquente certainement pour que je sois au-dessus d’une pareille misère.
DUHAUTCOURS, à Graff.
Tais-toi donc.
FRANVAL.
Ta fortune ! Fourbe imbécile, apprends à mieux jouer ton rôle.
GRAFF.
Qu’est-ce que c’est, monsieur ? des propos ? Sachez que je ne les aime pas. Au surplus, chacun est maître de se conduire comme il l’entend. Vous êtes créancier, je le suis aussi ; vous ne voulez pas signer, j’ai signé ; tant mieux pour vous ou pour moi, n’est-ce pas ? Et je vous souhaite le bonjour.
Il sort.
Scène VIII
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, MARASCHINI, VALMONT, FIAMMESCHI, AUTRES CRÉANCIERS
FRANVAL.
Choisissez donc un peu mieux vos agents.
DUHAUTCOURS.
Vaines paroles que tout cela ! c’est la majorité qui fait la loi ; les trois quarts en somme, c’est clair. Encore une fois, signez, c’est ce que vous avez de mieux à faire, et après cela nous serons les meilleurs amis du monde.
VALMONT.
C’est une caverne, je le vois ; mais il faut en finir.
Il signe.
FRANVAL.
Eh quoi ! vous aussi, vous signez ?... Mais c’est une friponnerie.
VALMONT.
Je le vois aussi-bien que vous ; mais que gagnerais-je à être entêté ? Des procès, des tribunaux, ma foi non ; cela me servira de leçon. C’en est fait, je ne place plus mon argent chez un ami.
Il sort.
Scène IX
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX, MARASCHINI, FIAMMESCHI, FRANVAL, AUTRES CRÉANCIERS
FRANVAL.
Et voilà les lâches qui, en composant avec les fripons, sont plus nuisibles aux honnêtes gens que les fripons eux-mêmes.
MARASCHINI.
Puisque monsieur Duhautcours croit que monsieur Durville paiera quelque jour, je vais lui faire une bonne proposition, moi. Je lui donne ma créance pour la moitié de ce qu’elle vaut.
FIAMMESCHI.
C’est bien dur ; mais c’est égal, va pour les cinquante pour cent.
DUHAUTCOURS.
Je le voudrais ; je ferais une très bonne opération ; mais je perds déjà beaucoup moi-même ; cependant je vous donne ma parole d’honneur que si vous signez, sous quelques jours peut-être je fais votre affaire.
FRANVAL.
Et pourquoi donc feriez-vous un pareil sacrifice ? Vos créances sont sacrées. On vous en refuse la moitié ; je suis moins difficile, je les prends pour la totalité.
MARASCHINI.
Vrai ?
FIAMMESCHI.
Ah çà ! ne plaisantez-vous pas ?
FRANVAL.
Non, certes ; donnez-moi vos billets, vos mémoires, mes amis.
FIAMMESCHI.
Ah ! monsieur, c’est trop beau ; mais tenez, vous êtes un galant homme, nous nous en rapportons à tout ce que vous ferez.
FRANVAL.
C’est à moi que vous aurez à faire, messieurs. Si tout le monde me ressemblait, vous n’auriez pas si beau jeu. Je vous attaque tous... au criminel.
PRUDENT.
Au criminel !
FRANVAL.
Ah ! ah ! vous entendez à présent, monsieur le sourd.
LEDOUX.
Moi, je n’y suis pour rien.
DUHAUTCOURS.
Mais, permettez donc... mes amis... monsieur Franval, voulez-vous afficher monsieur Durville ? Est-ce sa faute ?...
MARASCHINI.
Cela ne me regarde plus.
FIAMMESCHI.
C’est à ce galant homme que vous avez à faire, et il vous répondra.
MARASCHINI.
Et nous le soutiendrons.
À Franval.
J’ai des renseignements exacts sur le compte et sur les créanciers de ce Duhautcours.
FRANVAL.
Vous me les donnerez.
FIAMMESCHI, à Franval.
C’est lui seul qui entraîne monsieur Durville, qui était une excellente paye.
FRANVAL.
Suivez-moi, sortons, mes amis ; au revoir, monsieur Duhautcours, vous aurez bientôt de mes nouvelles.
Il sort avec Maraschini et les autres créanciers.
FIAMMESCHI.
Oui, monsieur, vous aurez de nos nouvelles.
Il sort.
Scène X
DUHAUTCOURS, PRUDENT, LEDOUX et AUTRES CRÉANCIERS
DUHAUTCOURS.
Ce Franval est un diable ; il nous perdrait, il faut un sacrifice. Mais avec sa sévère probité... bon ! bon ! cinquante billets de caisse font faire bien des réflexions.
LEDOUX.
Mais permettez donc.
PRUDENT.
Ceci devient inquiétant.
LEDOUX.
Au criminel !
DUHAUTCOURS.
Quoi ! cela vous fait peur !
LEDOUX.
Il est fort désagréable pour un galant homme, qui gagne loyalement son argent, de s’entendre dire des choses aussi dures.
PRUDENT.
Si je n’avais été sourd, il ne m’aurait pas insulté impunément.
DUHAUTCOURS.
Votre affaire ne me devient-elle pas personnelle ? Suivez-moi, les honnêtes gens ne m’ont jamais fait peur.
ACTE V
Scène première
FRANVAL, DELORME, MARASCHINI
FRANVAL, une lettre à la main.
Oui, j’aime à le croire avec vous, monsieur Durville n’est point encore tout-à-fait un malhonnête homme ; aussi vous voyez que je n’hésite pas à me rendre au rendez-vous qu’il demande : sa femme, son neveu méritent tout notre intérêt. C’est donc contre ce Duhautcours que nous devons réunir tous nos efforts ; si nous pouvons l’écarter du contrat d’union, monsieur Durville perd à jamais l’espérance de parvenir aux trois quarts en somme.
MARASCHINI.
Eh bien ! monsieur, tous les créanciers s’en rapportent à vous, vous êtes leur homme. Nous serons trop heureux de parvenir à être payés, grâce à un sacrifice supporté par toute la masse. Je vous l’ai dit, je connais, moi, tous les créanciers de ce Duhautcours ; il y a des billets, des obligations, des lettres de change, des prises de corps ; nous aurons cela pour rien.
FRANVAL.
Allez donc, mon cher Delorme, avec monsieur Maraschini. Je vous ai confié les fonds nécessaires ; je vous connais autant d’intelligence que de probité. Tous ces gens-là, dont la plupart attendent depuis dix ans, doivent être raisonnables et se trouver très heureux.
DELORME.
Soyez tranquille, je remplirai scrupuleusement vos intentions. La faiblesse de Durville, la bonté de sa femme, la délicatesse de son neveu, méritent sans doute que nous ne négligions aucun effort pour lui sauver l’honneur et le ramener à la probité.
MARASCHINI.
Avant une heure vous serez content.
Scène II
FRANVAL, relisant la lettre
« Durville a l’honneur de saluer monsieur Franval, et le supplie de se donner la peine de passer chez lui dans l’instant. » Que peut-il me vouloir ? Se repentirait-il déjà ?... Oui, Delorme a raison, cet homme est entraîné... Et sans cet infâme agent...
Scène III
DUHAUTCOURS, FRANVAL
DUHAUTCOURS, arrivant avec empressement.
Me voici, monsieur.
FRANVAL, avec dédain.
Ce n’est pas vous que j’attends ; c’est monsieur Durville qui m’a écrit, et que je veux bien consentir à entendre.
DUHAUTCOURS.
Monsieur Durville ne viendra pas, monsieur, c’est moi...
FRANVAL.
Vous ! que me voulez-vous ?
DUHAUTCOURS.
Je vois que les malheurs de Durville vous ont aigri à un point... On ne sort pas des affaires aussi facilement que l’on voudrait. J’aime la paix, surtout entre mes amis... Et vous avez développé tant d’énergie, tant de probité dans cette assemblée, que j’en crains véritablement les suites.
FRANVAL.
Pour monsieur Durville, ou pour vous ?
DUHAUTCOURS.
Pour l’honnête et respectable monsieur Franval.
FRANVAL.
Au fait.
DUHAUTCOURS.
J’ai une proposition à vous faire.
FRANVAL.
Parlez.
DUHAUTCOURS.
C’est cinquante mille francs qui vous sont dus ?
FRANVAL.
Oui, cinquante mille francs.
DUHAUTCOURS.
Je connais un homme fort riche, un honnête homme, un ami de Durville, qui est pénétré de cet événement ; il me le disait encore ce matin. Il ne serait pas éloigné de venir au secours de Durville ; mais il faudrait qu’on fût raisonnable.
FRANVAL.
Eh bien ! que cet honnête homme fasse des propositions aux créanciers.
DUHAUTCOURS.
Aux créanciers ! ce n’est pas cela ; vous entendez bien qu’il ne peut pas avoir affaire à toute la masse, mais à quelques-uns, aux honnêtes gens, à vous, par exemple.
FRANVAL.
Ah ! fort bien.
DUHAUTCOURS.
Oui, sans doute, vous trouver compris dans un arrangement comme celui-là ! quand vos fonds n’ont passé entre les mains de Durville que depuis quelques jours ; oh ! cela est cruel ! Je conviens qu’il est dur de voir perdre les autres, mais enfin chacun pour soi, d’abord.
FRANVAL.
C’est la morale universelle.
DUHAUTCOURS.
Ah ! mon Dieu, oui. Ce galant homme, cet ami de Durville, parlait donc ce matin de vous offrir...
FRANVAL.
Combien ?
DUHAUTCOURS.
Mais au lieu de vingt, trente pour cent.
FRANVAL.
Trente pour cent !
DUHAUTCOURS.
C’est bien peu, mais il faut de l’humanité. Ah ! si vous aviez vu ce pauvre Durville avant cette fatale assemblée, il vous aurait fait pitié comme à moi ; il avait un air égaré. Je tremble que cet homme-là ne se porte à quelque extrémité.
FRANVAL.
Trente pour cent !
DUHAUTCOURS, à part.
Bon ! il entre en négociation.
Haut.
Et si nous pouvions vous faire avoir cinquante...
FRANVAL.
Cinquante ! je perdrais vingt-cinq mille francs !
DUHAUTCOURS, à part.
À merveille !
Haut.
Peut-être ne les perdriez-vous pas ; car enfin Durville et moi réunissant toutes nos autres ressources...
FRANVAL.
Vous pourriez me compléter les trois quarts.
DUHAUTCOURS.
Je n’oserais vous le promettre, mais nous y ferions nos efforts.
FRANVAL.
Je vous vois venir ; pour peu que j’insiste, vous allez m’offrir la totalité de ma créance.
DUHAUTCOURS.
Je le voudrais, mais je n’ose.
FRANVAL.
Je n’en veux pas. Créancier de Durville, je dois partager le sort de tous ses créanciers ; je le partagerai, et ce court entretien achève de me prouver qu’il ne sera pas si malheureux que vous auriez voulu le rendre. Que voulez-vous ? Il y a des goûts bizarres dans le monde. Vous avez affaire à un homme qui ne veut pas de l’argent que vous lui offrez ; cela vous dérange peut-être, c’est dommage. Sans adieu, monsieur Duhautcours ; dites à monsieur Durville que j’aurai bientôt le plaisir de le voir.
Il sort.
Scène IV
DUHAUTCOURS, seul
Qui diable se serait imaginé que dans un siècle où tout se vend, un homme serait assez dupe pour refuser cinquante mille francs ? Il a raison, j’allais les lui offrir. Allons, il faut prendre un parti ; car s’il est aussi actif que ridiculement honnête...
Scène V
DURVILLE, DUHAUTCOURS
DUHAUTCOURS.
Ah ! vous voilà, mon ami ; eh bien ! le temps se brouille. Ce Franval, ces maudits créanciers... Il ne vous reste plus qu’une ressource...
DURVILLE.
Laquelle ?
DUHAUTCOURS.
De disparaître pour laisser passer l’orage.
DURVILLE.
Que dites-vous ? Fuir ! abandonner ma femme !
DUHAUTCOURS.
Vous laisserez sur votre secrétaire un billet qui la tranquillisera ; il circulera des bruits de désespoir, de suicide ; vos affaires s’arrangeront, et vous reparaîtrez.
DURVILLE.
Fugitif ! déshonoré ! sans amis !
DUHAUTCOURS.
Songez donc que je vous accompagne.
DURVILLE.
Non. Je ne fuirai pas.
DUHAUTCOURS.
Qu’allez-vous faire ?
DURVILLE.
Je ne sais encore ; mais je ne fuirai pas. Vous m’avez poussé sur le bord de l’abyme, mais vous ne m’entraînerez pas avec vous. Je reste.
DUHAUTCOURS.
Mais pensez donc...
DURVILLE.
Laissez-moi. J’ai eu la faiblesse de vous écouter ; je me suis interdit le droit de vous faire des reproches ; mais c’est vous qui m’avez perdu.
Il s’assied.
DUHAUTCOURS, à part.
Oui-da, monsieur Durville, je m’y attendais. Un beau mouvement de remords, et vous vous tirerez d’affaire en me sacrifiant ; non pas, s’il vous plaît.
Haut.
Ainsi, vous vous décidez à payer ?
DURVILLE.
Oui, je paierai tout.
DUHAUTCOURS.
Vous paierez tout... Vous ferez bien, et je suis enchanté pour ma part...
DURVILLE.
Pour votre part ?
DUHAUTCOURS.
Oui, sans doute, j’y gagne.
DURVILLE.
Comment ?
DUHAUTCOURS.
Ne suis-je pas votre créancier ?
DURVILLE.
Ô ciel !
DUHAUTCOURS.
D’une somme assez considérable. Je me contentais de vingt pour cent, j’aurai tout.
DURVILLE.
Mais vous savez trop bien...
DUHAUTCOURS.
Ne dites donc pas cela, ou tâchez de le prouver contre votre signature. Je voulais faire vos affaires ; vous ne le voulez pas, je dois songer aux miennes.
DURVILLE.
Misérable ! malheureux !
DUHAUTCOURS.
Point de colère, point d’injures, calculez que je n’ai rien à perdre, et que vous avez tout à ménager. Vous m’avez embarqué dans une mauvaise affaire, il faut que je m’en tire honnêtement. Je vous laisse à vos réflexions, et je reviens avec mon titre.
Scène VI
DURVILLE, seul
J’aurais dû le connaître. Point de preuves, pas même une contre-lettre... De quoi puis-je me plaindre ? Que me fait-il que je n’aie tenté de faire aux autres ? Allons, il est peut-être temps encore d’écouter la voix de l’honneur. Mais la honte de révéler... Ah ! qu’il me soulagerait d’un grand poids, celui qui m’arracherait un aveu. Franval ! Delorme... tous deux sévères et déjà victimes de ma cupidité... Ma femme ! elle m’est sincèrement attachée... Mais c’est à moi qu’elle doit ses chagrins... ses défauts, peut-être... Ai-je encore quelques droits à son indulgence, à sa pitié...
Tirant un portefeuille de sa poche.
La voilà cette fortune à laquelle j’ai sacrifié mon honneur, mon repos, ma conscience ! Je la possède et je suis le plus à plaindre des hommes !
Scène VII
DURVILLE, MADAME DURVILLE
MADAME DURVILLE.
Il est seul. Approchons. Mon ami...
DURVILLE.
C’est vous, madame ?
MADAME DURVILLE.
Durville, est-ce ainsi que vous devriez me recevoir ?
DURVILLE.
Pardon ; je sens mes torts.
MADAME DURVILLE.
Nous sommes sans doute bien à plaindre ; mais j’en juge par le mien, ton cœur n’a aucune action blâmable à se reprocher.
DURVILLE, à part.
Ciel ! j’allais lui avouer... Malheureux Durville, en es-tu venu au point de rougir même aux yeux de ta femme ?
MADAME DURVILLE.
Mon ami, tu le sais, dans toutes les occasions importantes je me suis toujours laissé guider par toi. Aujourd’hui permets-moi d’avoir une volonté. Tu me parlais hier de cette séparation de biens entre nous.
DURVILLE.
Eh bien ?
MADAME DURVILLE.
Permets-moi d’y renoncer. Je le dois, et tu dois y consentir ; je suis trop heureuse, si, au prix de quelque aisance, je peux t’épargner de nouveaux malheurs.
DURVILLE.
Ma bonne amie, ce sacrifice de ta part, ton amitié, ta confiance ont déjà versé un baume salutaire sur mes blessures. Tu m’encourages. Non, ne renonce pas à cette séparation ; rends-la utile au contraire à mes créanciers. Charge-toi de les payer, et joins à ta fortune ce portefeuille...
Il lui remet un portefeuille.
Il contient huit cent mille francs.
MADAME DURVILLE.
Huit cent mille francs ! Et qui a pu te procurer cette somme ?
DURVILLE.
Fais-en l’usage que je te prescris, et de grâce ne m’interroge pas.
Scène VIII
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME
MADEMOISELLE DELORME.
C’est vous, madame, monsieur... j’accours pour vous dire moi-même... J’avais toujours pensé que mon parrain, monsieur Franval, était un bon homme malgré sa brusquerie.
MADAME DURVILLE.
Que dites-vous ?
DURVILLE.
Monsieur Franval ?
MADEMOISELLE DELORME.
Mon père lui a vanté la droiture naturelle de monsieur Durville ; moi, je ne lui ai parlé que de vous ; j’ai osé dire un mot de monsieur Auguste. Il nous a promis de ne rien entreprendre contre monsieur Durville sans vous avoir vue.
DURVILLE.
Monsieur Franval doit avoir toute ta confiance, comme il a celle de tous mes créanciers ; c’est entre ses mains que tu dois déposer ce portefeuille.
Scène IX
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME, FRANVAL
DURVILLE.
Monsieur, je suis bien aise de vous voir.
FRANVAL.
Tant mieux, c’est bon signe. C’est madame Durville. On m’a fait votre éloge, madame ; et j’ai besoin de votre appui pour décider monsieur Durville à se conduire comme il le doit. Il est à-peu-près prouvé que, malgré vos corsaires, vos créanciers irlandais, et votre sourd qui entend si bien les vérités qu’on lui dit, vos malheurs ne sont pas aussi grands que vous voudriez le faire croire.
DURVILLE.
Monsieur...
FRANVAL.
Il en coûte de s’avouer ces choses-là à soi-même ; il doit en coûter bien plus de les avouer à d’autres ; mais nous sommes seuls : votre femme, mademoiselle Delorme qui prend le plus vif intérêt à votre famille, et moi, qui ne demande pas mieux que de vous rendre mon estime... Le moment est favorable. Si vous le laissez échapper, vous êtes perdu ; vous voilà condamné à passer pour le complice de Duhautcours. Chassez ce perfide conseiller ; déclarez que vos paiements sont ouverts, annulez ce projet de transaction qui n’a pas le sens commun. Alors je me charge d’arranger votre affaire avec vos créanciers ; vous recouvrez leur estime, et vous pourrez regarder en face les fripons, et saluer les honnêtes gens sans les obliger à détourner la tête.
MADAME DURVILLE.
Eh quoi ! monsieur, pouvez-vous soupçonner mon mari ?
FRANVAL.
Oui, madame ; ce Duhautcours a porté monsieur Durville à des choses qu’il n’aurait pas dû faire. Quand il n’y aurait que cette séparation de biens entre vous...
MADAME DURVILLE.
Eh bien ! monsieur, permettez-moi de profiter de cette séparation que vous nous reprochez peut-être avec justice. Je me charge de toutes les dettes de mon mari ; soyez mon interprète auprès de tous ses créanciers. Je vous confie ce portefeuille. Il renferme huit cent mille francs.
FRANVAL.
Que dites-vous, madame ? Expliquez-moi...
DURVILLE, vivement.
Acceptez, monsieur, le dépôt qu’elle vous offre.
FRANVAL.
Je vous entends ; c’est ce Duhautcours qui vous entraînait. Je ne m’étais pas trompé, et sans doute le traître ne s’est pas oublié.
DURVILLE.
J’ai eu la faiblesse de lui donner un titre de soixante mille francs.
FRANVAL.
Je l’avais prévu... Soixante mille francs ! c’est beaucoup !
DURVILLE.
Trop heureux encore de me délivrer à ce prix de ce misérable.
FRANVAL, lui prenant la main.
Bien ! j’aime à vous voir dans ces sentiments. Ne perdez pas courage pourtant.
Scène X
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME, FRANVAL, AUGUSTE
AUGUSTE.
Eh quoi ! mon oncle, avez-vous pu vous jouer ainsi de ma crédulité ? M’envoyer chez un homme absent ! J’ai précipité mon retour...
FRANVAL.
Paix ! jeune homme, votre oncle est malheureux ! Il reconnaît ses torts ; songeons à le sauver des embûches de ce Duhautcours qui le poursuit pour une fausse dette de soixante mille francs.
AUGUSTE.
Le scélérat ! je vais le trouver.
FRANVAL.
Laissez-moi le soin de terminer cette affaire. J’attends Delorme et j’espère... Ah ! le voilà.
Scène XI
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME, FRANVAL, AUGUSTE, DELORME, MARASCHINI
DELORME.
Voilà tous les papiers, tous les titres. J’ai trouvé des gens enchantés, qui vous comblent de bénédictions.
FRANVAL, examinant les papiers.
Bon ! tout est comme je le désire, J’admire comme un fripon sans crédit parvient encore à abuser autant de monde.
DURVILLE.
Mais, expliquez-moi...
FRANVAL.
Vous le saurez.
DELORME.
Il était temps que j’arrivasse ; Duhautcours marche sur mes pas.
DURVILLE.
Oser encore se montrer devant moi !
AUGUSTE.
J’ai peine à me contenir.
MADAME DURVILLE.
Je tremble.
MADEMOISELLE DELORME.
Laissez faire monsieur Franval.
FRANVAL.
Oui. Je l’attends de pied ferme.
Scène XII
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME, FRANVAL, AUGUSTE, DELORME, MARASCHINI, DUHAUTCOURS, LEDOUX
DUHAUTCOURS.
Mille pardons, messieurs, si je vous dérange. Ah ! monsieur Franval ! Il sait sans doute, comme moi, que monsieur Durville, ayant apparemment trouvé de nouvelles ressources, se décide à payer tout ; il est bien naturel que chacun se mette en règle. Voici monsieur Ledoux : c’était votre homme d’affaires tantôt ; c’est le mien à présent. J’ai pensé que sa présence pourrait amener une conciliation.
Présentant un papier.
Voici mon titre, il est paré.
DURVILLE.
Tu sais trop bien, perfide...
FRANVAL.
Laissez-moi répondre : monsieur Ledoux est votre homme d’affaires ; je suis celui de monsieur Durville.
DUHAUTCOURS.
Monsieur, il ne pouvait placer ses intérêts en de meilleures mains.
FRANVAL, prenant le papier.
Voyons ce titre de soixante mille francs. Oui, il est en règle, il faut vous payer.
DUHAUTCOURS.
C’est trop juste.
FRANVAL.
Mais vous, monsieur Duhautcours, n’avez-vous pas quelques créanciers ? N’avez-vous pas souscrit quelques billets dans votre vie ?
DUHAUTCOURS.
Oui, comme tout le monde. Mais revenons à notre affaire avec monsieur Durville. J’ai mes moyens pour payer mes dettes.
FRANVAL.
Ah ! vous avez vos moyens ! Moi, j’ai là pour vous payer quelques billets...
DUHAUTCOURS.
Oh ! des billets, de l’argent, de bon papier, de bonnes signatures... Moi, je suis rond en affaires.
FRANVAL, remettant à Duhautcours une partie des papiers que Delorme lui a apportés.
Fort bien, de bonnes signatures. Vous ne refuserez pas celle-ci.
DUHAUTCOURS, examinant les papiers.
Qu’est-ce que c’est que ça ? Je ne connais pas ça.
FRANVAL.
Votre signature !
DUHAUTCOURS.
Cela ne vaut rien. C’est-à-dire, c’est bon ; mais...
FRANVAL.
Eh bien ! reprenez votre titre ; poursuivez monsieur Durville, et c’est à moi, à moi seul que vous aurez affaire. J’ai réuni, j’ai acquis tous vos billets à moins de vingt pour cent, et j’ai fait des heureux encore.
DUHAUTCOURS.
C’est charmant, je suis enchanté pour ces bonnes gens... Vous avez bien fait de les payer.
FRANVAL, montrant le reste des papiers à Duhautcours.
Ce n’est pas tout : voilà une prise de corps contre vous. Souvenez-vous que je reste créancier d’une somme assez considérable, et que je saurai vous trouver.
DUHAUTCOURS, à part, déchirant ses billets.
Je suis pris. Un par corps. C’est déterminant.
Haut.
Que je m’applaudis de voir que les honnêtes gens aient quelquefois autant d’adresse et de finesse...
Il remet son titre à Durville.
FRANVAL.
Que les fripons.
DUHAUTCOURS.
Je suis votre très humble serviteur.
Il sort avec Ledoux.
Scène XIII
DURVILLE, MADAME DURVILLE, MADEMOISELLE DELORME, FRANVAL, AUGUSTE, DELORME, MARASCHINI
MARASCHINI.
Mais un moment, cette prise de corps appartient à tous les créanciers de monsieur Durville, et nous ne l’en tenons pas quitte.
FRANVAL.
Laissez ce misérable, il n’échappera pas à la vigilance des lois. Que cette somme de soixante mille francs que vous vous décidiez à payer soit la dot de ces deux jeunes gens. N’y consentez-vous pas ?
DURVILLE.
Oui, sans doute. C’est à toi, mon cher neveu, à te mettre à la tête de ma maison ; elle ne changera pas de nom, puisque tu portes le mien.
AUGUSTE.
Que dites-vous, mon oncle ? pourquoi ne pas continuer le commerce ?
DURVILLE.
Je me dois cette justice à moi-même. N’oublie pas la terrible leçon que ton oncle te donne aujourd’hui.
AUGUSTE.
Ah ! mon oncle, puissiez-vous oublier les reproches trop vifs...
FRANVAL.
Nous ensevelirons cette affaire dans le plus profond silence. Puissent tous les vrais commerçants ne s’éloigner jamais de ces principes ! Respect au malheur : indulgence au repentir ; guerre éternelle aux fripons.